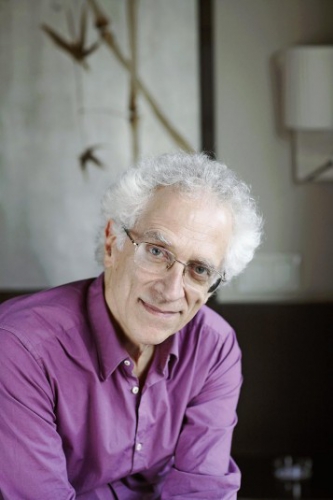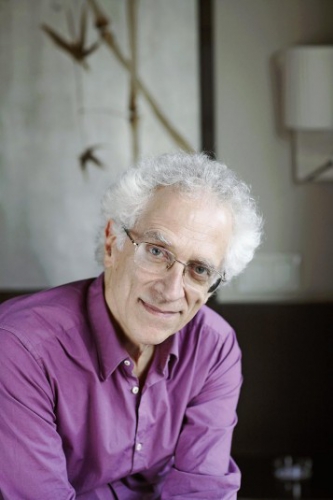
Tzvetan Todorov vient de mourir, à l'âge de 78 ans. Je l'avais rencontré en 1999, à la parution des Aventurier de l'absolu. Entretien à Paris.
C’est un livre immédiatement captivant que le dernier ouvrage paru de Tzvetan Todorov, intitulé Les aventuriers de l’absolu et consacré à trois écrivains qu’il aborde, plutôt que par leurs œuvres respectives : par le biais plus intime de leur engagement existentiel. La recherche de la beauté, dans le sens où l’entendaient un Dostoïevski ou un Baudelaire, liée à une quête artistique ou spirituelle, et aboutissant à un certain accomplissement de la personne, caractérise à divers égards ces pèlerins de l’absolu que furent Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke et la poétesse russe Marina Tsvetaeva. Sous un autre point de vue, ils se rejoignent également dans la représentation dualiste qu’ils se font de l’art et de la vie, comme si l’absolutisme artistique était foncièrement incompatible avec les nuances de celle-ci en son infinie relativité…
- Quelle a été la genèse de ce livre ?
- L’idée romantique qu’il y a une opposition entre l’œuvre de l’artiste et la vie reste très présente aujourd’hui. C’est une tentation que j’ai connue moi aussi, de croire que l’art est incompatible avec le quotidien. Lorsque j’étais étudiant en Bulgarie, j’étais attiré par la figure de l’artiste, de l’auteur ou de l’acteur, et j’ai d’ailleurs pensé, tout jeune que je deviendrais moi aussi écrivain, si possible génial. Puis je me suis aperçu que je serais plus doué pour l’essai que pour la fiction. La notion d’absolu, dans mon pays natal, se bornait alors aux idéaux du communisme, dont je me suis distancié dès ma treizième année, lorsque je suis entré dans le lycée russophone réservé à l’élite communiste, précisément. Un écrivain russe m’a fasciné durant ces années, et c’est le poète Alexandre Blok, dont l’oeuvre et la vie, les amours tumultueuses et ses relations difficiles avec la révolution en marche illustraient déjà cette figure du poète déchiré entre son idéal et la vie ordinaire.
- Quels critères vous ont-ils fait choisir Wilde, Rilke et Tsvetaeva ?
- Il s’agit de trois individus qui, sans être Français, se sont exprimés en langue française et ont été liés, plus ou moins, les uns avec les autres. Leurs postures respectives illustrent trois façons de pratiquer le culte du beau. Dans le cas de Wilde, ce qui m’intéresse est qu’il a été le chantre par excellence de l’esthétisme et que c’est dans la négation de celui-ci qu’il a atteint une vraie grandeur, notamment avec ses dernières lettres si poignantes, dont celle, écrite en prison, qu’on a intitulée De profundis. Sans être un très grand écrivain, Wilde exprime à la fin de sa vie des vues qu’on retrouvera chez Nietzsche. En ce qui concerne Rilke, je me demande si sa correspondance ne vas pas rester comme un sommet de son œuvre, à la fois parce que c’est là qu’il va vers les autres tout en atteignant une concentration de présence et d’expression sans pareilles. Il y a dans ses lettres l’une des plus belles explosions verbales du sentiment amoureux, qui contredit à l’évidence sa théorie selon laquelle la vie ne mérite que d’être piétinée. Quant à Marina Tsvetaeva, elle m’était naturellement plus proche du fait de ses origines slaves et parce que je la lisais en russe. Je l’ai approchée « au jour le jour » en établissant l’édition de Vivre dans le feu, après avoir fréquenté sa poésie des années durant. De ces trois auteurs, elle est naturellement la plus difficile à vivre, au point que ses amis les plus proches, comme un Mark Slonim, avaient parfois de la peine à se protéger de ses excès en même temps qu’ils s’efforçaient de la protéger d’elle-même. Avec sa détestation de la vie quotidienne, elle est évidemment celle des trois dont je me sens le plus éloigné…
- Est-ce à dire que la vie ordinaire vous importe plus que l’art ?
- Je ne suis pas en train de dénigrer l’idéal artiste de Tsvetaeva, mais je voudrais plaider pour une continuité liant la création artistique et le train-train de la vie quotidienne. Vous vous rappelez la position de Mallarmé dénonçant « l’universel reportage » et prônant une littérature purifiée de tout contact avec la réalité, toute vouée à la perfection formelle. Or je crois qu’en France Mallarmé ait vaincu. C’est vrai pour les écrivains, qui ont succombé à cette fascination formaliste, autant que pour les universitaires et la critique au sens large.
- Dans les années 60-70, vous passiez pourtant plutôt pour le critique des formes par excellence, surtout attaché aux structures du texte…
- Lorsque je suis arrivé à Paris, en 1963, c’est en effet la tendance inverse qui prévalait, donnant toute l’importance à la vie de l’auteur ou au contenu du texte, au détriment de ce qui le constituait. J’avais le sentiment d’un déséquilibre, que nous nous sommes efforcés de pallier, notamment dans la revue Poétique. Mais ni moi ni mon ami Gérard Genette n’avons voulu ce glissement vers le rejet du sens que j’ai tâché de corriger par un article, à un moment donné, qui s’intitulait La vérité poétique… et qui n’a jamais paru. D’où mon retrait de la revue, en 1979.
- Vos livres auront marqué, par la suite, une évolution nette…
- L’évolution de mes livres, à partir de La conquête de l’Amérique, en 1982, et ensuite avec Une tragédie française, notamment, s’est faite par étapes successives, en fonction d’une quête de sens qui devait me conduire, à travers l’histoire des idées et la ressaisie du choc des cultures que j’avais moi-même vécu, à préciser une conception du monde et une sorte de nouvel humanisme. Ayant échappé à la paranoïa de la société totalitaire, constatant un jour que je ne me retournais plus pour voir si j’étais écouté, libre de penser et d’exprimer ce que je pense, je me suis donné pour règle de penser ma vie en conséquence et de vivre ma pensée. Ceci dit, je ne me définis pas vraiment comme un écrivain. Je suis du côté de l’Histoire et des faits, non de la fiction, et le rapport que j’entretiens avec la langue est donc celui d’un essayiste écrivant.
- Dans quelle mesure le travail de votre compagne, Nancy Huston, a –t-il influencé ou été influencé par le vôtre ?
- Il est certain que notre vie commune, et donc nos travaux respectifs, ont été marqués par un grand partage de plus de vingt ans et des enrichissements réciproques. Il m’est pourtant difficile de dire ce qui, dans mon évolution, vient d’elle. Ceci tout de même, je crois : le souci de m’adresser à une audience moins spécialisée : disons au lecteur en général. J’admire énormément la conduite de Nancy en tant qu’écrivain, qui aspire à l’évidence à un absolu sans sacrifier pour autant les choses de la vie. Pour ma part, je me sens également « du côté de la vie », de plus en plus attentif aux nuances de celle-ci, à sa richesse, à sa variété, à sa fragilité et à son unicité.
Tzvetan Todorov. Les aventuriers de l’absolu. Editions Robert Laffont, 277p.
Lumières ! Editions Robert Laffont,
A lire aussi : l’autobiographie intellectuelle que constitue Devoirs et délices, paru en 2002 aux éditions du Seuil. Et aussi : Marina Tsvetaeva, vivre dans le feu. Laffont, 2005.