

RENCONTRE Youssou N’Dour évoque son nouvel album, avant la présentation, à New York, de Retour à Gorée, le film de Pierre-Yves Borgeaud qu’il a inspiré en mémoire de ses ancêtres esclaves.
On le voit à l’écran dans Retour à Gorée, et l’homme est exactement le même au naturel, en jeans rapiécés dans le lobby de ce palace parisien : Youssou N’Dour est resté la simplicité même en dépit de sa gloire mondiale, de son « empire » et de son rôle emblématique dans la défense universelle des droits de l’homme. Très présent au Sénégal, il y a lancé au printemps 2007 une première mouture de son nouvel opus sous le titre d’Alsaama Day (« bonjour le jour », en mandingue), redéployé pour sa diffusion mondiale sous le titre de Rokku Mi Rokka, signifiant « quand tu donnes je donne » en langue pulaar. La touche mauresque et peul est d’ailleurs accentuée par la présence de feu le guitariste Ali Farka Touré, alors que la chanteuse Neneh Cherry rejoint Yousou pour l’irrésistible Wake up sur lequel s’achève l’album, probable tube à venir…
- Comment présenteriez-vous votre dernier album à… un sourd ?
- D’abord, je lui donnerais une carte du Sénégal pour lui expliquer la traversée des Peuls du sud à l’ouest et au nord du pays et lui montrer qu’en cette zone, partagée entre le Sénégal, la Mauritanie et le Mali, s’enracinent des musiques comme le blues ou le reggae. La danse pourrait lui faire voir ensuite ce que je raconte dans ce disque, qui remonte aux sources du rythme. La langue peut aussi être un obstacle à la compréhension de ce que je dis, comme la surdité, mais mon « message » passe d’abord par le rythme. Enfin, je dirais à « votre » sourd qu’il est beaucoup question, dans Rokku mi Rokka, de la vie de mon pays.
- Pourriez-vous évoquer le dernier morceau de ce nouvel opus, intitulé Wake up ?
- J’y parle, précisément, à mes frères Africains. En premier lieu, j’exprime la nouvelle réalité de L’Afrique qui se réveille et commence à parler : à parler d’elle-même et à se parler, entre Africains. En outre, j’y affirme que, par rapport au monde, l’Afrique n’a plus à se justifier d’être réduite au cliché d’un continent dévasté par le sida, la pauvreté et la guerre, mais doit se montrer fière de sa façon de percevoir le monde et de faire avancer les choses à sa façon, avec son énergie et sa joie de vivre.
- Beaucoup d’artistes et d’écrivains africains sont déchirés, par rapport à leur pays d’origine, qu’ils soient en exil politique ou cherchent la notoriété en Occident. Est-ce pourquoi vous êtes resté au Sénégal ?
- L’Afrique est un continent contradictoire, et beaucoup d’écrivains se sont expatriés pour fuir les dictatures et continuer d’exprimer l’opposition et l’espoir de leur communauté. Si j’ai eu la chance de pouvoir exporter ma musique, je ne l’ai jamais conçue hors de son environnement vivant. Il me semblait plus important de parler d’abord aux Africains, quitte à en devenir ensuite le porte-voix. Si je voyage beaucoup et trouve des sons ailleurs qu’en Afrique, celle-ci est ma vraie mesure : elle m’apaise. C’est là que j’ai mon cœur.
- De là le côté « racines » de votre dernier disque ?
- En fait, j’ai toujours été « roots », mais le fait d’avoir voyagé m’a sans doute aidé à mieux « sentir mes racines ». Je suis un griot, qui a beaucoup parlé jusque-là de la vie moderne. Mais à présent je trouve intéressant de remonter à nos sources.
- Dans le film de Pierre-Yves Borgeaud, ce retour se fait de façon plus large et profonde, aux sources de l’esclavage et du jazz. Qu’est-ce qui vous y a amené ?
- C’est d’abord la rencontre avec le jazz, au Festival de Cully, à l’initiative de Moncef Genoud, et ensuite avec Emmanuel Gétaz qui voulait donner une suite aux concerts. J’ai pensé alors qu’il serait beau de faire ce voyage à la fois musical et historique aux origines du jazz. Avec Pierre-Yves, en lequel j’ai senti que je pouvais avoir confiance et qui était si discret avec sa caméra, nous avons vécu une aventure humaine magnifique et je suis content que le film rayonne et parle à tous les publics, au-delà des amateurs de jazz. Je reviens à l’instant d’Angleterre où il a été très bien accueilli.
- Quels personnages ont compté le plus dans votre formation personnelle et votre vision du monde ?
- Le premier est Nelson Mandela, qui m’a beaucoup marqué et appris, à la fois par son combat politique et, lorsqu’il a laissé le pouvoir alors que tant s’y sont accrochés, par sa stature humaine, notamment dans sa lutte le sida. Peter Gabriel m’a aussi apporté énormément, autant pour son intérêt à ma musique que par son engagement au service des droits de l’homme, en me permettant de mieux incarner ces valeurs que je sentais en moi, représentant mon idéal humain.
Youssou N’dour en dates
1959 Naissance à Dakar, le 1er octobre. De religion musulmane, dans la tradition soufi.
1985 Concert pour la libération de Mandela, auquel il consacre une chanson, au stade de l’Amitié de Dakar.
1994 Succès planétaire de 7 Seconds, avec Neneh Cherry, (2 millions d’exemplaires).
1996 Prix du meilleur artiste africain.
1998 Musique du film d'animation Kirikou et la sorcière et de La Cour des Grands, hymne de la Coupe du monde de football disputée la même année en France.
1999 Artiste africain du siècle.
2005 Grammy Award pour Egypte, meilleur album de musique du monde. Youssou N’dour est ambassadeur de bonne volonté de l’Unicef et du BIT. Il a mis sur pied une maison de production, le studio Xippi, et le groupe de presse Futurs Médias.
2007 29 octobre : sortie de Rokku Mi Rokka. Novembre : présentation de Retour à Gorée à New York.
Ci-dessus: la dernière porte, à Gorée, que passaient les esclaves.
Cet entretien a paru dans l'édition de 24Heures du 1er octobre 2007.

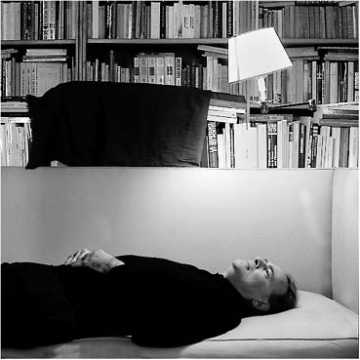
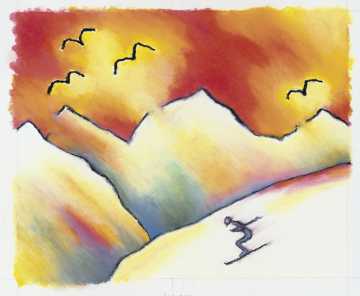
 A la même enseigne, dans un registre d’observation et d’expression très vif et fouaillant le « quotidien » de 2001, Antonin Moeri nous revient avec son neuvième livre, après Le sourire de Mickey, intitulé Juste un jour et passant au scanner verbal, sur fond de « monde nickel dominé par l’urgence et la proximité », un quatuor familial en séjour dans le paradis programmé d’une station de sports d’hiver. Il y a du Houellebecq, en moins nihiliste et en plus nuancé, chez cet ironiste walsérien qui a l’art de prendre les lieux communs au piège de sa lucidité, et de jouer avec l’oralité de manière nouvelle.
A la même enseigne, dans un registre d’observation et d’expression très vif et fouaillant le « quotidien » de 2001, Antonin Moeri nous revient avec son neuvième livre, après Le sourire de Mickey, intitulé Juste un jour et passant au scanner verbal, sur fond de « monde nickel dominé par l’urgence et la proximité », un quatuor familial en séjour dans le paradis programmé d’une station de sports d’hiver. Il y a du Houellebecq, en moins nihiliste et en plus nuancé, chez cet ironiste walsérien qui a l’art de prendre les lieux communs au piège de sa lucidité, et de jouer avec l’oralité de manière nouvelle.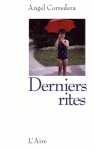 Si la relève juvénile brille par son absence, le deuxième roman d’Angel Corredera (37 ans) à L’Aire, après une entrée remarquée en littérature avec La confrontation, était attendu et tient ses promesses dans une narration beaucoup plus ouverte qui explore, en perspective cavalière, le monde de la fin des « seventies ». De son côté, également à L’Aire, Loyse Pahud évoque les années 60-75 dans le récit choral de Casse-tête. Plus directement autobiographique et enjouée, La vallée de la jeunesse d’Eugène, publiée à La Joie de lire, revisite une enfance et une adolescence partagées entre la Roumanie d’origine de l’auteur et sa découverte du monde, par le truchement de vingt objets qui lui ont fait du bien ou du mal.
Si la relève juvénile brille par son absence, le deuxième roman d’Angel Corredera (37 ans) à L’Aire, après une entrée remarquée en littérature avec La confrontation, était attendu et tient ses promesses dans une narration beaucoup plus ouverte qui explore, en perspective cavalière, le monde de la fin des « seventies ». De son côté, également à L’Aire, Loyse Pahud évoque les années 60-75 dans le récit choral de Casse-tête. Plus directement autobiographique et enjouée, La vallée de la jeunesse d’Eugène, publiée à La Joie de lire, revisite une enfance et une adolescence partagées entre la Roumanie d’origine de l’auteur et sa découverte du monde, par le truchement de vingt objets qui lui ont fait du bien ou du mal. Comme souvent, « nos » écrivains brillent autant sinon plus dans l’essai digressif que dans le roman, mais c’est entre les deux genres que Jean-Bernard Vuillème module la narration très originale d’Une île au bout du doigt, paru chez Zoé où le nomadisme cher à Bouvier rebondit. De la même façon, Jil Silberstein, à L’Age d’Homme, combine profession de foi
Comme souvent, « nos » écrivains brillent autant sinon plus dans l’essai digressif que dans le roman, mais c’est entre les deux genres que Jean-Bernard Vuillème module la narration très originale d’Une île au bout du doigt, paru chez Zoé où le nomadisme cher à Bouvier rebondit. De la même façon, Jil Silberstein, à L’Age d’Homme, combine profession de foi Au même rayon des regards croisés, rappelons enfin la publication, en mai dernier chez Metropolis, d’un épatant Petit guide de la Suisse insolite, sous la plume de Mavis Guinard. Autant dire que la rentrée ne se fait pas à un mois près…
Au même rayon des regards croisés, rappelons enfin la publication, en mai dernier chez Metropolis, d’un épatant Petit guide de la Suisse insolite, sous la plume de Mavis Guinard. Autant dire que la rentrée ne se fait pas à un mois près… Un livre absolument magnifique m'est arrivé ce midi, que j'ai lu d'un souffle en une heure, et que je relirai trois fois avant d'en écrire quoi que ce soit. Il s'agit du deuxième ouvrage de Philippe Rahmy, après Mouvement par la fin, portrait de la
Un livre absolument magnifique m'est arrivé ce midi, que j'ai lu d'un souffle en une heure, et que je relirai trois fois avant d'en écrire quoi que ce soit. Il s'agit du deuxième ouvrage de Philippe Rahmy, après Mouvement par la fin, portrait de la  douleur, paru chez Cheyne en 2005. En soixante pages étincelantes, belles à pleurer mais sans une once d'auto-compassion ou de ressentiment tournant à vide, Demeure le corps sublime le chaos et la catastrophe avec une puissance verbale extraordinaire, alternant le cri et le blues, l'imprécation et la supplique enfantine. Philippe Rahmy, né à Genève en 1965, est-il un auteur romand et fait-il encore partie de la relève ? On s'en bat l'oeil, mais on se l'arracherait aussi bien de ne pas lire Demeure le corps.
douleur, paru chez Cheyne en 2005. En soixante pages étincelantes, belles à pleurer mais sans une once d'auto-compassion ou de ressentiment tournant à vide, Demeure le corps sublime le chaos et la catastrophe avec une puissance verbale extraordinaire, alternant le cri et le blues, l'imprécation et la supplique enfantine. Philippe Rahmy, né à Genève en 1965, est-il un auteur romand et fait-il encore partie de la relève ? On s'en bat l'oeil, mais on se l'arracherait aussi bien de ne pas lire Demeure le corps. 

