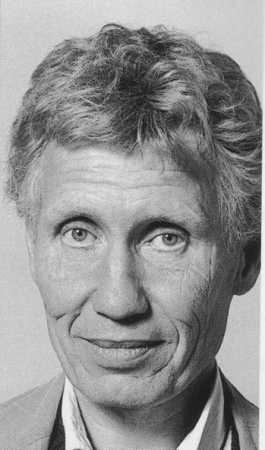
EMMANUEL François. Regarde la vague. Seuil 2007.
- Exergue d’Henry Bauchau : « Je sais que je ne suis qu’un lierre, je sais que je ne suis qu’un lien, j’étreins mon arbre et je ne le connais pas ».
- Généalogie des Fougeray : Père et mère décédés.(Georges et gabriela) Six enfants (Marina, Olivier, Pierrot )décédé), Grâce , Alexia et Jivan (adopté)
- LA VEILLE
- Jivan. Arrive à Chavy en voiture.
- Avec la sensation retrouvée de communier avec la beauté.
- Ressent encore la « main noire » de Noah sur son cœur. Noah qu’il vient de quitter. Se rappelle le père. Sa mère silencieuse.
- Pense qu’ils seront tous là. Y compris Alexia toujours en mission.
- Olivier a investi la grange pour son mariage.
- Les chevaux d’Olivier apparaissent.
- Tout de suite un flux mental impérieux. Musique intime.
- Il est question d’un tableau, signé Micha. Crépuscule sur la mer. Emporté par Grâce.
- Va déposer son bagage avant de chercher Alexia à l’aéroport de Cherbourg.
- Aperçoit ses neveux. Hyacinthe la farouche. Qui lit Moi qui n’ai pas connu les hommes.
- Elle a un « sourire perdu ».
- Alexia. Rêve qu’Olivier brusque leur père.
- Elle a été mariée à Nathan
- Consigne ses rêves dans un cahier de moleskine pour son psy. Lequel est « obnubilé par le sexe ».
- Rien de cela dans ses souvenirs du père.
- Elle travaille dans l’humanitaire.
- Se rappelle l’Afrique.
- Elle a un petit garçon prénommé Ulysse.
- Grâce. Genre bourgeoise d’intérieur.
- Elle a été opérée d’un cancer du sein.
- En pince pour son chirurgien russe.
- Toute délicatesse et fragilité forte.
- Jivan. Raconte l’arrivée d’Alexia. Une ombre dans son regard.
- Le questionne sur Noah.
- Lui dit seulement de la tête : non, non, non.
- Elle lui dit que Noah lui aurait plombé la vie. Evoque le « mal noir des femmes ».
- Il cherche les « écorchées de la vie2.
- Marina. Note un geste affectueux de son prof de piano aveugle.
- Qui l’a beaucoup aimée. Et lui sourit "A quoi sourient les aveugles ? »
- Elle l’interroge sur Hyacinthe, sa fille taiseuse.
- Il la dit « un être tendu, magnifique, mais qu’il ne faut pas perdre ».
- Non pas feu dormant mais comme elle « feu noir ». Et lente à céder…
- Alexia . - Retrouve la famille réunie dans la cuisine de la ferme.
- Avec la vieille Lili.
- Olivier est absent. Il a voulu que les femmes s’habillent en bleu, la mariée (enceinte) en blanc.
- Elle dérogera.
- Jivan parle avec Marina de l’enquête sur la disparition du père en mer.
- Son corps introuvable après le retour du bateau.
- Le sourire de Marina dénote « la force souveraine, la puissante impassibilité des Fougeray ».
- Le fils d’Olivier, Gil, ne sera pas là. Zone à Paris.
- Le petit Ulysse parle anglais.
- La TV déverse ses images tragiques qui lui rappellent « la geste sanglante » du monde.
- Grâce l’interroge sur Nathan.
- Grâce qui ne peut se lâcher. Coincée.
- Marie-Doune, fille aînée de Marina, la cuisine sur son job.
- Jivan. Il entre dans le bureau du père. Dont il se dit qu’il n’a jamais été pour lui que l’enfant indien de la mère, adopté après la perte de Pierrot.
- Olivier. Pense à ses attelages. Cinq pour le mariage. Qui feront l’image « dream ».
- Un fou de chevaux. Homme à femmes aussi.
- Lynn est angoissée, mais c’est elle qui le soutient.
- Désire que l’action soit « ronde ».
- Le mec qui assure en apparence. Mais qu’on sent fêlé.
- Marina. A son tour dans le bureau du père. A la recherche d’une photo de jeune fille. Mihaela, liaison secrète du père.
- Elle a contacté la jeune femme. Pour l’inviter.
- Conversation touchante entre les deux femmes.
- Se rappelle les derniers mots de son père sur le tarmac de Caen.
- Lui a dit rêver d’une « fin légère ». Elle a 46 ans.
- Jivan. Assiste à la colère d’Olivier contre le fils du traiteur.
- Observe ses trois sœurs de loin.
- Constate que ce qui les unit est plus fort que ce qui les distingue.
- Lui n’est pas de leur sang.
- Le rire à distance d’Alexia le glace.
- Scène à forte valeur visuelle, proprement cinématographique.
- Tout se déroulant comme un film intérieur à multiples points de vue alternés.
- Grâce. Se rappelle le prénom de son docteur. Sergueï.
- Y pense avec bonheur et gêne à la fois.
- Alexia. Lit Ulysse avec Ulysse.
- Il exige ce livre pour s’endormir.
- Hyacinthe entre pendant la lecture.
- Lui adresse un sourire doux.
- Le mutisme d’Hyacinthe engage Alexia à lui dire qu’elle la comprend, mais la jeune fille s’esquive.
- Olivier. Il lui faut appeler Lynn. Qui est encore à l’hôtel.
- Dans sa chambre, avise un trou noir dans le miroir.
- Lui rappelle ses « crises ».
- Suit un traitement médical. Violence latente en lui.
- Lili lui reproche d’en vouloir trop.
- Jivan. Alexia lui a parlé de la dernière lettre, « magnifique », du père.
- Alexia voudrait lui dire ce que le père désirait transmette, mais Jivan n’écoute pas.
- Il aimerait lui parler d’autre chose.
- Elle subodore que c’est de Noah. Parle de « saleté d’amour ».
- Alors lui se braque.
- Grâce. Se rappelle la pesante présence sexuelle de Franz.
- La seule fois qu’elle pousse un cri, c’est en pensant à Sergueï.
- Franz le prend pour lui…
- Marina. Rejoint Hyacinthe. Se rappelle comme l’enfant a été laissée à Chavy.
- Une fille hors du commun. Sauvage.
- Songe au « petit corps d’avant l’autre corps »…
- Alexia. Jivan lui a demandé si elle-même a jamais connu l’amour.
- Jivan. Se retrouve seul dans son ancienne chambre. Repense au temps où Alexia l’appelait dans la sienne.
- Olivier. Tout à ses pensées terre à terre d’homme pratique.
- S’est disputé violemment. S’est déstressé en picolant trop.
- Ulysse. - Dernière image de cette première partie, du petit garçon courant en rêve et murmurant « catch him, catch him ».
- Tout cela très beau, très doux, très musical et pictural en même temps. L’espace admirablement « construit » par les voix.
- 2. LE JOUR
- Olivier. Auprès de la splendide Lynn, Olivier Fougeray sera « le grand maître du dream », yes sir.
- Marina. Voit son tour cette image de la famille aux cinq tilburys.
- Grâce. Pense aux absents et aux morts. Toute fière que son couple ait tenu, avec Franz et les jumelles.
- Alexia. Son point de vue est plus narquois sur le « grand film » d’Olivier.
- JIVAN. Se rappelle, sur son tilbury, l’enterrement de sa mère, et le père alors « seul au monde ».
- ALEXIA. Réagit aux formules du sacrement religieux. Pensées grinçantes dans la chapelle.
- JIVAN. Son regard est plus serein. Sent une joie en lui.
- Se rappelle que cette famille blanche l’a adopté à l’autre bout du monde, à l’orphelinat de Cochin.
- MARINA. Lutte contre l’ennui de la messe. Se rappelle un voyage en Suisse avec le père. Qui lui a transis divers objets préhistoriques. Comme un legs personnel. Leur secret.
- GRÂCE. Au moment de l’échange des anneaux, reprend le fil du récit, qui glisse d’un personnage à l’autre, sans aucun accroc.
- ALEXIA. A présent Jivan rit. On s’est retrouvé sur la route. On prendrait bien la tangente au lieu de rejoindre le vin d’honneur…
- GRÂCE. Joue son rôle de femme organisée au vin d’honneur.
- OLIVIER. Ne pense qu’aux images objectivées de la fête. Pensées érotiques au passage, quand le frôle Dolly avec laquelle il a souvent fait Oli-Dolly.
- L’auteur rend parfaitement tout ce qui se passe en deça des mots, dans le for de chacun. Toutes les sensations, observations, impressions, gestes, échanges de regards, tout enrichit le récit.
- ALEXIA. Glisse d’un groupe à l’autre. Tout ça rappelle un peu Dolce Agonia de Nancy Huston, en moins chargé existentiellement mais en plus musical.
- Une voix chaude s’adresse à elle. Un homme en noir en lequel elle reconnaît un beau jeune homme de jadis.
- MARINA. Un homme lui parle pendant qu’elle observe sa Hyacinthe à une fenêtre.
- Se dit que sa fille lui a échappé comme son mari, parti pour une plus jeune.
- JIVAN. Se revoit enfant dans une fête pleine de monde. Comment on l’a arraché à sa honte dans les rires partagés. Comment il « faisait bébé » avec Alexia.
- ALEXIA. Reconnaît le bel homme à la voix grave. Le fils d’un ouvrier polonais qui venait à la maison.
- Il se passe quelque chose entre leurs regards.
- GRÂCE. « Grâce avait l’impression que chacun était à sa place dans la polyphonie du monde ».
- Tout à fait le sentiment qui se dégage du livre aussi.
- Elle sent que quelque chose s’est passé en elle.
- Comme si elle était prête pour l’amour. Elle pense à ses morts et se dit qu’elle ne pourra plus parler qu’é Sergueï.
- MARINA. Surprend, avec stupéfaction, une conversation entre Jivan et Hyacinthe la muette.
- Mais sa fille se tait dès que cette intimité est troublée.
- Elle s’effondre dans un divan.
- JIVAN. Constate l’effondrement de sa sœur aînée. A qui il confie qu’Hyacinthe perçoit la vente envisagée de la maison comme une sorte de fin du monde. Lui aussi en est très affecté.
- Jivan est impressionné par Marina qui incarne la « tranquillité souveraine » des Fougeray.
- MARINA. Dit à Jivan qu’elle a laissé Hyacinthe à Chavy pour la commune sauvagerie de l’enfant et de son grand-père.
- OLIVIER. Lynn le panse comme un cheval fou.
- La remarque d’une invité, à propos de l’absence de son fils Gil, l’a piqué au vif.
- ALEXIA. Observe les convives avec ironie. Des conversations nourries par le « consumérisme ambiant » qui « finiraient par communier au dernier tohu-bohu médiatique, l’époque était d’un conformisme affligeant ».
- JIVAN. Fait parer sa vieille tante Lucia pour qu’elle lui raconte un peu plus de détails de son adoption.
- Se demande pourquoi on l’a choisi lui.
- Aimerait élucider le mystère d’une petite cicatrice en croix à son bas-ventre.
- Se rappelle son retour adulte à Cochin.
- La vieille femme qu’il a baisée une nuit et un jour durant.
- MARINA. Eprouve le besoin de quitter les convives et de se retrouver seule.
- Se rappelle le tableau de Micha.
- Se rappelle les jeux de lumière du tableau auxquels son père l’a rendue attentive.
- Son père qui aimait dire « regarde la vague »…
- ALEXIA. Regarde l’homme noir la regarder. Loin l’un de l’autre, « chacun comme une image pour l’autre, un rêve ou un rêve de rêve ».
- MARINA. Retrouve Hyacinthe en rêve.
- Puis se rend dans sa chambre où elle tombe sur un cahier noir, écrit par son père.
- Qu’elle commence à lire.
- Et tout aussitôt le récit se charge d’une nouvelle gravité.
- Le père évoque son besoin d’écrire (p.94)
- « Ici, j’écris comme on parle seul, à Dieu peut-être, si ce mot a un sens, et non pas ce Dieu de Gabriela que je n’ai jamais vraiment compris, mais plutôt à cet inconnu de moi, qui demeure sans image, effacement même de l’image, et prend ma main quand je la tends vers l’ombre ».
- Evoque son père et sa génération de héros.
- Note que « plus rien ne nous unit que le sentiment de la foule »
- ALEXIA. Ecoute l’éloge débile d’Olivier par un sien ami.
- Olivier est quasiment un étranger pour elle.
- Se dit qu’il doit la trouver « bien roulée » et par trop idéaliste.
- Remarque que le discours de l’ami a fait l’impasse sur l’existence de Gil.
- Gil qui erre à Paris entre squats et asiles de nuit.
- Le Père. - Devient un élément constitutif du récit.
- Evoque ses relations avec la fidèle Lili. « Lili est la charge infatigable du temps.
- Evoque ses souvenirs de bonheur « dans le temps ».
- Très belles séquences.
- Se rappelle son enfance, Gabriela, ses enfants à travers les années.
- « Ce sont les fragments de mon archéologie ».
- Très belle mise en abyme du roman, avec la voix si proche de l’absent.
- OLIVIER. – Son complexe quand on lui demande un discours. « Rien à voir avec le père ».
- Se sent « grand piteux misérable.
- Voudrait se reposer sur Lynn.
- Raconte le dressage de Takia par Lynn.
- Lui aussi « grand cheval indomptable ».
- En parlant il avise une silhouette noire à la porte.
- Redoute que ce soit on fils Gil.
- Journal du père. – Evoque son âge. 75 ans. Qu’il ne sent guère.
- Evoque les petits vieux de son âge. « Ils ssont devenus des vieux enfants qui jouent à des jeux et dansent autour des tables au moindre mirage de la lucarne d’abondance ».
- « Je crois que c’est l’inaccompli de nos vies qui nous rend si oeu aptes à partir ».
- Se reproche de n’avoir jamais su parler à Olivier.
- Evoque le Dieu de Gabriela, sa femme, qu’il n’a jamais compris.
- « Mais l’Ange a toujours eu pour moi un autre visage, j’aurais dû grandir dans un monde où le vent, le fleuve, le feu portent la parole sacrée, où le ciel nous recouvre, où le terrible et le doux se confondent ».
- JIVAN. – Pense à Noah, qui lui dit ne pas le mériter. Se sent à la fois elle et lui quand ils font l’amour.
- Journal du Père. – Evoque ses enfants petits. Revoit Pierrot, son fils disparu dont la mort l’a terrassé.
- « C’est l’encombrant privilège de la vieillesse que de mélanger les générations, comme le rêve qui ne s’embarrasse pas du temps » (p. 105)
- ALEXIA. – Remâche son agacement envers Hubert, qui la cherche sur le thème de la psychanalyse.
- Rend magnifiquement ce passage dansé et dansant de l’un à l’autre des personnages, dans le vacillement de la danse.
- Journal du père. – Evoque les « chambres du temps » qu’il a parcourues en étudiant les grottes du magdalénien.
- « Rien ne m’a plus appris ou désappris que ces chambres du temps. Tout y était sacré, même et surtout l’animal mis à mort, sa mort exigeant de rendre par les rites ce qui lui était ôté. »
- Suit une méditation amère sur notre perte du sacré.
- « Nous qui avons accumulé un savoir immense sur le monde, nous ne savons plus être dans le monde »
- Il a mesuré « l’étendue du désastre auquel la modernité nous expose ».
- Les filles le trouvent un très, très vieil homme ».
- ALEXIA. – Remarque à son tour cette femme, une étrangère vêtue de noir qui lui rappelle quelque chose.
- Cette présence annonce une bascule de la fête.
- Journal du père. – Il aimerait rappeler ses enfants et leur dire ce qu’i n’a jamais su leur dire.
- Se rappelle à la fois la pudeur des Fougeray à l’égard des choses graves.
- Pense à Hyacinthe, la jeune indomptable.
- MARINA. – Se trouve soudain surprise par sa fille, en train de lire le journal du père.
- L’apostrophe sur un ton inquisiteur : « Comment tu l’as eu, ce cahier ».
- Ce qui provoque la fureur muette de sa fille.
- Elle s’enfuit à la fois honteuse et mécontente d’elle.
- ALEXIA- S’étonne de voir Marina « comme elle ne l’avait jamais vue ».
- Mais sa sœur se dérobe, prétendant qu’il ne s’est rien passé.
- JIVAN. – Noah l’appelle de nouveau sans qu’il sache d’où. Elle le supplie de ne pas la rejeter.
- Trois mots sur son portable : Miyako est morte.
- Lui rappelant leur rencontre, dont la vieille Japonaise fut témoin.
- Jivan lui lisant des auteurs japonais, et Noah, servante de Miyako, y assistant un jour.
- Se rappelle la beauté de Noah quand il lisait Pluie d’orage d’Inoué.
- Avec la mort de Miyako ils redeviennent « orphelins du monde »
- Il hésite avant de lui répondre.
- OLIVIER. – Songe à la beauté lisse, de magazine, de Lynn – une beauté pour tous qu’il aimerait pour lui seul.
- Se sent jaloux et inquiet.
- Voudrait la tenir et la posséder rien que pour lui.
- Comme quand il la possédait au fond du box de son cheval.
- MARINA. – Voit en cette femme vêtue de noir un « oiseau de malheur ».
- Se rappelle les mots du journal de son père à son propos.
- Elle l’aborde et lui propose une promenade.
- Se retrouvent sur la plage.
- Mihaela désirait la rencontrer depuis des années.
- La rencontre avec Alexia, ménagée par le père, à Genève, a tourné court.
- Mihaela se sent marquée du sceau de l’étrangère.
- La question lancinante: pourquoi le père s’est-il laissé prendre par la mer.
- GRÂCE. Se rappelle que « tout doit disparaître ». Ce que lui a communiqué le notaire avec sa « sale petite voix »
- Elle attend toujours, fébrilement, le docteur V.
- Son jardin secret.
- Elle a 41 ans. Se donne encore « 15 ans de beauté »
- ALEXIA. Monte au grenier pour lire Ulysse à Ulysse.
- Elle aimerait lui transmettre la magie légendaire de son enfance.
- Il y a là un cerf-volant. Le dragon de Pierrot que son père a violemment arraché des mains de Jivan.
- Toute la tristesse de son père refluée dans ce souvenir
- Ulysse : « Hey look, mum, look, her comes the music ».
LA NUIT
- JIVAN. – Alexia l’a invité à l’inviter à danser.
- Pense à Noah qui revient.
- Va la laisser attendre un peu.
- ALEXIA. – Durant la valse avec Jivan, elle se rappelle leurs rapports d’enfants et d’ados, au bord de l’inceste.
- Ils n’ont jamais vraiment fait l’amour, quoique presque.
- Jivan est resté pour elle une sorte de « garde du corps ».
- OLIVIER. – On glisse ensuite vers Olivier.
- Qui se sent ,dansant avec Lynn, « dans l’œil du cyclone».
- Jivan. Revenu seul dans la cour, il pense à Noah et tremble de la perdre
- MARINA. – Dans la nature endiablée avec Mihaela, mais elle sent que le contact ne se fera pas vraiment, tout occupée qu’elle est mentalement par Hyacinthe et l’épisode du cahier.
- GRÂCE. – Se retrouve en face de Sergueï qui vient de débarquer avec sa femme.
- On sent comme un malaise de jalousie entre les deux femmes.
- Mais l’attention se reporte ailleurs, Olivier venant de provoquer un esclandre. Il vient en effet de brutaliser Hyacinthe.Alexia. – Voit ressurgir la « vieille chose de la famille ». On pense évidemment à l’épilepsie.
- JIVAN. – La violence d’Olivier lui fait revivre une scène de violence opposant le père et Olivier. Il avait alors pensé « c’est la guerre », ou plus précisément « ils sont dans la guerre »
- Il a vu Hyacinthe partir vers la mer.
- OLIVIER. – Ne peut soutenir le regard de Lynn. Pour sa défense, il explique à Alexia qu’Hyacinthe « le cherche », comme son fils Gil.
- ALEXIA. – En espérant que le bal reprenne, elle pense à l’ »ancestrale violence des hommes envers les femmes »
- MARINA. – « Voit » le corps de sa fille, qui a filé vers la mer, au pied de la falaise.
- Se rappelle Hyacinthe à sa naissance, qu’elle a failli perdre.
- ALEXIA. – Sur la piste de danse, retrouve le fils du Polonais Milan, un personnage de son enfance qui lui rappelle qu’elle aimait soigner les oiseaux blessés.
- Elle ressent une attirance, tout en pressentant un probable malentendu : « Un début fulgurant sans doute, puis assez vite une sorte d’embourbement ».
- MARINA.- Descend à la plage à travers les rochers.
- Et là, voit flamber la petite maison sauvage d’Hyacinthe, héritée de son grand-père.
- La voit ensuite là-bas sur la plage et court pour la rejoindre.
- Et retrouve bientôt « sa grande jeune fille toute molle au milieu du combat ».
- Tout cela très fort, avec des éléments quasi faulknériens. Une grande force d’évocation très physique et sensible à la fois.
- GRACE. – Gamberge devant la repro de La lutte avec l’ange, que son père aimait fort.
- Vera lui raconte Louxor. Bavardage mondain.
- Sergueï n’en a plus que pour Frantz.
- Se rend compte qu’elle a fantasmé dans le vide et annonce qu’elle va s’étendre.
- MARINA. – Augustino l’aveugle, et son ami Tam, se pointent en voiture sur la plage.
- ALEXIA. – Se rappelle la première apparition de Milan.
- MARINA. – Voit Augustino s’éloigner avec Hyacinthe. Une complicité particulière les attache. Augustino lui a conseillé de ne pas trop s’inquiéter.
- OLIVIER. – Il aimerait maintenant que Lynn lui accorde la moindre attention, dont on sent que sa crise l’a déstabilisée
- JIVAN. – Son portable grelotte. Tout lui semble avoir retrouvé la douceur de l’espoir.
- Le romancier rend admirablement le décor, l’espace et la « musique » de la soirée, avec son concert de voix distribuées sur divers plans.
- MARINA. – Se retrouve vers le brasier de la cabane. Voit de loin la Mercedes de Tam et Augustino, qui ont pris Hyacinthe en charge.
- JIVAN. – Il a l’impression que Noah l’appelle de tout près. En fait elle est là, qui implore son pardon et dans les bras de laquelle il se jette.
- GRACE. – Finalement n’est pas allée se coucher.
- Décide de ne plus accorder un regard à Sergueï.
- Rejoint Olivier qui a un drôle de sourire.
- Et qui tombe soudain en transe épileptique.
- Grace s’en remet à Frantz, l’homme fort
- MARINA – Est restée près du brasier. Pense qu’elle s’est toujours protégée de la vie.
- Ensuite rejoint Agustino dans sa voiture. Qui lui explique la douleur d’Hyacinthe.
- Qui voudrait savoir absolument ce qu’« ils » ont fait à Pachou.
- Ainsi appelle-t-elle son grand-père chéri.
- Augustino : « On n’enseigne plus le vide dans le monde, ce monde est devenu trop plein ».
- OLIVIER. – Sous sédatif, il voudrait que Lynn comprenne.
- Se rappelle Black Beauty.
- Se demande s’il arrive aux juments de pleurer.
- Se rappelle un traumatisant souvenir d’enfance.
- Enfermé avec « la bête » par son père.
- Alexia. – Passé minuit. Sent que Mihaela voudrait lui parler.
- Elle l’a rencontrée déjà, notamment à Brasov.
- Mihaela - lui montre la photo d’un petit garçon, qui lui rappelle aussitôt Pierrot.
- Un garçon de 12 ans prénommé Martin.
- Fils naturel du père on le comprend.
- Mais déjà le taxi de Mihaela est prêt à l’emmener…
- JIVAN. – Si mon souvenir est bon, Jivane signifie le vivant en serbo-croate.
- Jivan et Noah fond un grand tour autour de Chavy.
- « Qui es-tu pour me tuer d’amour, toi ? »
- Cela finit par une étreinte passionnée, dans le vent et les clameurs de la mer.
- OLIVIER. – Se rappelle la punition paternelle. Sa peur d’enfant. La bête crainte et les bottes de papa au soupirail.
- A toujours été considéré comme la tête brûlée des enfants.
- GRACE – Pallie l’incurie de Lynn, et Lili apporte les noyaux de cerises chauds. « son éternel petit sac guérisseur ».
- Ma mère-grand pratiquait de même : cataplasme dégoûtants à la purée grise et oreillers pleins de noyaux de cerises.
- Elle voit Sergueï partir avec sa tigresse, sans regret.
- Crois ensuite Alexia la « merveilleusement intelligente », avec laquelle elle ne peut plus parler qu’en leurs enfance dans leurs lits jumeaux , tournées « chacune vers leur grand mur noir ».
- ALEXIA. – Fin de bal fellinien en plus sombre, sur du Leonard Cohen.
- Se rappelle que sa mère après la mort de Pierret a proposé de donner les vêtements de celui-ci au fils du Polonais.
- Se rappelle son père pleurant Pierrot.
- Se rappelle l’arbre arraché.
- Danse avec Milan Oposzewski avec un double sentiment d’accord physique et de distance, comme si elle dansait ailleurs dans ces bras protecteurs.
- Pleure en se rappelant l’expression du médecin, « assommé par la barre ».
- MARINA. – A son tour de réagir au « vieux mélancolique ».
- Lynn, à côté d’Olivier, a un visage défait par « cet ahurissement morne de ceux qui n’attendent plus rien ».
- On voit d’avance le joli couple…
- On voit le couple d’Alexia et de Milan danser seul et semblant vivre quelque chose rien qu’à lui.
- Alexia voudrait échapper à Milan, mais les chansons de Cohen ajoutent au sortilège. Pourtant il lui dit lui-même qu’elle est une femme seule et qu’il sera toujours ainsi.
- Elle n’en pleure que plus.
- JIVAN. – Le silence revenu sur les lieux, Noah lui parle d’elle, non sans difficulté. Lui raconte sa « vieille envie de détruire », liée à ce que lui a fait subir son beau-père attoucheur.
- Comment Miyako l’a désenvoûtée.
- Et comment Miyako a choisi Jivane comme lecteur « pour sa seule voix ».
- Comment elle lui a recommandé de ne pas détruire cet homme au « cœur immense ».
- Or Jivane sait maintenant qu’elle va repartir sans approcher sa « famille bourgeoise ». (p.172)
- Tout ça est d’une extrême douceur et d’une grande force en même temps.
- Me rappelle Hugo Claus mais en plus tendre et en plus mélodieux.
- Me font sourire ceux qui prétendent que la littérature est morte.
- C’est qu’ils ne l’aiment pas ou ne savent plus lire.
- ALEXIA. – L’au revoir se fait sans aucune démonstration. Juste.
- « Il s’en va lentement par le Chemin des Bêtes. »
- MARINA. – Cinq heures du mat. Pluie d’été.
- Resonge au « trésor de transmission » du journal de son père.
- Va voir dans la chambre d’Hyacinthe, qui sort, et où elle ne voit trace du cahier toilé. Pense que sa fille l’a brûlé.
- « Paix sur vous ».
- Jivan rentre tout trempé.
- JIVAN – Voit en Marina la réincarnation de leur mère.
- « C’est toi qui veille », pense-t-il.
- Sur son portable s’inscrivent les lettres d’un poème de Lorand Gaspard : « Nous fouillerons les pierres claires jusqu’à l’extrême limite de l’obscur ».
- Puis s’inscrit le mot amour, que Noah n’a jamais prononcé.
- GRÂCE. – Repense à ce que Vera lui a dit en aparté, à la place de Sergueï qui n’a pas osé, dit-elle : qu’il faudra tout enlever, avec un « faux regard de compassion ».
- OLIVIER. – Tout apaisé auprès de Lynn qui, finalement, n’a pas l’air fâché.
- Lili lui a dit que les gens ne s’étaient aperçus de rien.
- ALEXIA. – Réalise que Milan n’est venu que pour elle.
- Revit la mort occultée de Pier rot.
- La conclusion de cette partie apartient à Ulysse : « Day’s coming, mum, day’s coming ».
Le Lendemain
- Jivan. Séance avec le notaire. Qui annonce que le partage ne se fera pas avant des mois.
- Olivier s’impatiente.
- Grâce écoute plus que les autres.
- Le temps est comme suspendu dans la maison.
- Jivan pense que quelque chose va peut-être se dire.
- Marina. – Alexia et elle se forcent à être présentes, tandis qu’Olivier s’impatiente et que Jivan est ailleurs.
- Alexia. – Déclare qu’elle ne s’intéresse qu’à un objet et pas du tout à l’argent: le tableau de Micha, qui n’est plus sur le mu, la Grande marine au couchant. En souvenir de ses rêveries d’enfant et de son père.
- Grâce le prend mal.
- Jivan. Observe la réaction de Grâce, qui accuse Alexia d’avoir toujours fait ce qu’elle voulait et de n’aimer personne.
- Une déchirure se fait alors entre les frères et sœurs. Grâce a dit ce qu’il ne fallait pas selon le code de pudeur du clan.
- Se pose incidemment « la terrible question de ce qui les liait encore ».
- Mais Grâce, Jivan le sait, sera blessante sans aller jusqu’à la querelle.
- L’ombre de la mère veille sur le maintien du lien entre les Fougeray.
- Marina. – Grâce se fait jérémiante pour expliquer qu’elle a fait restaurer à réencadrer le tableau à ses frais.
- Rappelle en outre tout ce qu’elle a fait pour la maison.
- Grâce la prévenante terre à terre.
- Olivier la remercie pour la noce.
- Grâce. – Mais Grâce de récuser ce soutien et de dire un peu plus de ce qu’elle ne voudrait pas dire…
- Jivan. – Alors Alexia de sortir une lettre du père, dont elle lit quelques fragments. Il y est question de son legs, non pas d’objets mais de ce qu’il estime important de transmettre é chacun.
- Et Grâce de balbutier, puis de s’excuser.
- Tout cela très juste et très émouvant.
- Marina.- Sur quoi le notaire range ses affaires.
- Et comme Olivier fait mine lui aussi de s’en aller, lui aussi, Marina et Alexia l’enjoignent de rester.
- Suit « un incroyable silence ».
- Olivier. – Se rappelle que Lynn l’attend pour leur voyage de noces. S’agit de pas manquer l’avion pour les îles.
- Jivan. – Marina évoque ce qui restera, ou pas, après le partage.
- Elle réclame soudain l’attention d’Olivier à propos d’Hyacinthe.
- Elle évoque ce qui manque du père, qu’on oubliera bientôt. Mais qu’Hyacinthe continue à sa façon.
- Alexia. – Guette la réaction d’Olivier, l’étenel « enfant fautif ».
- Jivan. – Sur quoi Marina se lève, annonçant que Lili a préparé un frichti pour ceux qui resteraient encore.
- Sur quoi les uns et les autres se lèvent.
- Alexia. – Se demande pourquoi elle a lu ce bout de lettre.
- Elle voit les mômes heureux, et là-bas Grâce un peu perdue, visiblement touchée, « cruellement accablée ».
- Femme blessée.
- Puis elle surprend un conciliabule entre Marina et Lili. Celle-ci se voyant proposé de l’emploi par celle-là, et le refusant.
- Tout cela noté avec une précision proustienne (les servantes de Proust)
- Jivan. – Alexia l’entraîne vers la mer.
- L’a percé à jour : « Tu l’as revue, n’est-ce pas ? »…
- Ulysse patauge dans la vague.
- Suit l’image du père se prenant les pieds dans les cordages, avec toute la mer autour de lui.
- Olivier. – Se retrouve « dans le bleu ». Bleu de l’espoir que tout s’arrange aux îles.
- « Rien de grave », se dit-il en repensant à la soirée avec le besoin de se rassurer.
- Se dit qu’en vacances Lynn se laisse « ouvrir » facilement.
- Ce genre de pensées simples…
- Pense aussi à la vente et à un « crédit de raccord ».
- Alexia. – Lit un rapport professionnel.
- Ecrit, non sans hésiter, quelques mots à Milan : « C’est vrai, les enfants ne s’endorment pas facilement ».
- Et la vie continue.
- Marina. – En voiture avec Hyacinthe et sa cadette Maya, Marina se demande : « Nous sommes-nous retrouvées, ma petite Hya ? »
- « Et quel cette part aveugle, quel corps en nos corps, dans la nuit de nos corps ? »
- Grâce. – Sa conclusion délicatement émouvante.
- Grâce ou la fidélité et la « petite besogne ».
- Que sa mère disait « la plus courageuse de toutes mes filles ».
- Grâce qui me rappelle tant ma petite mère.
- Jivan. - Et cela finit comme cela a commencé, sur la vague de Jivan.
- Le dernier mot du roman étant : lumière.
- Un roman des lumières du cœur.
- « Si le roman n’est pas mort, écrivait Georges Nivat, c’est que l’homme ne l’est pas. »
- Ni le poète, ni le médium d’un chacun. A mes yeux le plus beau livre lu ces semaines, avec celui de Mikhaïl Chichkine. Beaucoup moins ample certes, mais d’une justesse sans faille, d’une musique prousto-woolfienne, d’une mélancolie et d’une générosité égales.
- François Emmanuel. Regarde la vague. Seuil, 2007.
-
-
L'humanité du loup

Jean-Claude Lebrun, dans L'Humanité du 30 août 2007, signe le premier grand article consacré à La symphonie du loup de Marius Daniel Popescu. Merci camarade !Les éditions Corti viennent de procéder à un deuxième tirage du livre. A écouter: entretien de l'auteur avec Alain Veinstein, sur France-Culture. La Symphonie du loup a été sélectionée pour le Prix de la Librairie des Abbesses de Montmartre.
Le souffle des grands
C’est de Suisse que nous provient l’un des romans les plus remarquables de cette rentrée. Par l’ampleur de la vision, par la qualité d’écriture, loin au-dessus de ce qui s’annonce comme le quotidien de l’actualité littéraire automnale. En quatre centaines de pages époustouflantes, le Roumain d’origine Marius Daniel Popescu fait entendre une tonalité nouvelle dans l’espace romanesque francophone. Composition magistrale, images à couper le souffle, profusion du sens : ce livre fera trace, à n’en pas douter. Dans une ville de Suisse, un homme gagne sa vie en col- lant des affiches publicitaires. Il a dans les trente-cinq ans, est marié à une employée d’une agence de voyages. Le couple a deux petites filles. Une existence sans relief apparent, pareille à celles d’une foule de citoyens de la Confédération. Mais on apprendra tout cela plus tard. Le récit s’ouvre en effet sur une scène du passé, vingt et un ans en arrière, alors qu’on se prépare à enterrer le père de cet homme, mort après un accident sur une route de province de sa patrie. Une voix raconte cette journée particulière, remonte les années, revient aux préparatifs rituels de la cérémonie, laisse entrevoir une maison, une rue, une ville, un dénuement immense, un pays comme à l’abandon, mais aussi des humains se serrant les coudes. Cette ouverture, en même temps limpide et sombre, d’une puissante beauté, annonce les thèmes du récit et touche déjà au vif des choses. Celui qui parle est aujourd’hui âgé de quatre-vingt-dix-huit ans et il est le père du mort d’alors. Il s’adresse ici à son petit- fils exilé en Suisse, faisant resurgir le « pays de là-bas », cette Roumanie de Ceaucescu – dont le nom ne sera ici jamais prononcé. Il est ainsi des mots qui « ne devraient pas exister ». Le petit-fils est arrivé il y a onze ans. Depuis lors il colle des affiches. Et il écrit. Des dizaines de carnets s’entassent chez lui, à côté de livres roumains et français. Des textes sont stockés dans l’ordinateur. Au récit du grand-père il ajoute maintenant le sien. Parfois à la première personne. Plus souvent à la deuxième ou troisième. Il a vécu déjà tant de vies. Dans cette Suisse où il s’est finalement installé, il se perçoit d’ailleurs comme « une sorte de touriste intégré dans le pays ». Il se rappelle une enfance d’évidences simples. Une petite maison, une route poussiéreuse, des chats, des cerisiers, une rivière de laquelle revenaient les Tziganes avec leurs charrettes de bouteilles, « comme le vitrail ambulant d’un monastère ». Mais aussi, à la fois lointain et omniprésent, le « parti unique », instance dont on se méfiait et se jouait. Il y avait eu ensuite le lycée, les deux années d’armée et celle sur un chantier en forêt, puis l’examen d’entrée en faculté et les études supérieures de sylviculture. Puis la chute du régime. Et donc le nouveau commencement dans le « pays d’ici » : après le monde du parti unique, celui de « la publicité unique ». Un fantastique tableau se compose, juxtaposition de séquences du passé et du présent. Toujours au plus près des êtres et des choses. Énumérant à la façon du nouveau roman la multitude des objets qui, mieux que les mots, racontent la vie d’avant et celle de maintenant. L’on y sent passer aussi les ombres de Chagall, de Kafka et de Ramuz. La légèreté et le rêve, la drôlerie et l’absurdité, la lucidité et la lourde angoisse… Tandis que des évocations associant réalisme et fulgurantes échappées baroques suggèrent une proximité d’esprit avec le grand artiste de la civilisation danubienne, Emir Kusturica. C’est un roman à la fois profus et ramassé, intime et épique, chargé de multiples résonances, que nous propose Marius Daniel Popescu. La Roumanie du « socialisme réel » s’y trouve campée avec une inventivité et une force peu communes. Des détails de la narration naît la grandeur du tableau. De la multiplicité des personnages se dégage une âme collective dont l’écrivain se présente comme l’un des dépositaires. À la fois accusateur et nostalgique des petits et grands moments de résistance. Peintre du froid et de la boue, mais aussi de la chaleur entre les hommes et d’une possible pureté face à la vie. En l’espèce les ingrédients constitutifs d’une oeuvre marquante.
LA SYMPHONIE DU LOUP, de Marius Daniel Popescu, Édition José Corti, 400 pages, 22 euros. Lecteur de tous les pays, lisez la rubrique littéraire de L'Humanité: http://www.humanite.fr
Lecteur de tous les pays, lisez la rubrique littéraire de L'Humanité: http://www.humanite.fr -
La Belle et la Bête
Deux nouveaux livres hors normes de Fabienne Verdier et Umberto Eco
Mes petites variations sur les thèmes de la beauté et de la laideur vont trouver ces prochains jours de nouveaux prolongements avec deux livres magnifiques.
 Le premier est dévolu à l’art et à la pratique de celui-ci, dans son nouvel atelier de la région parisienne, de Fabienne Verdier, approchée par Charles Juliet et accompagnée dans sa geste picturale par les photographes Dolorès Marat et Naoya Hatakeyama. Après L’Unique trait de pinceau, illustrant le travail de la calligraphe, c’est le peintre à part entière qui nous accueille dans l’univers de signes et de fulgurances formelles de sa peinture qu’on dirait dansée – et c’est d’ailleurs bien ainsi quelle procède, manipulant d’énormes pinceaux suspendus entre ciel et terre. J’y reviendrai sous peu, en espérant une visite prochaine à la Sente des Fouines.
Le premier est dévolu à l’art et à la pratique de celui-ci, dans son nouvel atelier de la région parisienne, de Fabienne Verdier, approchée par Charles Juliet et accompagnée dans sa geste picturale par les photographes Dolorès Marat et Naoya Hatakeyama. Après L’Unique trait de pinceau, illustrant le travail de la calligraphe, c’est le peintre à part entière qui nous accueille dans l’univers de signes et de fulgurances formelles de sa peinture qu’on dirait dansée – et c’est d’ailleurs bien ainsi quelle procède, manipulant d’énormes pinceaux suspendus entre ciel et terre. J’y reviendrai sous peu, en espérant une visite prochaine à la Sente des Fouines. Du second, intitulé Histoire de la laideur et rassemblant une prodigieuse iconographie, je relève d’abord cette citation de Voltaire qu’Umberto Eco reproduit dans son introduction : « Demandez à un crapaud ce que c’est que la beauté, le grand beau, le tò kalon. Il vous répondra que c’est sa crapaude avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un ventre jaune, un dos brun. Interrogez un nègre de Guinée ; le beau est pour lui une peau noire, huileuse, des yeux enfoncés, un nez épaté. Interrogez le diable ; il vous dira que le beau est une paire de cornes, quatre griffes et une queue ».
Du second, intitulé Histoire de la laideur et rassemblant une prodigieuse iconographie, je relève d’abord cette citation de Voltaire qu’Umberto Eco reproduit dans son introduction : « Demandez à un crapaud ce que c’est que la beauté, le grand beau, le tò kalon. Il vous répondra que c’est sa crapaude avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un ventre jaune, un dos brun. Interrogez un nègre de Guinée ; le beau est pour lui une peau noire, huileuse, des yeux enfoncés, un nez épaté. Interrogez le diable ; il vous dira que le beau est une paire de cornes, quatre griffes et une queue ».Le beau a été théorisé à qui mieux mieux dans la culture occidentale, où le laid n’a jamais été qu’un repoussoir, en tout cas dans les grandes largeurs. Or l’univers du laid, relativement laid selon les époques, parfois d’une inquiétante beauté ou d’une joyeuse odieuseté, signe aussi du tragique ou du refoulé, est à redécouvrir à travers tous ses avatars, de l’Antiquité au romantisme ou du kitsch au camp…
 Fabienne Verdier. Entre ciel et terre. Avec un texte de Charles Juliet, 86 œuvres et 56 photos en couleurs. Albin Michel, 272 p. 75 euros.
Fabienne Verdier. Entre ciel et terre. Avec un texte de Charles Juliet, 86 œuvres et 56 photos en couleurs. Albin Michel, 272 p. 75 euros.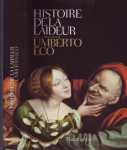 Umberto Eco. Histoire de la laideur. Flammarion, 451p
Umberto Eco. Histoire de la laideur. Flammarion, 451p -
Les faits avant la fiction
Après le retour en beauté de l’inspecteur Bosch, dans le récent Echopark, ce recueil des chroniques judiciaires publiées par Michael Connelly entre 1984 et 1992 dans le South Florida Sun-Sentinel et le Los Angeles Times est une bonne illustration des sources d’une œuvre à la fois pétrie de drames humains et soumise à la rigueur de l’observation autant qu’à l’effort de compréhension du chroniqueur, en lequel Michael Carlson, dans sa postface, voit essentiellement un « reporter » plus qu’un journaliste d’investigation. «Avoir de l’empathie, ce n’est pas s’identifier », précise-t-il avant de noter que « Connelly est reporter et réussit à maintenir la distance du journaliste entre lui et ses sujets, ce qui lui permet de voir le tableau général du monde dans lequel ils vivent ». Rien d’un voyeur à sensation chez ce témoin de l’horreur, qui raconte dans un éclairant avant-propos comment, à seize ans, il a été mêlé pour la première fois à une affaire criminelle irrésolue, à partir de laquelle il devint « accro » aux faits divers violents puis aux romans à la Chandler. « C’est pour les tragédies et les calamités que vit le journaliste », précise Connelly avant d’y plonger le lecteur, non sans ajouter avec une noire ironie : « Nos pires journées sont les meilleures…
Michael Connelly. Chroniques du crime ; 23 histoires vraies. Points Seuil, 325p. -
La drague mode d’emploi
. 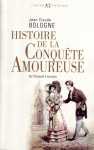 « C’est surtout dans les théâtres que tu dois te mettre en chasse : ce sont les terrains les plus giboyeux. Tu y trouveras tout ce que tu cherches : de quoi aimer ou de quoi t’amuser, la passade d’un jour ou une histoire sérieuse ».
« C’est surtout dans les théâtres que tu dois te mettre en chasse : ce sont les terrains les plus giboyeux. Tu y trouveras tout ce que tu cherches : de quoi aimer ou de quoi t’amuser, la passade d’un jour ou une histoire sérieuse ». Le conseil n’est pas d’un maître-dragueur contemporain mais d’un certain Ovide, au début de L’Art d’aimer, s’adressant aux jeunes Romains en quête de bagatelle ou plus sérieux si affinités. Or vingt siècles plus tard, la tactique consistant pour le jouvenceau à s’asseoir près de la jouvencelle, au théâtre ou au cinéma, et de la serrer « flanc à flanc », a moins changé que le vocabulaire, puisque la « drague », explique Jean-Claude Bologne, est « indissociable des années 1950-1970 » et « ne peut se comprendre sans la pilule, la mixité dans les lycées, les congés payés, la libération sexuelle, l’émancipation de la femme ». Cela précisé, qu’on « alourde » ou qu’on « gale » avant de « coqueter » ou de «flirter », la saga de la séduction est vieille comme le désir et ses épisodes en disent long sur l’évolution des mœurs même s’il y a encore du prédateur à massue chez le mâle du XXIe siècle. Or cette Histoire de la conquête amoureuse a elle aussi de quoi séduire, mêlant érudition joyeuse et récit à la coule.
Jean-Claude Bologne. Histoire de la Conquête amoureuse de l’Antiquité à nos jours
Seuil, 385p -
Compères à cran

 Bernard Delvaille
Bernard Delvaillerapproche
Cendrars et Cingria
.
Contrairement à ce que pensait un Nicolas Bouvier, qui disait regretter que Cendrars et Cingria ne se fussent point connus en chair et en os, tant cette rencontre eût été selon lui magnifique, les deux grands écrivains se sont bel et bien fréquentés et appréciés avant de se fâcher, comme souvent les créateurs de très forte trempe, et de se lancer mutuellement des flèches assassines au fil de phrases d’anthologie.
Cette brouille fameuse, située « dans les années 40 » et qui semble découler initialement du peu de reconnaissance manifestée par Cendrars à l’égard des textes de Cingria, taxé de « pauvre et génial raté », n’est qu’un des objets d’intérêt de ce petit livre sagace de Bernard Delvaille, qui a le premier mérite de rendre justice à chacun des deux compères tout en distinguant précisément ce qui les apparente (un rapport mystique au monde, le goût du voyage et l’art du conteur, entre autres) et ce qui les différencie à maints égards.
Puisant aux bonnes sources, le poète et érudit mort à Venise un soir d’avril 2006 (auquel Gérard-Julien Salvy rend brièvement hommage en préface) emprunte notamment à Pierre-Olivier Walzer, qui a beaucoup fait pour la défense parallèle de Cendrars et de Cingria, les traits essentiels propres à celui-ci et à celui-là.
Bernard Delvaille.Vies parallèles de Blaise Cendrars et de Charles-Albert Cingria. Les Portraits de la Bibliothèque, 79p
-
De l'immonde à l'icône

Conférence de Georges Nivat
3e Festival francophone de philosophie,
Saint-Maurice, le 17 septembre 2007.
- Se défend d’être un spécialiste ès esthétique.
- Se fonde sur sa connaissance de la littérature et de l’image honteuse.
- Voudrait interroger la possibilité de représenter l’immonde.
- Et les rapports du beau et du laid.
- Que la hideur de Socrate va de pair avec sa beauté intérieure.
- Evoque les liens séculaires du beau et du bien dans la tradition gréco-chrétienne.
- Première attaque sérieuse de la vénération du beau avec Nietzsche.
- Comme une illusion ridicule.
- D’où procède tout le retournement de l’art du XXe siècle, avec le développement de l’esthétique du laid.
- Mais qu’est-ce que la laideur ?
- Revient sur l’étymologie des deux mots.
- Beau vient du latin, tandis que laid vient du germain Leid, contenant l’idée d’outrage et de douleur.
- En anglais, même opposition latino-germanique avec beautiful et ugly.
- La laideur conserve une trace d’effroi.
- En russe, le mot krasny signifie beau. Il n’y a pas de mot qui corresponde exactement au mot laid.
- Le mot équivalent signifie plutôt non-fertile, ou disgracié.
- Revient à la tradition du laid en art.
- Avec les saturnales romaines
- Cite les travaux de Muriel Gagnebin, dont le premier livre a paru à L’Age d’Homme.
- Evoque l’éclosion et l’évolution du laid chez Goya.
- Des portraits de nobles espagnols aux Caprices.
- Où la laideur devient l’expression d’une déchirure morale.
- Cite le Goya noir du Prado.
- Goya montre l’irreprésentable avec Saturne dévorant son fils ou le chien qui se noie.
- Le laid comme destruction voulue de l’harmonie plus ou moins factice.
- Dans la filiation directe de Goya : Bacon et son pape Innocent encagé sur sa chaise électrique.
- De Goya procède aussi la révolte expressionniste du début du XXe siècle.
- Rappelle les collections de monstres du Tsar Pierre Ier.
- Rappelle la tradition iconoclaste byzantine.
- Puis enchaîne sur Hans Bellmer.
- Qui désarticule le corps féminin et le mécanise.
- Bellmer a fui le nazisme et se venge, selon Nivat, contre l’académisme totalitaire.
- Je vois mal, pour ma part, ce que Bellmer apporte en matière de laideur.
- Digression sur la passion des totalitarismes pour l’académisme physique.
- Des nus qui ne sont jamais nus : des figures stylisées, abstraites, idéologiques en quelque sorte. Ni poils ni défauts.
- Comme dans la pub d’ailleurs. Autre esthétique « totalitaire » en somme, me semble-t-il.
- Nivat évoque ensuite son ami serbe Dado.
- Qui répond à l’esthétique totalitaire par ses assauts de « laideur ».
- Ainsi a-t-il tagué la chapelle de Gisors en magnifiant la laideur à sa façon.
- Plus convaincant cela.
- Me rappelle aussi la beauté panique produite par les dessins souvent jugés « laids » du génial Louis Soutter.
- Mais Nivat n’en parle pas, pas plus que de Zoran Music, peintre de l’immonde concentrationnaire.
- Revient à la formule prêtée à Dostoïevski, selon laquelle « la beauté sauvera le monde ».
- Beaucoup plus fort, illico, que sur ce qui précède.
- Précise que Dostoïevski n’a jamais dit cela.
- Et que la parole n’est que prêtée au prince Mychkine.
- Rappelle ensuite la réflexion de Dostoïevski autour du Christ mort de Holbein, du musée de Bâle.
- Le cadavre du Christ opposé à la Madone sublimée.
- Introduit le personnage d’Hyppolite, qui crache sur la beauté.
- Tuberculeux, désespéré, Hyppolite, qui se suicidera, voit en la beauté une façon de torture, et en son culte une imposture.
- Célèbre la beauté d’un simple mur.
- Exactement l’anti-esthétisme d’un Joseph Czapski.
- La tragédie opposée aux psaumes.
- Le poids du monde, contre le chant du monde.
- Mais l’un exclut-il l’autre ?
- Tel n’est pas mon avis.
- Selon Nivat, le laid est un cri.
- Evoque alors Egon Schiele, dont les représentations exacerbées découlent de sa perception du tragique.
- Son érotisme est douleur.
- Son autoportrait en masturbateur n’est pas provocation gratuite mais expression de sa douleur, ainsi qu’il l’a expliqué.
- Nivat cite alors le prophète Esaïe qui annonce le Seigneur « dénué de toute beauté et sans rien qui plaise à l’œil » (Es.53)
- Revient à Dado qui se dit « enceint » de trois guerres.
- Comment vivre avec tout ça ?
- Enchaine ensuite avec L’Ecole d’impiété, le roman d’Aleksandar Tisma, dont il cite la scène atroce de torture, où un beau jeune homme est massacré par un bourreau qui défie Dieu en le « traitant » et finit par éjaculer au moment de l’agonie de sa victime.
- Cite aussi Stavroguine, le héros des Démons, d’une beauté démoniaque.
- Et Platonov dans la foulée.
- Evoque la difficulté morale, pour un Soljenitsyne, de représenter l’immonde dans L’Archipel du goulag.
- Et sa réaction à l’illustration picturale de son livre, des scènes les plus crades.
- Pour en finir avec l’esthétique des Bienveillantes, violemment attaquée par Pierre-Emmanuel Dauzat, auquel Georges Nivat se rallie aujourd’hui à la réserve de celui-ci. Cf. son article du Débat. Pas d’accord avec lui. En ce qui me concerne, je ne trouve aucune complaisance chez Littell. Ou alors il y a autant, chez Dostoïevski ou chez Dado, de fascination pour l’immonde.
- Chez Zoran Music au contraire, nulle fascination, mais une transfiguration.
- Or on a esquivé le « moment » décisif de la Comédie de Dante, dont Barilier a parlé en revanche.
- Conclusion qui me semble un peu téléphonée sur l’esthétique des icônes, figures par excellence, ou supposées telles, de l’irreprésentable beauté. Pas d’accord avec ça.
- Le Christ « sale » de Corinth participe autant de la rupture évangélique que la plupart des icônes.
- Les Christs de Louis Soutter ou de Rouault sont, eux aussi, des « icônes » à cet égard, qui « travaillent » la laideur dans le mouvement de transfiguration. Même mouvement chez Goya ou chez le Greco, chez Soutine le Juif ou chez Dürrenmatt le protestant…
