Réponse à Juan Asensio.
Un écrivain peut-il tout dire ? Et faut-il défendre à tout prix celui qui pratique l’invective ? Est-ce parce qu’un penseur ou un romancier est rejeté par l’opinion publique ou médiatique qu’il mérite notre attention ou notre respect ? Les plus grands talents, les plus originaux, les plus hardis sont-ils forcément les moins fréquentables de l’heure ? Enfin y a-t-il seulement un dénominateur commun entre ceux qu’on dit infréquentables ?

 é du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline. Qui plus est: je vote aujourd'hui plutôt à gauche, quand je ne l'oublie pas. Sacré progrès...
é du style d’Aragon, Les mots de Sartre ou Matinales de Jacques Chardonne, Nord de Céline. Qui plus est: je vote aujourd'hui plutôt à gauche, quand je ne l'oublie pas. Sacré progrès...
En matière d’idées, j’avais trouvé à vingt-cinq ans, dans les romans fourre-tout de Stanislaw Ignacy Witkiewicz la critique la plus dévastatrice qui me semblât, des totalitarismes, mais aussi et surtout la vision prémonitoire de la fuite vertigineuse dans le bonheur généralisé de nos sociétés de consommation, mais qui eût pu dire de quel bord était Witkiewicz ? Les années passant, et découvrant quels énormes préjugés, quel refus de penser, quels blocages dissimulaient les plus souvent, chez mes amis de gauche ou de droite, leurs certitudes idéologiques, je me suis éloigné de plus en plus de celles-ci en même temps que j’approfondissais une expérience de la littérature, par l’écriture autant que par la lecture, dont la porosité allait devenir le critère essentiel, que l’œuvre de Shakespeare illustre à mes yeux en idéal océanique. Or Shakespeare est-il de gauche ou de droite ? L’océan est-il fréquentable ou infréquentable ?
 Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’aimerais lire tout Shakespeare et l’annoter pièce par pièce, et plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir : que CELA monte.
Je lis Proust sans discontinuer depuis des années, et je relis ces jours Dostoïevski, je lis et relis Balzac, je lis et relis Montaigne et Pascal, j’aimerais bien lire une bonne fois La montagne magique de Thomas Mann et L’homme sans qualités de Musil, que je n’ai jamais lus en entier, comme j’aimerais lire tout Shakespeare et l’annoter pièce par pièce, et plus je vais et plus je constate que, dans cet océan, tout est à sa place. Je lis tous les jours des tas de livres, dont j’aime à replacer chacun. Chacun est comme une bribe de l’immense conversation qui se poursuit jour et nuit à travers ce texte dont les livres ne reproduisent qu’un fragment, et qui me semble le contraire de l’universel bavardage pour autant que CELA converge, à savoir : que CELA monte.
Hors de CELA, que je dirais la poésie du monde, point de salut à mes yeux. Toute parole séparatrice, tout verbe coupé de sa source, de son rythme et de sa couleur, de son grain de voix et de son âme, je renonce à les fréquenter comme je renonce à la laideur et à la vacuité, à la platitude et à la mesquinerie - à toute délectation morose.
Plus je vais et plus la littérature me semble le lieu de la relation et non de la séparation, de la continuité et non de la rupture, de la fécondité et non du repli sur soi. Je comprends qu’on la trouve aujourd’hui menacée et vilipendée, mais je vois aussi qu’on la comprend mal. J’essaie de comprendre ce que dit Juan Asensio dans L’infréquentable est le révolutionnaire le plus abouti, et je vois que des notions séparatrices, pour ne pas dire sectaires, contredisent absolument une exigence de liberté qui accorde ou dénie la qualité en fonction de jugements restreignant précisément ladite liberté. Ainsi célèbre-t-on le style, en référence au « grammairien par excellence » que serait Dieu, pour mieux rejeter un Julien Gracq ou un Francis Ponge, stylistes manquant en somme à la foi si je comprends bien, moi qui trouve pourtant chez Ponge et Gracq bien plus de pages vivantes et vibrantes que chez un Renaud Camus, dont la seul qualité est probablement de penser un peu, parfois, à contre-courant - sans style aucun hélas, à mon goût tout au moins.
Mais penser mal est-il, au fait, une qualité suffisante à faire un écrivain ? Juan Asensio s’interroge sur ce qui fait le propre d’un infréquentable, sans parvenir vraiment à se convaincre de ses approximations successives, et c’est tant mieux. On ne voit pas bien ce qu’est « le révolutionnaire le plus abouti », pas plus que ce qui distingue celui qui assume ses positions (de droite évidemment) ou sa foi (catholique résolument) équivaut à un brevet d’infréquentabilité, ni moins encore la qualité de « logocrate » chère à George Steiner, qui ne connaît aucune frontière idéologique. Est-ce l’ « échec social des antimodernes » qui les valorise alors ? Quelle dérision ce serait, que de considérer qu’une réussite sociale fasse ainsi illusion. D’un glissement l’autre, Juan Asensio finit donc par établir que l’infréquentable serait « d’abord et avant tout un homme libre », ou bien encore « celui qui dérange les Assis », à moins que, der des ders, l’infréquentable ne soit « qu’une notion sans consistance autre que celle que veulent à tout prix lui donner les censeurs, un non-lieu où sont prudemment relégués celles et ceux qui ont osé et osent affronter les minables catégories érigées par la bouche anonyme de « l’universel reportage ».
Il y a du vrai dans tout cela, mais beaucoup de rhétorique aussi, à base d’idéologie. La littérature excède ces limites. Or il est intéressant, à lire attentivement les textes (très inégaux eux-mêmes) réunis sous le fronton de ces Ecrivains infréquentables, combien se mêlent les goûts et les idées, les partis pris et les conclusions hâtives, la liberté de jugement et les âneries à œillères. La vraie critique littéraire demande de l’humilité et de la précision, de l’amour et des citations. On en trouve heureusement, par exemple dans le texte de Sarah Vajda consacré à Corneille, ou dans les introductions à Dominique de Roux, Léautaud ou Nicolas Gomez Davila, entre autres. Mais ce que je préfère dans cette revue, c’est que l’oreille de la liberté pointe bel et bien un peu partout, avec des éclats de littérature. Une ou deux lettres de Dominique de Roux et c’est parti. Ensuite, infréquentables ou pas, reste à voir sur pièces. Car cela seul est intéressant : le détail et non la catégorie. Le détail, pour aller voir ailleurs, c’est In memoriam de Paul Léautaud, notes griffonnées au chevet du père agonisant, c’est relire Corneille et s’en amuser en se foutant des nouvelles conventions le classant républicain pro-Bush. C’est lire Gombrowicz dans son Journal et le Gombrowicz de Dominique de Roux, c’est relire Bernanos qui est au purgatoire plus qu’au placard des infréquentables, c’est lire Post Mortem ou Ma confession de Caraco, c’est lire Ponge et Michaux aussi volontiers que Suarès ou Darien, c’est lire Giorgio Agamben qui lit Carl Schmitt qui lit Dostoïevski ou Bloy, c’est lire Bloy contre Zola et Jules Renard contre Bloy.
Vous avez raison finalement, Juan Asensio : les infréquentables ne le sont que par délation médiocre. Nul écrivain de qualité, nul penseur de valeur n’est infréquentable. Mais les médiocres se fréquentent, et ça fait du monde place de Grève…
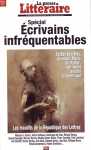

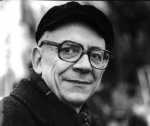

 A propos du Petit ami et d'In Memoriam
A propos du Petit ami et d'In Memoriam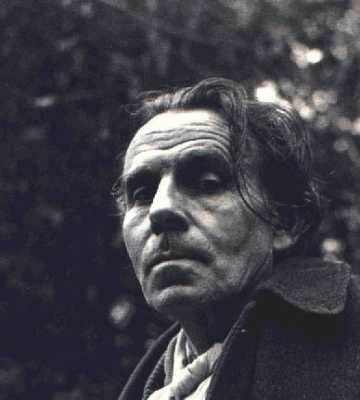
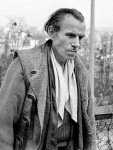 C'est du moins le parti de Philippe Alméras qui, travaillant sur Céline depuis quarante ans, comme un Henri Godard (responsable de l'édition en Pléiade) estime que Céline et son œuvre sont indivisibles et doivent être pris pour tels sans souci constant de les excuser ou de s' excuser d'y prendre de l'intérêt. Loin de s' en laisser conter par Céline, Alméras, auteur de la seule biographie de Céline non autorisée (Céline entre haines et passion, Laffont 1994) est d'autant plus crédible qu' il récuse autant la fascination mimétique des uns (très fréquente avec cet auteur, comme avec un Thomas Bernhard) que l'inquisition réductrice des autres.
C'est du moins le parti de Philippe Alméras qui, travaillant sur Céline depuis quarante ans, comme un Henri Godard (responsable de l'édition en Pléiade) estime que Céline et son œuvre sont indivisibles et doivent être pris pour tels sans souci constant de les excuser ou de s' excuser d'y prendre de l'intérêt. Loin de s' en laisser conter par Céline, Alméras, auteur de la seule biographie de Céline non autorisée (Céline entre haines et passion, Laffont 1994) est d'autant plus crédible qu' il récuse autant la fascination mimétique des uns (très fréquente avec cet auteur, comme avec un Thomas Bernhard) que l'inquisition réductrice des autres. ges historiques ou imaginés par l'écrivain.
ges historiques ou imaginés par l'écrivain. Abécédaire célinien
Abécédaire célinien