
A propos de Perla de Frédéric Brun et de Fracas de Pascale Kramer.
Je viens de lire ce matin gris un petit livre en une heure, le premier d’un auteur du nom de Frédéric Brun, paru sous le titre de Perla, et, resongeant aux arguties de Pierre Bayard sur la non-lecture, je me dis que malgré tout rien ne vaut la lecture et complète, d’un livre, et que parler de celui-ci sans l’avoir lu serait une absurdité. Je me faisais la même réflexion hier à propos d’un autre livre, de mon amie Pascale Kramer, intitulé Fracas et dont pas une miette ne doit être perdue sous peine de passer à côté. Que maintes gens passent à côté de Perla ou de Fracas ne m’inquiète pas autrement, je suis bien conscient qu’on peut vivre et survivre sans avoir lu Fracas ou Perla, mais ce n’est qu’en lisant ces livres d’un bout à l’autre qu’on peut se parler à soi-même d’eux en connaissance de cause, en démêler les qualités et les éventuels défauts, surtout s’en incorporer la substance puisque substance il y a - étant entendu que les livres sans substance, on les laisse tomber après deux trois pages et voilà tout.
Perla est un livre de deuil, comme on dit, un livre de larmes et limpide, comme nettoyé par la douleur et l’effort de la surmonter en écrivant, un livre clair et lumineux. Frédéric Brun a rêvé qu’il brûlait son manuscrit après être revenu à Auschwitz, soixante ans après que sa mère Perla y a séjourné quelques mois, déportée dans le dernier convoi parti de Drancy, en juillet 1944. Frédéric Brun n’a pas détruit son manuscrit en réalité et nous lui en savons gré car son récit, vital sans doute pour lui, mérite aussi d’être lu et « vécu » par chacun. C’est l’histoire d’un homme qui va devenir père au moment où sa mère, Perla, disparaît après des années à la fois brillantes (elle s’est refaite une belle situation, comme on dit, au retour des camps) et régulièrement marquées par la dépression. Tandis que le fœtus de son enfant grandit dans le ventre de Manon, Frédéric évoque, en alternance, les faits liés à la Shoah, dont sa mère lui a très peu parlé mais qu’il documente avec tous les livres qui en témoignent, et les motifs de l’apprentissage existentiel qu’il découvre dans les Bildungsromanen des romantiques allemands. D’aucuns hausseront les épaules et diront sans lire : lu et relu, vu et revu. Or précisément, la vraie lecture de vrais livres ne relève jamais du « déjà vu ». Cela tient à des riens, dont un Pierre Bayard ne dit rien : cela tient à la voix de l’auteur, à la forme de ses phrases, à la musique de celles-ci, à ce qui fait l’unicité de chaque personne, que l’art exprime corps et âme. Parler en ville de Perla ne nous donnera aucun prestige, mais lire ce livre est un cadeau qu’on se fait.
 Pareil pour Fracas, en plus fouillé, complexe, tordu et captivant, pour autant qu’on lise sans en perdre une miette. Pascale Kramer est une romancière tout à fait originale, dont la substance de l'écriture, si poreuse, est unique. Il ne se passe apparemment presque rien dans Fracas, qui se donne sans dialogue « extérieur ». Or ce livre hypertendu bruisse de voix et les événements minuscules s'y bousculent. Il s’agit d’une famille franco-américaine qui se retrouve dans une maison perdue, au bord d’un canyon californien ravagé par une tempête, avec la menace latente d’un bloc de rocher en suspension au-dessus de son toit. Au déchaînement récent des éléments fait pendant la sourde tempête intérieure qui tourmente les membres adultes de la famille (mais les mômes aussi s’agitent alentour) après un accident dont vient d’être victime la jeune Cindy, probable maîtresse du père, mais celui-ci et sa femme, à cran, font tout pour verrouiller ce secret.
Pareil pour Fracas, en plus fouillé, complexe, tordu et captivant, pour autant qu’on lise sans en perdre une miette. Pascale Kramer est une romancière tout à fait originale, dont la substance de l'écriture, si poreuse, est unique. Il ne se passe apparemment presque rien dans Fracas, qui se donne sans dialogue « extérieur ». Or ce livre hypertendu bruisse de voix et les événements minuscules s'y bousculent. Il s’agit d’une famille franco-américaine qui se retrouve dans une maison perdue, au bord d’un canyon californien ravagé par une tempête, avec la menace latente d’un bloc de rocher en suspension au-dessus de son toit. Au déchaînement récent des éléments fait pendant la sourde tempête intérieure qui tourmente les membres adultes de la famille (mais les mômes aussi s’agitent alentour) après un accident dont vient d’être victime la jeune Cindy, probable maîtresse du père, mais celui-ci et sa femme, à cran, font tout pour verrouiller ce secret.
Lu et relu, vu et revu ? Sans doute, s’il n’était question que du « sujet », mais quel est-il en réalité ? Et qui a jamais observé comme ça, forgé de telles métaphores et trouvé de tels adjectifs, dit tant de choses sur ce qui ne se dit pas à l’ordinaire ? Une telle lecture ne m’est pas plus vitale, dans l’absolu, que celle de Don Quichotte, que je n’ai jamais lu en entier (ça viendra) ou de La Divine Comédie, dont je n’ai jamais lu en entier Le Paradis, mais ces jours Fracas, comme Tumulte de François Bon, lu en parallèle, ou Perla, m’ont apporté des choses que la non-lecture ne m'apportera jamais. C’est affaire, une fois encore, de voix plus que de savoir, de peau et de regard, de ce je ne sais quoi qui fait que chaque vrai livre a un bout de vérité unique in the world à nous transmettre…
Frédéric Brun. Perla. Stock, 2007.
Pascale Kramer. Fracas. Mercure de France, 2007.
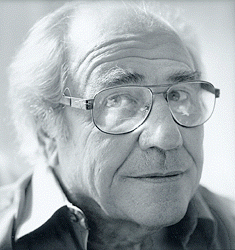


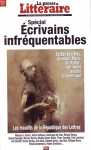 Ces « maudits » qu’on fabrique
Ces « maudits » qu’on fabrique