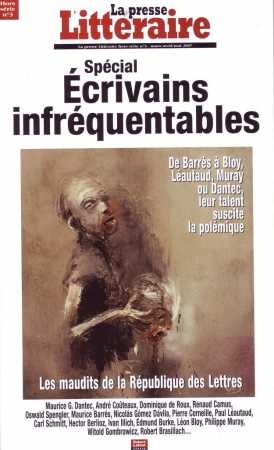Sur les écrivains infréquentables
Armand Robin publia, dans Le Libertaire du 29 novembre 1946, donc en pleine Epuration, une Demande officielle pour obtenir d’être sur toutes les listes noires, et cela relance décidément l’admirative sympathie que m’inspire l’auteur salubre de La fausse parole, dont le courage intellectuel est rappelé dans un article consacré par Jean-Luc Moreau à Dominique de Roux « l’indispensable contemporain », à lire dans la dernière livraison hors-série de La Presse littéraire de Joseph Vebret, intitulée Ecrivains infréquentables et conçue par Juan Asensio avec dix huit auteurs.
Les écrivains, de portée littéraire et de styles très variables et même très inégaux (on oscille entre Pierre Corneille et Renaud Camus, Maurice Barrès et Ivan Illich…), réunis dans cet ensemble aussi substantiel qu’hétéroclite, ne sont guère assimilables à une famille d’esprits repérable, et l’on ne voit d’ailleurs pas en quoi un Witold Gombrowicz ou un Paul Léautaud peuvent être qualifiés de « maudits », alors qu’y manquent un Lucien Rebatet, un Pierre Gripari ou un Albert Caraco, sans parler de Céline dont les pamphlets restent toujours frappés d’opprobre. Dans le même ordre de réserves, on pourrait chipoter sur la première affirmation de Joseph Vebret, dans son introduction, évoquant «des livres qui depuis longtemps auraient dû être de grands classiques de la littérature si leurs auteurs n’avaient rejoint l’arbitraire liste noire des écrivains réputés infréquentables ». Ce dernier critère est hautement variable selon les époques (Céline, maudit dans les années 50, est aujourd’hui en livre de poche, de même que Bloy ou Barrès), et parler de «grands classiques de la littérature à propos de Philippe Muray (excellent essayiste, mais bon...) ou d’André Coûteaux fait tout de même un peu sourire. De même les essais de définition de l’infréquentable comme «révolutionnaire le plus abouti », sous la plume de Juan Asensio, ou le non moins intempestif Eloge du réactionnaire, sous celle d’Ivan Rioufol, en dépit de leurs développements respectifs intéressants, ne parviennent pas à dissiper l'impression générale qu’on se trouve ici dans un fourre-tout d'indéfinissables esprits libres dont le seul dénominateur commun est peut-être le même refus du conformisme intellectuel et la même inadéquation au chic littéraire régnant.
Dans cette perspective non dogmatique, composite voire anarchique, et même s’il y a là-dedans à prendre et à laisser, cela reste une belle et bonne idée que de rassembler ainsi des aperçus sur des œuvres originales et parfois réellement méconnues en dépit de leur valeur, comme celle du très réactionnaire et nons moins éclatant Nicolas Gomez Davila, dont l'illustration fait regretter l’absence d’une présentation égale de Vassily Rozanov, son « cousin » russe… A signaler aussi: quatre lettres de Dominique de Roux, préludant à la publication d’un important choix de lettres chez Fayard ; une lecture, par Olivier Noël, de Maurice G. Dantec, pertinente mais qui me semble faire trop peu de part aux deux grands romans récents de cet indéniable « infréquentable » ; une très épatante défense d'un certain Pierre Corneille signée Sarah Vajda (mais au fait : pas trace d’infréquentable femelle dans l’histoire de la littérature ?), et un hommage à Carl Schmitt taxé de « grand catholique » par Rémi Soulié, entre autres approches de Berlioz, Burke ou Brasillach.
Juan Asensio et Joseph Vebret encourent-il un appel à la Fatwah tel que celui que le magazine Teknikart a lancé contre Dantec ? Je l’espère bien, et je prépare dûment la rédaction de ma Demande officielle pour obtenir le droit de figurer sur la même liste noire…
La Presse littéraire. Hors série no3. Spécial Ecrivains infréquentables. Mars/Avril/Mai 2007. La peinture reproduite en couverture est une oeuvre d'Olivier de Sagazan.