En lisant Tumulte de François Bon
Plus je vais et plus je rêve au livre rêvé, qui n’est à vrai dire ni le livre idéal non plus que le livre parfait, mais le livre qu’on rêve réellement la nuit ou le jour, les yeux ouverts à le lire ou l’écrivant les yeux fermés puis ouverts, et tous les jours depuis des années je lis Proust ainsi et j’écris ce que j’essaie d’écrire en rêvant qu’à mesure que j’écris mon nom s’efface comme le nom de Proust s’efface quand je le lis, ne gardant de ce nom que les noms pour mieux m’en imprégner comme de la rosée du matin la prairie encore hagarde, et c’est ainsi que je lis depuis le lever de ce jour Tumulte de François Bon, de toute évidence un fragment de ce livre rêvé dont je rêve…
Je savais que ce livre existait quelque part, j’ai vu François Bon dire Rabelais à Besançon, je sais son œuvre considérable et tout ce qu’il fait dans ses ateliers d’écriture et sur internet sans avoir jamais lu cependant, je crois, aucun livre de lui, comme si je devais entrer vierge et nu dans Tumulte, et tout aussitôt je me retrouve sur une chaise de bois dans notre cinéma de quartier Le Colisée à regarder Ben-Hur, cela me revenant parce François Bon évoque, dans les premières pages de Tumulte, son Ben-Hur à lui dont le souvenir lui rappelle « lorsqu’on nous avait emmenés à Paris pour la première fois »…
Ce ne sont pas les souvenirs de François Bon qui me touchent aussitôt, mais sa façon de les laisser couler dans le rêve de la page. Je suis content de n’avoir jamais feuilleté les pages virtuelles de Tumulte, pour y entrer ainsi où je veux et quand je veux, avec ce livre que je m’étais promis d’acheter depuis longtemps et dans lequel opère en effet la magie que je pressentais je ne sais pourquoi, peut-être par le besoin d’ouvrir d’autres portes comme celle dont parle François Bon lorsqu’il évoque un logis modeste de ses années d’apprentissage, derrière laquelle se retrouvaient des Portugais ; et la topologie de sa remémoration me renvoie à des souvenirs rêvés de maisons à travers les années, comme cette carrée de nos années bohèmes où « il y avait du passage »…
Il n’y a pas un mot de trop chez Proust, même quand je m’y ennuie à mort, et dans Tumulte il me semble que l’étoffe du rêve sera de la même texture, dans un tout autre cinéma dont le découpage me rappelle la remarque d’Alain Cavalier sur le sien : que le problème est de passer d’un plan à un autre. Or le montage de Tumulte m’évoque cette parfaite respiration de celui du Filmeur de Cavalier, et c’est donc parti pour 542 pages à rêver d’un plan à l’autre…
François Bon. Tumulte. Fayard, 542p.
-
-
Dessins pour mémoire
Charlotte, vie ou théâtre ? de Richard Dindo
Entre 1939, à Villefranche-sur-Mer où ses parents l’avaient envoyée pour la protéger, et l’été 1943, à la fin duquel elle fut déportée à Auschwitz avec son compagnon, Charlotte Salomon a consigné « toute sa vie » dans un ensemble de 769 dessins à la gouache qu’elle confia à un docteur français en lui recommandant d’en prendre soin. Cette œuvre étonnante, aujourd’hui déposée au Musée juif d’Amsterdam, revit dans un film de Richard Dindo datant de 1992, disponible sur DVD.
Comme une sorte de chronique dessinée, Vie ou théâtre, ainsi que Charlotte intitula elle-même l’entreprise « extraordinaire ou folle » qu’elle devait réaliser pour échapper à sa tentation du suicide (sa grand-mère venait de l’accomplir en se jetant par la fenêtre, comme sa mère des années plus tôt), déploie une frise magnifiquement vivante et émouvante, d’une force d’expression plastique rare.
En découvrant cette merveille, je me suis rappelé les dessins au quotidien de Joseph Czapski, avec lesquels ceux de Charlotte ont une ressemblance saisissante – tous deux tenant ainsi comme une sorte de journal enluminé où les mots inscrits comptent aussi beaucoup.
De son enfance à Berlin - entre une mère dépressive et un père chirurgien, qui se remaria avec une cantatrice après le suicide de son épouse -, aux premières manifestations antijuives de 1933, c’est en effet tout un théâtre, à la fois intime et collectif, parfois émouvant et parfois violent, qui s’anime sous nos yeux. Richard Dindo rappelle lui-même quel fut le destin de l’artiste, en entremêlant ensuite les gouaches de celle-ci et, en contrepoint, les images des lieux et des gens évoqués au fil de ce récit de vie « pour mémoire ».
Richard Dindo. Charlotte, vie ou théâtre ? DVD La Sept/Vidéo, Mémoires juives.
-
Une arnaque de JLK

Ou comment j’ai (si bien) parlé des Bienveillantes avant d’avoir lu tout le livre…
Première question : faut-il lire les 903 pages très tassées des Bienveillantes de Jonathan Littell pour en parler ? Les visiteurs de ce blog auront pu constater qu’il n’en est rien : la plupart de ceux qui se sont exprimés à ce propos n’avaient manifestement pas lu le livre. Plus précisément, ceux qui l’avaient le moins lu en parlaient le plus !
Deuxième question : faut-il avoir lu Les Bienveillantes en entier pour en parler ? Je dirai que c’est préférable, mais pas obligatoire.
Troisième question : faut-il avoir lu Les Bienveillantes, et en entier, pour présenter le livre convenablement dans un journal ? A cela, je réponds tranquillement en révélant un scoop mondial : à savoir que j’ai écrit, en date du 2 septembre 2006, un article dans le journal 24 Heures, sur Les Bienveillantes, intitulé La sarabande du démon, que j’estime un papier convenable, alors même que je n’avais lu réellement que les deux tiers du livre, disons 600 pages au total, d’un bout à l’autre mais avec de longs chapitres juste survolés.
J’affirme aujourd’hui avoir lu Les Bienveillantes de A à Z, comme en témoigne le carnet de notes que j’ai publié sur ce blog, mais cette lecture intégrale m’a pris trois mois alors que je n’avais qu’une semaine pour préparer l’article que ma rédaction m’a commandé dès que les médias ont commencé de « tirer »… Or peut-on lire Les Bienveillantes en une semaine ? On le peut en ne faisant que ça, mais il se trouve que je n’avais pas que ça à faire cette semaine-là.
N’empêche : j’estime avoir compris, en sept minutes, que Les Bienveillantes était un livre à lire, j’en ai entrepris la lecture pour comprendre, après 150 pages, que ce livre était si important qu’il fallait le lire de A à Z et que ça me prendrait des semaines, mais ma rédaction ne l’entendait pas ainsi, c’était lundi et l’article était à paraître le samedi suivant, allez coco manie-toi.
Et coco a fait ce qu’il a pu : il a lu les 312 premières pages des Bienveillantes, jusqu’à la fin des grands chapitres Allemandes I et II, après quoi il s’est livré à une suite de « carottages» représentant à peu près 300 autres pages, et c’était vendredi, coco, la panique, à toi de « tirer »...
En relisant ce papier intitulé La sarabande du démon, je me dis que je suis un vieux pro roué qui « assure ». Personne, évidemment, des lecteurs de 24 Heures convaincus (mais si, mais si) que j’avais lu les 903 pages du livre, n’avait de raison d’en douter en lisant cet article évidemment trop court (la faute à la rédaction), légèrement amélioré lors de l’attribution du Goncourt aux Bienveillantes. Pour la défense de coco, je dirais que les circonstances l'obligeaient, en l’occurrence, à cette arnaque, alors même que je continuais de lire Les Bienveillantes et de les annoter de A à Z. De cette lecture complète, j’ai tiré un article beaucoup plus personnel et complet, il me semble, intitulé Le cauchemar de l’homme fini et paru dans Le Passe-Muraille de janvier 2007.
Cela dit, pour en revenir au livre de Pierre Bayard sur les vertus de la non-lecture, j’ajouterai ceci à propos des Bienveillantes : qu’il est possible de parler de ce livre sans l’avoir lu en entier, mais que c’est moins intéressant que de le lire de A à Z ; qu’il est sans intérêt d’en parler sans l’avoir lu ; qu’il est sans intérêt de ne pas le lire en entier, même s’il compte parfois des « longueurs », autant qu’on en compte dans A la recherche du temps perdu...
Si j’ai consacré des semaines et des mois à la lecture et à l’annotation des Bienveillantes, ce n’est pas pour me donner bonne conscience mais par seuls plaisir et intérêt. J’ai récemment parlé sur ce blog des Microfictions de Régis Jauffret, qui fait la Une du Monde des livres de cette semaine, après avoir constaté, sur la base de 30 pages (les sept minutes d’examen ou un peu plus) que les 1000 pages de ce livre étaient de trop. J’en lirai un peu plus pour argumenter tout le mal que je pense de ce livre, qui nous éloigne de nous-mêmes et du monde en prétendant nous en rapprocher, mais j’estime d’avance que lire ces 1000 pages de trop serait un grave manquement à la plus élémentaire hygiène de vie selon les règles du Dr Wilde…
-
Metaphysical Fiction
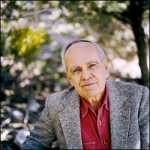 Cormac McCarthy, le film des frères Coen et la critique parisienne. Note de Juan Asensio
Cormac McCarthy, le film des frères Coen et la critique parisienne. Note de Juan Asensio Il faudra attendre encore quelques mois pour savoir si les frères Coen se sont trompés. Il faudra attendre encore quelques mois pour savoir si les célèbres réalisateurs, en adaptant le dernier roman traduit en français de Cormac McCarthy, Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme, n’ont réalisé qu’un film idiot privilégiant, banalement, la violence extrême qui exsude de ces pages écrites en quelques mois. Il est ainsi piquant de remarquer que, anticipant toutes les possibles, voire très probables erreurs d’interprétation, la prestigieuse Library of Congres a catalogué ce roman sous les entrées suivantes : 1) Drug traffic-Fiction, 2) Treasure-trove-Fiction, 3) Sheriffs-Fiction et enfin 4) Texas-Fiction… Apparemment, nul ne semble avoir songé au fait que la catégorie Metaphysical-Fiction, si d'aventure elle existe, rendrait assez bien compte, sans toutefois en épuiser la richesse, de l’histoire contée par Cormac McCarthy. Je me console cependant en pariant sur le fait suivant : nous n’attendrons en revanche que quelques jours (mieux, elles se tiennent déjà, l’œil vitreux et l’écaille blafarde, sous nos yeux, avant d’avoir, sur les étals de notre glorieuse République des Lettres aussi peu achalandés que ceux d’une épicerie de la Roumanie communiste, le déplaisir de lire les critiques dites littéraires qui évoqueront ce roman, le dépeignant, tout aussi banalement et sottement que le ferait n’importe quel demi-solde journalistique amateur des romans de Chandler, Cain ou Ellroy, comme un «polar pur et dur» ou, pourquoi pas, un «western moderne ultra-violent», stigmatisant au passage, comme il se doit, les réflexions quelque peu réactionnaires qui émaillent le roman, puisque c’est désormais dans ce genre de plastique sale que le chroniqueur moderne emballe la carne de sa sottise.
(suite sur: http://stalker.hautetfort.com/)
-
Le « cinéma » des fonctionnaires
On a vu quelques séquences de « cinéma » intéressantes, aux dernières Journée cinématographiques de Soleure, significatives de la nouvelle orientation prise par la Section Cinéma de l’Office fédéral de la culture, sous l’impulsion personnelle de MM. Jean-Frédéric Jauslin et Nicolas Bideau.
La plus spectaculaire fut évidemment la soirée « glamour » mise sur pied pour donner plus de visibilité à la cérémonie des Prix du cinéma suisse. A la toute fin de celle-ci, après un apéro où se frottaient, non sans lustre plaisant, célébrités helvètes du cinéma, de la télévision, de la politique et des médias, la remise du Prix du meilleur film de fiction de l’année 2006 à Vitus, de Fredi M. Murer, par Nicolas Bideau et Pascal Couchepin, donna lieu à une saynète qui ne manquait pas de sel. Désignant les assez rares contrevenants au code vestimentaire exigé (tenue de soirée), le chef de la Section Cinéma dauba sur le fait qu’on était en train de « tuer mai 68 », avant que son supérieur ne remarque qu’il en avait vu encore « quelques résidus ». Passons sur cette ironie du fonctionnaire et du politique, accordée à l’ambiance humoristico-foireuse de la soirée, mais une question plus sérieuse se pose : était-ce bien à Nicolas Bideau et à Pascal Couchepin de paraître à ce moment-là ? N’était-ce pas indécent, même, que Nicolas Bideau, qui a taxé en son temps Vitus de « film de vieux », récupère ainsi le succès de cet ouvrage éclatant de fraîcheur ?
Ce qui est sûr, c’est que, sous ses airs bravaches, et surfant sur la vague d’une embellie momentanée, Nicolas Bideau ne trompe pas les gens de la profession : le fait est qu’il tâtonne, autant que son supérieur Jauslin. Les deux fonctionnaires n’en ont pas moins opté, sans doute à bon escient, pour plus de visibilité et de communication. Or celle-ci donna lieu à une autre scène d’anthologie, vendredi dernier à Soleure, où le chef et le superchef dévoilèrent les « quatre piliers » de leur politique de soutien. Sous-titre proposé par le soussigné : la montagne accouche d’une souris. De fait, convoquer les professionnels du cinéma suisse pour leur annoncer que la « révolution » a été faite et qu’il s’agit maintenant de « consolider », alors qu’on poursuit simplement une politique tâtonnante avec (trop) peu de moyens, relève de la scène de trop...
Jean-Frédéric Jauslin est de bonne volonté, et sans doute est-ce un gestionnaire avisé. D’aucuns lui reprochent de n’avoir aucune « vision », mais est-ce son rôle ? Le nouveau chef de l’Office fédéral de la culture a (notamment) une noble et rude tâche, qui est de servir la cause de la culture auprès du politique à une période de restrictions budgétaires et de réaménagements légaux. Jean-Frédéric Jauslin l’a martelé : 2007 sera l’année de la culture en Suisse, pour laquelle il s’engagera en première ligne. Le même Jauslin a précisé dans la foulée qu’à la devise d’un de ses prédécesseurs, « Servir et disparaître », il préférait celle d’un service assumé personnellement. Ainsi donne-t-il à ses heures, comme Nicolas Bideau, dans le « cinéma ». Or celui-ci servira-t-il les créateurs ? Qui vivra verra.
Pour le moment, cependant, Jauslin et Bideau tâtonnent. Quand Jauslin déclare qu’il faut amener les jeunes au cinéma, en restant dans le vague, et que Bideau enchaîne en affirmant qu’il faudrait peut-être s’intéresser à Breakout de Mike Eschmann, film-pour-jeunes très racoleur, qui l’ennuie lui-même, l’observateur bien disposé est tenté d’y aller d’un petit conseil : messieurs, va pour le « cinéma », mais attention au retour sur images…
Cette chronique a paru dans l'édition de 24Heures du 30 janvier 2007.




