
Celui qui croit que Be bop a Lula est l’hymne national brésilien / Celle qui menace la Vierge de manquer trois messes si Elle n’accorde pas la victoire aux Bleus / Ceux qui appellent nationalisme le patriotisme des autres et patriotisme leur nationalisme / Celui que Zidane a aidé à positiver dans sa vie de merde / Celle qui a offert le maillot du Brésil à son fils adoptif aveugle / Ceux qui crèvent les ballons des gosses du quartier qui tombent dans leur jardin privatif / Celui qui affirme que la sensation du gazon fraîchement arrosé relève de l’extase prénatale / Celle qui n’a jamais admis qu’on parle de ça à table / Ceux qui estiment que le foot est un vecteur d’aliénation identitaire pour les nations saines / Celui qui trouve une ressemblance saisissante entre Cafu et l’épicier du coin / Celle qui sait ce qu’il en est des accointances du docteur Fuentes et de Ronaldinho mais qui se la coincera ce soir au bar Copacabana en banlieue de Vesoul / Ceux qui se sont promis de casser du travelo au Bois en cas de victoire du Brésil / Celui qui descendra un pot de chimarrao à lui tout seul dès le coup d’envoi / Celle qui enfonce une aiguille dans la poupée-effigie de Makelele / Ceux qui trouvent que Domenech a l’air d’un corbeau / Celui qui connaît les résultats de tous les matchs disputés par l’équipe de France depuis 1953 / Celle qui reconnaît le fils des Leconte du Nouy dans le public de Francfort / Ceux qui zappent en attendant le premier but français / Celui qui voit en le jeu de football une métaphore de la théorie palingénésique des récurrences / Celle qui tape une gomme à son Adrien pendant que celui-ci engueule Zizou / Ceux qui écoutent Metallica à fond la caisse pour emmerder les footeux d’à côté, etc.
-
-
Je suis peintre
Je suis peintre mais personne ne me connaît ou presque. Le monde m’est toujours apparu si immense, profond et sombre que j’ai préféré rester dans l’ombre. On dirait plutôt que c’est l’ombre qui m’a choisi. Toujours mes actions, mon caractère m’ont poussé hors de cette fausse lumière. Tout ce que je suis, vois, comprends, éprouve, est dans ma peinture et cela a suffi à mon bonheur. Oui j’ai été heureux. Ce que j’ai vu de ce monde ne m’a guère donné l’image du bonheur, aussi j’ai cherché à le poursuivre seul. Une femme et un fils m’ont apporté de grandes joies et finalement mon fils aura été la plus grande, même s’il ne me ressemble pas, s’il est différent, tant mieux après tout. La quête que j’ai poursuivie est celle du mystère de la lumière. La lumière est dans les choses, elle est le cœur de la vie et ne s’éteindra jamais. Oui l’éternité est la permanence de la lumière. Le reste n’est que littérature. J’aime la littérature parce qu’elle raconte le monde, elle dit sa folie, sa démesure. Comme un cercle ce que je cherche c’est le centre, le point nodal. Je crois l’avoir trouvé : il est dans l’éternité que certains appellent « Dieu ». La lumière et donc la peinture en est la traduction, celle que j’ai tentée en tout cas.
Paul Cézanne
(Cette lettre inédite, parue dans la livraison de juillet 2006 du Passe-Muraille, No 70, est de la plume de Raymond Alcovère, qui publiera en 2007 Le sourire de Cézanne, aux éditions N&B.) -
Cézanne, les couleurs et les mots
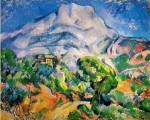 Une lettre de Rainer Maria Rilke
Une lettre de Rainer Maria Rilke« … Mais à propos de Cézanne, je voulais encore dire ceci : que jamais n’était mieux apparu à quel point la peinture a lieu dans les couleurs, et qu’il faut les laisser seules afin qu’elles s’expliquent réciproquement. Leur commerce est toute la peinture. Celui qui leur coupe la parole, qui arrange, qui fait intervenir d’une manière ou d’une autre sa réflexion, ses astuces, ses plaidoyers, son agilité d’esprit, dérange et trouble leur action. Le peintre (comme l’artiste en général), ne devrait pas pouvoir prendre conscience de ses découvertes ; il faut que ses progrès, énigmatiques à lui-même, passent, sans le détour de la réflexon, si rapidement dans son travail qu’il soit incapable de les reconnaître au passage. Quiconque, à ce moment-là, les épie, les observe, les arrête, les verra se métamorphoser comme l’or des contes, qui ne peut rester pur par la faute de tel ou tel détail. Le fait que les lettres de Van Gogh se lisent si bien, soient si riches, parle en fin de compte contre lui, comme parle contre ce peintre (comparé à Cézanne) le fait davoir voulu, su, éprouvé ceci ou cela : que le bleu appelait l’orange, et le vert le rouge ; ainsi qu’il l’avait entendu dire, le curieux, aux aguets au fond de son œil. Aussi peignait-il des tableaux fondés sur un seul contraste, tout en pensant au coloris simplifié des Japonais qui ordonnent les surfaces selon le ton voisin, plus haut ou plus bas, et les additionnent pour obtenir une valeur totale; ce qui les conduit au contour continu, exprimé (c’est-à-dire inventé), sertissage de surfaces équivalentes, donc à l’ntentionnel, à l’arbitraire, en un mot : au décoratif.
Un peintre qui écrivait, donc un peintre qui n’en était pas un, a voulu inciter Cézanne aussi à s’expliquer en lui posant des questions de peinture : mais, quand on lit les quelques lettres du vieillard, on constate qu’il en est resté à une ébauche maladroite, et qui lui répugnait infiniment à lui-même, d’expression. Il ne pouvait presque rien dire. Les phrases où il s’y efforce s’étirent, s’embrouillent, se hérissent, se nouent, et il finit par les abandonner, furieux. En revanche, il parvient à écrire très clairement : « Je crois que ce qui vaut mieux, c’est le travail ». Ou bien : « Je fais tous les jours des progrès, quoique lentement ». Ou bien : « J’ai près de soixante-dix ans ». Ou bien : « Je vous répondrai avec des tableaux ». Ou encore : « L’humble et colossal Pissaro » (celui qui lui a appris à travailler) ; ou enfin, après avoir bataillé un peu (on sent comme c’est caligraphié, et avec soulagement), la signature complète : « Pictor Paul Cézanne ». Et dans la dernière lettre (du 21 septembre 1905), après des plaintes sur sa mauvaise santé, simplement : « Je continue donc mes études ». Et le vœu qui a été exaucé littéralement : « Je me suis juré de mourir en peignant. » Comme dans une vieille Danse des Morts, la Mort a saisi sa main par derrière, posant elle-même la dernière touche, avec un frisson de plaisir ; son ombre s’étendait depuis quelque temps sur sa palette, elle avait eu le temps de choisir, dans la ronde franche des couleurs, celle qui lui plaisait le mieux ; quand le pinceau y aurait plongé, elle s’en saisirait et peindrait… Le moment vint; la Mort allonga la main et posa sa touche, la seule dont elle soit capable ».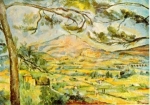
(…) « Toute parlote est un malentendu. Il n’y a de compréhension qu’à l’intérieur du travail, sans aucun doute. Il pleut, il pleut… » (…)Rainer Maria Rilke. Lettres sur Cézanne. Traduites et présentées par Philippe Jaccottet. Seuil, coll. Le don des langues, 1991.
-
Chacun son voyage
Journal des Lointains, No 3.
De Terre de Feu au volcan Merapi, ou du Salon Cunning de Buenos Aires à l’ancienne cité de l’or Sofala au Mozambique, entre autres points de chute, quatorze auteurs, écrivains plus ou moins confirmés (trois seuls sont déjà un peu connus), journalistes ou routards-qui-écrivent, évoquent les épisodes marquants de leurs périples, à la demande de Marc Trillard, maître d’œuvre de cette revue exclusivement réservée à la littérature de voyage et dont c’est la troisième livraison.
Si l’on n’y trouve pas de grand bourlingueur-poète à la Cendrars ou de maître styliste à la Bouvier, les invités de Trillard ont pour point commun de vivre le voyage à l’écart des sentiers rebattus du tourisme de masse. D’emblée il nous semble replonger dans un roman d’aventures de notre jeunesse en embarquant, avec Laurent Maréchaux, sur le Darwin sound, ketch de 72 pieds lancé à travers les eaux fuégiennes aux « tempêtes d’anthologie », sur les traces du mythique Beagle. L’aventure est en revanche dans les rencontres de hasard, pour Brina Svit, romancière slovène qui dit préférer, en Argentine, les vivants aux grandes ombres à la Borges dont on lui propose (forcément) de visiter les cafés qu’il a hantés…
Avec Rémi Marie, c’est par la transe de l’écriture qu’est rendue la sensualité, vibrante en surface mais pauvre en émotions, selon lui, de Rio à l’approche du carnaval. Saisissante également, mais surtout pour son climat, la plongée de Michel Abax Dans le corps obscur de la nuit, entre Pérou et Bolivie, où la recherche d’un amour perdu l’amène en zone dangereuse. Romancière éprouvée, Caroline Lamarche déçoit avec un récit mexicain sans relief, tandis que Michaël Ferrier, mémorable chroniqueur japonais, découvre Antananarivo avec émerveillement , et qu’Alain Dugrand, savoureux baroudeur, nous rappelle que la guerre, ici en Abkhazie, peut aussi être « du voyage »...
Journal des lointains. Réalisé par Marc Trillard, avec 14 auteurs. Editions Buchet-Chastel, 213p.
-
D'îles en elles
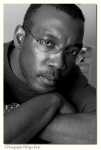 A propos d''Un archipel dans mon bain, de Jean-Euphèle Milcé
A propos d''Un archipel dans mon bain, de Jean-Euphèle MilcéLe moins que l’on puisse dire, c’est que Jean-Euphèle Milcé sait dire beaucoup en peu de mots. Condenser : l’art du poète. La promesse de son premier roman, L’Alphabet des nuits, est tenue dans le second, Un archipel dans mon bain, autant par le choix des thèmes que par la qualité de l’écriture – cette recherche constante de la tournure nouvelle, de la phrase courte mais habitée, du mot juste, autant dans son sens que dans sa sonorité.
Evita se raconte au présent. À « quarante ans et quelques centimes », veuve d’un riche peintre « mort artiste et amoureux absolus », elle s’ennuie dans sa tristesse, en « un jour qui s’enroule méthodiquement dans mille aunes de chagrin ». Mais une courte lettre anonyme la force à avouer qu’elle a menti à propos de son passé. Non, elle n’a pas connu ses parents, qui ne possédaient certainement ni galerie à Londres, ni résidence secondaire en Grèce. Elle n’a pas de diplôme, n’a pas appris de métier. Et n’a vécu son enfance que « par saisons désaccordées ».
En parallèle nous est contée l’arrivée à Genève de Marie Raymonde, jeune femme née sur l’île bretonne d’Ouessant, qui débarque « avec un embryon de rêve » dans cette « ville de nulle part, de nulle appartenance », puis galère dans un bistrot jusqu'à être engagée dans une douteuse « agence de mannequins ».
Les chapitres développent en alternance ces deux histoires qui avancent ainsi côte à côte, jusqu’à se rejoindre, puisque l'on finit par comprendre que Marie Raymonde n'est personne d'autre qu'Evita, vingt ans plus tôt.
Retour au présent, où Evita, « déesse de la lubie », se cherche une île sur la carte du monde, un endroit où ranger son enfance et, peut-être, placer son futur. Et c’est Haïti qu’elle choisit – à moins que ce ne soit Haïti qui la choisisse. Elle quitte la maison de « ce village vaudois » où elle est arrivée après avoir changé de nom, quitte le jardin gigantesque, les amis de feu son mari, et elle s’envole de l’autre côté de l’Atlantique.
C’est là que se déroule la deuxième partie du livre. En Haïti. On retrouve alors encore plus franchement ce regard sombre et cette langue attentive, inventive, qui dominaient dans le premier roman de l’auteur. Il y a cependant modulation, car contrairement à Assaël, le narrateur de L’Alphabet des nuits, Evita est Blanche, son passeport est français, et c’est une femme, ce qui change considérablement la manière d’appréhender le monde. Assaël était Haïtien, errait donc dans ses propres terres, nous en montrait les révoltes et les peurs intestines. Evita arrive de l’extérieur, elle découvre en même temps que nous « un pays à travers ses malheurs entrelacés ». Mais Port-au-Prince reste Port-au-Prince, un « espace qui a perdu son destin de capitale », une « ville déchue qui traverse ses jours et ses nuits sans véritable rancune », qui porte toujours « les traces d’une ancienne grandeur ».
À travers trois personnages (« l’ancêtre » d'Evita, « l’arrière-grand-oncle » et celui qui « aurait pu être le grand-père ») à peine plus qu’esquissés en de courts chapitres et que l’on sent pourtant bien vivants, Milcé développe une belle réflexion sur la filiation, la mémoire, l’histoire universelle dans laquelle se fondent les histoires personnelles, les déchirements et les renouements avec des passés plus ou moins ensevelis, et puis ce thème éternel de l’errance. « En réalité, la vraie histoire n’est que celle qui nous convient. Et le reste s’identifie à l’oubli. Au patrimoine. ». Trois hommes qui ont la double fonction d’éclairer chacun un certain pan de l’Histoire, et de nous mener à travers les siècles jusqu’à Evita, puis à sa fille. Ils sont les « racines voyageuses, avaleuses de kilomètres », ballottés entre deux îles – Ouessant et Haïti –, traversant inlassablement l’Océan écartelé « entre deux continents. Deux mondes ». La généalogie, cet art « de nouer ficelles, câbles, lignes de sisal, fils de nylon, cordes de chanvre entre eux », s’exprime ici dans ce qu’elle a de plus beau et fascinant – l’ancêtre et sa descendance écorchés au fil barbelé de l’histoire du monde, qui s’y accrochent quand même, malgré tout, parce qu’ils n’ont pas le choix.
L’île, c’est l’unité qui tente de se faire une place dans l’archipel impitoyable, c’est ce morceau de terre au milieu des eaux qui lutte pour ne pas s’effondrer ni se laisser engloutir, tout en se demandant quel est le volcan qui, jadis, l’a craché au monde. L’île, dans ce roman, c’est Ouessant, c’est Genève, c’est bien sûr Haïti, et puis c’est Marie Raymonde qui deviendra Evita, c’est la petite Gaëlle, sa fille… Toutes ces îles qui forment les « éléments épars d’une tentative d’espoir ».
Bruno Pellegrino
Jean-Euphèle Milcé, Un archipel dans mon bain, Bernard Campiche Editeur, 2006, 160 pages.
Cet article est à paraître dans la dernière livraison du Passe-Muraille de juillet 2006.
-
Pourquoi je relis (souvent) André Hardellet
 Comment rencontre-t-on un écrivain ? Dans mon cas, ce fut par une photographie. Robert Doisneau venait de publier un livre de portraits de personnalités connues parmi lesquelles Jacques Prévert, à qui je vouais un culte tout particulier pour ses dialogues des Enfants du paradis et pour son recueil de poésie Paroles, classé pourtant parmi les poètes mineurs par mon professeur de lycée (contre qui je garde, depuis, une dent toute particulière). Parmi ces portraits en mode mineur ou majeur, un seul m’était inconnu. De la droite de la photographie noir et blanc, un mec moustachu, cheveux courts, la cinquantaine, chemise sombre élégante, gauloise bleue allumée entre l’index et le majeur de la main droite, se penchait vers moi l’air de dire « Eh, petit, tu ne me remets pas ? ». Intrigué, je suis allé consulter le dictionnaire qui m’a appris que le type goguenard qui semblait me dévisager, André Hardellet, était écrivain et qu’il avait publié des poèmes (les Chasseurs) et des romans (Le Seuil du jardin ; Lourdes, lentes… ; Le Parc des Archers). Comme à mon habitude (salut Jacques Roman !), j’ai tout acheté ce qui était encore disponible dans le commerce (bien peu de choses avant 1990) et ai mis mon libraire de deuxième main en chasse. Bien m’en a pris : celui-ci me trouvait coup sur coup tous les titres cités plus haut ainsi que Lady Long Solo, splendide évocation illustrée par Serge Bajan. Immédiatement, ce sont les Chasseurs qui m’ont conquis, peut-être aussi parce que la version en poche est illustrée d’un tableau de René Magritte que j’admire par-dessus tout. Je me suis retrouvé plongé dans un état de rêve éveillé, une sorte de temps retrouvé. D’ailleurs, Hardellet adore Proust (moi aussi) qu’il a lu, dit-il, comme un roman policier. Il rend d’ailleurs hommage à l’athlète de la chambre en liège à plusieurs reprises, par exemple en commençant précisément Lourdes, lentes… par la même phrase que celle du début de la Recherche. C’est d’ailleurs pour ce roman qu’il se fait traîner devant les tribunaux sur plainte de la Ligue de défense de l’enfance et de la famille et se fait condamner (en 1973 !) pour outrages aux bonnes moeurs, malgré des témoins comme Julien Gracq ou le prince Murat. Plutôt que de s’offusquer d’un érotisme somme toute léger, un critique intelligent, comme Jean-Marc Rodrigues, y voit d’abord de nouvelles approches des territoires enchantés de l’innocence. Hardellet me sert souvent de guide, me parle de ses explorations de territoires interdits, envahis par les herbes folles où se perdent les jockeys de Magritte et que des chasseurs arpentent, dans une brume trompeuse. A ce propos, le début des années 90 m’a permis de lire, chez l’Arpenteur justement, l’œuvre complet de l’alchimiste Hardellet en 3 volumes. Un régal. J’y ai découvert Serge Gainsbourg en tueur de vieilles dames, Guy Béart et son Bal chez Temporel, mais aussi des photos avec Albert Simonin (ah, relire Du mouron pour les petits oiseaux ou Le cave se rebiffe !), René Fallet et… un raton laveur.
Comment rencontre-t-on un écrivain ? Dans mon cas, ce fut par une photographie. Robert Doisneau venait de publier un livre de portraits de personnalités connues parmi lesquelles Jacques Prévert, à qui je vouais un culte tout particulier pour ses dialogues des Enfants du paradis et pour son recueil de poésie Paroles, classé pourtant parmi les poètes mineurs par mon professeur de lycée (contre qui je garde, depuis, une dent toute particulière). Parmi ces portraits en mode mineur ou majeur, un seul m’était inconnu. De la droite de la photographie noir et blanc, un mec moustachu, cheveux courts, la cinquantaine, chemise sombre élégante, gauloise bleue allumée entre l’index et le majeur de la main droite, se penchait vers moi l’air de dire « Eh, petit, tu ne me remets pas ? ». Intrigué, je suis allé consulter le dictionnaire qui m’a appris que le type goguenard qui semblait me dévisager, André Hardellet, était écrivain et qu’il avait publié des poèmes (les Chasseurs) et des romans (Le Seuil du jardin ; Lourdes, lentes… ; Le Parc des Archers). Comme à mon habitude (salut Jacques Roman !), j’ai tout acheté ce qui était encore disponible dans le commerce (bien peu de choses avant 1990) et ai mis mon libraire de deuxième main en chasse. Bien m’en a pris : celui-ci me trouvait coup sur coup tous les titres cités plus haut ainsi que Lady Long Solo, splendide évocation illustrée par Serge Bajan. Immédiatement, ce sont les Chasseurs qui m’ont conquis, peut-être aussi parce que la version en poche est illustrée d’un tableau de René Magritte que j’admire par-dessus tout. Je me suis retrouvé plongé dans un état de rêve éveillé, une sorte de temps retrouvé. D’ailleurs, Hardellet adore Proust (moi aussi) qu’il a lu, dit-il, comme un roman policier. Il rend d’ailleurs hommage à l’athlète de la chambre en liège à plusieurs reprises, par exemple en commençant précisément Lourdes, lentes… par la même phrase que celle du début de la Recherche. C’est d’ailleurs pour ce roman qu’il se fait traîner devant les tribunaux sur plainte de la Ligue de défense de l’enfance et de la famille et se fait condamner (en 1973 !) pour outrages aux bonnes moeurs, malgré des témoins comme Julien Gracq ou le prince Murat. Plutôt que de s’offusquer d’un érotisme somme toute léger, un critique intelligent, comme Jean-Marc Rodrigues, y voit d’abord de nouvelles approches des territoires enchantés de l’innocence. Hardellet me sert souvent de guide, me parle de ses explorations de territoires interdits, envahis par les herbes folles où se perdent les jockeys de Magritte et que des chasseurs arpentent, dans une brume trompeuse. A ce propos, le début des années 90 m’a permis de lire, chez l’Arpenteur justement, l’œuvre complet de l’alchimiste Hardellet en 3 volumes. Un régal. J’y ai découvert Serge Gainsbourg en tueur de vieilles dames, Guy Béart et son Bal chez Temporel, mais aussi des photos avec Albert Simonin (ah, relire Du mouron pour les petits oiseaux ou Le cave se rebiffe !), René Fallet et… un raton laveur.J’y ai, plus sérieusement, savouré toute une série d’œuvres poétiques que je ne connaissais pas comme L’Essuyeur de tempêtes, par exemple, qui regroupe des métiers, plus improbables les uns que les autres : L’expression « essuyer une tempête » remonte à la plus haute antiquité. (…). Mon grand-père Beaujolais-la-Pivoine n’essuyait pas les tempêtes à proprement parler ; il ne s’occupait généralement que des « grains », des bourrasques modestes, mais il les traitait de la même manière. Une fois pourtant, entre Epineuil et Sainte-Agathe (j’avais sept ou huit ans), il me montra une tempête allongée sur une prairie et qu’il venait de « terminer ». Elle était tellement propre, briquée et transparente, que vous auriez juré qu’il n’y avait rien là, devant vous. J’écarquillais mes yeux d’enfant ; Beaujolais me dit : « Elle va r’partir, maint’nant, quasiment toute neuve ».
Si je relis volontiers chaque texte de Hardellet, pour son climat d’écriture particulier, je reste toujours abasourdi par les trouvailles des Chasseurs, surtout dans son répertoire :
Campagnol. Va-t’en le chercher dans les forêts de paille ou sur un tapis de Turquie.
Saltimbanques. Crépusculaires, un doigt sur la bouche, ils connaissent le chemin du val et du bal.
Croquemitaine. « Viens, lui dit-elle, tu dois subir ta punition. » Un ogre en laine, un épouvantail ambulant.
Elle le conduisit dans le cabinet noir qui sentait l’encaustique et poussa le verrou. Elle ôta ses défroques, s’épanouit, délaça son odeur. Puis, lentement, avec précaution, elle guida sa main neuve.
Il n’a jamais vu son visage – mais c’était la plus belle d’entre toutes. Et, depuis, il la cherche partout à tâtons.
Alors, je m’en vais flâner dans des toiles comme l’Empire des lumières, le Domaine d’Arnheim ou celles de Paul Delvaux. Je rencontre Labrunie, Mac Orlan, Peter Ibbetson et je marche dans un Paris, vide soudain, à la recherche de découvertes inattendues. Je reviens ensuite dans notre monde, un peu étourdi, et, pour sur-vivre, j’essaie, parfois avec difficulté, de suivre les conseils que Lady Long Solo laissa un jour à André Hardellet, avec un bouquet de violettes, tellement sombres qu’elles en paraissaient noires : « Prends patience ». La lecture se poursuit…
Jean Perrenoud
Ce texte est à paraître dans la livraison du Passe-Muraille de juillet 2006, No70.
-
L’Afrique en ses confessions urbaines
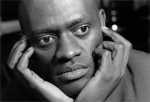
Sur Verre cassé d’Alain Mabanckou
Ils sont de plus en plus nombreux ceux qui, à tort ou à raison, entre deux grains de chapelets, rêvent d’une littérature francophone africaine moins balafrée. Les histoires d’enfants-soldats, les accouplements des esprits divers et des animaux sages à midi pile dans la savane, les machettes rouillées par le sang séché, la route sans borne des déplacés ont honorablement traversé un bon demi siècle.
Pour combler le vide entre deux rentrées littéraires, pour légitimer la françafrique et les festivals de rédemption, aussi pour les besoins d’une politique éditoriale exotique et ghettoïsante, Continent Noir, l’Harmattan, Présence Africaine, entre autres, nous en ont gavé. Nous ont servi l’excellent et le pire. Reconnaissance et complaisance. Littérature et folklore. Grands livres et commerce.
Sans crier à la rupture, une nouvelle génération d’écrivains africains nous propose, en toute fantaisie, la découverte d’une Afrique assumant, tant bien que mal, la redéfinition sauvage des espaces de regroupement des collectivités, de transmission des savoirs et de l’organisation utile du travail.
Alain Mabanckou est sans doute actuellement l’écrivain africain le plus décomplexé. Vagabond de quarante ans, il est habité par trois continents. On le rencontre aussi à l’aise en Afrique d’où il vient (Congo-Brazaville), en France où il a fait une partie de ses études et travaillé un temps et aux Etats-Unis où il enseigne la littérature africaine.
Son dernier roman Verre Cassé est un miracle à la fois naïf et maîtrisé.
Un picoleur, grand raté et inconscient du verdict de la Société, accepte le mandat, à la bonne manière africaine, de consigner dans un cahier les déchéances et les déchirures d’une bande d’éclopés de la vie, clients du bar « le crédit a voyagé ». L’Afrique se présente dans son urbanité fantastique. Les chagrins immunisés qui nagent au dessus des flots d’alcool. Les prostituées qui monnayent l’affection, les déracinés, les refoulés de la France. Un sodomisé en prison oublie qu’il porte des couches depuis. Ca parle. Ca pisse derrière le comptoir. Ca pue. Le patron fait des affaires. La vie comme une tique malveillante s’accroche aux clients.
Une ville congolaise crachote sans pudeur des intrigues de palais, défie le pouvoir des marabouts, coupe la parole au refoulé qui a imprimé des histoires et des photos de gens « sérieux » pour le compte de Paris-Match. On s’invite sans difficultés dans un monde de coups bas (familles déréglées, abus dans la fonction publique), de comptes à régler. Aujourd’hui. Demain.
Verre cassé est une fête jusqu’au petit jour. Une beuverie désinhibée des convenances. Les voix fusent multiples, discontinues dans un débit diluvien. Et le lecteur se laisse emporter par les ragots, l’ironie, la malfaisance, les regrets et les projets. L’ambiance est joyeuse : « les jours passent vite alors qu’on aurait pu croire le contraire lorsqu’on est là, assis, à attendre je ne sais quoi, à boire et à boire encore jusqu’à devenir le prisonnier des vertiges, à voir la Terre tourner autour d’elle-même et du Soleil même si je n’ai jamais cru à ces théories de merde que je répétais à mes élèves lorsque j’étais un homme pareil aux autres »
Après Bleu-Blanc-Rouge, les Petits-Fils nègres de Vercingétorix et African Psycho, Alain Mabanckou rassure son lectorat avec Verre Cassé. La construction du texte est périlleuse. Ponctué qu’avec des virgules. Sans séparateurs de phrases. Des minuscules au début des paragraphes. Pourtant le texte se laisse lire du début à la fin.
Malgré l’intention –trop perceptible- de mettre en évidence, dans le texte, la mémoire littéraire (en réalité, classique) du professeur de littérature qu’il est, Alain Mabanckou nous ouvre les portes d’un tout grand univers. Son écriture est juste, moderne et majeure. Verre Cassé est à lire en toutes saisons.
Jean-Euphèle Milcé
Alain Mabanckou. Verre Cassé, Seuil, Paris, 2005.Cet article est à paraître dans la nouvelle livraison du Passe-Muraille, no 70.
-
Guignol's band bis
A propos d’Entre les murs de François Bégaudeau
On connaît l'antienne: l'école publique, en Europe, est un vaste chantier où les expériences les plus saugrenues sont encouragées au nom de... Les responsables sont fébriles. Après le laxisme, retour à l'autoritarisme. On crée des commissions pour rédiger des règlements: si la casquette n'est pas autorisée, le bandana le sera-t-il? Perplexité des intervenants. Si le mot clitoris est régulièrement tracé au feutre indélébile sur les pupitres, quelle stratégie adopter pour éradiquer cette mauvaise habitude? Y a des profs qui s'en foutent! hurle une débutante. Le principal la rassure: S'ils ne jouent pas le jeu, tu nous les signales, on leur fera comprendre!
C'est exactement ce que pourrait raconter François Bégaudeau dans son dernier livre Entre les murs. Mais le pessimisme et le regard désabusé ne sont plus de mise. Le créneau a été pris trop souvent: Altschull, Barrot, Capel, Boutonnet, Kuntz, Milner, Michéa, Lurçat, Goyet... Tout le monde est au courant: on a cassé l'école républicaine, l'enseignement a été vidé de sa substance, l'horreur pédagogique a triomphé. Et pourtant, les ados continuent de fréquenter ces étranges lieux de vie, certains parents continuent d'assister à des réunions et de signer des carnets scolaires, les profs continuent d'évaluer le comportement des jeunes, d'écouter l'Autre, d'élever la voix, de corriger des textes argumentatifs. Des profs au crâne rasé, percings dans les sourcils et au bord des oreilles, jean déchiré, qui tombent en extase devant Matrix et Narnja, écoutent le même rap que leurs élèves, portent le même sweat que leurs élèves, sur lequel un vampire décrète Apocalypse now! Des profs qui, malgré la platitude de leurs propos et leur orthographe déficiente, se prennent très au sérieux. Voyons! Leur mission est d'éduquer! Souleymane, Youssouf, Djibril et Hadia ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Après que... suivi du subjonctif ou de l'indicatif? Peu leur chaut. Et pourtant... Quand Aïcha décide d'y aller, c'est toujours avec une heure de retard... Or Ming se prend au jeu: les temps du récit au passé, ça l'intéresse... Et dans la salle dite des maîtres, Gilles avale son second Lexomil, Elodie lit son horoscope dans un journal. Le principal affirme qu'il faut rentabiliser les heures de français. Il ouvre des pistes de réflexion. Il propose de changer les horaires fixés par son prédécesseur... On se croirait dans une farce... On imagine Céline mettant en scène cette bande de guignols: le perpétuel boudeur qui refuse de tomber sa capuche, celle qui va se plaindre de la dureté d'un prof auprès de la nouvelle psy, l'enseignante d'histoire bien fringuée qui fait la morale "avec une miette de pepito collée à la lèvre inférieure". Le vacarme, la gabegie, la difficile transmission du sens des mots, les acrobaties chaplinesques du pion se contorsionnant entre les cultures, les règles de grammaire, les races, les règles de vie, les droits de l'homme et les montagnes d'emmerdements, la componction compatissante du conseiller social faisant la collecte pour payer les frais d'enterrement du père de Salimata, les coups de pied de l'intendant dans la photocopieuse, le racisme anti-Blanc des enfants de victimes du colonialisme français, la "pétasse" qui lit La République offrent un matériau idéal pour construire un roman.
Viens, on va regarder la télé! dit un père à sa fille qui se sent obligée de voir avec lui les tétons énormes, les cuisses qui s'ouvrent, le membre turgescent. Quant à Soumaya, elle préfère regarder la télé en Egypte, parce que là-bas,"on est tranquille, on n'a pas toujours la main sur la télécommande des fois qu' y aurait du sexe". Excellent sujet pour débattre, exprimer un désaccord, écouter l'Autre, transmettre des valeurs et produire, in fine, un texte argumentatif. Mais un récalcitrant casse l'ambiance. Il trouve que, le onze septembre, ils ont eu raison de planter les avions dans les tours. Alors là, trop c'est trop! Carnet de correspondance! Il est convoqué chez la psy. Elle aurait passé un contrat avec lui. Il ne devra plus dire... Et voilà que le sang a pissé. Souleymane a frappé un camarade. L'encapuchonné doit comparaître devant un conseil de discipline. L'éducatrice lui trouve des circonstances atténuantes: le père vient de...
On l'aura compris, ce qui intéresse Bégaudeau, ce sont surtout les chaînes sonores qui se croisent dans ce lieu déterritorialisé qu'est l'école publique actuelle. Il scrute attentivement et passionnément une langue vivante qui s'articule au plus près des pulsions. Pour capter les ondes émotives, il transcrit les tics langagiers, les éructations et les mélodies dans son laboratoire, chambre d'échos où le lecteur perçoit les voix claires ou enrouées de Khoumba, Gibran et Jiajia, toutes ces affirmations maladroites, ces phrases syncopées et ces hoquets de rage voués à l'oubli, ce non-dit où prolifèrent les germes de ressentiment, d'aigreur, de haine et de violence... La meilleure posture à adopter devant ce sidérant lieu de vie ou hôpital de jour que les décideurs de Bruxelles nomment Ecole-Santé (sic) est sans doute celle de l'écrivain: montrer les choses avec précision et légèreté, ne pas les commenter. En cela, l'entreprise de Bégaudeau est parfaitement réussie.
Antonin Moeri
François Bégaudeau: Entre les murs.Editions Verticales 2006
Ce texte est à paraître dans le numéro 70 du Passe-Muraille
Photo: Hélène Tobler
-
Chippendale
Elles rient comme des folles paniquées et cela fait fondre mon tendre coeur de pro. Du coup je les rassure: ne vous méprenez point Madame Public, je ne suis pas la brute que vous imaginez, et c’est pourquoi je m’en vais vous en donner plus que votre content.
Je suis le nu qui s’offre tout aux sinistrées que vous êtes. Non seulement vous aurez droit à la vue intégrale, mais au sentir, au palper, au goûter, je vais vous soulever de vos sièges et faire de votre assemblée d’inapaisées une seule vague ascendante.
Nous n’aurons même pas besoin de dire les mots: je vous ..., vous me ..., je vous ferai ..., vous me ferez..., je vous la... dans le ... et vous me le ... dans la ...
Naturellement votre peur m’excite, et mon état fait alors redoubler vos cris, mais ne craignez point la chose, ce n’est que le doigt d’un dieu bonne pâte, allez, on vous a fait la vie difficile, prenez donc, attrapez, tenez, serrez, faites ce qui vous botte !



