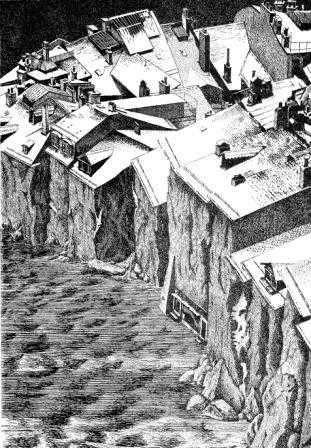On fait le tour du quartier et c’est un monde. De la mansarde d’à côté j’entends les vieux Russes blancs qui s’enguirlandent. Du fond de la rue montent les mélopées entêtantes du café maure. Aux soirs de fin de semaine on est à Rome ou à Barcelone. Cependant, chaque matinée, c’est la province et la Provence qu’on retrouve rue Legendre. Le libraire taciturne a des gestes de mandarin, mais les vrais Chinois du supermarché d’à côté ne s’inclinent même pas : ils ont acquis la même morgue que les Polonais de l’épicerie où je me fournis en Krupnik, la liqueur au miel de feu qui tue de bonheur. Plus loin, à la Butte-aux-Cailles, les basses maisons chaulées m’évoquent le Mexique assoupi. C’est là-bas qu’une fin d’après-midi, place Paul-Verlaine, j’ai commencé de lire Lumière d’août de Faulkner. Ainsi me suis-je retrouvé quelque part entre Alabama et Mississippi, et c’est alors qu’il s’est mis à pleuvoir en plein soleil. Je me trouvais hors du temps, il ne me semblait pas que je pleurais, mais tout pleurait en souriant, tout était trempé, mon livre et mes vêtements, tout était comme lavé et purifié.
-
-
Devos l’émerveillé
Cet hommage a paru dans le quotidien 24Heures du 16 juin.

Hommage à l'ami public No1
La gloire céleste vient de happer Raymond Devos pour sa dernière envolée. Tous ceux qui l’ont applaudi se rappellent la considérable et légère baudruche qu’il mimait, filant dans les nébuleuses, à la fois clown singeant les vanités humaines et bonhomme à cœur d’ange s’exerçant à la chute ascensionnelle, léger et mouvant comme une grosse bulle qu’une piqûre d’humour ramenait sur notre vieille Terre en imaginant, plus grinçant à sa douce façon, que la télévision avait enregistré son dernier soupir…
On avait beau l’avoir vu et revu, dans un récital qui ne variait que par fines bribes d’une année à l’autre sans se répéter pour autant : Raymond Devos ragaillardissait chaque fois son ami public avec la même truculence, le même souffle de mammouth au cœur d’enfant, la même verve de jongleur du langage jouant avec les mots pour en éclairer les facettes et s’en étonner, ou nous confronter à l’étrangeté, à l’absurde, à la cocasserie surréaliste de tant d’expressions toutes faites, au fil de trouvailles à n’en plus finir qui faisaient de son feu d’artifice une féerie. « Si ma femme doit être veuve, j’aimerais mieux que ce soit de mon vivant », lançait-il ainsi. Ou bien : « Qui prête à rire n’est jamais sûr d’être remboursé »…
Il y avait du clown de Fellini chez Devos, qui mettait une salle dans sa poche avec des clins d’yeux gros comme ça mais sans démagogie ni vulgarité. Avec trois fois rien, il créait une atmosphère, et c’était un monde. Un vibraphone, des bulles irisées, un trombone à surprises, un violon minuscule sortant de sa mère majuscule, un raton-laveur surgi de l’inventaire de Prévert et la magie agissait, qui relevait d’une poésie rare aujourd’hui chez les humoristes. Des plus médiatiques de ceux-ci, il se distinguait en n’abordant jamais deux thèmes de leur fond de commerce : la politique et le sexe. D’aucuns, à ce propos, trouvaient Devos trop gentil, par opposition au percutant Bedos. Or Raymond Devos n’était pas gentil : il était bon. Et de quel parti est donc la bonté ? La question paraissait incongrue dans le cas de Devos, qui n’avait rien pour autant de sucré ou de flatteur. Optimiste, il n’en accusait pas moins, dans les grosses valises qu’il avait sous les yeux, des traces de larmes versées sur le monde comme il va ou plutôt ne va pas. Mais ce pachyderme était un délicat, qui s’avançait sur un fil, avec un sens de l’équilibre qui signalait également un immense métier. De fait, son art de la suggestion était l’aboutissement d’une longue pratique où, à côté du travail sur le texte, le mime, la chanson, la manipulation d’instruments ou d’accessoires les plus variés contribuaient à l’aspect « polyphonique » de ses spectacles
Il est important alors de rappeler que Raymond Devos, touilleur rabelaisien de la langue française, était Belge d’origine et, à ce titre, marqué par le surréalisme ambiant du plat pays de Brel. « J’aime à être pris en flagrant délire », déclarait-il comme aurait pu le faire un Michaux, génie belge d’une autre dimension mais qui partageait sa légèreté de Plume…
-
Les années Rimbaud
J’aime ces vieilles pierres grises friables.
Maintenant c’est en étranger que j’y passe.
Les autres croient que j’ai changé, depuis le temps.
Sur l’escalier de bois du quartier bohème,
je me suis arrêté ce blême matin d’hiver,
tant d’années après.
C’est ici qu’à dix-huit ans je me croyais Verlaine.
Je fumais de l’Amsterdamer sec à la gorge.
Je me droguais au café serré.
J’étais si malheureux, si tendre, si salaud.
Je croyais que jamais tout ça ne finirait:
le coeur à vif, les mots fous, les années Rimbaud.
Maintenant que je sais, je me tais en songeant,
et la pluie, et la vie, et la nuit, et l’oubli. -
Au plus que présent
A La Désirade, ce mercredi 14 juin. – Cinquante-neuf ans aujourd’hui, et qu’est-ce à dire : le masque et la déprime ? Tout le contraire : frais et léger comme l’aube de ce jour de juin aux doigts de rose. Trente-neuf fois plus présent et clairvoyant qu’à vingt ans, vingt-neuf fois moins égaré dans mon esseulement qu’à trente ans, dix-neuf fois plus décidé et délié qu’à quarante ans, neuf fois plus obstiné et détaché qu’à cinquante ans, et chaque jour plus reconnaissant d’avoir passé par tous ces âges et ces avatars, chaque jour mieux fait à l’idée que tout passe…
Reconnaissance alors à cela simplement qui est ce matin: le sourire d’L. qui me dit qu’elle m’aime, la pensée de nos deux enfants là-bas dans leur vies, le pensée de nos vivants aimés et de nos chers défuntés. A peine un souffle sur l’eau bleue. Et quoi de plus ?
Tant à vivre au jour le jour. Tant à recevoir et à donner. Tant à lire et à écrire encore. Ce matin sur ma table : ce livre reçu hier de l’occulte ami Bona, et qui me parle aussitôt « à hauteur d’enfance ». Ou cet autre message de la noire cavalière, elle aussi rencontrée sur la toile, qui me recommande, à propos d’un certain Ange déglingué, de lire tel livre de Jean-Yves Leloup qu’il lui a fait découvrir, et que j’ai moi-même déjà lu et relu : Désert, déserts... Ou cette lettre de mon cher Bernard, en écho aux pages de mon roman en chantier, dont l’intelligence du cœur s’est retrempée au tréfonds de la souffrance et qui dispense tant de bonne lumière.
Tant d’intersections de vraie vie féconde. Ma bonne amie que je surprends à l’instant plongée dans Matière et mémoire de Bergson, alors que tous les jours je retrouve moi-même la matière et la mémoire de la Recherche du temps perdu. Et ma chère L. de me dire que ces rencontres la délivrent du poids des engluements de la vie en ville et de tant de menées de médiocres bureaucrates ne détestant rien tant que ce qui bouge et respire - les éternels morts-vivants se perdant dans le simulacre de travail.
Quand l’éternel présent est à ressusciter, et que là réside le vrai travail où coïncident savoir et saveur, science et poésie, écoute et don de soi - de là renaissant la joie simplement d’être là, vivant et présent… -
Le dernier adieu
 L’auteur masqué (22)
L’auteur masqué (22)
De quel auteur est cette prose? Celle ou celui qui le découvrira recevra un livre et un numéro gratuit du journal littéraire Le Passe-Muraille.Non pas cette neige d’une nuit sous le pâle soleil rose, ou le regard au lacs de mille signes déchiffre avec ennui les feintes, les chasses, les famines de tant de bêtes glacées ! Qu’ai-je à faire de ces traces trop pareilles à celles des hommes ? Elles s’en vont toutes vers la tanière et vers le sang.
La neige a d’autres signes. Son épaule la plus pure, des oiseaux parfois la blessent d’un seul battement de plume. Je tremble devant ce sceau d’un autre monde. Ecoute-moi. Ma solitude est parfaite et pure comme la neige. Blesse-la des mêmes blessures. Un battement de cœur, une ombre, et ce regard fermé se rouvrira peut-être sur ton ailleurs (…)
Mais tu sais bien qu’il n’y a pas de repos.
Est-ce que tu te souviens encore ? Les pauses miséricordieuses parfois qui venaient rompre cette obsession de l’éternité, les musiques, les visages et soudain, sur le sable même de la rive absolue, le dernier adieu du temps… La lumière change comme une voix. Elle n’est plus le témoin sans force d’une agonie. Elle redevient soleil, ce long rayon vivant qui s’agenouille au bord des draps dans un fauve reploiement d’ailes. Tu soulèves une main. Tu lui tends l’inquiète main des mères qu’elles glissent à la nuque de leurs petits garçons hors d’haleine. Il la pose au creux de ses paumes chaleureuses, dore et détend les doigts qu’il r amène à leur repos. Tes mains dorment dans l’ombre. Là-bas la première abeille de l’année frôle une vitre et fuit. Une abeille, un rayon, quel adieu plus léger ?
Mais déjà ton oreille est close et sur ces lèvres scellées, l’absence dessine le lent sourire sans réponse qui ne s’effacera plus. -
La rage du fils de personne

Avec Le fils du lendemain, paru sous pseudonyme, Jean-Bernard Vuillème donne le plus personnel ; existentiellement, le plus engagé et, littérairement, le plus accompli de ses livres.
« Je me suis façonné dans le malaise et le mystère de ma naissance, dans le sentiment d’aversion que m’inspire ma mère et d’étrangeté très tôt éprouvé pour son ex-mari mon père », écrit Bernard Jean au début de ce récit lancé « à tombeau ouvert », puisque la destination du narrateur, fonçant sur la route, est le cimetière où repose son vrai père dont il a finalement découvert l’identité, obstinément camouflée par sa mère. Egalement occultée dans un premier temps, la véritable identité de l’auteur, écrivain romand au talent reconnu, ne pouvait à vrai dire le rester, son dévoilement faisant en quelque sorte partie du jeu de l’exorcisme et de la révélation dans ce qui est sans doute le meilleur livre de Jean-Bernard Vuillème.
- Quelle a été la genèse de ce livre ?
- Je n’y ai pensé que lorsque que mon intuition a été confirmée dans les pipettes des analyses de sang alors que j’avais déjà plus de 45 ans. Dès ce moment, il m’a semblé que l’écrivain devait tenter de dire ce qu’il y a d’indicible dans une histoire de ce genre.
- Son élaboration vous a-t-elle posé des problèmes particuliers ?
- La part autobiographique, évidemment importante, devait se limiter au thème de ce fils doutant dans sa chair de son origine biologique et bannir tout développement anecdotique. J’ai rencontré des problèmes de distanciation, beaucoup élagué, réécrit, restructuré. L’enjeu était avant tout littéraire, dans le « comment dire » et non dans le « que dire ».
- Quelle place Le fils du lendemain tient-il dans l’ensemble de vos livres ?
- Une place importante il me semble, parce que je crois que ma rage d’écrire, de devenir quelqu’un par l’écriture, trouve son origine dans cette histoire. J’ai voulu qu’il soit une sorte de synthèse entre l’intime et la fiction.
- Pourquoi recourir à un pseudonyme, dont vous pouviez vous douter qu’il serait éventé ?
- Avec un peu de recul, je m’aperçois que c’est ingérable ! L’idée, c’était de protéger celui que j’appelle mon père des propos de café du Commerce, surtout dans la ville où il habite, et non de me cacher. Ensuite, ce pseudonyme fait partie du récit, il était pour ainsi dire naturel de le signer ainsi. Faire de son double prénom choisi par les parents son nom d’auteur en inversant les termes, signer autrement sans rien renier de ce qui vous constitue…
- Ce livre vous a-t-il libéré?
- Disons que je suis au clair quant à l’étranger que je sentais parfois s’agiter clandestinement dans ma chair et dans mon sang, sur la puissance des délires de ma mère et celle de ma propre intuition à débusquer le mensonge. Comment dire ? Je me sens aussi reconnaissant en tant qu’écrivain… Ecrire Le Fils du lendemain, c’était une épreuve, à la fois périlleuse et jouissive, dans une brèche de l’être, près du souffle, et il me semble que j’ai assez bien franchi ce cap…
Comme une seconde naissance
Si la pilule du lendemain est censée « effacer » les traces indésirables de l’écart d’un soir, celui que Bernard Jean appelle « le fils du lendemain » pourrait être dit le fruit doublement illégitime d’un semblable repentir, puisque son père biologique, amant d’une femme mariée, a convaincu celle-ci de « couvrir » leur probable embryon par le truchement d’une seconde relation arrachée in extremis au mari avec lequel elle n’avait plus de rapports intimes depuis belle lurette.
L’enfant Bernard Jean eût aimé, comme chacun, vivre en harmonie avec papa, maman et son grand frère Otto. Or non seulement il aura enduré, dès son plus jeune âge, les effets collatéraux de la guerre opposant ses parents, mais bientôt lui viendront l’intuition qu’« une phrase aussi rassurante que papa fume la pipe » ne fut qu’un leurre, et le soupçon d’abord confus, puis le doute lancinant et la découverte finale du secret de famille défendu par la mère avec une « sainte » véhémence dans le mensonge, longtemps encore après la mort du « vrai père ».
Mais qui fut précisément le vrai père, du géniteur biologique lâchement disparu ou de celui qui l’a pour ainsi dire adopté ? En quoi cet Auguste Daniel Nebel (notez les initiales…) sur la tombe duquel le narrateur se rend en se repassant, non sans fureur légitime, le film de ses tribulations de mal-aimé, mérite-t-il le nom de père ? La question se pose évidemment, mais c’est bel et bien de ce nébuleux faux-jeton qu’il se sent le fils malgré la véritable amitié qu’il a développé avec son père Trellert (notez le palindrome…) contre lequel sa mère, jouant à tout coup les victimes et sombrant finalement dans la démence, n’aura cessé de le monter…
Quête de la filiation, déniée et comme renouée par le jeu de l’aveu et de la fiction, ce livre de douleur et de rage compulsive s’élève, par delà le « récit de vie », au rang de la meilleure littérature, tant par son écriture cinglante et trépidante que par l’humour déjanté de l’auteur, notamment dans la seconde partie, avec la rencontre d’un illuminé raélien en veine de clonage - clown parmi d’autres sur cette Terre « où la vie peut être drôle, un moment »…
Bernard Jean. Le fils du lendemain. Editions Zoé, 118p.
Ces articles ont paru dans l'édition de 24Heures du 13 juin 2006.