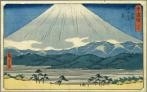Villa Amalia, paradis précaire
L’intercity à deux étages glissait du sud au nord à travers un décor de petits jardins assoupis et de roseaux et de canaux – c’était la région de Bienne où Robert Walser a tant flâné -, tandis que la protagoniste de Villa Amalia, passant par Bienne elle aussi, s’en allait maintenant vers les Grisons et l’Engadine, le lac de Côme et, plein sud, jusqu’à Naples et l’île d’Ischia…
Lorsque j’ai changé de train à Olten, cette ville industrielle dont on ne voit de la gare que des entrepôts et des câbles, Eliane Hidelstein, alias Ann Hidden, avait déjà avoué à son ami homo Georges, à qui elle avait fait croire d’abord qu’elle partait pour le Maroc et le désert , que non : qu’elle se trouvait à l’instant à Ischia où il lui semblait tout reconnaître et être reconnue de tous. Après quoi, mon train suivant se dirigeant vers l’Engadine, Ann remontait en Bretagne chez sa mère impossible et retrouvait, pour tout en liquider, sa maison de Paris et l’homme qu’elle avait largué pour sa trahison et « tout le reste », qui lui chialerait dans le gilet en ne parlant que de lui et lui proposerait de lui payer un psy pour l’«’aider »…
Or Anne Hidden, qui deviendra l’Anna de la villa Amalia, longue maison jaune au toit bleu qui surplombe la mer et dont elle fera son paradis de quelque temps, n’a pas besoin d’être aidée mais seulement de se retrouver, elle, que son père a abandonnée petite tout en lui léguant la passion de la musique, entretenue chez elle jusqu’au génie.
C’est donc l’histoire d’une rupture radicale (Ann Hidden tirant prétexte de l’infidélité du médiocre Thomas pour tout bazarder de leur vie passée) que raconte Pascal Quignard dans Villa Amalia, roman très elliptique, à fines touches hypersensibles, qui se déroule un peu comme un film mental tout en donnant, aux lieux nommés et aux moments les plus denses, un relief d’une saisissante présence. Le lecteur brûle ainsi de découvrir à son tour les bords de l’Yonne à Teilly ou tel petit port de l’île d’Ischia, sans parler de la terrasse de la villa Amalia.
Il en va finalement de la possibilité d’une île de liberté créatrice et de plus justes relations entre les gens, de reconnaissance mutuelle et de passion partagée pour cela simplement qui est ou pour la musique plus précisément dans le vertige de laquelle se perdre et se retrouver. Cela s’effiloche un peu sur la fin, mais on dirait alors que l’auteur, s’en tenant à une possibilité de roman, en laisse la conclusion à chacun. Ainsi ce beau livre module-t-il une sorte de rêverie esthétique, ponctuée de vues profondes sur la vie ou la musique, parfois cédant à certaine préciosité ou certaine solennité sentencieuse, mais laissant une trace délicate, en fort contraste avec les platitudes et la vulgarité au goût du jour.
Le paradis de Villa Amalia reste évidemment précaire, sans relever pour autant de la chimère trop dérisoire : une cacahuète avalée de travers suffit à en ruiner l’harmonie apparente en coûtant la vie à une enfant qui semblait à vrai dire vouée à un destin bref, mais la musique rejaillit comme Anna rebondit au gré de ce qui pulse et danse en elle, comme pulse et danse l’écriture de l’auteur…
Citations notées sur les tablettes du train :
« L’air de Paris sentait son odeur si particulière, putréfiée, charcutière, mazoutée, épouvantable ».
« C’était une femme entièrement à sa faim, à son chant, à sa marche, à sa passion, à sa nage, à son destin ».
« Il y a une extrême tendresse répugnante, excessive, malodorante, osseuse, chez les vieilles gens».
« Ceux qui ne sont pas dignes de nous ne nous sont pas fidèles ».
« Le chagrin est plus ancien et presque plus pur en nous que la beauté »
« C’était une petite enfant dont le visage était la nostalgie même ».
« Les œuvres inventent l’auteur qu’il leur faut et construisent la biographie qui convient ».
« Cela sentait la pluie, la laine mouillée, la craie, la poussière, l’encre fade, la transpiration très aigre des jeunes garçons ».
« En vieillissant je suis devenue butineuse ».
Pascal Quignard. Villa Amalia. Gallimard, 297p.
 L’Auteur démasqué (2)
L’Auteur démasqué (2)