
30 ans après avoir bouté le feu au chalet du magnat de la presse Axel Springer, ainsi qu’il le révèle aujourd'hui, Daniel de Roulet présente son récit Un dimanche à la montagne comme une illustration de sa naïve jeunesse.
Daniel de Roulet a-t-il réellement incendié le chalet d’Axel Springer, magnat de la presse allemande, en janvier 1975 ? Le récit, d’ailleurs filé de main de maître, qu’il tire aujourd’hui de cet attentat relève-t-il de la confession effective ou n’est-ce pas une pure affabulation de romancier ? Le lecteur d’Un dimanche à la montagne ne manquera pas de se poser la question, accentuée par l’effet d’annonce du livre, fort bien orchestré par l’écrivain. Celui-ci n’a pourtant guère le profil du frimeur médiatique, même s’il ne lui déplaît pas de défrayer la chronique, de loin en loin, en prenant par exemple la défense de tel écolo dynamiteur ou en égratignant l’image d’un Le Corbusier pro-Vichy.
Reste que l’histoire « vraie » qu’il raconte dans son dernier livre paraît si incroyable, dans le genre Bob et Bobette font du terrorisme, si invraisemblable cette petite expédition de deux tourtereaux « politiquement conscients » qui se prélassent toute une nuit dans les draps du Palace de Gstaad avant de monter, à peaux de phoques, jusqu’au nid d’aigle (allusion obligée à Hitler…) où se dresse la résidence forcément « arrogante » d’Axel Springer, dans laquelle le jeune homme pénètre et dispose ses deux bougies incendiaires tandis que sa Dulcinée fait le guet, que le doute persiste alors même que le livre paraît le meilleur « roman » de l’auteur. Celui-ci, au demeurant, ne nous tiendra pas trop rigueur de l’aborder comme un éventuel affabulateur de première…
- Quelle preuve tangible, Daniel de Roulet, pouvez-vous nous donner de la véracité de votre récit ?
- La meilleure preuve, c’est que je n’en ai aucune. Pas un objet. Pas un livre que j’aurais pu piquer au passage dans la bibliothèque de Springer, dont je ne me souviens d’ailleurs que très vaguement des détails de la maison. Vous pensez bien que les médias allemands m’ont drillé à ce propos : mais je n’ai rien trouvé pour les satisfaire. Et pas une trace écrite non plus. Vraiment croyez-moi : rien…
- Pas même l’un ou l’autre des « chers communiqués » aux signatures fantaisistes que vous avez envoyés après votre coup aux rédactions ?
- Non, parce qu’il importait évidemment d’effacer toute trace. Mais si vous creusez bien de ce côté, peut-être trouverez-vous une piste… Cela étant, si vous doutez de ma parole, ce que je conçois tout à fait, une autre preuve de ma bonne foi tient à cela que je n’ai pas cherché à faire monter les enchères en m’adressant à un éditeur spécialisé en coups médiatiques. Je suis resté fidèle à Buchet-Chastel, qui ne fait pas dans la sensation, et je ne puis enfin vous dire que ça : que je dis la vérité.
- Persuadé, à 30 ans, que Springer était un nazi polluant nos Alpes, vous vous posiez en héros aux yeux de votre petite amie. Mais quoi d’héroïque dans le fait d’incendier un chalet complètement isolé ?
- Ce qui me semblait héroïque, c’était de ne pas être attrapé… Or ce que j’ai tenu à montrer, c’est en effet l’immense naïveté dont beaucoup de gens de notre génération on fait preuve. On a tendance, trop souvent, à parer cette période d’une légende glorieuse, alors que nous étions souvent dupes de préjugés ou de mensonges, par sectarisme et par aveuglement. J’ai cru moi-même sincèrement, jusqu’en 2003, qu’Axel Springer avait été un nazi…
- Quelle est, pour conclure, la finalité de votre livre ?
- Comme je le raconte : c’est aussi une histoire d’amour et de jeunesse. Retrouvant la femme que j’aimais alors et qui m’a suivi jusque-là-haut, tous deux sexagénaires, elle cancéreuse en phase terminale, je lui ai promis ce témoignage qui est aussi une façon de répondre à Gerhard Schröder, mon contemporain exact que j’ai entendu dire, en août 2003 au Tessin, cette phrase terrible: « Je passe mes journées à combattre ce pour quoi je luttais dans ma jeunesse »…
Daniel de Roulet. Un dimanche à la montagne. Buchet-Chastel, 158p.

Le goût des « révélations »
De Jacques Chessex à Yves Laplace ou Alexandre Jardin, les « confessions» gratinées se multiplient. Mais à quel prix ?
Il y a quelques années paraissait, sous la signature de Jacques Chessex, un petit récit annoncé avec fracas, intitulé L’économie du ciel et dans lequel l’écrivain affabulait « autour » d’un meurtre commis par le père du narrateur, double évident de celui de l’auteur. Un jeu très équivoque avec les médias, impliquant tel « secret de famille », ne manqua pas de produire certaine sensation, dopant aussi bien les ventes.
Or la même tendance aux « révélations » familiales marquait le dernier livre d’Alexandre Jardin, Le roman des Jardin, lancé avec le même effet d’annonce tapageur, où les frasques sexuelles de la fameuse tribu, en sa villa veveysane, devenaient l’appât de toutes les curiosités. Dans une optique non moins « gratinée », Yves Laplace s’est posé en épigone de Michel Houellebecq avec deux romans récents (L’original et Butin) dont l’un des protagonistes est un viveur proxénète et pédophile, l’auteur-narrateur jouant lui aussi sur des « révélations » plus ou moins affriolantes.
Le désir de paraître, exacerbé par les temps qui courent, est le penchant le mieux partagé chez les écrivains et les artistes, autant que celui d’être aimé : prétendre le contraire serait faire de l’angélisme. Mais à quel prix ? Telle est la question.
Le paradoxe, en ce qui concerne Un dimanche à la montagne de Daniel de Roulet tient alors à ce que sa qualité propre ne doit à peu près rien à ses « révélations », mais plutôt à ce qu’il dévoile plus subtilement. Dès lors, que l’auteur affabule ou qu’il ait bel et bien vécu ce qu’il raconte n’a pas la moindre importance. Se non è vero…
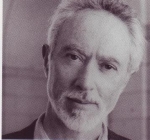
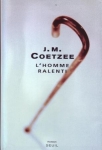



 Festen est le grand film de la transgression d’un secret de famille, qui débouche à la fois sur la purification et la fraternité. J’ai rarement été aussi poigné par une situation exposée au cinéma, et la façon de la présenter m’a conforté dans ma propre détermination de tout dire. C’est simplement l’histoire du gosse qui dit tout haut ce que les autres savent mais préfèrent ignorer. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’un gosse mais du fils aîné de la famille, qui choisit le speech qu’on lui demande de prononcer à l’occasion du banquet d’anniversaire des soixante ans de son père pour évoquer, d’un ton égal, comment ledit père les violait, lui et sa soeur, laquelle s’est suicidée pour échapper à la hantise de ce souvenir. Il y a là comme un modèle de ce qu’il faut faire aujourd’hui, non du tout un modèle moral ou sociologique, mais bel et bien artistique; car c’est l’art qui m’intéresse là-dedans au premier chef, c’est à cause de l’art, de la forme, de la beauté de tout ça, de l’émotion, de l’énergie, de l’intensité qui se dégage de tout ça que j’ai été bouleversé, par delà la situation humaine.
Festen est le grand film de la transgression d’un secret de famille, qui débouche à la fois sur la purification et la fraternité. J’ai rarement été aussi poigné par une situation exposée au cinéma, et la façon de la présenter m’a conforté dans ma propre détermination de tout dire. C’est simplement l’histoire du gosse qui dit tout haut ce que les autres savent mais préfèrent ignorer. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’un gosse mais du fils aîné de la famille, qui choisit le speech qu’on lui demande de prononcer à l’occasion du banquet d’anniversaire des soixante ans de son père pour évoquer, d’un ton égal, comment ledit père les violait, lui et sa soeur, laquelle s’est suicidée pour échapper à la hantise de ce souvenir. Il y a là comme un modèle de ce qu’il faut faire aujourd’hui, non du tout un modèle moral ou sociologique, mais bel et bien artistique; car c’est l’art qui m’intéresse là-dedans au premier chef, c’est à cause de l’art, de la forme, de la beauté de tout ça, de l’émotion, de l’énergie, de l’intensité qui se dégage de tout ça que j’ai été bouleversé, par delà la situation humaine. Pépites de mémoire
Pépites de mémoire
