Le Meilleur film suisse 2006

Soleure, ce jeudi 19 janvier. – C’est une belle petite ville que Soleure où il fait bon, dans les vieux bistrots de bois ciré fleurant l’Europe cultivée autant que la bohème artiste et le populo à cigares, discuter des derniers films de la cinématographie helvétique qu’on y projette à journée faite une semaine durant.
La Suisse est ce pays d’extrême-Europe, au fonds populaire, et même sauvage, à peu près méconnu par les temps qui courent, réduite qu’elle se trouve aux clichés du banquier à face blême, ou pire: du fonctionnaire vétilleux, ou pire encore : de l’intellectuel responsable convaincu que l’art et le commerce sont incompatibles. Ce fut le débat tournant à vide lancé par les médias à ces 41es Journées de Soleure, constituant les Etats généraux annuels du cinéma suisse, mais il a suffi de quatre chenapans fuguant à travers les monts de Heidi et les vaux de Guillaume Tell, dans la foulée de Bakounine et de Max und Moritz, sur un ton picaresque oscillant entre Mark Twain et Harry Potter, pour déplacer la discussion sur le terrain d’un cinéma renouant, contre toute attente, avec l’esprit du conte.
My Name ist Eugen, du jeune réalisateur Michael Steiner, entièrement parlé en dialecte alémanique, est devenu un film « culte » en quelques mois, drainant plus d’un demi million de spectateurs suisses allemands, et voici que les pros l'ont élu Meilleur film de fiction de l'année. Ce n’est sûrement pas un chef-d’œuvre du 7e art mais c’est une merveille de fraîcheur, d’humour et de fantaisie, mêlant tous les joyeux poncifs du kitsch helvétique dans un tourbillon d’images et de musiques complètement déjanté, dont l'arrière-goût de nostalgie m’a rappelé Radio Days de Woody Allen, mais avec une frénésie juvénile étourdissante.
Je me fiche bien, pour ma part, de ce qu’on a appelé l’helvétisme, à propos d’une idéologie qui a fait date, mais j’ai toujours pensé que les clichés contenaient une part de vérité et pouvaient être revivifiés, et c’est toute une Suisse profonde de nos enfances que j’ai retrouvée dans ce film à la fois lyrique et gouailleur, tendre et anarchisant - nos enfances de plusieurs siècles, jusqu’à ces bandes d’escholiers pieds nus qui sillonnaient l’Europe de la Renaissance en quête de maîtres de latin ou d’hébreu, qui filent aujourd’hui en skateboard et s’envoient par SMS les mêmes serments de fidélité à la vie à la mort…



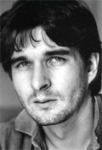 que rien d’intéressant ne s’écrit dans ce pays, un reproche plus fondé a souvent été fait, à la littérature romande, de manquer d’attention au monde extérieur et de se cantonner dans un certain nombrilisme spiritualisant, dans la double tradition de l’individualisme protestant et du romantisme panthéiste hérité de Rousseau. Ce qu’on appelait naguère l’« âme romande», les yeux au ciel, a cependant du plomb dans l’aile, tant l’éclatement des frontières et la transformation des mentalités et des mœurs ont marqué le climat social et moral dans lequel nous baignons, et les preuves de rupture ne cessent de se multiplier, comme l’illustrent les deux derniers livres d’Yves Laplace et Frédéric Pajak, tous deux d’ailleurs assez décentrés par rapport à la culture romande, encore que…
que rien d’intéressant ne s’écrit dans ce pays, un reproche plus fondé a souvent été fait, à la littérature romande, de manquer d’attention au monde extérieur et de se cantonner dans un certain nombrilisme spiritualisant, dans la double tradition de l’individualisme protestant et du romantisme panthéiste hérité de Rousseau. Ce qu’on appelait naguère l’« âme romande», les yeux au ciel, a cependant du plomb dans l’aile, tant l’éclatement des frontières et la transformation des mentalités et des mœurs ont marqué le climat social et moral dans lequel nous baignons, et les preuves de rupture ne cessent de se multiplier, comme l’illustrent les deux derniers livres d’Yves Laplace et Frédéric Pajak, tous deux d’ailleurs assez décentrés par rapport à la culture romande, encore que…
