A propos des Papiers de Jeffrey Aspern de Henry James

Maître, en ses dernières étapes, d’un théâtre du questionnement de l’être sous les voiles du paraître, de la parole dans ses balbutiements, d’une vérité à chaque fois atomisée en vérités, lecteur du monde autant qu’il est écrivain lui-même, artisan de la scène autant qu’artiste, professeur aussi («on n’enseigne jamais que que ce qu’on cherche», relèvera-t-il à ce propos), et nous pourions enfin dire honnête homme à l’irradiante conversation, Jacques Lassalle a créé à Lausanne la mise en théâtre des Papiers d’Aspern, nouvelle tendrement cruelle de l'inépuisable Henry James que, depuis longtemps, soit par le cinéma soit à la scène, il rêvait d’aborder.
«L’oeuvre de James est de celles qui m’ont le plus intéressé, au même titre que l’univers de Tchekhov, et d’abord parce qu’elle est essentiellement fondée sur l’ambivalence. Quant aux circonstances qui m’amènent enfin à monter l’adaptation théâtrale de cette nouvelle si caractéristique de l’art jamesien, elles sont liées initialement à la rencontre, à Londres, de Jean Pavans, traducteur de James et connaisseur sans pareil de l’oeuvre. Jean Pavans est ce type de l’homme-livre se consacrant intégralement à un auteur, dont la ferveur m’enchante. De James, outre ses traductions, Pavans a adapté trois nouvelles pour le théâtre: Le retour à Florence, Daisy Miller et Les papiers de Jeffrey Aspern. Or, après une longue conversation avec lui, il m’est apparu que je devais monter Les papiers de Jeffrey Aspern."
L’action de la nouvelle de James se passe à Venise, dans un palais décati où vivent, pauvres et retirées du monde, une Américaine nonagénaire et sa nièce. On sait que la première fut la maîtresse du grand poète Jeffrey Aspern (figure qu’on peut imaginer un condensé de Byron et Shelley), dont elle posséderait encore une précieuse correspondance. C’est pour mettre la main sur celle-ci que débarque un jeune homme que passionne l’oeuvre d’Aspern, et qui va ruser en sorte d’amadouer la vieillarde par le truchement de la moins âgée, laquelle s’éprend secrètement de lui. Mais que se passe-t-il en réalité sous nos yeux ? Telle est bien l’énigme que Jacques Lassalle a choisi de démêler.
«Il y a là un concentré de thèmes jamesiens qui n’ont rien perdu de leur intérêt à l’heure que nous vivons. C’est par exemple la fascination de l’Amérique pour la vieille Europe, et la confrontation des âges et des sexes, sur fond de lent engloutissement dans cette Venise fin de siècle. Le thème de la passion littéraire est également modulé, avec tout ce qu’il suppose de passions, de procédures et de vanités. L’étrange relation qui s’établit entre les trois personnages repose sur un malentendu et de constantes incertitudes qui me passionnent. Où est le vrai ? Il est tant de vrais possibles. James nous met dans la situation qui est la sienne même, de l’écrivain dont la vie est papier, et papier vivant, papier chargé d’amour mais papier négociable aussi, papier qui vous fait brûler et que vous pourriez brûler de la même façon. L’oeuvre de James est une enquête interminable sur nous-mêmes. Plus nous y puisons et plus nous nous nous interrogeons sur notre présence au monde. Et c’est cela, comme chez Tchekhov ou chez Molière, qui ne cesse de m’interroger aussi bien. Je crois aimer par-dessus tout l’ambivaence de nos vies. Et le secret. Sous les déterminations les plus simples en apparence, il me plaît de sonder l’énigme...»
Dans l’appartement parisien de Jacques Lassalle, qu’on pourrait dire rêveusement bourgeois, et donc un peu jamesien, la substance condensée de la conversation nous a transportés comme hors du temps, mais déjà nous imaginons la représentation à venir...
«Une oeuvre est toujours une énigme. Nous commençons par travailler autour de la table, et c’est l’espace du savoir. Ensuite, ce qui se joue dans la pénombre de la répétition relève de l’inconnu. Toute lecture, vous le savez, est une nouvelle naissance. La mise en scène est partout et nulle part, mais à la fin je la voudrais invisible. La représentation vient nous questionner doucement sur notre secret. Cependant nous avons besoin des autres. Et ce qui me touche peut-être le plus, alors, est ce petit silence, après le dernier mot et avant le premier applaudissement, qui dit si le partage s’est accompli.»

-
-
Puisse le polar rester paria

Georges Simenon se plaignait naguère de ce que la critique et le public français le considérassent (pour parler comme San Antonio) strictement comme un auteur de romans policiers, alors que le reste du monde voyait en lui un écrivain à part entière.
Or s’il est vrai que la France, patrie historique de la Littérature avec une grand aile (c’est elle qui le dit), aime à séparer ce qui est « noble » des genres dits mineurs (polar, science fiction, littérature popu en un mot), il n’est pas moins évident que le rompol a ses règles spécifiques qui en font, qu’on le veuille ou non, et sans mépris, un genre particulier. Simenon reconnaissait, le premier, que la série de Maigret obéissait à certains schémas dont il éprouva, à un moment donné, le besoin de se libérer. Cela ne signifie pas que ses Maigret soient tous schématiques, mais le fait est que le meilleur de Simenon échappe aux normes du polar. Lettre à mon juge ou Le bourgmestre de Furnes, La neige était sale, Les inconnus dans la maison, Feux rouges, Les gens d’en face ou L’homme qui regardait passer les trains, pour ne citer que ceux-là, ressortissent bel et bien à la meilleure littérature, comme il en va de Crime et châtiment de Dostoïevski, si proche de certains romans noirs contemporains…


La confusion s’accentue pourtant aujourd’hui, où le terme de polar englobe des auteurs et des formes extrêmement variés à tous points de vue, et de niveaux qualitatifs oscillant entre le pire (Gérard de Villiers pour aller vite dans le ton vulgaire et démago) et le meilleur (Chester Himes, Patricia Highsmith ou James Ellroy pour citer les plus connus), avec ce dénominateur pourtant commun de l’omniprésence du Mal et de la Mort.
De la belle énigme sophistiquée classique (Double assassinat dans la rue Morgue d’Edgar Allan Poe ou Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux) aux embrouilles glauques du Ripley de Patricia Highsmith, en passant par les enquêtes socio-politiques de Michael Connelly (L’envol des anges, etc.), les incursions dans le monde des Indien pueblos de Tony Hillerman ou les nouveaux auteurs français de Manchette à Fred Vargas, les atmosphères et les thématiques du « polar » sont aujourd’hui aussi diverses, à vrai dire, que celles des romans ordinaires.
Comme l’illustre le récent et substantiel dossier consacré à la vogue du polar par Le Nouvel Observateur, le genre en question ne fait plus aujourd’hui figure de paria, n’était-ce que parce que certains de ses auteurs (mais pas souvent les meilleurs) « cartonnent » dans les listes de best-sellers et relancent la vogue, plus diluée encore du point de vue de la qualité, des séries télévisées standardisées et bien pensantes du style Julie Lescaut ou Navarro.
Mais le polar gagne-t-il à se voir acclimaté et promu au rang de « noble » littérature. L’évolution d’un Daniel Pennac laisse songeur, et les élégants pastiches d’un Jean Echenoz ne font guère illusion quand on les compare aux descentes aux enfers des auteurs sondant les ténèbres du cœur humain, tels Patricia Highsmith (qu’un Graham Greene qualifiait de « poète de l’angoisse ») ou Robin Cook dans le terrifiant J’étais Dora Suarez, ce roman noir qui vous fait ressentir quasi physiquement le sort de la victime et de son bourreau dément.
Du catholique Chesterton au visionnaire Dürrenmatt, les plus grands écrivains ont passé par les rues sombres du polar, pour en tirer parfois des vérités humaines éclairantes et de vraies pages de littérature. Autant dire que le polar en soi n’est qu'une appellation fourre-tout, alors même le Mal et la Mort échapperont toujours aux classifications et autres tendances…
Cette chronique a paru dans l'édition de 24Heures du 28 juillet 2005
Post scriptum: on découvrira bientôt, dans l'étincelant Dictionnaire égoïste de la littérature française, à paraître chez Grasset sous la signature de Charles Dantzig, des pages très pertinentes sur les rapport de San Antonio avec la langue française en particulier et la littérature en général.
-
Poésie du tout-venant
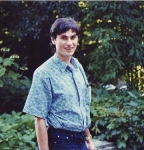
Les Arrêts déplacés de Marius Daniel Popescu
Dans l'amical préambule à ce nouveau recueil de Marius Daniel Popescu, René-Luc Thévoz prétend que la démarche du Roumain établi à Lausanne " n'est pas de la littérature ", ce qu' on admettra à la rigueur dans la mesure où cette écriture est toute de simplicité apparente, mais risque de confiner l'auteur, conducteur de bus atypique et auteur unique du journal Le persil, dans les marges du pittoresque.
Plus judicieux, le préfacier précise ensuite que " l'objectif poétique de Marius Popescu consiste à faire entendre, à faire voir ". Et d'ajouter qu' " on part à la découverte sensorielle des objets qui nous passent sous la main, sans discrimination, et de là, on s' envole vers des univers plus intérieurs ".
De fait, c'est à partir des " événements " les plus anodins en apparence, que le poète compose ce collage de sensations et d'émotions dont le premier mérite est de rendre aux mots leur densité première, comme par le truchement d'un rituel.
Telles des " cellules " poétiques, une suite de petits grains (d'un à onze) cristallisent des instants simultanés, du plus simple (" toutes / les femmes / sont / belles ") à de plus complexes intersections, comme pour faire percevoir tout ce qui se trame à la même seconde, ici et partout. De la chose vue à l'émotion, il suffit parfois d'un lien de mémoire comme celui qui associe, " événement rare dans ces contrées ", ce chien noir et sans laisse errant en ville et l' " un des passages de ta grand-mère parmi une foule d'hommes qui buvaient des bières debout "…
Arrivé en Suisse en 1990, Marius Daniel Popescu pratique notre langue avec une étonnante maîtrise, alternance de limpidité et de baroquisme inventif, en usant (et parfois en abusant) de procédés formels ou typographiques rappelant les expériences lettristes. Pourtant le noyau vif de cette poésie doit moins aux " trucs " qu' à la perception fraîche (" quand / la pluie sursaute autour de toi / comme une gitane ") et à l'accueil de " cela simplement qui est ", selon l'expression d'un Cingria, restituant la présence des proches (les enfants, la compagne ou les amis), de telle vieille dame assise à la gare de Lyon, de tel moribond étendu sous un drap blanc au pied d'un immeuble, de toutes ces vies qui se croisent (" de plus en plus de gens qui parlent seuls "), et l'on oscille du minimal haïku aux plus amples coulées de La sept ou du Tueur de livres, dans une atmosphère d'intimité collective, si l'on ose dire, rappelant un peu la poésie d'un Raymond Carver (Travail manuel ou Big-bang en sont de bons exemples) ou les icônes profanes d'un Charles Bukowski.
Parfois insuffisamment transposée, la matière poétique de ces Arrêts déplacés n'en est pas moins habitée et frémissante, fraternelle en son regard et généreusement accessible à tout un chacun, comme l'était celle d'un Prévert. D'ailleurs " les paroles dorment sous les gouttes d'eau comme des moineaux ", écrit Marius Daniel Popescu, dont les pépites du verbe étincellent dans le tout-venant des jours.
Marius Daniel Popescu. Arrêts déplacés. Antipode, 87p. -
Fugues nippones

Premier matin à Tokyo
Il y a ces jours dans l’air de Tokyo une espèce de tiédeur anachronique d’été indien. Pourtant c’est le moindre des étonnements de quiconque y débarque pour la première fois. Parce que c’est un monde éberluant que celui de Tokyo, dont les images toutes faites qu’on en peut avoir valdinguent aussitôt qu’on y plonge.
Aux idéogrammes près, on se croirait d’abord aux States. Les buildings, les parkings enterrés ou empilés et les nouveaux quartiers à shopping : tout y est. Sauf qu’il y a ici des congrès de grillons et de drôles d’oiseaux moqueurs dans les arbres, et toutes sortes d’arbres aux feuilles en forme de cœurs ou de petits éventails ; et de ravissants enfants et des collégiennes en uniformes de matelotes mille fois plus mutines que nulle part ailleurs ; et des balayeurs à gants blancs qui ramassent les mégots et les menus détritus avec des soins de préparateurs en pharmacie. Or, en dépit du sentiment d’écrasement qu’on éprouve aussitôt devant son hétéroclite immensité, Tokyo ne laisse aussi de nous immerger dans un fleuve humain bonnement revigorant.
Le premier matin, ainsi, aux très petites heures, c’est dans les halles ruisselantes et sonores du marché au poisson de Tsukiji que j’ai commencé de flairer ce Tokyo-là. Dans une atmosphère fleurant d’abord les œufs pourris et tournant ensuite à l’air salé du grand large, on découvre là tout un peuple de matinaux aux gueules shakespeariennes maniant coutelas et crocs à longs manches, s’activant entre les rangées fumantes de vapeur de glace de thons et d’espadons la tête ouverte ou les entrailles sondées à la loupiote.
Mais le choc de ces lieux tient surtout à la criée se modulant en litanies gutturales lancées tout à coup des petits tréteaux dressés de loin en loin dans ce dédale grouillant, qui évoquent tout un monde de luttes élémentaires et de rudes échanges, d’ancestrales angoisses filtrées et modulées en incantations lancinantes.
Les extrêmes semblent à tout moment s’opposer au pays de l’arc et de la massue. Ainsi du silence bruissant de feuilles de papier de soie des mille bouquineries du quartier de Kanda, puis des vociférations gutturales des extrémistes à mégaphones debout sur leurs blindés noirs, en plein centre d’affaires de Ginza...