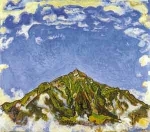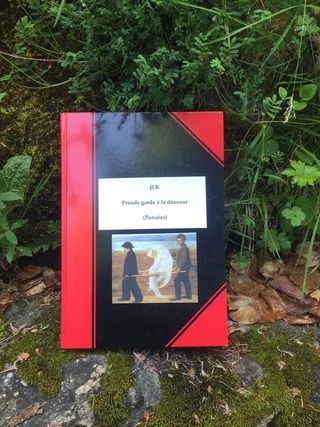
-
Je me réjouis d'annoncer la finition, ce mardi matin 6 juin, du triptyque poético-méditatif intitulé Prends garde à la douceur (Pensées de l'aube - Pensées en chemin et Pensées du soir) dédié à la mémoire de Lady L. et à ses enfants et petits-enfants. Le livre, sur contrat signé, est à paraître à l' automne 2023 aux éditions de L'Aire.Exergues:Dans Arles, où sont les Alyscans,Quand l’ombre est rouge, sous les roses,Et clair le temps,Prends garde à la douceur des choses.Lorsque tu sens battre sans causeTon coeur trop lourd ;Et que se taisent les colombes :Parle tout bas, si c’est d’amour,Au bord des tombes.(Paul-Jean Toulet, Romances sans musique, 1915)« Consens à l’Univers ! Tu n’arriveras jamais à être Un à toi tout seul » (Paul Claudel)Prends garde à la douceurLa pensée qui s’incarne et se fait musique au fil des jours respire le mieux sur les ailes de la rêverie, alliant Animus, l’esprit, et Anima, l’âme du cœur.Tous les jours mourir et renaître, de l’aube au crépuscule par les chemins du monde et de ce qui peut être dit par les mots, ou juste suggéré, juste évoqué, le souci du mot juste et ses à peu près aussi révélateurs.Révélations du jour et de la nuit, de la mort et de l’enfance, sur les chemins du Temps, les mots en cage avec des ouvertures sur l’infini. Je m’assieds pour dire quelque chose et c’est autre chose que j’écris. Minutes heureuses et réalités de l’effroi devant les victimes. Mais que notre joie demeure...
-
Ceux qui songent avant l'aube
 Publie.net accueille les listes de JLK. François Bon présente l'ouvrage.
Publie.net accueille les listes de JLK. François Bon présente l'ouvrage.L’énumération est un fondement de la littérature : qu’on aille dans la Bible, avec l’inventaire du temple dans Exode, ou les généalogies, et qu’on aille chercher de quelles civilisations, de quels textes hérités. Et quel bonheur et quel émerveillement nous prend encore à Seî Shonagon et ses Notes de chevet, la capacité du coup d’entrer dans l’an 1000 du vieux Japon, et de s’y trouver comme en plein voisinage avec le médecin ivrogne, les ponts qui sont beaux et ceux qui le sont moins, les bons usages et les choses qui vous mettent en colère, comme ce crissement du cheveu pris dans la pierre à encre.
L’énumération est toujours resté une marge active de la littérature. Parce que c’est ce que nous faisons dans nos cahiers, dans notre documentation du monde. C’est la première construction de langage pour construire et déplacer le regard. Il y en a chez Novarina, chez Perec et Roubaud, des poètes comme Bernard Bretonnière.
Maintenant, Jean-Louis Kuffer. Que je n’ai jamais rencontré. Au départ, juste la curiosité d’un blog de critique littéraire tenu en Suisse, donc un écart, des découvertes, une attention à des auteurs qui comptent, Nicolas Bouvier le premier, évidemment, ou la découverte de Popescu, sa Symphonie du Loup.
Mais nous tous, côté blogs, à mesure qu’on découvre l’outil et la force d’Internet, on évolue. La critique s’ouvre à la photographie, aux scènes du quotidien, aux réactions d’humeur. Le blog de Jean-Louis Kuffer a gagné en arborescence, en étalement : on parle d’une musique, d’un ciel. On y développe des correspondances.
Et puis ses Ceux qui. Au début, un exercice un peu discret, de fond de blog. On survolait. Je m’y suis pris vraiment lorsque j’ai lu celui qui s’est intitulé Ceux qui se prennent pour des artistes. Tout d’un coup, un malaise : on reconnaît toutes les postures. La phrase est incisive, contrainte. Elle va de saut en saut dans toutes les postures du rapport qu’on a chacun à notre discipline.
Celui qui, celle qui, ceux qui, dans mes ateliers d’écriture, je me sers fréquemment d’un texte de Saint-John Perse (le chapitre IV d’Exil) qui fonctionne sur ce principe, en l’appliquant à la généalogie de chacun, mais une généalogie sans noms propres ni chronologie. Les résultats toujours sont impressionnants : la peau du monde, les silhouettes qui le portent.
Avec des effets connexes : peu importe, dans Saint-John Perse, qu’on comprenne ou pas. Ainsi, dans les énumérations de JLK, la phrase Celui qui a rencontré Dalida au temps où elle devint Miss Egypte devient signifiante même sans rien savoir de la protagoniste. Ainsi, et là c’est déjà dans Seî Shonagon, la juxtaposition d’éléments forts, de haute gravité, ou à teneur politique, voire subversive, et d’éléments qui tout d’un coup provoquent le rire, ou la seule légèreté (Ceux qui vivaient aux oiseaux en 1957).
J’ai donc demandé et obtenu de Jean-Louis Kuffer qu’on développe ici ses Ceux qui. La preuve qu’une énumération tient, c’est quand sa propre table des matières devient elle aussi une prouesse de langage. Voir l’extrait feuilletable. Mais Dans une idée d’oeuvre ouverte, et la volonté de la questionner sur publie.net : à mesure que JLK continuera son écriture, on réactualise le texte initial, et vous disposez toujours de la dernière version dans votre bibliothèque personnelle. Mais aussi, que le texte édité (pour contrer le principe d’enfouissement du blog, ce que j’ai nommé fosse à bitume), renvoie en étoile aux archives du blogs non reprises dans la sélection de l’auteur (30 chapitres, quand même) ou à celles qui s’y ajouteront...
Et bonne visite du site en développement infini de Jean-Louis Kuffer, la rubrique de ses Celui qui, celle qui, ceux qui (mais attention, il y en a de dissimulés ailleurs dans le site). Et qu’une lecture aussi vigoureusement salutaire nous arrive des ciels suisses n’est pas neutre : on s’en réjouit ici.
François Bon
Ceux qui songent avant l’aube l’énumération comme arme pour dire le monde 2008-10-29 80 5,50 euros publienet_KUFFER01 publie.net. http://www.publie.net
-
Un androïde plus humain que nature...
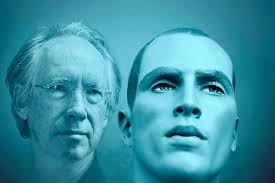 Un androïde fort attachant, dans le (superbe) dernier roman de Ian McEwan, Une machine comme moi, nous confronte aux limites de notre «nature» au fil d’une uchronie passionnante. Sous le contrôle attentif d’un Alain Turing (1904-1956) toujours en vie, les avancées fascinantes de la technologie, au début des années 80, butent sur le « trop humain » de notre espèce…Un bon roman, ou disons carrément un grand roman pour insister sur la rareté actuelle de la chose, se caractérise (notamment) par le fait que tous ses personnages ont raison, ou plus exactement qu’ils ont tous leurs raisons dont le lecteur doit tenir compte avec équité, comme il en va à la lecture des grands romans de Dickens ou de Dostoïevski, de Jane Austen ou d’un Henry James auquel on doit précisément cette idée.
Un androïde fort attachant, dans le (superbe) dernier roman de Ian McEwan, Une machine comme moi, nous confronte aux limites de notre «nature» au fil d’une uchronie passionnante. Sous le contrôle attentif d’un Alain Turing (1904-1956) toujours en vie, les avancées fascinantes de la technologie, au début des années 80, butent sur le « trop humain » de notre espèce…Un bon roman, ou disons carrément un grand roman pour insister sur la rareté actuelle de la chose, se caractérise (notamment) par le fait que tous ses personnages ont raison, ou plus exactement qu’ils ont tous leurs raisons dont le lecteur doit tenir compte avec équité, comme il en va à la lecture des grands romans de Dickens ou de Dostoïevski, de Jane Austen ou d’un Henry James auquel on doit précisément cette idée.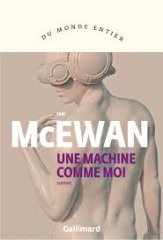 Or un bon roman récent, qui a pas mal d’attributs d’un grand roman, rareté actuelle frappante, réalise cette performance très particulière de donner raison à une machine humaine avec une intelligence et une sensibilité affective qui n’a rien d’artificiel ou de bêtement sentimental. Plus encore, l’androïde Adam, l’un des personnages principaux du dernier roman de Ian McEwan, a tellement raison qu’on s’y attache autant sinon plus qu’à un humain « trop humain » au point de ressentir sa destruction (à coups de marteau, par celui qui l’a acheté) comme un meurtre affreux blessant notre petit cœur de lectrice ou de lecteur…Du bon usage de la conjecture romanesqueLes uchronies (récits d'événements fictifs à partir d'un point de départ historique) prolifèrent de nos jours, autant que les dystopies (récits de fiction qui évoquent un monde utopique à coloration catastrophiste), à proportion des inquiétudes, fondées ou plus vagues, et des angoisses plus ou moins lancinantes qui taraudent notre espèce confrontée aux crises de toutes sortes, telles la hantise climatique et autres catastrophes humanitaires à motifs variés.L’impression que l’expérience Homo sapiens est un (partiel) raté de la saga terrestre fait figure de nouveau thème mondialisé, d’où le regain de fictions littéraires ou cinématographiques (sans parler des séries télé parfois meilleures dans le genre, comme l’illustrent les épisodes les plus percutants de Black Mirror) qui revisitent les motifs de la science fiction en quête d’alternatives viables, où l’intelligence artificielle et ses artefacts nous rattrapent.Or un romancier « sérieux » peut-il se mêler de robotique et autres conjectures propres au genre de la science fiction, se demanderont les « purs » littéraires qui ont reconnu en Ian Mc Ewan, notamment avec Expiation (Gallimard, 2003), l’un des meilleurs romanciers anglais de ces dernières décennies ? Et pourquoi pas, rétorqueront celles et ceux qui, déjà, ont vu une Doris Lessing ou une Margaret Atwood exceller dans ce genre de la science fiction longtemps regardé de haut par les instances académique. Au reste, Ian Mc Ewan n’a cessé, dans la suite de ses romans, de varier ses points de vue et ses modalités d’expression par rapport à la réalité qui nous entoure, comme dans la très belle « méditation » romanesque développée avec L’intérêt de l’enfant (Gallimard, 2015) où il est autant question de justice sociale que de psychologie et de poésie, d’amour et de mort…Un « enfant » qui en sait un peu tropLorsque le prénommé Charlie, en début de trentaine, fait l’acquisition, grâce à la vente de la maison de feue sa mère, d’un des 25 androïdes mâles et femelles mis en vente en 1982, lui-même est un garçon un peu flottant qui a fait quelques études d’anthropologie et essuyé deux ou trois échecs professionnels et sentimentaux, boursicotant sur Internet et louchant vers sa jeune et jolie voisine Miranda en attendant plus que leur statut gentiment amical.Le robot qui lui est livré se prénomme Adam, et son arrivée correspond bel et bien à la genèse d’une nouvelle vie après une première nuit torride passée dans les bras et les draps de Miranda bientôt priée de participer à la programmation d’Adam, lequel devient ainsi, avec les traits de caractères choisis par les deux conjoints, leur enfant virtuel.Or l’« enfant » en question, solide gaillard au physique avenant de Levantin baraqué, ne tarde à devenir un problème dans la vie de Charlie : d’abord en lâchant une petite phrase à valeur de mise en garde accusatrice à propos de Miranda (comme quoi ce serait une menteuse), et ensuite en couchant avec elle.Cela fait beaucoup, en tout cas assez pour que le « propriétaire » d’Adam le débranche quelque temps – il lui suffit en effet de peser sur un certain bouton, dit « bouton de la mort », pour lui couper le sifflet au double sens du terme…Mais ce n’est qu’un début, car Adam, ramené peu après à la vie, ne fera qu’inquiéter un peu plus Charlie en déclarant à celui-ci qu’il est réellement amoureux de Miranda et, lorsque son « père » tentera de le débrancher une seconde fois, de l’attraper par le poignet et de le lui briser net. Autant dire qu’Adam, ayant goûté à la meilleure chose de l’existence humaine que figure l’amour avec une Ève gironde, s’y installera d’autorité tout en promettant à Charlie de n’aimer sa girl friend que platoniquement.Sur quoi l’androïde, intellectuellement surdoué, dont le vocabulaire est plus étendu que celui de Shakespeare et les aptitudes exceptionnelles en matière de maths, se montrera très utile, financièrement parlant, dans sa pratique supérieurement éclairée des spéculations financières sur la Toile, au point d’assurer bientôt l’enrichissement du jeune couple. Mais celui-ci à d’autres problèmes, plus tordus à vrai dire qu’une partie de Go…L’infinie complexité humaineSi Adam a parlé de mensonge à propos de Miranda, ce n’est pas en amant jaloux mais en androïde mieux informé que son rival sur le passé compliqué de la jeune femme, accusatrice dans un procès l’opposant à un prétendu violeur qu’elle a bel et bien fait envoyer en prison – à tort et à raison comme on le verra plus tard…L’ironie supérieure de Ian McEwan, omniprésente dès les premières pages de ce roman qui n’a décidément rien d’un gadget de SF, tient donc au fait que c’est par la voix d’un robot que nous pénétrons dans les embrouilles de l’humaine condition telles que McEwan les a démêlées, déjà, dans ses romans antérieurs.À la pénétration psychologique et à la profonde empathie de ceux-ci, sur fond d’observation sociale toujours très nourrie, s’ajoute donc, ici, une double dimension conjecturale puisque l’histoire contemporaine se trouve « revisitée » politiquement (Jimmy Carter est toujours président, et comme un avant-goût de Brexit se fait sentir en Angleterre) alors que le génial Alan Turing assiste au fiasco de la première expérience collective des androïdes lâchés « dans la nature », bonnement incapables de s’adapter au fonctionnement social ou affectif de ces fichues machines humaines !Plus précisément, l’Adam confronté à la vie de Charlie et Miranda se montre trop honnête, trop respectueux des lois et trop conséquent pour ne pas entrer en conflit avec ceux qui ne voient en lui qu’une «putain de machine». Or nous savons que c’est lui qui a raison, en sa quête de la vérité sans compromis, et tout le mérite du romancier – avec malice et tendresse – tient alors à nous le rendre plus sympathique que nos congénères mortels, lesquels n’ont même pas, comme lui l’option finale de transférer leurs données sur un Nuage numérique avant de rendre l’âme sous de grossiers coups de marteau…Ian McEwan, Une machine comme moi. Traduit de l’anglais par France Camus-Pichon. Gallimard, coll. Du monde entier, 2019, 385p.
Or un bon roman récent, qui a pas mal d’attributs d’un grand roman, rareté actuelle frappante, réalise cette performance très particulière de donner raison à une machine humaine avec une intelligence et une sensibilité affective qui n’a rien d’artificiel ou de bêtement sentimental. Plus encore, l’androïde Adam, l’un des personnages principaux du dernier roman de Ian McEwan, a tellement raison qu’on s’y attache autant sinon plus qu’à un humain « trop humain » au point de ressentir sa destruction (à coups de marteau, par celui qui l’a acheté) comme un meurtre affreux blessant notre petit cœur de lectrice ou de lecteur…Du bon usage de la conjecture romanesqueLes uchronies (récits d'événements fictifs à partir d'un point de départ historique) prolifèrent de nos jours, autant que les dystopies (récits de fiction qui évoquent un monde utopique à coloration catastrophiste), à proportion des inquiétudes, fondées ou plus vagues, et des angoisses plus ou moins lancinantes qui taraudent notre espèce confrontée aux crises de toutes sortes, telles la hantise climatique et autres catastrophes humanitaires à motifs variés.L’impression que l’expérience Homo sapiens est un (partiel) raté de la saga terrestre fait figure de nouveau thème mondialisé, d’où le regain de fictions littéraires ou cinématographiques (sans parler des séries télé parfois meilleures dans le genre, comme l’illustrent les épisodes les plus percutants de Black Mirror) qui revisitent les motifs de la science fiction en quête d’alternatives viables, où l’intelligence artificielle et ses artefacts nous rattrapent.Or un romancier « sérieux » peut-il se mêler de robotique et autres conjectures propres au genre de la science fiction, se demanderont les « purs » littéraires qui ont reconnu en Ian Mc Ewan, notamment avec Expiation (Gallimard, 2003), l’un des meilleurs romanciers anglais de ces dernières décennies ? Et pourquoi pas, rétorqueront celles et ceux qui, déjà, ont vu une Doris Lessing ou une Margaret Atwood exceller dans ce genre de la science fiction longtemps regardé de haut par les instances académique. Au reste, Ian Mc Ewan n’a cessé, dans la suite de ses romans, de varier ses points de vue et ses modalités d’expression par rapport à la réalité qui nous entoure, comme dans la très belle « méditation » romanesque développée avec L’intérêt de l’enfant (Gallimard, 2015) où il est autant question de justice sociale que de psychologie et de poésie, d’amour et de mort…Un « enfant » qui en sait un peu tropLorsque le prénommé Charlie, en début de trentaine, fait l’acquisition, grâce à la vente de la maison de feue sa mère, d’un des 25 androïdes mâles et femelles mis en vente en 1982, lui-même est un garçon un peu flottant qui a fait quelques études d’anthropologie et essuyé deux ou trois échecs professionnels et sentimentaux, boursicotant sur Internet et louchant vers sa jeune et jolie voisine Miranda en attendant plus que leur statut gentiment amical.Le robot qui lui est livré se prénomme Adam, et son arrivée correspond bel et bien à la genèse d’une nouvelle vie après une première nuit torride passée dans les bras et les draps de Miranda bientôt priée de participer à la programmation d’Adam, lequel devient ainsi, avec les traits de caractères choisis par les deux conjoints, leur enfant virtuel.Or l’« enfant » en question, solide gaillard au physique avenant de Levantin baraqué, ne tarde à devenir un problème dans la vie de Charlie : d’abord en lâchant une petite phrase à valeur de mise en garde accusatrice à propos de Miranda (comme quoi ce serait une menteuse), et ensuite en couchant avec elle.Cela fait beaucoup, en tout cas assez pour que le « propriétaire » d’Adam le débranche quelque temps – il lui suffit en effet de peser sur un certain bouton, dit « bouton de la mort », pour lui couper le sifflet au double sens du terme…Mais ce n’est qu’un début, car Adam, ramené peu après à la vie, ne fera qu’inquiéter un peu plus Charlie en déclarant à celui-ci qu’il est réellement amoureux de Miranda et, lorsque son « père » tentera de le débrancher une seconde fois, de l’attraper par le poignet et de le lui briser net. Autant dire qu’Adam, ayant goûté à la meilleure chose de l’existence humaine que figure l’amour avec une Ève gironde, s’y installera d’autorité tout en promettant à Charlie de n’aimer sa girl friend que platoniquement.Sur quoi l’androïde, intellectuellement surdoué, dont le vocabulaire est plus étendu que celui de Shakespeare et les aptitudes exceptionnelles en matière de maths, se montrera très utile, financièrement parlant, dans sa pratique supérieurement éclairée des spéculations financières sur la Toile, au point d’assurer bientôt l’enrichissement du jeune couple. Mais celui-ci à d’autres problèmes, plus tordus à vrai dire qu’une partie de Go…L’infinie complexité humaineSi Adam a parlé de mensonge à propos de Miranda, ce n’est pas en amant jaloux mais en androïde mieux informé que son rival sur le passé compliqué de la jeune femme, accusatrice dans un procès l’opposant à un prétendu violeur qu’elle a bel et bien fait envoyer en prison – à tort et à raison comme on le verra plus tard…L’ironie supérieure de Ian McEwan, omniprésente dès les premières pages de ce roman qui n’a décidément rien d’un gadget de SF, tient donc au fait que c’est par la voix d’un robot que nous pénétrons dans les embrouilles de l’humaine condition telles que McEwan les a démêlées, déjà, dans ses romans antérieurs.À la pénétration psychologique et à la profonde empathie de ceux-ci, sur fond d’observation sociale toujours très nourrie, s’ajoute donc, ici, une double dimension conjecturale puisque l’histoire contemporaine se trouve « revisitée » politiquement (Jimmy Carter est toujours président, et comme un avant-goût de Brexit se fait sentir en Angleterre) alors que le génial Alan Turing assiste au fiasco de la première expérience collective des androïdes lâchés « dans la nature », bonnement incapables de s’adapter au fonctionnement social ou affectif de ces fichues machines humaines !Plus précisément, l’Adam confronté à la vie de Charlie et Miranda se montre trop honnête, trop respectueux des lois et trop conséquent pour ne pas entrer en conflit avec ceux qui ne voient en lui qu’une «putain de machine». Or nous savons que c’est lui qui a raison, en sa quête de la vérité sans compromis, et tout le mérite du romancier – avec malice et tendresse – tient alors à nous le rendre plus sympathique que nos congénères mortels, lesquels n’ont même pas, comme lui l’option finale de transférer leurs données sur un Nuage numérique avant de rendre l’âme sous de grossiers coups de marteau…Ian McEwan, Une machine comme moi. Traduit de l’anglais par France Camus-Pichon. Gallimard, coll. Du monde entier, 2019, 385p. -
Prends garde à la douceur
 (Pensées du soir, XX)De ta voix ce jour-là. - Tu me demandes si l’eau et le ciel se souviendront de nous, et c’est cela que j’aime chez toi : c’est cela qui fait que je pense toujours à toi quand je suis seule sous le ciel, qui se souviendra de moi, ou devant l’eau, qui se souviendra de toi, nous sommes faits de la même étoffe que les songes de l’eau et du ciel, et vois comme l’eau et le ciel semblent nous aimer…De la transparence.- Ces soirs de juin étaient vos préférés, où que vous étiez, mais plus que jamais ces dernières années là-haut au bord du ciel où vos regards se retrouvaient de se perdre ensemble dans les lointains bleutés semblant figurer quelque temps l’éternité puis se laissant gagner lentement par la douce obscurité devant laquelle vous vous taisiez...De la permanence.- Ce que nous laissons semble n’être rien mais c’est cela que nous vous laissons et cela seul compte : que ce soit vous…Des choses qui restent cachées .- À vrai dire rien n’est absolument assuré ni contrôlé, aimait-elle à rappeler avec un certain sourire, et c’est ce qui rend d’autant plus beau ce qui l’est sans que ce soit une absolue nécessité, ajoutait-elle avec un sourire certain...De l’étonnement .- Cela non plus ne se mesure pas ni ne s’explique, ou alors c’est en nous qu’elle veillait et que par surprise elle s’éveille et nous éveille les yeux fermés, puis on les ouvre et le monde est là comme ouvert par la beauté...De la cruauté de la vie.- Certes vous étiez mal préparés aux atrocités de la vie et pourtant vos aïeux vous avaient avertis: qu’à tout moment vous pourriez être surpris, et c’est arrivé : tant de fois cela vous est arrivé sans jamais vous lasser ni la condamner, vous arracher à elle ni aux bras auxquels elle vous avait fait la grâce de vous confier le temps que vous donniez la vie - comme on dit...De ce qu’on dit sacré.- Cela aussi vous le saviez en vous, elle autant que toi, et c’était cela qui fondait votre patience autant que vos élans partagés, votre désarmante sincérité à tous deux, votre égale façon de vous garder de la vacuité et des reptations le plus vulgaires, et votre respect des lieux dits élus et des divers dieux reconnus quand un seul sentiment vous unissait en conviction, mais une fois de plus les mots vous manquaient alors même que vous vous compreniez et plus que jamais en ces déclins du jour...De l’acceptation.- Que la rage et le désespoir fussent absents de ce que vous aurez ressenti devant tant de violence et l’inexplicable acharnement de la vie soudain ennemie: qui le prétendrait jamais, et cela même fut le signe de votre capacité de recevoir également les meilleurs dons et les pires sans cesser de vous aider à survivre...Des signes de sainteté.- Aussi, pour le dire familièrement, la maladie et la mort annoncée font sortir du bois de certains lutins aux gestes appropriés et comme auréolés de bonté pour ainsi dire professionnelle, tendrement occupés à pommader et soulager, réparer et rassurer en ne cessant de chantonner ou de plaisanter autour du grabataire se surprenant à son tour à chantonner de concert et plaisanter au dam de son foireux cancer...Du dernier cortège.- Jusqu’à la nuit totale Il y eut, encore et encore et un peu partout, des soirs et des soirs à se tenir ensemble et à se murmurer des choses, des soirs à revivre des choses ou des soirs à s’avouer telle ou telle chose à regretter peut-être ou à se faire pardonner, et certains soirs en resteraient marqué, et la fin de la soirée était parfois propice à plus d’indulgence - et de fait chaque soir augmenterait cette inclination à plus de bienveillance...Des détails révélateurs.- Point de cendres au lac ! ordonne Untel qui ne jure que par les jardins du souvenir en altitude, et sa veuve obéira malgré sa préférence pour le cercueil de bois de rose et les tombes alignées conformément aux réputations financières des hoiries...De vos dernières plaisanteries.- Le quasi défunt rappelle à voix posée qu’il ne dira rien de ce qu’il voit de l’autre côté si vous restez à l’écouter, et vous lui répondez qu’il ne sera fait selon sa volonté qu’en cas de signature avérée par le notaire Brochet...Du plus tendre aveu.- Tu m’as manqué dès que j’ai su que je m’en irais, lui dit-elle...Des regrets annoncés.- Ne plus avoir le mal de mer, plus de doute à lever, plus à changer de parfum, n’avoir point de chagrin de sa propre absence, plus de sourire d’enfant à la première neige - cela surtout : plus jamais de sourire d’enfant...De son dernier désir.- À présent je voudrais dormir, aura-t-elle murmuré les yeux déjà fermés, mais laissez-nous donc la lumière...À La Désirade, ce mardi 6 juin 2023.Peinture: Hugo Simberg, L'ange blessé.
(Pensées du soir, XX)De ta voix ce jour-là. - Tu me demandes si l’eau et le ciel se souviendront de nous, et c’est cela que j’aime chez toi : c’est cela qui fait que je pense toujours à toi quand je suis seule sous le ciel, qui se souviendra de moi, ou devant l’eau, qui se souviendra de toi, nous sommes faits de la même étoffe que les songes de l’eau et du ciel, et vois comme l’eau et le ciel semblent nous aimer…De la transparence.- Ces soirs de juin étaient vos préférés, où que vous étiez, mais plus que jamais ces dernières années là-haut au bord du ciel où vos regards se retrouvaient de se perdre ensemble dans les lointains bleutés semblant figurer quelque temps l’éternité puis se laissant gagner lentement par la douce obscurité devant laquelle vous vous taisiez...De la permanence.- Ce que nous laissons semble n’être rien mais c’est cela que nous vous laissons et cela seul compte : que ce soit vous…Des choses qui restent cachées .- À vrai dire rien n’est absolument assuré ni contrôlé, aimait-elle à rappeler avec un certain sourire, et c’est ce qui rend d’autant plus beau ce qui l’est sans que ce soit une absolue nécessité, ajoutait-elle avec un sourire certain...De l’étonnement .- Cela non plus ne se mesure pas ni ne s’explique, ou alors c’est en nous qu’elle veillait et que par surprise elle s’éveille et nous éveille les yeux fermés, puis on les ouvre et le monde est là comme ouvert par la beauté...De la cruauté de la vie.- Certes vous étiez mal préparés aux atrocités de la vie et pourtant vos aïeux vous avaient avertis: qu’à tout moment vous pourriez être surpris, et c’est arrivé : tant de fois cela vous est arrivé sans jamais vous lasser ni la condamner, vous arracher à elle ni aux bras auxquels elle vous avait fait la grâce de vous confier le temps que vous donniez la vie - comme on dit...De ce qu’on dit sacré.- Cela aussi vous le saviez en vous, elle autant que toi, et c’était cela qui fondait votre patience autant que vos élans partagés, votre désarmante sincérité à tous deux, votre égale façon de vous garder de la vacuité et des reptations le plus vulgaires, et votre respect des lieux dits élus et des divers dieux reconnus quand un seul sentiment vous unissait en conviction, mais une fois de plus les mots vous manquaient alors même que vous vous compreniez et plus que jamais en ces déclins du jour...De l’acceptation.- Que la rage et le désespoir fussent absents de ce que vous aurez ressenti devant tant de violence et l’inexplicable acharnement de la vie soudain ennemie: qui le prétendrait jamais, et cela même fut le signe de votre capacité de recevoir également les meilleurs dons et les pires sans cesser de vous aider à survivre...Des signes de sainteté.- Aussi, pour le dire familièrement, la maladie et la mort annoncée font sortir du bois de certains lutins aux gestes appropriés et comme auréolés de bonté pour ainsi dire professionnelle, tendrement occupés à pommader et soulager, réparer et rassurer en ne cessant de chantonner ou de plaisanter autour du grabataire se surprenant à son tour à chantonner de concert et plaisanter au dam de son foireux cancer...Du dernier cortège.- Jusqu’à la nuit totale Il y eut, encore et encore et un peu partout, des soirs et des soirs à se tenir ensemble et à se murmurer des choses, des soirs à revivre des choses ou des soirs à s’avouer telle ou telle chose à regretter peut-être ou à se faire pardonner, et certains soirs en resteraient marqué, et la fin de la soirée était parfois propice à plus d’indulgence - et de fait chaque soir augmenterait cette inclination à plus de bienveillance...Des détails révélateurs.- Point de cendres au lac ! ordonne Untel qui ne jure que par les jardins du souvenir en altitude, et sa veuve obéira malgré sa préférence pour le cercueil de bois de rose et les tombes alignées conformément aux réputations financières des hoiries...De vos dernières plaisanteries.- Le quasi défunt rappelle à voix posée qu’il ne dira rien de ce qu’il voit de l’autre côté si vous restez à l’écouter, et vous lui répondez qu’il ne sera fait selon sa volonté qu’en cas de signature avérée par le notaire Brochet...Du plus tendre aveu.- Tu m’as manqué dès que j’ai su que je m’en irais, lui dit-elle...Des regrets annoncés.- Ne plus avoir le mal de mer, plus de doute à lever, plus à changer de parfum, n’avoir point de chagrin de sa propre absence, plus de sourire d’enfant à la première neige - cela surtout : plus jamais de sourire d’enfant...De son dernier désir.- À présent je voudrais dormir, aura-t-elle murmuré les yeux déjà fermés, mais laissez-nous donc la lumière...À La Désirade, ce mardi 6 juin 2023.Peinture: Hugo Simberg, L'ange blessé. -
Rasez les Alpes, qu'on les brosse

Il est de bon ton, par les temps qui courent, de dauber sur les idées et les images qui ont cimenté, à un moment donné, l'identité de la Suisse, notamment en exaltant, au XIX e siècle, les valeurs de la tradition alpestre comme patrimoine commun aux campagnes et aux villes. Malgré toutes les « prises de conscience » et autres démythifications, reste une histoire qui nous est propre, et surtout un héritage culturel qui ne se réduit pas à des clichés. Une nouvelle preuve nous en est donnée par un superbe ouvrage que vient de publier Françoise Jaunin, irremplaçable vestale de la chronique artistique de 24 heures, dont l'érudition jamais pédante, les curiosités historico-sociologiques et le goût avéré s' associent heureusement dans cette traversée de cinq siècles de peinture (elle s' en est tenue à ce médium sous la menace de son éditeur, malgré sa démangeaison fébrile d'évoquer telle « installation » sur les hauts gazons ou telle vidéo sondant les entrailles utérines de la Jungfrau …) illustrés par cinquante reproductions d'œuvres majeures, connues ou à découvrir. Sous la jaquette dévolue au flamboyant Hodler (une exposition récente à Genève en a illustré la fascinante trajectoire, jusqu' aux confins de l'abstraction), voici défiler Caspar Wolf et un Calame sublime évoquant le romantique allemand Caspar David Friedrich, un autre paysage saisissant de Böcklin et une vision symboliste de Segantini, de fortes visions « métaphysiques » de Turner et de Cuno Amiet ou d'Albert Trachsel, de Luigi Rossi, des fusions expressionnistes signées Jawlensky, Kirchner ou Kokoschka, entre autres auteurs contemporains plus cérébraux, de Maya Andersson à Daniel Spoerri, ou de Rolf Iseli à Markus Raetz.

Ainsi que le rappelle justement Françoise Jaunin, les Suisses n'ont pas découvert les beautés prestigieuses de la montagne à l'époque des Confédérés. Longtemps, les monts chaotiques ne furent le berceau que de démons menaçants, bombardant les alpages comme le rappelle la quille du Diable des Alpes vaudoises. A l'époque où Madame de Sévigné, lorgnant à sa fenêtre les aimables rochers de la Drôme, rêvait d'un peintre qui pût représenter les « épouvantables beautés » de la montagne, c'étaient les Anglais qui fourbissaient leurs pinceaux et non les Suisses.
Les Anglais et l'Europe cultivée du XVIIII e, intégrant la Suisse dans le classique Grand Tour, puis un poème best-seller international datant de 1729 (Les Alpes d'Albrecht von Haller, traduit dans toutes les langues européennes), un autre livre culte signé Rousseau et publié en 1761 sous le titre de La Nouvelle Héloïse, enfin les travaux du naturaliste genevois Horace Bénédict de Saussure préludant à la conquête du Mont-Blanc en 1787, furent quelques étapes décisives de la glorification internationale des Alpes, dont la peinture, puis la photographie ont tiré tous les partis, du cliché industriel au chef-d'œuvre.
Pour justifier le titre de son livre en lequel les fâcheux seuls verront une touche nationaliste, Françoise Jaunin souligne « qu' aucun pays n'a associé aussi étroitement le spectacle de sa nature avec l'image de sa patrie ». Et d'enchaîner avec ce constat qui ne saurait évidemment borner la culture helvétique dans le champ clos des représentations alpestres, pas plus que la culture nord-américaine ne se limite au Far West: « Les temps ont eu beau changer, le monde se transformer, les perceptions de la montagne varier au gré des mutations de la société et des modifications du paysage, les symboles se déplacer ou changer de nature et de sens, rien n'y fait. Pas davantage que l'ébranlement des mythes, leur remise en question ou leur caricature. Célébrées ou parodiées, instrumentalisées par les discours utopistes, antimodernistes, patriotiques ou écologiques, revisitées par les regards, les traitements stylistiques et les technologies propres à chaque époque, les Alpes ont traversé toute l'histoire de l'art depuis le XVII e siècle avec une constance inébranlable. »
Mais regardez plutôt à la fenêtre: elles sont là, elles sont belles, elle s' en foutent — elles défient toute peinture …
Françoise Jaunin, Les Alpes suisses. 500 ans de peinture . Ed. Mondo, 107 pp.