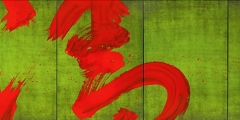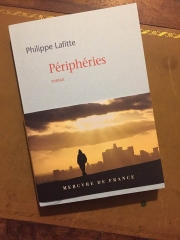Seul contre le Souverain bernois dont il taxe l’occupation d’injustice et d’oppression, Davel reste aujourd’hui une figure sacrificielle quasi christique, en principe irrécupérable, et qui l’est presque forcément, sauf par l’art et la poésie, la beauté,l’émotion et la réflexion en phase avec la recherche historique. L’opéra de Christian Favre , sur un livret de René Zahnd et dans une mise en scène de Gianni Schneider, qui célèbre la destinée tragique du visionnaire, a suscité l’immédiat enthousiasme du public , à la fois par ses qualités musicales propres, sa réalisation scénique magistrale et l’aura du personnage.
Seul. C’est le premier mot que Jean David Abraham Davel, enchaîné, adresse à l’inquisiteur de Wattenwyl venu l’interroger dans son cachot : j’ai agi seul, je suis seul responsable. Et cela, plus que tout, est insupportable au représentant du Souverain impatient d’identifier des complices et toute une sédition cantonale ou peut-être plus générale. Mais rien à faire, et même sous la torture, forçant le respect de celui qui le soumet à la question, le major débarqué à Lausanne le 31 mars 1723 a la tête de six cents hommes armés de fusils sans munitions (!) et ne se doutant pas de la teneur réelle de l’opération, revendique la seule responsabilité de son acte à la fois inspiré et insensé qu’on pourrait dire le contraire d’une agression terroriste puisque lui seul, invoquant bel et bien son Dieu, sera l’unique victime expiatoire.
Avec la candeur d’une âme pure, Davel a pensé que ce qui le révoltait, qui provoquait autour de lui la colère des gens, allait rallier ceux-ci en nombre avec l’aval des autorités de souche vaudoise, lesquelles commencent par le flatter avant de le lâcher. Le major de Crousaz, notable soucieux de son seul intérêt et parfait collabo avant la lettre, sera le Judas de l’affaire en ne cessant de jouer l’homme raisonnable à la façon suavement débonnaire des faux-culs à la vaudoise...
Dans la foulée, quelques mots hautement significatifs de sa morgue aristocratique (et qu’on pourrait évidemment entendre dans la bouche des dirigeants de partout à travers les siècles) expriment son mépris paternaliste du bon peuple : « Les Vaudois ne sont -Ils pas plus heureux soumis ? Peuple de chuchoteurs, de petits comploteurs, d’experts en médisance » déclare De Crousaz après l’arrestation de son compagnon d’armes .
«Ce peuple mérite -t-il la liberté que tu tenais tant à lui offrir ? »
Et le librettiste d’entrouvrir un abîme dans le personnage qui se défend d’être un félon : « Et ne me dis pas traître ! Je sais ma juste place : au service d’un maître. Le pouvoir et la fortune sont de bons médecins pour les plaies qui béent tout au fond de moi »...
Tout cela étant chanté par le superbe ténor Christophe Berry, qui n’en sera pas moins hué au rappel final pour son rôle évidemment très ingrat...
À ses côtés, l’on ne manque ra de saluer, dans la grand et bel équipage local et international réuni par le capitaine de vaisseau Éric Vigier, le puissant et non moins émouvant Davel de Regis Mengus, le non moins excellent De Wattenwyl de François Lis modulant en acteur deux scènes relevant de l’humour noir, et la belle inconnue d’Alexandra Dobros-Rodriguez, notamment - et n’oublions pas les musiciens de l’OCL galvanisé par Daniel Kawka et les choristes grands et petits...
Réhabiliter Davel ? Autant refaire le procès du Christ...
Des voix bien intentionnées, à la veille du tricentenaire de la mort de Davel, se sont fait entendre afin que celui-ci soit réhabilité. Nos bonnes consciences en seraient dorlotées, mais comment ne pas voir que la condamnation du major n’est pas que le fait des autorités de l’époque mais de tout un peuple consentant ?
« Nous avons laissé faire », écrira Ramuz. Et c’est un moment fort de l’opéra que celui de la profération du chœur, aux costumes mêlant les époques et aux chanteuses et chanteurs faisant front sur scène et martelant: "Le poing tranché, la tête coupée !"
Cela dit , taxer de récupération opportuniste ceux qui voudraient réhabiliter Davel relève d’un autre forme de récupération, alors que le sacrifice de Davel participe d'un réalité échappant à toute logique judiciaire ou bonnement humaine. On est ici du coté des fols en Christ qui prennent les injonctions de l'Evangile au pied de la lettre, au dam de toutes les cléricatures.
Davel, au demeurant, est conscient du conflit de fidélités auquel il est confronté, sachant qu’il est lui-même nourri et honoré par l’occupant bernois qui oppresse les siens.
«Où est ta vraie loyauté ? » se demande-t-il avant de conclure en wokiste avant la lettre: « Mais n’est-ce pas le devoir de celui qui voit clair d’ouvrir les yeux de ceux qui dorment ou qui se cachent ? Assez d’hypocrisie, de mauvaises habitudes ! Assez de scandales et d’injustices honteuses ! L’heure du réveil à sonné ! »
Le cher homme a-t-il vraiment tenu ces mots que lui prête le librettiste ? Disons que la substance y est.Et le caractère angélique de la Belle inconnue a-t-il le moindre fondement historique ? Question de pieds-plats, qu’on trouve ailleurs que chez les Vaudois, à propos de la Béatrice de Dante ou des monologues de sainte Jeanne au cinéma...
Ce qui nous ramène à ce thème équivoque de la récupération morale ou politique, propre à toutes les idéologies, de la figure du bouc émissaire.
Davel fut-il un révolutionnaire au sens où nous l’entendons aujourd’hui, englobant Robespierre, Lénine et Che Guevara ? Évidemment pas, même si les termes , extrêmement fermes et sévères de son Manifeste lu par lui seul aux conseillers lausannois, pendant que ses hommes faisaient le pied de grue autour de la cathédrale, relèvent d’un défi bonnement révolutionnaire.
Le hic, c’est que cet officier de haut rang, supposé en connaître un bout en matière de tactique et de stratégie, n’a rien fait pour assurer ses arrières et bénéficier du soutien de quiconque, seul une fois encore à rêver debout tout en montrant un extraordinaire courage.
Or ce même dissident se fait, jusque sur l’échafaud, le défenseur ardent d’un ordre, sinon établi, du moins rétabli, soumis aux valeurs fondamentales; et les historiens nous ont appris depuis lors qu’il n’était pas sans alliés potentiels, jusqu’ à l’avoyer bernois Steiger trouvant, dans le fameux Manifeste, bien des arguments recevables. Pourtant l'essentiel est là, qui le distingue des sans-culotte: malgré la pertinence de son intransigeance, Davel refuse le moindre acte de violence.
Le vert Raphaël Mahaim, dans sa défense d’une réhabilitation, compare sa révolte à celle d’Antigone devant Créon, et Félicien Monnier, président de la Ligue Vaudois, de conclure son plaidoyer contre la réhabilitation en ces termes aussi défendables que ceux de son contradicteur : « Se dégage ainsi une étrange combinaison entre la puissance de l’affirmation politique de Davel et l’immense retenue humaine et personnelle de son geste »...
Je tire ces citations de l’indispensable numéro spécial de la revue historique Passé simple, distribuée à la sortie de l’opéra en renfort du programme déjà bien étoffé, et l’on passe alors de l’interprétation artistique aux lumières croisées éclairant la destinée du Major , incessamment récupéré par les uns et les autres et leur échappant en fin de compte- comme tout récit consacré à la figure du bouc émissaire (un René Girard a tout dit à ce propos) et à ses avatars historiques ou mythiques.
Reste aussi l’échappée vers le haut, de l’interprétation. Reste ici cette très belle œuvre collective en mémoire d’un homme seul...
Christian Favre. Davel. Opéra de Lausanne, jusqu'au dimanche 5 février.