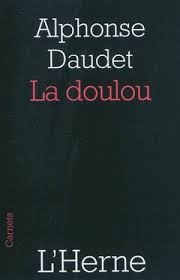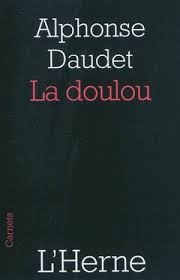
(Pour ceux qui savent ce qu'elle est, et surtout pour les autres))
Je me souviens de ce qu’on m’a dit des cris de douleur de mon frère aîné, renversé par une voiture sur la Route d’En Haut et que j’étais trop petit pour visiter au pavillon de traumatologie avec notre mère « dans tous ses états »…
°°°
Je me souviens, plus encore que de la lecture du Petit Chose et des Lettres de mon moulin, de celle de La Doulou d’un Alphonse Daudet marquée au fer rouge de la torture quotidienne…
°°°
Je me souviens de l’air désolé de notre père, dans les périodes les plus dures de sa maladie, et de son air de s’excuser de « déranger »…
°°°
Je me souviens de la grande salle de l’hôpital cantonal aux vingt-cinq lits de petits lascars dont les plus mal en point étaient les moins bruyants…
°°°
Je me souviens de la douleur muette émanant du visage de cire fondue du petit Toupie, mon camarade de classe leucémique plus habile que moi au jeu du Mikado, auquel j’offris, lors de ma visite que je ne savais pas être la dernière, un Argus bleu ciel pour sa collection de papillons…
°°°
Je me souviens des rugissements de fureur et des hurlements de détresse quasi enfantine de mon vieux voisin de box, aux urgences du CHUV en je ne sais plus quelle année, auquel on venait d’apprendre en pleine nuit qu’on allait l’amputer de sa jambe déjà gagnée par la gangrène, et de son lit vide le lendemain matin.
°°°
Je me souviens, au lendemain de l’accident de moto qui m’amena inconscient au pavillon de traumatologie de l’ancien hôpital cantonal, de la douleur impuissante que j’éprouvai en découvrant l’état de mes jeunes voisins de chambre dont beaucoup ne marcheraient plus jamais – et la vision terrifiante de celui d’entre eux qui passait ses journées à plat ventre dont le dos nu sculpural était celui d’un athlète apprécié de sa société de gymnastique…
°°°
Je me souviens de la lecture de J’ai saigné, évoquant sous la plume de Blaise Cendrars la fin atoce de son jeune voisin de chambre, et du discours imbécile du gradé lui expliquant en passant que son martyre lui était offert par La France…
°°°
Je me souviens de la phase consternante de Ramuz, bien au cocon dans sa chambre de littérateur, au moment même où Cendrars se fait amputer, qui dit comme ça que oui, que c’est terrible, ces jeunes qui meurent de l’autre côté des frontières, mais qu’en somme savoir qu’ils meurent est presque aussi douloureux que mourir soi-même , n’est-ce pas…
°°°
Je me souviens de ce que je ne souvenais de rien quand mes camarades m’ont ramassé au pied des trente premiers mètres de la première longueur de l’arête W de l’Aiguille Purtscheller après un chute opportunément adoucie par la neige…
°°°
Je me souviens de l’effroi paralysant que j’éprouvai après le téléphone d’Hèlène m’apprenant, à mon bureau de chef de la culturelle du Matin, ce 16 août 1985, que mon ami Reynald n’était pas rentré de la course que nous devions faire ensemble au Mont Dolent et qu’il avait finalement décidé de faire seul…
°°°
Je me souviens du long silence et des larmes que nous avons partagés au sommet du Dolent, un mois près la mort de Reynald, avant que nous ne balancions ses cendres dans la face glaciaire par grand beau temps...
°°°
Je me souviens du corps prêt à être lavé de notre père, et de notre mère désignant ses multiples hématomes comme les stigmates d’un long martyre...
°°°
Je me souviens de la remarque de mon ami Dimitri, des mois après le grave accident qui lui valut des souffrances extrêmes, selon laquelle il lui avait fallu cette épreuve pour concevoir les douleurs du Christ sur la croix…
°°°
Je me souviens du regard un peu étonné de notre petite Sophie dans la nuit de son premier faux croup…
°°°
Je me souviens des éclats de rire argentins de la petite Louise à laquelle nous avions offert un Pégase bleu à crinière violette volant crânement au-dessus de son lit de douleurs à quelques semaines de sa mort annoncée…
°°°
Je me souviens que c’est grâce à l’immobiiisation forcée due à mon accident de moto que j’ai écrit mon premier livre en trois mois…
°°°
Je me souviens avec une extrême précision de chaque souffrance morale que j’ai pu infliger à ceux que j’aime, je me souviens aussi de leurs occasionnelles douleurs physiques, sans avoir rien retenu des miennes que le surcroît de lucidité et d’attention reconnaissante que mérite la bonne vie…
°°°
Je me souviens que nous aurons bien ri, certain soir à Cetona, au fin fond de la Toscane, quand Guido Ceronetti m’a lancé de sa voix aiguë et grave la fois : «La vie est vache !» , et que je lui ai répondu selon le code millénaire: «Mais rien ne vaut la vie !»…
Sur La Doulou…
La Doulou d'Alphonse Daudet est l'un des rares ouvrages traitant directement et uniquement de la douleur physique. Le courage consiste à ne pas effrayer les autres.
Du jour où la Douleur est entrée dans ma vie…
A quoi ça sert, les mots ? Ils arrivent quand c’est fini, apaisé. Ils parlent de souvenirs, impuissants ou menteurs...
Douleur toujours nouvelle pour moi et qui se banalise pour eux. Ils s’y habituent, moi pas…
Croissance morale et intellectuelle par la douleur, mais jusqu'à un certain point.
Extraits
Retour de la douche avec X, un malade de la tête, que je réconforte — que je « frictionne » en chemin, pour le plaisir si humain de me faire de la chaleur à moi-même.
… du jour où la Douleur est entrée dans ma vie…
Ce que j’ai souffert hier soir — le talon et les côtes ! La torture… pas de mots pour rendre ça, il faut des cris.
D’abord, à quoi ça sert, les mots, pour tout ce qu’il y a de vraiment senti en douleur (comme en passion) ? Ils arrivent quand c’est fini, apaisé. Ils parlent de souvenir, impuissants ou menteurs.
Pas d’idée générale sur la douleur. Chaque patient fait la sienne, et le mal varie, comme la voix du chanteur, selon l’acoustique de la salle.
Douleur toujours nouvelle pour celui qui souffre et qui se banalise pour l’entourage. Tous s’y habitueront, excepté moi.
Douleur qui se glisse partout, dans ma vision, mes sensations, mon jugement ; c’est une infiltration.
Et j’imaginais une conversation de Jésus avec les deux larrons sur la Douleur.
Dans ma pauvre carcasse creusée, vidée par l’anémie, la douleur retentit comme la voix dans un logis sans meubles ni tentures. Des jours, de longs jours où il n’y a plus rien de vivant en moi que le souffrir.
Ecrit pendant l’une de ces crises.
Croissance morale et intellectuelle par la douleur, mais jusqu'à un certain point.
La lutte, ce qu’il y a de plus affreux. Au moins, le jour où il n’y a plus moyen de bouger…
Mon sosie. L’homme dont le mal se rapproche le plus du vôtre. Comme on l’aime, comme on le fait parler. Moi, j’en ai deux : un peintre italien, un conseiller à la Cour d’appel, qui, à eux deux, sont ma souffrance.
Des enfants malades. Causé avec un petit. Certaine fierté dans ses douleurs. (Fragilité des os).
Mais je souffre, moi aussi, et en ce moment ; mais j’ai pris l’habitude de garder mes souffrances pour moi ; quand la crise est trop forte et que je me laisse aller à une plainte un peu vive, c’est un tel bouleversement autour de moi ! « Qu’est-ce que tu as ? D’où souffres-tu ? » Il faut avouer que c’est toujours la même chose et qu’on serait en droit de nous dire : « Oh ! alors, si ce n’est que ça ! »
Car cette douleur, toujours nouvelle pour nous, notre entourage y est habitué, elle deviendrait vite une fatigue pour tout le monde, même pour ceux qui nous aiment le plus. La pitié s’émousse. Aussi, ne serait-ce par générosité, c’est par fierté que je retiendrais mes plaintes, pour ne jamais lire dans les yeux les plus chers la fatigue ou l’ennui.
 Comme dans Rashomon, du même Kurosawa, c’est « en creux », par les témoignages alternés de ceux qui ont vu le défunt se transformer, durant ses derniers mois, que se reconstruit son portrait tandis qu’on voit le vieil homme, seul sur une balançoire de jardin public, sous la neige, murmurer un chant lancinant et mélancolique d’une lugubre splendeur. À relever l’interprétation, à commencer par celle, formidable, de Takashi Shimura.
Comme dans Rashomon, du même Kurosawa, c’est « en creux », par les témoignages alternés de ceux qui ont vu le défunt se transformer, durant ses derniers mois, que se reconstruit son portrait tandis qu’on voit le vieil homme, seul sur une balançoire de jardin public, sous la neige, murmurer un chant lancinant et mélancolique d’une lugubre splendeur. À relever l’interprétation, à commencer par celle, formidable, de Takashi Shimura.