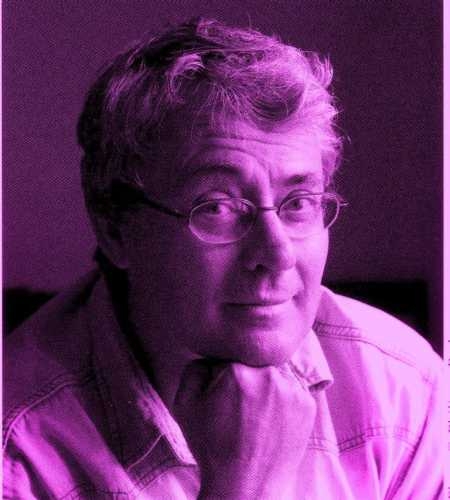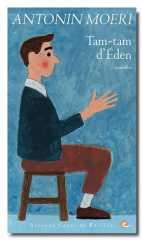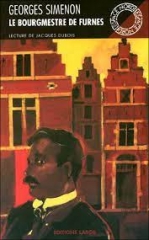Un film satirique déjanté au casting d’enfer (Meryl Streep en présidente des USA et Leonardo Di Caprio en astronome à chemise de coton à carreaux, Jennifer Lawrence en découvreuse de comète et Timothée Chalamet en skater angélique, notamment), intitulé Don’t look up et traitant de l’extinction de l’humanité avec une légèreté parfois un peu lourdingue mais un regard critique non moins acéré sur le monde actuel (politique, économique, médiatique, matérialiste ou transhumaniste), pétille ces jours au-dessus de la brume pandémique ou endémique, signé Netflix (pour la prod) et Adam McKay. À voir avant le Big Boum…
Que diriez-vous si l’Autorité politique (un Alain Berset mondial) et sa Task Force d’experts scientifiques, vous annonçaient, en ces splendides journées de début d’année au ciel apparemment pur de toute pollution et de tout virus flottant, que les jours de notre terre « qui est parfois si jolie », comme disait le poète, sont comptés, ou plus précisément qu’avant trente jours toute vie animale ou végétale aura disparu de sa croûte après la percussion d’un astre fou d’un diamètre de 5 à 10 kilomètres lancé de là-haut vers notre ici-bas ?
La question, qu’on pourrait rapporter à l’annonce, à chaque individu de tous les sexes, de sa mort prochaine, est celle qui plombe les 100 dernières pages assez déchirantes d’anéantir, le dernier roman de Michel Houellebecq, mais les deux points d’interrogation se conjuguent dans la formidable BD cinématographique que représente en somme Don’t look up d’Adam McKay, dont les cinémanes avertis se rappellent sûrement qu’il a déjà raconté « le casse du siècle » avec The Big short, en 2015.
Le «problème» et sa gestion…
Lorsque l’éminent professeur d’astronomie Randall Mindy (alias Di Caprio) se pointe à la Maison-Blanche avec la jeune doctorante Kate Dibiaski (Jennifer Lawrence), la première lanceuse d’alerte, pour annoncer à la présidente Janie Orlean qu’ «on a un problème», selon l’expression en vogue dans les séries, et plus précisément qu’une comète se dirige droit sur la planète terre pour en bousiller les habitants, Meryl Streep, du haut de ses talons aiguilles, ne s’exclame pas « Oh my God ? », mais répond par une question : « Et qu’est-ce que ça va me coûter ? ». Il faut dire que le mi-mandat approche et que se prendre une comète dans les sondages n’est pas franchement une bonne nouvelle.
Du moins le ton de l’affrontement entre Science et Politique est-il immédiatement donné, l’incrédulité de la présidente tenant aussi à la tenue vestimentaire flottante du Dr Mindy et à l’impétuosité alarmiste de la jeune Kate, et ce malgré la présence d’un général en uniforme et d’un représentant de la NASA.
Pratiquement éconduit, le tandem scientifique décide d’alerter les médias (le boyfriend de Kate est journaliste) et se trouve «calé» dans le programme du soir de Feu sur l’info, émission d’impact national dont il partage la vedette avec une chanteuse hyper sexy qui vient de rompre avec son rappeur mais assure un max dans la promo de son nouveau tube virtuel.
Quant à la terrible nouvelle annoncée par le beau Randall (qui tape tout de suite dans l’œil de la présentatrice blonde sur le retour d’âge) et une Kate réellement angoissée pour le genre humain : on la trouve originale quoique peu cool, vu qu'« ici on aime édulcorer les mauvaises nouvelles», et ladite Kate d’exploser, perdant toute crédibilité et se faisant ensuite flinguer par les réseaux sociaux déchaînés, au point d’être larguée par son boyfriend...
Rebondissement cependant à la Maison-Blanche, où l’on a réfléchi, pensé que l’Amérique pouvait sauver la planète, et décidé qu’un Héros lancé dans une navette spatiale escorté d’une flotte de fusées tueuses de comètes pourrait redorer le blason de la nation, alors que, parallèlement, un certain Peter Isherwell (l’irrésistible Mark Rylance), prépare sa propre intervention à l’enseigne de son programme BASH de ponte mondial du numérique à visées transhumanistes, qui envisage de faire exploser l’astéroïde et d’en récolter, avec ses drones capteurs, les inestimables richesses de ses roches truffées de silicium et autres composants dont bénéficieront vos i-Phones de générations à venir – tout cela trop grossièrement résumé, s’agissant d’un film qui vaut surtout par la profusion de ses trouvailles comique, gorillages et parodies, clins d’yeux à n’en plus finir que le public américain saisira plius entièrement que nous autres - mais chaque abonné à Netflix n’est-il pas "in" à sa façon, qui a déjà vu la percutante série anglaise Black Mirror ?

Au pied du mur, du tragi-comique à la tendresse
Lorsque le poète algérien Kateb Yacine, impatient de s’exprimer à propos de la tragédie vécue par son pays, s’en alla prendre conseil auprès de Bertolt Brecht, celui-ci lui répondit : écrivez une comédie ! Or bien plus qu’un paradoxe plus ou moins cynique, l’injonction du dramaturge allemand contenait un fond de sagesse dont l’humour des peuples, et particulièrement des peuples opprimés, témoigne depuis la nuit des temps et partout.
C’est ainsi que, devant la pire situation imaginable, à savoir sa destruction collective imminente, ou la mort prochaine d’un individu particulier, notre espèce a pris, parfois, le parti d’en rire.
Dans le cas de Dont’look up, le rire est évidemment «jaune», car tout de la situation, décrite à gros traits caricaturaux autant qu’à fines pointes faisant mouche, renvoie à une réalité que nous connaissons, catastrophique à bien des égards. Notre rire ne va donc pas sans malaise, et celui-ci est porteur de sens et vecteur de lucidité.
Le sous-titre du film, «déni cosmique», se rapporte à de multiples situations actuelles, de la crise climatique à la pandémie, entre autres moments de l’histoire où nous n’aurons pas «voulu savoir». Entre les métaphores de la « danse sur le volcan » et de « la croisière s’amuse », la saga du déni devrait inciter au désabusement, mais en rire est peut-être plus sain…
Ce qui est sûr en tout cas, si l’on s’efforce de prendre au sérieux le propos du film d’Adam McKay, et par exemple en focalisant son attention sur le personnage de la jeune Kate – qui incarne au plus haut point l’esprit de conséquence et l’honnêteté devant les faits établis – c’est que le rire déclenché par ce film n’a rien de gratuit.
Et sil y a à rire, ne vous rassurez-pas : ce n’est pas qu’aux States: une heure avec l’immonde Cyril Hanouna et c’est notre monde aussi, le « déni cosmique » implique toutes les récupérations, la lutte contre le terrorisme devenant terreur d’Etat, tout le monde il est Charlie et si tu me dis que le ciel menace j’en fais un hashtag ou son contraire : mateleciel ou don't lookup.
Le film a l’air de cogner genre karaté, mais regardez mieux : c’est du judo qui utilise le poids de l’autre pour lui faire toucher terre en douceur. Et suivez le regard de Kate: il est d’abord colère, folle rage face au déni de la Présidente, à l’imbécilité dilatoire des médias et à l’hystérie de masse des réseaux, puis elle « fait avec » comme au judo, et merde pour vous tant qu’à faire et les yeux au ciel avec le joli Yule: on s’envoie en l’air, après quoi ce sera, frères et sœur , une des scènes finales (il y en a une autre plus tard, délectable, où les transhumains goîtent aux délices ( !) d’une exoplanète édenique) que baigne une lumière adorablement douce où l’on se fait un dernier repas entre amis avec la bénédiction du Très haut invoqué par Timothée Chalamet – et ne croyez pas que c’est un blasphème !
Pas plus que n’est obscène, à la fin d’anéantir de Michel Houellebecq, le dernier recours du couple principal à la baise d’amour, quand Paul, atteint d’une tumeur affreuse, exténué par les rayons et les chimios, bénit Prudence de le sucer et de le branler en prenant elle-même un pied géant dans un grand fondu enchaîné de tendresse - oui la comète et le cancer nous pendent au nez mais il nous reste, bordel, cette tendresse aux résonances (quasi) infinies...
Adam McKay, Don’t look up, à voir sur Netflix.
Michel Houellebecq, anéantir, Flammarion, 2002.