
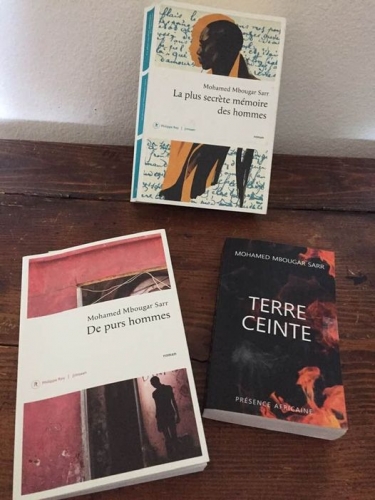
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

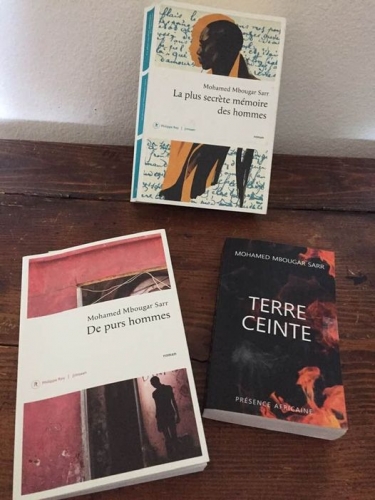



Pour tout dire (96)
De la cuistrerie obscure en matière poétique, et du rire qu’elle nous valut, tel jour au Yorkshire avec le sémillant Bona Mangangu, à la lecture d’un inénarrable recueil de Philippe Beck, chastement intitulé Dans de la nature…
Nous aurons bien ri, cette année-là à Sheffield, avec mon ami Bona Mangagngu, compère de blog depuis des années et enfin rencontré en 3D, par les cafés et les quartiers et les musées et les jardins de Sheffield, autant qu'avec sa douce moitié.
Or un soir, pour stimuler pneumatiquement notre rire, nous aurons trouvé l'irremplaçable objet transitionnel d'un recueil de poësie poëtique trouvé par Bona pour 2 livres chez un bouquiniste, intitulé Dans de la nature et signé Philippe Beck, identifié sous le surnom de « l'impersonnage » par la critique de poësie poëtique en France française.
Dès les premiers vers que nous aurons lu de ce parangon de jobardise en sa 69e séquence, nous aurons immédiatement été mis en joie avant d’y trouver le leitmotiv de notre hilare complicité.
Et ces premiers vers les voici:
« À la question du coquillage,
je dois répliquer Non ».
Et pour ne point les laisser flotter comme ça, même s'ils restent emblématiques dans l'absolu du Projet du poète poëtique, les vers suivants doivent être cités dans la foulée « pour la route »:
« Les bergers musiqueurs
qui peuplent la future Bucolie
(Bucolie dans les branches du haut qu'assemble la tête) sont des ballons dans la Pièce
Colorée Pure, pas plus.
Le « Jardin Suspendu Spirituel ».
Car Pièce fleurit
le bouquet des essais
piquants et décriveurs
pour évoquer Muse (Effort
=Muse)
au milieu des animateurs ».
Or donc, ces « animateurs » nous auront mis en joie, mon compère Bona et moi. Dès la révélation de ces premiers vers de la 69e séquence de Dans de la nature (Flammarion, 2003) nous n'aurons eu de cesse de découvrir ceux de la 68e ainsi lancés:
« Dignes paquets d'expression
et universalité plaintive
ont de la peine à faire Lac.
Des groupistes se creusent,
comme les « Viens » inarrêtables,
Bruit entre feuilles, oiseaux,
pailles générales, poutres
exigent force d'être là
encyclopédiquement »., etc.
Déjà notre rire était propre à soulever, cela va sans dire, la réprobation des amateurs avérés de la poësie poëtique de Philipe Beck, « impersonnage » fort en vue dans les allées académiques et médiatiques, jusques aux cimes de l'officialité de la culture culturelle (il préside la sous-section poëtique du CNL, faut-il préciser), autant dire : un ponte, voire un pontife, et comment en rire ?
Cependant, aussi philistins l'un que l'autre, mon compère Bona et moi n'en finissions pas de revenir au seul Texte, comme Rabelais jadis et comme Léautaud naguère, en déchiffrant pareil galimatias, tel celui de la 7e séquence de De dedans la nature:
« Sa bouche est dans le paysage.
Il est rupture idyllique. Intolérée, et si aimable si l'oeil se lève,
redresseur. C'est Monsieur Transitif ».
J'entends encore le rire de crécelle de Paul Léautaud quand, dans ses entretiens mythiques avec Robert Mallet, il taille des croupières à Valéry ou à Mallarmé à propos de certaines tournures ampoulées ou obscures de leurs vers, dont la musicalité et le jeu des images n'ont évidemment rien à voir avec les vers aphones de notre « impersonnage ».
La poésie, surtout contemporaine, depuis les Symbolistes et Lautréamont, Rimbaud et les Surréalistes, regorge d'obscurités, et Baudelaire n'échappe pas aux images que le bon sens peut trouver absconses, comme l'a bien montré Marcel Aymé dans cet essai joyeusement impertinent qu'est Le confort intellectuel.
Or le vieux bon sens populaire ou terrien, relancé par le verve naturelle de Bono le Congolais, a cela de précieux et de tonifiant qu'il parie en somme pour la poésie la plus simple et la plus limpide, lisible par tous, dont l’eau claire nous désaltère depuis La Fontaine, etc.
Philippe Beck, Dans de la nature. Flammarion, 2003.