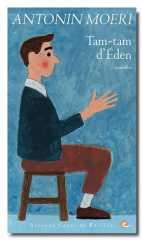Le sens du comique
À propos de Tam-tam d'Eden d'Antonin Moeri, exemple assez rare de nos jours d'un regard et d'une patte sensibles à l'irrésistible drôlerie du monde perclus de drames qui nous entoure...
Antonin Moeri poursuit, depuis une vingtaine d’année, une œuvre narrative alternant récits, romans et nouvelles, dont la singularité et la constante évolution la placent au premier rang des auteurs romands actuels.
Entré en lice en 1989 avec Le fils à maman, roman relevant partiellement de l’autofiction et marqué par la double influence de Robert Walser et de Thomas Bernhard, auteurs très prisés par le jeune comédien germaniste, Moeri a donné ensuite plusieurs récits de la même veine qu’on pourrait dire d’exorcisme autobographique, tels L’île intérieure (1990), Les yeux safran (1991) et Cahier marine (1995), modulant une observation psychologique et sociale de plus en plus variée et toujours acérée, comme dans les nouvelles d’ Allegro amoroso (1993), de Paradise now (2000) et du Sourire de Mickey (2003).
Or, après son dernier roman intitulé Juste un jour (2007) et marquant une nouvelle avancée dans l’objectivation du regard de l’auteur sur ce qu’on pourrait dire la nouvelle classe moyenne euro-occidentale (pendant helvétique de celle qu’observe un Houellebecq), avec une maîtrise croissante de la narration et un ton passé de l’ironie acerbe à l’humour, c’est avec une vingtaine de nouvelles à la fois mieux scénarisées et plus travaillées dans le détail, tissées de formidable dialogues, qu’Antonin Moeri nous revient cet automne dans Tam-Tam d’Eden.
Ce qu’il faut relever d’abord est que ce livre est d’une drôlerie constante, parfois même irrésistible. Le personnage récurrent de l’ahuri mal adapté, très présent dans les anciens écrits de Moeri, n’apparaît plus ici que de loin en loin, comme ce Maurice (dans Clémentine) que sa cheffe envoie quelques jours au vert, avant un possible burn out, et qui se retrouve dans le bourg lacustre au vénérable platane (on identifie Cully, même si ce n’est pas indispensable) où se passent la plupart de ces nouvelles, dont la population a bien changé depuis l’époque de Ramuz. C’est ainsi que Maurice assiste benoîtement à une petite fête publique donnée à l’occasion du baptême solennel d’une barque baptisée du même nom que la femme camerounaise du pêcheur Henri dit Riquet, dont l’union réalise la rencontre par excellence de l’Autre et l’aspiration collective à l'intégrale Intégration. Or, rien de trop facilement satirique dans cette séquence significative des temps actuels, qui fourmille par ailleurs d’observations cocasses, traduites par autant d’expressions et de tournures de langage que Moeri, comme un Houellebecq là encore, capte et réinjecte dans sa narration ou ses dialogues. Le meilleur exemple en est d’ailleurs à noter dans le dénouement de la première nouvelle, La Bande des quatre, qui évoque les relations juvéniles d’un petit groupe dominé par « la star » Pétula, égérie des jeunes gens avant de se livrer, plus tard, à l’élevage des chèvres et d’ouvrir un gîte pour touristes dans le sud de la France, alors que le narrateur se coule dans un train-train parfait entre collègues ouverts aux espaces de délibération, très solidaires et très concernés par le tout-culturel, et vie privée réduite à une formule également recuite: que du bonheur !
Autant qu’il est sensible au comique des situations, qui rappellent parfois celles qu’a fixées jacques Tati dans ses films, autant l’écrivain, multipliant les astuces narratives (parfois un peu trop visiblement), échappe au ton d’une satire convenue qui épingle et moque. De mieux en mieux, Antonin Moeri parvient en effet à étoffer ses personnages, qui nous émeuvent autant qu’ils nous font rire. Ainsi ddes tribulations du narrateur de La lampe japonaise (qui commence par la phrase « c’est juste faux ce que vous me dites, monsieur »…), solitaire et mal dans sa peau, que ses voisins bruyants emmerdent tant par leur boucan qu’il en informe les forces de l’ordre et la justice locale, pour finir par « péter les plombs » comme tant de paumés humiliés, après que tout s’est retourné contre lui.
Si les développements narratifs ou les chutes peuvent sembler, ici et là, un plus attendus voire « téléphonés », comme dans le dénouement trop parfait de C’est lui ! évoquant un larcin, dans un magasin, aussitôt associé à la présence d’un client noir en ces lieux, la plupart des nouvelles de Tam-Tam d’Eden, à commencer par l’histoire éponyme précisément, nous surprennent par la multiplication de leurs points de vue et la richesse foisonnante de leurs observations, au point qu’on se dit que l’auteur pourrait tirer une nouvelle de l’observation d’un cendrier ou d’une paire de bretelles…
En attendant de ne plus parler que de cendriers et de bretelles, Antonin Moeri nous entretient des drôles de choses qui saturent nos vies en ce drôle de monde, et particulièrement des drôles de relations entre conjoints (dans Brad Pitt, par exemple) ou entre membres d’une même famille rejouant à n’en plus finir, entre autres, les liens de ronces unissant Caïn et Abel, dans Le petit, peut-être la meilleure nouvelle de l’ensemble, comme sculptée par le dialogue, lequel dépasse de loin le ping-pong verbal pour construire les scènes dans l’espace et le temps.
Bref, Tam-tam, d’Eden est un livre qui vous fait tout le temps sourire et rire aussi, à tout bout de champ, par le comique de ses situations et par l’humour amical qui s’en dégage. Il marque une étape importante dans la progression d’Antonin Moeri qui dispose désormais d’un « instrument » à large spectre d’observation et d’expression, gage sans doute d’autres étonnements à venir...
Antonin Moeri. Tam-tam d’Eden. Campiche, 235p.