
Des livres contre les bombes (10)
L’injonction la plus cruelle, à l’instant où Michel Strogoff va perdre la vue, me revient du fin fond asiate des steppes russes, et les miens me la répéteront à l’envi : « Regarde ! Regarde de tous tes yeux ! », et c’est, par delà les épopées, des fols en Christ du temps d’Avvakoum aux chevauchées en cinémascope de Tolstoï, loin des souterrains enfumés de Dostoïevski, quelque part en province semblable à la mienne ou à celle d’Ossorguine en douce France, dans la maison de l’indolent Oblomov que je situe mon originelle Russie affective : cette pleine paroi de notre Datcha qu’il me faudrait d’autres vies pour explorer toute, et toujours ce sera cette plainte radieuse, ce cher désastre, cette poésie du tréfonds, ce canapé crevé, ces bras d’une servante dont on tombe amou- reux de la douceur, et Vassily Rozanov y insiste dans ses Feuilles tombées : «La vie russe est sale, médiocre, mais d’une certaine façon attachante. Et c’est justement ça qu’on a peur de perdre, car alors tout irait “à vau-l’eau”. Peur de perdre quelque chose d’unique qui ne se répétera jamais. On pourrait refaire mieux, mais ce ne serait plus la même chose. Or c’est justement ça qu’on veut.»
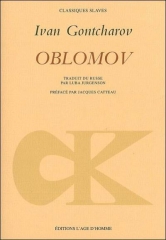
Certes il y a l’homme positif, cet ami d’Illia Illitch Oblomov au nom fringant de Stolz, industrieux Allemand qui s’efforce de l’arracher à son canapé crevé, comme Lénine le battant tentera de le discréditer au regard des foules en le taxant de parasite, mais ce n’est pas Oblomov qui trompera et fera massacrer celles-ci et c’est pourquoi je reviens à n’en plus finir à son samovar ou aux veillées d’arrière-été dans le jardin d’Anton Pavlovitch qu’on disait se complaisant en médiocre compagnie alors qu’il incarnait le saint profane, malade et guérisseur déplorant l’aveu- glement de tous sans les juger et leur répétant : « Regardez ! Regardez de tous vos yeux ! »

L’argus de Nabokov
Il me reste de lui ce petit Argus bleu dans son enveloppe de papier de soie, dont il a fait cadeau à mon ami Reynald qui l’a soigné au CHUV de Lausanne et me l’a donné pour me remercier de lui avoir fait découvrir un jour l’adorable Lolita.
C’était le dernier grand maître de la littérature occidentale, que les cuistres de Stockholm ont honoré en s’obstinant à ne pas lui décerner le Prix Nobel, comme s’il était naturellement au-dessus de ces honneurs calculés, trop insolemment libre pour aller donner la papatte à un monarque social-démocrate.
Nabokov est mort à Lausanne, il a vécu trente ans à Montreux, Vladimir Dimitrijevic l’accueillit parfois lorsqu’il était libraire à la rue de Bourg, mais pour ma part je ne l’aurai vu qu’une fois en vie, au petit écran où il était apparu trônant derrière ses ouvrages et proférant d’extravagants et poétiques propos dont on sentait que chacun avait été minutieusement préparé tout en témoignant, avec quelle fraîcheur paradoxale, du plaisir à la fois savant et ingénu que l’écrivain éprouve à dégager les mots de leur gangue d’impréci- sion ou de trivialité, à les nettoyer de leurs scories pour les faire chatoyer et scintiller sous nos yeux comme des pierres précieuses.
Et de fait c’est le poète qui me touchait avant tout, plus encore que le génial romancier, chez Nabokov : c’est cet amour des choses du monde qu’on découvre, qu’on nomme et qu’on inventorie, la passion du natura- liste faisant écho, dans les constellations du langage, à celle du trouvère de jadis.
Descendant direct de Pouchkine, et considérant d’ailleurs sa propre traduction d’Eugène Onéguine, du russe en anglais, comme l’un de ses meilleurs ouvrages, Nabokov l’apollinien s’inscrit cependant, aussi, dans la lignée plus obscure et grinçante de Gogol, selon lui « le plus étrange poète en prose qu’ait jamais produit la Russie », auquel il consacra d’ailleurs un petit livre singulier. Du premier il avait la lumineuse intelligence, l’esprit de géométrie et l’équilibre classique, la vaste culture et l’orgueil aristo- cratique, et du second le fond plus trouble et la perversité malicieuse, l’ironie et certain goût du trivial – mais on chercherait en vain chez lui la trace d’aucune dévotion et d’aucun autre culte que celui de la littéra- ture scientifique ou poétique, avec la révérence particulière qu’il accordait à son propre don du ciel qui méritait, n’est-ce pas, le respect et le meilleur entretien quotidien.
On se le figure supérieur, réactionnaire et même cynique, mais je vois surtout en lui l’émerveillement à tout instant revivifié de l’enfant d’Autres rivages, ce petit collectionneur fervent des pétales volants du Jardin d’Éden qui tout au long de sa vie, d’un exil à l’autre, refera ce geste innocent et prédateur d’attraper la beauté au vol ; et dans une zone plus secrète je m’incline devant l’humour trempé au bain d’infamie de la personne déplacée, qui raconte dans Jeu de hasard cette affreuse histoire de l’exilé russe errant d’une ville d’Europe à l’autre, à la recherche de sa femme disparue et qui décide un soir, dans le wagon-restaurant où il a été embauché comme serveur, d’en finir avec cette vie méchante et sale.
Or, tandis qu’il prépare avec soin sa disparition, comme s’il composait un problème d’échecs, nous apprenons que celle qui suffirait à lui rendre sa raison de vivre se trouve à l’instant dans le même train que lui – mais on se doute que la rencontre ne se fera pas, que le pire adviendra en atten- dant que d’autres livres s’écrivent pour nous faire oublier cette faute de goût de la destinée, comme le beau temps revient.
Je regarde à l’instant mon petit papillon bleu et j’ai les larmes aux yeux en pensant à tous ceux qui voletaient ainsi dans la lumière en se croyant peut-être éternels et qu’une patte incompréhensible a saisis soudain pour les clouer dans une boîte, sur une porte de grange ou à une croix. Je ne vois plus Vladimir Nabokov qu’en chemise d’hôpital, tel que me l’a décrit mon ami Reynald, mon cher ami de jeunesse mort en montagne sept ans après son illustre patient, et ces livres qui nous restent comme des rayons de miel, où je sais que je reviendrai me nourrir à n’en plus finir.

Mais ce n’est pas fini et l’on y revient !
Ce sont d’abord des images à foison. Des ambiances, des prises de vue au flash stylographique, des métaphores, des formules frappées comme des médailles : l’étoile bleue d’une étincelle de tramway, dans une rue de Berlin évoquant un décor de théâtre ; une jungle à myrtilles, au fond du parc d’un grand domaine russe, où des enfants ensoleillés vont se barbouiller de pulpe violette ; le désert silencieux d’un hôtel particulier de Saint-Pétersbourg dont la lumière des lampes, terne et jaune en hiver, se reflète sur le linoléum enduit de colophane.
Tout cela ressaisi avec son poids spécifique et sa rondeur très concrète, quand bien même la réalité serait transfigurée, chez Nabokov, par la double alchimie de la mémoire et du style.
Et ces souvenirs soudain rassemblés, comme une limaille multicolore, d’un voyage de noces traversant pays et saisons. Ou ces tortues du zoo de Berlin, enfonçant leurs têtes plates et ridées dans un monceau de légumes mouillés pour mâcher « salement » leurs feuilles. Ou cette table mise, dans un appartement saturé de parfum de femme, pour un souper très intime. Ou cet autre domaine russe enseveli sous les monceaux de neige.
Enfin tous ces moments dont la substance paraît tout à coup plus dense, où l’on voit mieux, comme sous une loupe, chaque détail de la tapisserie du monde ; et tous ces lieux, aussi, qu’un grand tremblement de passion ou qu’une tristesse de catastrophe incorporent à jamais à notre mémoire vive.
Si telle rue de Berlin, à tel moment de flamboyant crépuscule, dans les Détails d’un coucher de soleil, nous apparaît avec tant de relief, c’est que l’artiste a entrepris de raconter, dans un branlebas d’images qui semble faire participer le monde entier à l’événement, la fin tragi-comique de Mark le blond, le « veinard en col dur », charmant vendeur de cravates dont la ferraille déambulatoire d’un tramway interrompt brutalement la course censée le jeter dans les bras de sa fiancée Klara, laquelle ne veut d’ailleurs plus entendre parler de lui – mais le pauvre couillon l’ignore.
Faits divers banalissime ? À n’en pas douter. Mais qui n’en devient pas moins, ici, le prétexte à restituer avec des moyens techniques typiquement « années vingt », qui rappellent à la fois le cinéma, la peinture futuriste et les formes narratives de Boulgakov, de Zamiatine ou de Pilniak, l’atmosphère de Berlin que le jeune exilé a bel et bien connue, mais alors transfigurée.
Vladimir Nabokov est de ces écrivains que rebutent le réalisme et l’aveu direct, mais dont les œuvres sont à la fois tissées de réminiscences autobiographiques. Ses romans, tels Pnine, Lolita ou Regarde les arlequins, l’illustrent aussi bien que ses quatre cycles de nouvelles, de L’extermination des tyrans à Mademoiselle O, en passant par Une beauté russe.
Pour en revenir enfin au dernier recueil paru, le petit Pierre d’Une mauvaise journée, ou les jeunes exilés russes dont nous suivons les tribulations poignantes dans Le retour de Tchorb et La sonnette, sont-ils les doubles littéraires de Nabokov ? Peu importe à vrai dire !
Car ce qui compte, en l’occurrence, tient précisément à la transformation du plomb en or, au passage du gris à l’enluminure, ou du particulier à l’universel.
Ce qui nous touche, dans le triste après-midi que passe le garçon d’Une mauvaise journée au milieu d’autres gosses qui le rejettent, c’est que Nabokov y capte l’essence de la détresse adolescente.
Dans Le retour de Tchorb, autant que le dénouement grinçant, voire scabreux, d’un drame épouvantable, c’est la prodigieuse remémoration des beaux jours partagés à laquelle se livre le protagoniste après la mort de la femme aimée.
Avec La sonnette, comme dans Retrouvailles, c’est la façon de dire, sans lamento d’aucune sorte, l’errance et la solitude de l’exilé.
Il y a, chez Vladimir Nabokov, un magicien de la langue, dont les jeux d’esprit nous éblouissent, comme dans La défense Loujine ou Feu pâle, deux de ses plus ses fascinants romans.
Cependant la lecture de ses nouvelles nous rappelle que l’écrivain est également un poète du sentiment, même si la pudeur voile chez lui toute effusion. Est-ce parce qu’on fait voler en éclats les clichés du toc sentimental ou de la mauvaise littérature qu’on est, pour autant, un cynique ou un cœur sec ? Tout au contraire, et la lecture de Noël, restituant ici le désespoir d’un père qui vient de perdre son fils, achèvera sans doute de convaincre le lecteur que l’habit d’Arlequin dont aimait à se parer l’écrivain dissimulait, aussi, un homme de cœur.