
19. Chiens de la Seine
Je me trouvais tout à l'heure à la cafète du Louisiane quand, ouvrant à peine ce livre intitulé Séismes, son incipit me cloue: "Quand mère s'est jetée sous le train, il a bien fallu trouver une femme de ménage".
Cloué, je te dis. À deux tables de là, dans l'espèce de couloir malcommode de la caféte du lieu mythique (mais oui, tu te rappelles: Henry Miller y a baisé tant et plus et Cossery y a défunté après des années à se momifier au sixième), le couple classique des intellos américains mal dans leurs vieilles peaux maugréait je ne sais quoi sous l'effigie en bas-relief plâtreux de je ne sais quel fondateur évoquant à la fois le profil de JFK et ceux de Scott Fitzgerald ou d'Hemingway jeune, et j'en reviens à l'humour noir si juste de ce constat fleurant le réalisme terrien de nos cantons: "Quand mère s'est jetée sous le train, il a bien fallu trouver une femme de ménage".

Déjà les exergues du nouveau livre de Jérôme Meizoz m'avaient épaté. De Zouc: "Mon village, je peux le dessiner maison par maison. Je le connais comme mon sac à main". Et de Maurice Chappaz: "L'encre est la partie imaginaire du sang".
Mais là, page 7 de Séismes, la chose, dont je n'attendais pas vraiment le foudroiement (j'aime bien Meizoz quand il échappe à son carcan d'universitaire bourdieusard bon teint, sans attendre de lui le feu du ciel, en tout cas jusque-là), j'ai pris ma fine pointe Ball Pentel et j'ai recopié dans mon carnet Paperblanks Black Maroccan format bréviaire: "Quand mère s'est jetée sous le train, il a bien fallu trouver une femme de ménage. Père était sur les routes dès l'aube pour le travail, je l'entendais tousser longuement le tabac de la veille, mettre rageusement ses habits, avaler en vitesse le pain et le fromage. Puis il criait un nom d'enfant, le mien, par la cage d'escalier, pour que l'école ne soit pas manquée. L'appel était si brusque, incontestable, malgré le diminutif affectueux, qu'il signait d'un coup le retour à la vie diurne. Père claquait la porte et le silence régnait dans l'appartement jusqu'au soir".
Ah mais ça: je ne pensais pas vraiment lire du Meizoz à Paris, ou alors dans le TGV du retour, demain serait bien assez tôt ! Et puis non: c'est avec Jérôme que je me suis résolu à prendre le métro tout à l'heure direction pas de direction, peut-être Saint-Denis ou Montrouge, peut-être les Buttes-Chaumont ou peut-être place Paul Verlaine où, une après-midi d'il y a bien des années, je lisais Les Palmiers sauvages de Faulkner quand il s'est mis à pleuvoir d'énormes gouttes dont le livre, j'te jure, garde la trace de la sainte onction...
Le métro parisien est l'idéal salon de lecture roulant de
tournure populaire, qui réduit à néant le préjugé selon lequel plus personne ne lit. Tout le monde lit au contraire dans le métro, j'veux dire: le métro parisien , et la preuve ce matin c'est que je dérange deux voyageuses en train de lire Joël Dicker pour continuer de lire Meizoz. Et tout de suite, d'Odéon à Châtelet, je me retrouve, à lire Séismes, dans la situation précise où, une autre année, je m'étais trouvé, dans une carrée de la rue de Lille que m'avait prêtée mon ami Tonio, alias Antonin Moeri, à lire Le Laitier de Peter Bichsel qui, subitement, m'avait ramené la voix de mon grand-père paternel dont les litanies allaient devenir un livre.
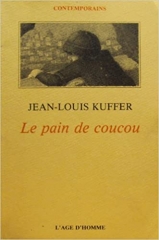
De la même façon, les séquences de la remémoration des années d'enfance de Meizoz, dans un monde à peine moins archaïque que celui de mon Grossvater, ont commencé de se déployer comme une espèce d'Amarcord valaisan dont se détachait précisément un avatar de la Gradisca sous les traits d'une belle plante se pointant à la messe avec ses fourrures de crâneuse - mais voici qu'à Châtelet il fallait changer de rame...
Jérôme Meizoz a encore vu, dans le Valais de son enfance, comment on traitait les Ritals et autres "saisonniers", mais son récit évoquant les débuts de la télé fait aussi apparaître un certain politicien (j'ai cru reconnaître le compère Jean Ziegler) qui martèle à la lucarne que la Suisse est une espèce de coffre-fort enterré aux multiples ramifications souterraines, et j'aime la façon dont son village cerné d'industrie (il y a un immense mur de barrage au béton bouchant le ciel d'un côté) prend peu à peu sociale consistance sans peser.
Une frise de personnages relance tout autrement le Portrait des Valaisans de Chappaz, les détails intimes foisonnent et résonnent comme chez Fellini (avec la chair qui s'éveille et les filles qui rôdent au bord du Rhône), et comme pour accompagner ma lecture je vois Paris se transformer sur la ligne de Saint-Denis, et tout soudain l'idée me vient d'un pèlerinage au Cimetière des chiens, donc je sors à La Fourche, je switche sur la ligne de Gennevilliers, je descends à Mairie de Clichy, je m'engage sur le boulevard Jean Jaurès présenté come "apôtre de la paix", je poursuis à pied sur le pont enjambant la Seine et là que vois-je à mi-fleuve: cette inscription de mémoire qui me scie le coeur, rappelant qu'ici des manifestants pacifiques furent jetés au fleuve le 17 octobre 1961.
°°°
Quant au Cimetière des chiens c'est un poème, et d'abord le poème des noms, à commencer par celui de Barry dont le considérable monument de granit se dresse à l'entrée de l'inénarrable nécropole et me ramène aux chanoines valaisans qui se sont efforcés de dresser, aussi, Jérôme Meizoz.

On n'oubliera pas que des hommes furent traités, non loin de là, plus mal que Bijou, Ramsès ou Rintintin la star. Pour ma part, je me rappelle cette anecdote rapportée par Léautaud, du type décidé à foutre son chien à la Seine, qui s'y reprend à deux fois car l'animal revient, et qui la troisième fois le rejette si violemment qu'il tombe à l'eau avec le chien, qui le repêche...
°°°
Je ne me lasse pas, dans le métro parisien, de regarder les gens. Pour échapper à l'effet de masse et de presse découlant évidemment du surnombre en mouvement brownien, je concentre mon regard sur les visages et les mains. Hier ainsi, sur le trajet de la banlieue nord, les mains se faisaient de plus en calleuses ou gercées, et les visages de plus en plus arabes ou africains; et comme il y avait plus de jeunots que de jeunotes, et de moins en moins mélangés, je me suis rappelé la psalmodie de Grand Corps Malade sur le thème de Roméo kiffe Juliette, après quoi j'ai remarqué de plus en plus de visages de mères en soucis.
°°°
Autant que les longs vols, que j'exècre, les trajets solo en TGV m'ont toujours semblé coupés du temps, voire de la vie. L'homme du TGV, à portable et calculette, est à mes yeux l'incarnation par excellence du zombie de fourmilière humaine; cependant un livre, un voisinage moins nul, ou l'alcool aident plus ou moins à passer d'une rive à l'autre de ce fleuve de vide.
Or l'alcool m'étant interdit ces jours pour excès de médics, je me suis replongé, le temps de mon retour de Paris, dans les récits de Tchékhov et, plus précisément, dans la terrible nouvelle intitulé Volodia, tandis que ma très jeune et jolie et blonde et fine voisine soupirait, à la lecture de Closer, sur un reportage consacré à la mort de Gérald au premier jour de tournage de l'imbécile série de Koh-Lanta.

C'est entendu: nous pleurons tous Gérald Babin, mais son pauvre sort sera bientôt liquidé par pertes et profits sur l'autel vénal des simulacres d'évasion, alors que le coup de feu qui met fin volontaire à la vie de Volodia, jeunot de dix-sept ans succombant au désespoir, retentira à jamais dans la nuit de nos mémoires.
°°°
De Montreux, jadis station lacustre pour Anglais, à l'Oberland bernois idyllique où tant de Russes de renom ont passé, de Tolstoï ou Tourgueniev à Nabokov brandissant son filet à papillons, le train préalpin qui me ramène à notre nid d'aigle figure au soir une volière de perruches hispaniques ou latino-américaines regagnant leurs pensionnats de haut renom. Toutes terroriseraient mon pauvre Volodia.
Or, nul mieux que Tchékhov n'a dit, comme dans cette nouvelle, le désarroi d'un garçon sensible se sachant laid, maladroit, humilié par sa mère volage et servile, ensuite pour ainsi dire violé par la coquette à laquelle il a osé avouer son impudent amour - nul n'a mieux suggéré le désespoir d'un garçon taxé de « vilain canard » par la dinde qui vient de s'offrir à lui, nul n'a décrit en si peu de pages le dégoût éprouvé par un coeur tendre pour le monde immonde des futiles - mais voici que j'aperçois quelqu'un que j'aime là-bas sur le quai, et c'est, ma parole, une dame au petit chien...