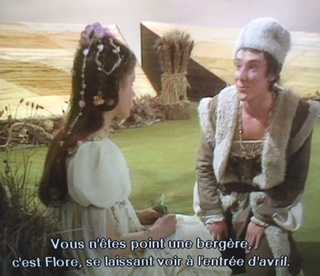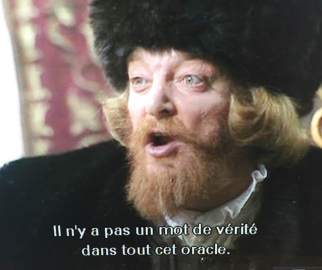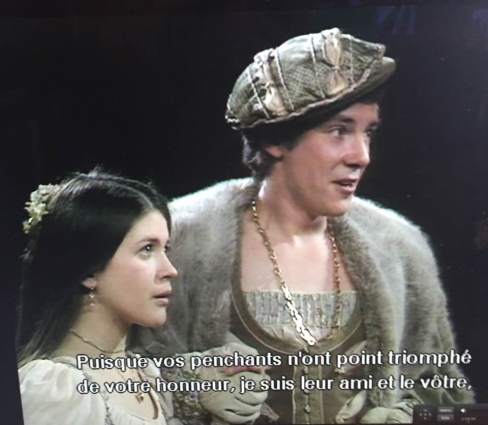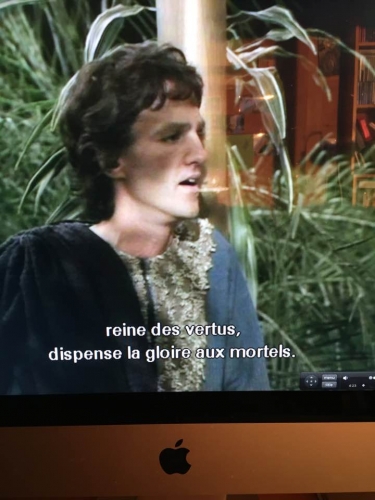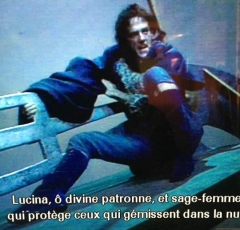Celui qui prétend sur Facebook qu'il "relit les Classiques" avec l'intention ferme de s'y mettre une fois s'il a le temps mais en tout cas pas maintenant vu que la lecture de Dan Brown va lui prendre des plombes avant la parution du best-seller annoncé de Marc Levy et Guillaume Musso réunis à quatre mains sur un roman dont l'héroïne est asexuelle et le héros gay tu te rends compte le défi Maguy ! / Celle qui pense qu'elle DOIT lire La Boétie comme l'a recommandé Michel Onfray sur France-Info / Ceux qui sont venus à Montaigne par Erasme qu'ils ont bien connu à Bâle avant qu'il n'arrête de fumer / Celui qui est sensible à la mélancolie de Montaigne plus qu'à la tristesse sépulcrale de Pascal dont le style surclasse parfois celui de l'autre ça c'est clair / Celle qui remarque que la mort sereine d'André Gide (Roger Martin du Gard notant: "Il faut lui savoir un gré infini d'avoir su mourir si bien") fut aussi désespérante et réconfortante à la fois que celle de La Boétie relatée par son ami en ces termes sobres: "Etant sur ces détresses il m'appela souvent pour s'informer seulement si j'étais près de lui. Enfin il se mit un peu à reposer, qui nous confirma encore plus en notre bonne espérance. De manière que sortant de sa chambre, je m'en réjouis avec Mademoiselle de La Boétie. Mais une heure après ou environ, me nommant une fois ou deux et puis tirant à soi un grand soupir il rendit l'âme, sur les trois heures du mercredi matin dix-huitième d'août, l'an mil cinq cent soixante-trois après avoir vécu trente-deux ans,neuf mois et dix-sept jours" / Ceux qui pensent naturellement à Stendhal lorsque Montaigne écrit du bon écrit selon lui qui est "un parler simple et naïf, tel sur le papier qu'à la bouche; un parler succulent et nerveux, non tantdélicat et peigné quevéhément et brusque, éloigné d'affectation, court et serré, décousu et hardi" / Celui qui a noté quelque part cette sentence selon laquelle "tout jugement en gros est lâche et imparfait", qui le conforte dans l'évitement souple des abus de généralités / Celle qui prononce Montagne pour rappeler qu'elle a estudié le vieux françois après que son père l'eut autorisée à couper ses nattes / Ceux qui ne se parlent plus depuis que le plus catholique de deux à option souverainiste a crié à l'autre qu'il fallait choisir entre Montaigne et Pascal point barre / Celui qui se rappelle les jugements de Barrès sur Montaigne en lequel il voyait essentiellement un crypto-youpin (langage d'époque) manquant de courage devant la peste et décriant les moeurs très-chrétiennes genre égorger un protestant ou un mahométan / Celle qui aime bien la façon qu'avait Montaigne d'admirer son père qui "parlait peu et bien" / Ceux qui lisaient Tintin au Congo à l'âge (sept ans) où Montaigne savait déjà par coeur Les Métamorphoses d'Ovide en latin / Celui qui ayant emporté le Journal de voyage en Italie a relevé sur le Campo de Sienne en laissant froidir son capuccio: "J'ai honte de voir nos hommes s'effaroucher des formes contraires aux leurs; ils semblent être hors de leur élément quand ils vont hors de leur village. Où qu'ils aillent ils se tiennent à leurs façons et abominent les étrangères" / Celle qui trouve bien plates les considérations artistiques de ce cher Montaigne qui de Sienne ne voit que le Campo jolient incurvé et rien des fresques de Simone Martini ou d'Ambrogio Lorenzetti / Ceux qui rappellent au taxidermiste anti-sceptique que Montaigne déposa une médaille votive en pensant à son épouse et sa fille en une chapelle de Lucca où il écrit qu"il y a là "plus d'apparences de religion qu'en nul autre lieu" / Celui qui compatit rétrospectivement (ce qui lui fait une belle jambe) aux douleurs subies par Montaigne sous l'effet de la pierre / Celle qui affirme que la détestation des médecins professée par Montaigne annonce celle de Molière qui n'a pas connu pour sa part les colites néphrétiques / Ceux qui rappellent volontiers que Montaigne traite explicitement de liberté de conscience à l'époque où le concile de Trente recommande l'instauration de l'Inquisition en France tandis que Calvin fait brûler Michel Servet / Celui qui apprécie particulièrement le goût de Montaigne pour les nuances et détails qui lui font voir divers aspects d'une même réalité - ainsi: "N'oserions-nous pas dire d'un voleur qu'il a une belle jambe ?" / Celle qui estime très sots ceux-là qui ne veulent lire que Bossuet et pas Les Essais ou que Rousseau et pas Voltaire / Ceux qui voient en Monsieur de La Boétie un crypto-protestant coincé mais ça aussi ça se discute / Celui qui considère Les Essais comme une vaste campagne à explorer sans cesse en de brèves excursions le long des rivières ou par les allées ombragées / Celle qui sait gré à Montaigne de n'avoir jamais été dupe de la nouveauté non plus que d'aucune utopie fauteuse de désordre en cuisine / Ceux qui ont appris de Montaigne "que philosopher c'est apprendre à mourir" / Celui qui reconnaît que d'un Michel (de Montaigne) à l'autre (Houellebecq) on ne s'est pas trop élevé / Celle qui remarque qu'au contraire des cathos enragés et des protestants Montaigne considère que Dieu est essentiellement bon comme le pensait aussi Jeanne de Lestomac sa nièce canonisée en 1949 / Ceux qui ont toujours Les Essais à portée de main dans lesquels ils piochent au hasard et sans suite comme ils le font du Zibaldone de Leopardi ou des Notizen de Ludwig Hohl, etc.
Montaigne. Les Essais, édition de 1595, suivis de Vingt-sept sonnets d'Etienne de La Boétie, de Notes de lecture et de Sentences peintes. Bibliothèque de la Pléiade, 2007.
Roger Stéphane. Autour de Montaigne. Stock, 1986.
Jean Lacouture. Montaigne à cheval. Seuil, 1997.