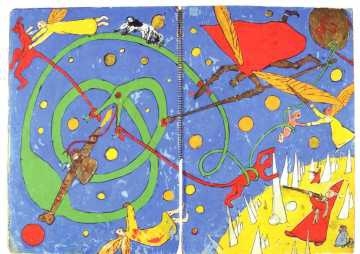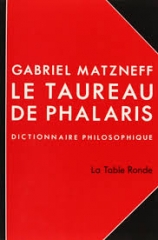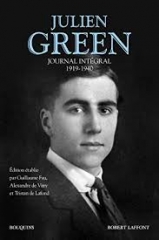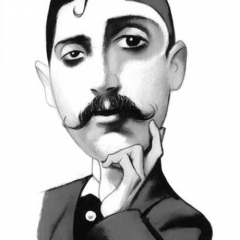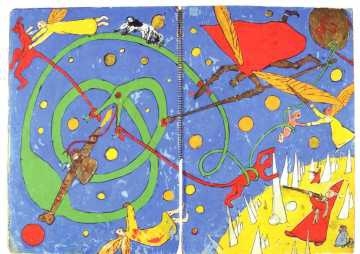
(Pages de journal)
Pour Tim et Anthony
À La Désirade, Ce mercredi 12 février . - Nous étions tous inquiets, ce matin, à cause du Petit. Sa mère, dans le box des urgences de pédiatrie, au même hosto où je me trouvais en décembre dernier, n’avait pas fermé l’œil, tandis que l’équipe du service «monitorait» l’enfant sous aide respiratoire; Lady L. et son frère avaient pris le relais auprès du Grand qui a dormi «comme un prince »; les médecins de Rennaz ont constaté un statu quo provisoire et je me suis renseigné sur Internet à propos du virus peut-être communiqué au Petit par le Grand via la garderie où celui-ci passe ses journées, juste à côté du Montreux-Palace de nabokovienne mémoire; nous nous sommes rappelé bien sûr le premier séjour de notre Grande à l’hosto pour son faux croup assorti de complications infectieuses, mais une angoisse n’est jamais réductible à une autre et celle que nous a valu notre première infante il y a plus de trente-cinq ans de ça ne banalise aucunement celle que nous vaut ce matin Tim le benjamin de notre puînée devenue grande...
DU VIOL. – Remonté à notre nid d’aigle de La Désirade pour y consulter mes cahiers chinois de l’année 2013 en vue de l’établissement du sixième recueil de mes carnets d’ores et déjà intitulé Mémoire vive (Lectures du monde 2013-2019), je tombe sur Le Taureau de Phalaris de Gabriel Matzneff que je retire de son rayon avec Un galop d’enfer, son journal des années 1977-1978, et consultant le sommaire du «dictionnaire philosophique» que constitue le premier je découvre cette rubrique consacrée au VIOL : «Dans Gloria mundi, film de Nikos Papatakis, on voit des parachutistes torturer une femme et la violer avec un tesson de bouteille. Il n’existe aucune différence entre ces tortionnaires et le jeune cadre dynamique qui prend une fille en auto-stop sur la route, puis la viole. Prétendre le contraire est un sophisme. Le type qui viole une femme et le type qui lui brûle les seins avec une cigarette participent à la même ignominie. Il est d’ailleurs rare que dans un viol l’homme se borne au seul acte sexuel : celui-ci est presque toujours accompagné d’une volonté sadique de dégrader, d’humilier la victime. La violence physique est une et indivisible. Dans la Grèce ancienne, la loi condamnait de façon semblable « toute espèce de mauvais traitement, de violence ou d’outrage contre un enfant, une femme, un homme libre ou esclave ». Et Démosthène, dans son discours contre Midias, loue l’humanité, la philanthropia de cette loi.
Les femmes qui s’apitoient sur les violeurs condamnés à de sévères peines de prison ne sont que des dupes. Les violeurs sont des ordures, et leur châtiment est une victoire du droit sur la sauvagerie. Récuser, comme le font certaines féministes, « la justice patriarcale de l’État bourgeois » (sic)) équivaut à débrider les brutes, pire encore : à les légitimer.
Et le pardon des offenses, m’objectera-t-on ? J’ai le droit de pardonner le mal que l’on me fait, mais non celui que l’on fait aux autres. Au jour du Jugement, seuls les martyrs auront le droit d’intercéder en faveur de leurs bourreaux ».
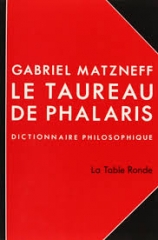
Or, recopiant ce passage, auquel je souscris entièrement, et le publiant sans nom d’auteur sur mon site de Facebook, je relève une nouvelle attaque fielleusement vertueuse de Médiapart, non seulement contre Matzneff mais aussi contre son ami Giudicelli, les éditions Gallimard en train d’être perquisitionnées (hourrah !) en attendant de flinguer tous ceux qui, de près ou de loin (gare à tes miches, cher Roland !) ont participé à l’abominable défense et illustration de ce monstre avéré dont j’ai gardé (horreur !) quelques lettres de remerciement datant des années 70, à l’époque où je rendais compte, en ma qualité (?) de critique littéraire, de L’Archimandrite ou de Nous n’irons plus au Luxembourg – années précisément d’Un galop d’enfer où il raconte tranquillement ses douces baises avec diverses lycéennes (il en rigole avec Sollers tout en pleurant la mort de Dominique de Roux) ou avec un Olivier de 15 ans, etc.
Or avais-je sursauté à la première lecture de ce journal des années 77-78 ? Nullement ? Devrais-je donc me sentir complice de crimes abominables ? Peut-être. Je ne me rappelle pas avoir, personnellement, «fait l’amour» avec aucune ou aucun mineur; je me rappelle qu’au Barbare le ténor S. siégeait entouré de gamins dont un blondinet que j’avais eu dans ma patrouille d’éclaireurs unionistes, vers mes seize ans et ses dix ans, mais quoi ? Ai-je été tenté de branler mes petits loups ? Non. Y ai-je seulement pensé. Pas du tout. Est-ce dire que j’obéissais à un Surmoi moral. Même pas. Et que penser alors de l’énorme vague de moralité qui déferle aujourd’hui sur le pauvre Gabriel ? Qu’il l’a cherché ? Peut-être. Qu’à l’instar d’un Richard Millet il a voulu cet opprobre ? Je ne le crois pas. Que le tribunal populaire d’Internet a mille fois raison ? Tout au contraire: il me fait gerber. Qu’il faut désormais en revenir à l’interdiction d’interdire que prône notre ami Roland ? Là encore c’est le contraire que je recommande : interdiction totale d’écrire et de penser autrement que les zombies filles et garçons de la nouvelle Humanité purifiée et propre sur soi comme un robot de ménage, etc.
SAGESSE DE GREEN. – Redescendu ce soir à la Maison bleue des fenêtres de laquelle je vois le lac se déchaîner sous le ciel vert et noir, au point de me ramasser une bonne gifle d’eau sur le quai où je vais aérer Snoopy, je lis ensuite une quinzaine de pages du Journal intégral de Julien Green (année 1934 à rumeurs de guerre ou de révolution) que m’a fait découvrir l’affreux Roland, ami du désormais infréquentable Gabriel, extraordinaires évocations du retour de l’écrivain bien établi (ses romans sont déjà traduits en américain) auprès de ses tantes et cousins côté maternel (il en a une centaine à Savannah), quinze ans après sa jeunesse qu’il dit très malheureuse faute de pouvoir réaliser ses désirs ardents, au milieu de la nature magnifiquement dépeinte (arbres-cathédrales aux ombres fantomatiques et aux racines flottant dans les eaux boueuses), dans l’alternance de souvenirs historiques (le général Sherman a passé dans la maison de son grand-père maternel), défense de la vision sudiste propre à sa mère et altérée par la mémoire officielle, dernières nouvelles inquiétantes de l’Allemagne contemporaine et de Paris, magma de la vie charriant aussi le récit de ses frasques sexuelles sans nombre dont il aura grand soin de ne rien livrer au public dans son journal édité de son vivant au point d’égarer un pieux biographe (un certain Nicolas Fayet) convaincu que sa relation avec Robert de Saint-Jean reste platonique, etc.
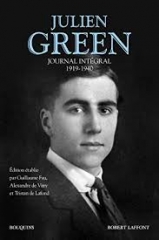
D’ÉMOUVANTS ANDROÏDES. – Tandis que le Petit se bat à l’hosto contre le virus, je pense à ce que le romancier Ian McEwan, grand réaliste doublé d’un grand fantaisiste fait dire à Alan Turing dans Une machine comme moi.
Génie des maths et de l’informatique qui a beaucoup travaillé sur les vingt-cinq androïdes en circulation au tournant de l’année 1982 (le vrai Turing s’est suicidé en 1956 en croquant une pomme empoisonnée dont l’entame est devenue le symbole d’Apple) le septuagénaire confesse une limite de la réplication parfaite du génie humain et de ses moindres inflexions affectives ou créatives : à savoir la perception du monde vécue par l’enfant (ou peut-être le génie à l’état retrouvé d’un Léonard ou d’un Shakespesare) avant son accès au langage commun.

Le Petit, à huit mois, n’est pas encore à même de s’exprimer, mais le Grand, de deux ans son aîné, est à observer avec des yeux purs...
Quant aux androïdes imaginés par Mc Ewan, ils auront de la peine à supporter la chaotique déraison humaine où la violence, contre les autres ou contre soi-même, l’autodestruction, l’envie pernicieuse et la mauvaise humeur, la vanité pire que l’orgueil et l’hybris faisant délirer les nations autant que les personnes, s’opposent à la calme ordonnance d’une vision juste et modérée – donc ces pauvres êtres trop parfaits se débranchent, les Èves achetées par des milliardaires du pétrole arabe sont les premières à rendre leur tablier et c’est ensuite la déroute en cascade - jusqu’au pauvre Adam trop droit et conséquent pour être supporté par le Charlie qui l’a acquis à grand prix et le massacre d’un coup de marteau sans se douter que l’androïde à déjà transféré ses données personnelles sur le Nuage en attendant une humanité meilleure, etc.