Il est triste le moment où l’on s’aperçoit
que quelqu’un qu’on aimait
cesse de nous manquer.
Comme il est triste aussi
le retour de celui
que personne n’attend.
(12 décembre 1987)
Louis Soutter, Seuls.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Il est triste le moment où l’on s’aperçoit
que quelqu’un qu’on aimait
cesse de nous manquer.
Comme il est triste aussi
le retour de celui
que personne n’attend.
(12 décembre 1987)
Louis Soutter, Seuls.


 En prévision de nos voyages, Lady L. s'occupe de tout. Je ne saurais en dire plus. Cela n'exclut pas mille surprises , et par exemple qu'un instant de distraction me fasse oublier mon laptop sur un quai ou qu'à un guichet elle se fasse délester de son portefeuille, mais la ligne de notre voyage est tracée comme celle d'un destin dans une main, et nous restons ouverts à toute bifurcation.
En prévision de nos voyages, Lady L. s'occupe de tout. Je ne saurais en dire plus. Cela n'exclut pas mille surprises , et par exemple qu'un instant de distraction me fasse oublier mon laptop sur un quai ou qu'à un guichet elle se fasse délester de son portefeuille, mais la ligne de notre voyage est tracée comme celle d'un destin dans une main, et nous restons ouverts à toute bifurcation.




 Le parc zoologique de San Diego est considéré comme l'un des plus beaux du monde, et c'est vrai que cet immense jardin d'Eden en pleine ville, cette jungle que survole un téléphérique aux nacelles bleues et dont on remonte des canyons à cascades par un tapis roulant entre volières géantes et savanes ou mangroves, sous l'œil implacable de l'aigle royal ou le regard plein de rêves flous du couple d'hippos immergés dans l'onde turquoise - c'est vrai que ce lieu évocateur de Genèse est incomparable à la fois par cette foison de présences immanentes et par le grand beau souci humain (révérence dans la foulée aux milliers de donateurs) de les préserver des massacres toujours en cours. Notre espèce saloparde assassine des bonobos. Ce n'est pas plus grave que d'exterminer des Indiens ou des Juifs, mais ce n'est pas bien.
Le parc zoologique de San Diego est considéré comme l'un des plus beaux du monde, et c'est vrai que cet immense jardin d'Eden en pleine ville, cette jungle que survole un téléphérique aux nacelles bleues et dont on remonte des canyons à cascades par un tapis roulant entre volières géantes et savanes ou mangroves, sous l'œil implacable de l'aigle royal ou le regard plein de rêves flous du couple d'hippos immergés dans l'onde turquoise - c'est vrai que ce lieu évocateur de Genèse est incomparable à la fois par cette foison de présences immanentes et par le grand beau souci humain (révérence dans la foulée aux milliers de donateurs) de les préserver des massacres toujours en cours. Notre espèce saloparde assassine des bonobos. Ce n'est pas plus grave que d'exterminer des Indiens ou des Juifs, mais ce n'est pas bien.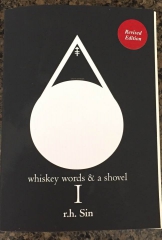






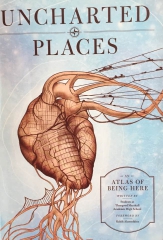

Le critique est parfois un artiste, dont Pietro Citati est l’un des plus beaux exemples vivants. Il fallait d’ailleurs un artiste, avec le mélange d’intelligence et d’intuition, de sensibilité et de culture, de porosité à la vie des autres et des textes, d’aptitude enfin à transmettre tout cela dans une écriture fluide et belle – il fallait tout l’art de Citati, auteur d’un Kafka mémorable et de La colombe poignardée, splendide essai consacré à Proust, pour nous intéresser encore, et nous toucher, nous bouleverser même à l’approche d’un couple dont on croit tout savoir… sauf peut-être l’essentiel, que Citati situe plutôt dans les œuvres, donc dans les âmes de Zelda et Francis Scott Fitzgerald, que dans leurs tribulations de phalènes.
A l’ère du « people » le plus vulgaire, le couple « phare » qui se maria le 3 avril 1920, année « mythique » s’il en fut du premier « glamour », reste le symbole de l’époque « rétro » dont les images « de rêve » comptent plus que le contenu des deux livres « cultes », voire « cultissimes », laissés par Fitzgerald : Gatsby le magnifique et Tendre est la nuit.  De la vie brillantissime et non moins pathétique des deux merveilleux papillons que furent Zelda et Scott, Pietro Citati parle évidemment, comme de leur époque aussi flamboyante (pour certains) que factice. Mais il va de soi que c’est ailleurs qu’il nous conduit aussi : tout au bout de la nuit de deux être aussi doués et fragiles l’un que l’autre ; au bout de la détresse d’une enfant gâtée qui rêvait d’être la première danseuse de son temps et qui périt dans les flammes après que des médecins suisses eurent détecté sa schizophrénie, d’une part ; au bout du seul mystère de la vie du buveur mythomane que fut Scott, à savoir le mystère de la naissance de son art, où le travail et la probité, « l’ouvrage bien fait et pour l’amour de l’art », comptaient autant pour cet élève de Keats et de Flaubert que son don premier. « Quand il parlait de l’écriture, dit John Dos Passos, son esprit devenait limpide et pur comme le diamant »
De la vie brillantissime et non moins pathétique des deux merveilleux papillons que furent Zelda et Scott, Pietro Citati parle évidemment, comme de leur époque aussi flamboyante (pour certains) que factice. Mais il va de soi que c’est ailleurs qu’il nous conduit aussi : tout au bout de la nuit de deux être aussi doués et fragiles l’un que l’autre ; au bout de la détresse d’une enfant gâtée qui rêvait d’être la première danseuse de son temps et qui périt dans les flammes après que des médecins suisses eurent détecté sa schizophrénie, d’une part ; au bout du seul mystère de la vie du buveur mythomane que fut Scott, à savoir le mystère de la naissance de son art, où le travail et la probité, « l’ouvrage bien fait et pour l’amour de l’art », comptaient autant pour cet élève de Keats et de Flaubert que son don premier. « Quand il parlait de l’écriture, dit John Dos Passos, son esprit devenait limpide et pur comme le diamant »
« Entre 1929 et 1931, Fitzgerald écrivit certains de ses plus beaux récits », écrit Pietro Citati : « La Traversée difficile, Le Mariage, Deux erreurs, Retour à Babylone. Sa vie sombrait dans l’angoisse et dans la folie; et pourtant, jamais peut-être il n’avait ainsi atteint cette vérité dans la voix, cette douloureuse douceur du ton. Le malheur l’avait fait descendre, ou s’élever, en un lieu qu’il ignorait, et qu’il explora avec une clarté et une lucidité merveilleuse, sans la moindre trace de larmes, d’alcool ou de dégradation ». La vie de ces deux grands vivants si mal faits pour la vie, la destinée si tragique de Zelda, la complicité liant Scott et Scottie leur fille, sont évoquées avec la même délicatesse et la même attention affectueuse, sans les sots partis pris qui ont réduit les relations du couple à une caricaturale guerre des sexes. Dans les lettres les plus intimes de Zelda et Scott ou de leurs proches, dans les livres de celui-ci et les plus secrètes aspirations et observations de celle-là, Pietro Citati rencontre la complexité de deux natures peu compatibles et la simplicité d’une passion enfantine.
La vie de ces deux grands vivants si mal faits pour la vie, la destinée si tragique de Zelda, la complicité liant Scott et Scottie leur fille, sont évoquées avec la même délicatesse et la même attention affectueuse, sans les sots partis pris qui ont réduit les relations du couple à une caricaturale guerre des sexes. Dans les lettres les plus intimes de Zelda et Scott ou de leurs proches, dans les livres de celui-ci et les plus secrètes aspirations et observations de celle-là, Pietro Citati rencontre la complexité de deux natures peu compatibles et la simplicité d’une passion enfantine. Pietro Citati. La mort du papillon ; Zelda et Francis Scott Fitzgerald. Traduit de l’italien par Brigitte Pérol et enrichi d’un cahier de photographies très significatives. Gallimard, L’Arpenteur, 127p.
Pietro Citati. La mort du papillon ; Zelda et Francis Scott Fitzgerald. Traduit de l’italien par Brigitte Pérol et enrichi d’un cahier de photographies très significatives. Gallimard, L’Arpenteur, 127p.

Callisto de Torsten Krol. Coup de pub dans l'eau ?
La pub et la rumeur se conjuguent, tout soudain, pour lancer ce roman picaresque d’un mystérieux auteur qui vivrait au fin fond du bush australien, à moins que ce probable pseudo ne dissimule un auteur anglo-saxon à succès ? Ce qui est sûr dans l’immédiat, c’est que Callisto de Torsten Krol se lit allègrement et d’une traite, dont on voit quel film épatant il ferait, mais déjà ce trait marque à la fois la dynamique de la chose et ses limites.
On annonce crânement un nouveau Salinger, mais ce n’est pas la première fois, et ça n’a pas plus de pertinence que les précédentes. On pourrait dire aussi qu’il y a là-dedans de la vitalité malicieuse à la Mark Twain ou de la causticité grinçante à la John Kennedy Toole, mais ces comparaisons à n’en plus finir sont aussi vaines et convenues que les sempiternels vivats de celui-ci ou de celui-là, genre « c’est le roman de l’été » ou «l’auteur le plus prometteur de la nouvelle génération ».
Le protagoniste de Callisto est une espèce de Candide américain du genre géant cool (il fait 1 mètre 90 et s’exprime lentement quoique sûrement), dont le nom d’Odell Deefus fait s’étonner chacun qu’il ne soit pas noir. A vingt-deux ans, il a lu seize fois Jody et le faon qui résume à ses yeux ce qu’il faut penser de la vie et de ses vicissitudes, de l’amitié, de l’amour et de tout le bazar. Les divers petits métiers qu’il a exercés jusque-là après avoir raté ses études et quitté son ivrogne de père ne lui ont guère convenu, aussi a-t-il résolu de s’engager dans l’Armée américaine pour combattre les « islamites » en Irak et glaner ainsi quelques médailles nécessaires à son prestige personnel auprès des jeunes filles. Sur le chemin du bureau de recrutement, à Callisto (Kansas), à bord d’une Chevy Monte Carlo de 78 pourrie, une première escale forcée dans une cahute habitée par un garçon de son âge taiseux, farouche et visiblement islamophile, va l’entraîner dans une suite de péripéties qui le retiendront en Amérique profonde. Il y rencontrera divers types éminemment représentatifs après avoir malencontreusement refroidi son hôte qu’il soupçonne de lui vouloir du mal : du télévangéliste en Cadillac qui le prend pour celui qu’il a assommé et le presse de revenir à la seule vraie foi, à la sœur du pauvre Dean, gardienne de prison jouant les mules de dope et dont il s’amourache, en passant par un inspecteur retors et un sénateur néo-conservateur, entre beaucoup d’autres que l’auteur excelle à portraiturer.
L’ambiance est à la paranoïa sécuritaire et à la collusion des conservatismes, sur fond de beaufisme et de corruption, et l’on s’amuse bel et bien à suivre l’équipée du charmant ahuri, combinant les ressorts du polar et de la satiriqe. C’est frais, vif, talentueux, mais est-ce un grand livre pour autant ? Disons plutôt : de la belle ouvrage de pro, comme il s’en fait et s’en fera sans doute de plus en plus, relevant du « coup éditorial » plus que de l’œuvre à suivre. Si le souffle et les astuces du conteur y sont assurément, l’écriture reste quelconque, que le traducteur Daniel Bismuth tire vers un négligé « djeune » encore moins convaincant.
A l’instant d’investir les têtes de gondoles des librairies francophones, Callisto est annoncé en parution simultanée aux Etats-Unis, en Allemagne, en Italie et en Angleterre, et les éditeurs ne manquent pas de faire mousser le « mystère » entourant l’identité de l’auteur. Mais y a-t-il vraiment de quoi se passionner ?
 Torsten Krol. Callisto. Traduit de l’anglais par Daniel Bismuth. Buchet-Chastel, 476p.
Torsten Krol. Callisto. Traduit de l’anglais par Daniel Bismuth. Buchet-Chastel, 476p.

…Tu me glaces, Liebling, j’ose pas te le dire mais t’as la peau banquise, tu me fais frisson de fjord, pourquoi que tu te laisses pas aller à ma main chaude, j’ose pas te le dire mais j’aurais vraiment l’impression de le faire avec une statue si tu me le demandais…
Image : Philip Seelen