
Thierry Vernet : « L’Art commence quand, après une longue et patiente partie d’échecs, d’un coup de genou sous la table on fait tout valser ».
Ce 1er novembre. - La littérature, en deçà ou au-delà de la philosophie et des sciences humaines, via la poésie ou le théâtre - de Dante à Shakespeare par exemple - peuvent-ils nourrir une réflexion actuelle sur notre rapport au Terrestre, et les romanciers contemporains, ou les poètes, méritent-ils la moindre attention des experts en la matière ? Inversement, une nouvelle orientation de notre perception du Global et du Local peut-elle enrichir la littérature ?
Ces questions ne se poseront peut-être pas pour les mâles Alpha à la Donald Trump, mais la lecture du dernier essai de Bruno Latour, en phase avec son ami allemand Peter Sloterdijk, leur donne une nouvelle base et un possible élan à venir avec l’effort de l’auteur de répondre, en Européen non aligné, à cette question d’Où atterrir ?

«Est-ce que je dois me lancer dans la permaculture, prendre la tête des manifs, marcher sur le Palais d’Hiver, suivre les leçons de saint François, devenir hacker, organiser des fêtes de voisins, réinventer des rituels de sorcières, investir dans la photosynthèse artificielle, à moins que vous ne vouliez que j’apprenne à pister les loups ?».
Voilà ce que chacune et chacun se demandent peut-être en toute bonne foi en se posant la sempiternelle question du Que faire ? Sur quoi Bruno Latour esquisse le début d’une suggestion : « D’abord décrire. Comment pourrons-nous agir politiquement sans avoir inventorié, arpenté, mesuré, centimètre par centimètre, animé par animé, tête de pipe après tête de pipe, de quoi se compose le terrestre pour nous ?»
°°°
Parlant d’«élites obscurcissantes », Bruno Latour reprend «la métaphore éculée du Titanic : les classes dirigeantes comprennent que le naufrage est assuré ; s’approprient les canots de sauvetage, demandent à l’orchestre de jouer assez longtemps des berceuses afin qu’ils profitent de la nuit noire pour se carapater avant que la gîte excessive alerte les autres classes ! »
°°°
Ce qu’il y a de formidable avec les bonnes femmes, quand elles se mettent à écrire et à décrire, c’est leur sens de la réalité terre à terre. Du moins est-ce ce que je me dis, en nos contrées, en lisant Alice Rivaz ou Janine Massard, aux States en lisant Alice Munro ou Annie Dillard, ou en France en lisant Maylis de Kérangal et, ces derniers jours, le nouveau roman de Marie-Hélène Lafon, Nos vies, dont le regard d’une terrienne de souche sur une immigrée farouche nous ancre littéralement dans le plus-que-réel avec des mots et des formules frappées au coin du cœur-à-corps.
°°°
Amaury Nauroy a 35 ans de moins que moi. Czapski en avait 51 de plus. Cela fixe des repères. Ma mère est née en 1917, moi en 1947. Lucy, l’australopithèque arboricole, va sur ses 30 millions d’années. Ainsi de suite…
°°°
L’amour de la littérature est un phénomène tout à fait particulier, qui ne se limite pas plus à un goût esthétique qu’à une passion intellectuelle, mais touche à tous les points de la sphère sensible et filtre les expériences les plus diverses.

Certains individus ont la foi, comme on dit, et d’autres pas ; certains entendent la musique ou voient la peinture mieux que d’autres ; et puis il y a ceux qui aiment la littérature, s’en nourrissent et se plaisent à la partager. Amaury Nauroy est de ceux-ci, qui semble vivre pour et par la littérature, à la fois en lecteur, en passeur et en écrivain se révélant superbement dans ce premier livre intitulé Rondes de nuit.
«La littérature romande ? Mais c’est la rose bleue !», s’exclamait Friedrich Dürrenmatt quand on l’interrogeait à ce propos, visant le mélange de spiritualisme diaphane et certaine préciosité de vieille fille du Grand Poète célébré par les Welches (on est censé penser à un Gustave Roud ou à un Philippe Jaccottet, même si le tonitruant Bernois n’avait probablement lu ni l’un l’autre) mêlant culte de la nature, déisme délicat et prose sublime.
Cliché pour cliché, le fluvial Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel, qui fascinait Léon Tolstoï et que Dimitri a publié dans son intégralité en douze volumes de plus de 1000 pages, a pu être taxé de «noix creuse» et devenir le symbole d’un certain nombrilisme romand, et la réception critique d’un Ramuz, en France, ne réserve pas moins de formules expéditives, voire débiles, l’assimilant à peu près à un auteur régional, sinon rural, plus ou moins traduit de l’allemand…
°°°
Le langage de l’époque est binaire, et débilitant par exclusion, alors que la littérature est inclusive et ramasse tout. Ramuz l’écrivait dans son plus beau roman : «Laissez venir l’immensité des choses». Et Charles-Albert Cingria de nuancer à sa façon: «Ça a beau être immense, comme on dit: on préfère voir un peuple de fourmis pénétrer dans une figue».

Ce qui suggère qu’il y a place, dans la littérature romande «et environs», pour la bourlingueur Cendrars autant que pour Maurice Chappaz le chantre du «Valais de bois», pour dame Anne Perrier la poétesse hypersensitive autant que pour l’intempestif Maître Jacques, pour Nicolas Bouvier nomadisant au Japon autant que pour Philippe Jaccottet dans sa lumière de Grignan, et toute la jeune bande récente dans la foulée, même si l’âme romande s’est mondialisée et que l’identité de la vieille fille se métisse avec le Roumain Popescu et le Camerounais Max Lobe, les uns «échangeant» sur Facebook et les autres tâtant de l’avenir radieux entre véganisme et permaculture.
Tout ça pour dire que la vieille fille présumée, réputée sortir de la 5e promenade du Rêveur solitaire de Rousseau, jadis chaperonnée par le couple du Pasteur et du Professeur, n’a pas encore dit son dernier mot pour autant qu’on lui prête une oreille attentive et même peut-être amicale.
°°°
Ce qu’il y a de beau dans le livre d’Amaury Nauroy, c’est l’espèce d’affection filiale courant entre l’auteur et ses personnages disparus ou vivants, qu’il s’agisse de Mermod ou de Jaccottet, de la petite-fille de l’éditeur ou de son fils flambeur à dégaine de raté à la Simenon, en passant par le peintre Jean-Claude Hesselbarth (voisin des Jaccottet à Grignan) et jusqu’au fils du poète, Antoine Jaccottet, devenu éditeur à son tour à l’enseigne du Bruit du temps avec autant d’extrême soin dans la réalisation de ses livres que Mermod.
Ces liens de filiation pourraient faire clan ou chapelle, et pourtant non : la ferveur joyeuse de l’auteur le préserve de ce travers, et le courant passe, la transmission se fait en beauté.
Ce mardi 7 novembre. – Départ ce matin à 8h.37 de Montreux, après un dernier café avec L. et P. Tout est sous contrôle, me semble-t-il. Je dormirai ce soir à Chiusi et demain soir à Cetona. Ciel couvert.
Neige sur le Grammont. Grisaille sur les collines de Sion. Le ciel se dégage aux abords de la Noble Contrée, qui me rappelle Rilke et ma visite à Jeanne de Sépibus, il y a plus de quarante ans de ça…
Après le Simplon, le Pendolino débouche dans le grand bleu du sud, passant sous des pentes forestières encore noires d’incendies passés.

Dans le train de Florence, je reprends la lecture des brefs textes de Philippe Jaccottet rassemblés (au Temps qu’il fait) sous le titre de Tout n’est pas dit. Comme je suis un peu fatigué par les quatre premières heures de mon voyage, cette lecture aimablement mesurée me convient. Jaccottet observe les premiers dégâts de la télévision à la fin des années 50, en Provence, il observe de jeunes voyageurs snobs et arrogants dans un train, il fait l’éloge de l’art discret du conteur André Dhôtel, il rend hommage à Gustave Roud en le dégageant de la tradition rousseauiste pour le situer plutôt dans la filiation des romantiques allemands, avec de lointains échos égyptiens ( !), il évoque (superbement) l’automne dont il préfère la lumière mélancolique aux sonneries trop flamboyantes des feuillages, il parle du haïku dont il est proche à certains égards, et l’ensemble du livre, tissé de petites chroniques, forme un ensemble équilibré traversé par une douce musique, parfois un peu trop posée, voire évanescente, à mes yeux, mais enfin c’est l’un des aspects de Jaccottet que je préfère.
Sur quoi, passé Bologne, je repique en lisant Couilles de velours de Corinne Desarzens, et là ça redevient du plus vif et du plus corsé - du plus coruscant dirait Charles-Albert -, avec des saillies parfois saisissantes. Cela qui va de soi : «Le grand âge assure l’illusion de pouvoir tout dire. Sur le bâtiment qu’est le corps. Sur la fusée qu’est le destin. Sur la moutarde après dîner qu’il faut éviter parce qu’elle veut dire trop tard ». Et tout ce qui, de fait, aujourd’hui, me souffle de sa voix insidieuse voire cruelle : « trop tard »…
Du coup je revois la Comtesse, un certain jour chez Francis, à Paris, qui nous avait pris en affection durant un repas de midi et qui, au moment des desserts, nous a recommandé de prendre bien soin l’un de l’autre, etc.

À Chiusi, ce même soir. – Bien arrivé et très content d’être descendu dans un modeste hôtel jouxtant la gare dont la petite chambre (hélas sans table) me coûte 35 euros ! Dieu sait que je ne suis pas rapiat, mais un prix normal est si rare par les temps qui courent...
°°°
Je me régale à la trattoria toscane Al Punto, réalisant la bonne tradition populaire italienne, où j’observe cependant tout un parterre de jeunes gens littéralement scotchés à leurs smartphones, ne discontinuant de les consulter sans cesser pourtant de parler entre eux et ensuite de se régaler à leur tour. Nulle part, ni à Paris ni en Suisse, ni non plus aux States, je n’ai vu un tel spectacle à l’italienne, et qui me rappelle la délirante télé vue par Fellini…
À la table voisine, j’observe une enfant (quatre ou cinq ans) et son père tatoué à casquette d’équipe de football américain, qui n’en finit pas de rappeler sa présence en réclamant ceci ou cela, crisant, trépignant, avalant trois bouchées et en refusant trois autres, filant à une autre table où diverses jeunes femmes jacassent, puis revenant au père qui se lève pour faire quelques pas avec elle jusqu’à une autre table de mecs, avant de caser enfin la môme devant un jeu vidéo sur sa mini-tablette, etc.
L’aliénation de l’Italie, pointée par Guido Ceronetti dans Un Voyage en Italie, La Patience du brûlé et Albergo Italia, atteint ces jours des proportions martiennes, comme je le constate ce soir au Punto, et pourtant il y a toujours quelque chose d’un vieux fonds populaire et joyeux qui résiste au nivellement total et à la crétinisation massive, chez ces chers Ritals, qui incite à leur appliquer un « jugement » à deux poids deux mesures, découlant finalement d’une légèreté et d’une démesure particulière, etc.
Cetona, ce mercredi 8 novembre. – Le sommeil un peu perturbé par le vin d’hier soir, mais j’ai fini par me rendormir et me trouve à l’instant dans les meilleures dispositions de corps et d’esprit à une table de l’ancien Caffè dello Sport de Cetona, rebaptisé Da Nilo, après une première brève escale au Poggiosecco dont j’ai pu apprécier la parfaite situation, sur une éminence boisée à deux kilomètres du bourg, et la bonhommie sympathique du colosse barbu venu me répondre en robe de chambre…
Coïncidence plaisante : Paolo est un ancien journaliste de rubrique économique, dans la soixantaine, qui s’est retiré en ces lieux avec la belle Paola pour tenir cette maison d’hôtes - belle paire de Romains civilisés et d’emblée très avenants, qui m’ont attribué une ravissante petite maison rose attenant à la vieille ferme restaurée dans les règles de l’art.

San Quirico d’Orcia, ce 9 novembre. - Toute l’âme italienne, ou plus précisément toscane, se trouve comme rassemblée et résumée en ces lieux où nature et culture se fondent, me dis-je en savourant de grandes ravioles à la truffe noire arrosées de Brunello. L’établissement rappelle, par son enseigne, l’infernal gourmand Ciacco de la Commedia, et ce giron de l’Inferno, à l’abri de la pluie dantesque, me convient tout à fait à l’instant.

°°°
J’envoie ce soir ce courriel indicatif à mon illustrateur préféré : « Cher Matthias, ma 15e chronique sera donc consacrée au monde vue de Toscane en automne, autour d’un lutin génial du nom de Guido Ceronetti, qui a écrit sur l’Italie des choses terribles (il voit le champignon atomique blanc derrière la truffe) et magnifiques. C’est à la fois un chroniqueur percutant (dans La Stampa durant des années) et le fondateur du Teatro dei Sensibili, des marionnettes qui transmettent sa vision du monde, actuellement manipulées par une bande de jeunes gens, en complicité avec le Maestro autant qu’avec les mânes de Fellini. L’Italie populaire et délirante de Fellini et celle de Ceronetti font en effet bon ménage. Les livres de Guido (Voyage en Italie, Albergo italia, La patience du brûlé, Ce n’est pas l’homme qui boit le thé mais le thé qui boit l’homme, etc.) alternent à tout moment le poids du monde et le chant du monde, la hideur massive et la beauté des animaux (c’est un écolo anti-nucléaire anti-poulet en batterie, anti-chasse et anti-guerre enragé de la première heure), ce sont des sortes de patchworks de tags et de pensées chinoises, de sentences profondes et de titres de tabloïds, etc. Hier dans un parc sur une cahute de chiottes il y a avait une tête de loup et des citations de la Divine comédie au feutre noir: du pur Ceronetti.
À l’instant je vous écris dans une sorte de paradis sur terre, au milieu des biches et des renards, dans le flamboiement de l’automne, après une soirée passée avec la belle Paola et Paolo le titan barbu qui avait fait ses tagliatelle al ragù et me racontait ses années de journaliste d’investigation entre Rome et Milan au coin du feu en même temps que passait un épisode de Montalbano à la télé. C’est ça l’Italie à mes yeux : le chant du monde et le poids du monde. Ma basta così. Je vous filerai l’adresse de la Casa Poggiosecco où il vaut la peine de faire étape, et vous souhaite monts et merveilles ».
°°°
Je suis Romain je suis humain, disait je ne sais plus quel idéologue droit dans ses bottes, et c’est avec malice que je détournerai cette crâne sentence au crédit des deux Romains - elle d’une délicate finesse d’esprit au visage de madone profane, et lui grandgousier barbu - tenant maison d’hôtes en ces hauteurs forestières de la Toscane , combien humains en leur façon de vous recevoir comme un ami de longue date mais impatients de refaire connaissance sans une once d’indiscrétion pour autant...
La belle Paola me rappelle les douces personnes des films de Comencini, tandis que le géant Paolo m’évoque illico les cuisiniers premiers couteaux de Fellini, très avisé des finesses de la poésie culinaire. Ainsi, lorsque je lui demande, au coin du grand âtre de l’ancienne ferme, s’il fait aussi sa pâtisserie in casa, comme son pain et les tagliatelle au ragù dont nous nous régalons, me répond-il que non: que la pâtisserie est un art en soi relevant de l’alchimie apprise la plus précise: si la recette t’impose 13 grammes de blanc d’œuf tu n’en mettras ni 14 ni 18 même si c’est la guerre !
L’art de vivre s’apprend entre l’enfance et l’exercice actif du métier de vivre, mais il découle, dans toutes les cultures et civilisations, de siècles de savoir transmis et mémorisé dont j’aime déchiffrer le palimpseste partout où je vais, et à cet égard le grand livre toscan est un trésor. Je n’irai pas au Festival de la truffe annoncé sur les affiches de Montepulciano, mais à San Quirico d’Orcia où la mémoire remonte aux Étrusques, un modeste primo piatto de ravioli al tartufo (la truffe en italien) me fait sourire à l’évocation d’un Tartufe qui invoque le ramadan pour les autres sans cesser de s’en mettre plein la truffe...
°°°
Pour ma part je trouve autant de saveur à trois morceaux de fromage de brebis servis avec trois lamelles de poire qu’à un grand festin, mais chacun son goût et nul hasard si je tombe, au coin de la prochaine rue, sur un tout petit livre du Maestro Ceronetti que je retrouverai demain à Cetona, intitulé Per non dimenticare la memoria...

« S’il est des paysages qui sont des états d’âme, ce sont les plus vulgaires », écrivait sentencieusement le cher Albert Camus dans son évocation de la Toscane de Noces, si je ne fais erreur, mais Camus pour une fois s’est montré obtus dans sa perception d’une haute terre et de ses gens.
En Toscane les états d’âme sont évidemment des sous-produits, comme un peu partout, mais ce jugement réduisant une émotion devant tel ou tel paysage me semble bien académique au moment où importe surtout la première sensation et la joie très pure qui en découle.
Les collines de Toscane et plus particulièrement les lunaires crêtes siennoises, n’ont point de mer pour horizon, au contraire de Tipasa ou de Djemila, mais leur mélange de beauté naturelle roulant à l’infini, et d’ordonnance ajoutée à main humaine ne me font pas me demander s’il n’y a là que de l’état d’âme suspect de vulgarité vu que je n’aspire qu’à une muette reconnaissance.
°°°
Les ors et la pourpre d’automne jetaient leurs derniers feux, ces jours, sur les collines de haute Toscane, où Nature et Culture n’en finissent pas de se fondre et de survivre au fracas des batailles séculaires.

De Florence а Pérouse, en passant par les collines lunaires des crêtes siennoises, ou en fonçant sur les autoroutes démentes, la double nature infernale et «capable du ciel» de notre terrible espèce a trouvé sa plus mémorable illustration dans La Divine Comédie de Dante, que les livres joyeusement désespérés de Guido Ceronetti relancent а leur façon dualiste
Miel et fiel, festival local de la truffe et champignon blanc de la hantise mondiale d’une Apocalypse nucléaire, subite apparition de trois biches а ma fenêtre sur fond d’oliviers argentés et de cyprès en immobiles flammes noires, et sempiternelle jactance de la télé de Berlusconi & Co relayant les Fake News du twitteur ubuesque de la Maison-Blanche: tel est le monde qu’on dirait aux mains d’un marionnettiste tantôt démoniaque et tantôt angélique.

Souvenir perso remontant а l’an 2012: à Turin, а l’inénarrable Festival des désespérés réunissant, sur scène, le vieux lutin génial et sa compagnie juvénile. Masques et marionnettes pour dire la tragi-comédie humaine. Magie de l’antique poésie populaire. Séquence de plus à l’Amarcord fellinien! Mais le théâtre des sensibles n’est pas qu’italien: il est de partout et nous en sommes…
°°°
 Quant à Fabio Ciaralli, il a fait l’expérience extrême de la douleur existentielle, qui l’a amené а plusieurs reprises au bord du désespoir et de la tentation suicidaire.
Quant à Fabio Ciaralli, il a fait l’expérience extrême de la douleur existentielle, qui l’a amené а plusieurs reprises au bord du désespoir et de la tentation suicidaire.
Paradoxalement, c’est avec deux maîtres contemporains du pessimisme philosophique qu’il a trouvé la force de survivre: Guido Ceronetti, qu’il a lu avec passion et avec lequel il a entretenu une longue correspondance, pour devenir son ami ; et Cioran, dont il aime à dire qu’il lui a sauvé la vie. Cioran «a nourri mes veilles», écrit-il, «il m’a tenu en vie»…

Enfin, ce fut un bonheur tout simple, sans flafla mondain ni paparazzi accrochés aux angelots en stuc 3D, que cette rencontre tricéphale en présence d’un public de tous les âges, au milieu des fresques polychromes de l’église dédiée а Santa Annunziata et transformée en «salle polyvalente» selon l’expression plaisante du Maestro.
D’ailleurs le monde actuel lui-même est une espèce d’église polyvalente en déficit redoutable de mémoire, et c’était d’autant plus émouvant d’entendre le Maestro égrener ses souvenirs de Cioran, avec quelle précision malicieuse, que son hypermnésie se troue parfois comme les chaussettes des pèlerins au long cours...
Or ça nous arrive а tous, nous qui aurons vécu plus longtemps que Mozart ou le rabbi Iéshouah, mais le titre d’un des derniers petits livres du Maestro m’a sauté l’autre jour aux yeux, sur un rayon d’une petite librairie de San Quirico d’Orcia, au milieu d’un des plus beaux paysages du monde, entre vestiges étrusques et chapiteaux romans, avec ce titre indicatif que je traduis dans la langue d’adoption de Cioran: Pour ne pas oublier la mémoire...

Je me sens en Italie, ou plus précisément en Toscane, auprès de gens aimables, comme chez moi. Je vais tâcher de dire ce que j’apprécie dans cette Italie-là, qui relève à mes yeux de la civilisation, même s’il y a en elle aussi du pasticcio païen ou barbare.
Avec mes hôtes de l’Albergo Toscana Podereso Poggiosecco, nous avons eu hier soir une dernière conversation où nous avons parlé d’un peut tout, sur la même longueur d’ondes.
Ce mercredi 15 novembre. – Invité ce midi par l’abbé Vincent. Très bonne conversation d’abord arrosée d’absinthe chez lui, ensuite au restau voisin où il m’a régalé. Nous avons bien ri. Parfois même nous nous sommes gondolés. Comme lorsqu’il cite sa grand-mère : « Au fond il n’y a pas de milieu, quand on devient très vieux : soit on devient tout bon, soit tout mauvais ». Ce qui m’encourage in petto à devenir tout bon et de plus en plus.
Autre saillie tordante, comme il évoque une conférence donné par Tariq Ramadan à l’Octogone, après laquelle avec quelques amis, ils avaient mangé et bu pas mal, assez pour délier la langue de l’abbé qui lança au (faux) frère musulman: « J’ai trouvé, Monsieur, votre discours brillantissime, mais je n’en crois pas un mot ! ».
°°°
 Très surpris en bien par les romans d’Antonin Moeri et de Jean-Yves Dubath que j’ai trouvés dans mon courrier de ces derniers jours, à mon retour de Toscane. Achevé le Dubath ce soir. Très étonnant petit roman proustien, tenu et tendu, cristallisant un vrai chagrin et une vraie petite tragédie illustrant le choc des cultures, comme on dit. L’histoire d’un esthète artiste (Julius), considéré comme un « Leonor Fini helvète », qui s’entiche d’un jeune Roumain faisant le trafic d’objets de toute sorte entre la Suisse et la Roumanie. Parfaite illustration de la montée aux extrêmes du mimétisme destructeur. Julius est prêt à renoncer à ses dessins « à chair » de nus masculins, qu’il n’ose montrer à Basile, pour envisager la peinture de tableautins alpestres que celui-ci pourrait revendre en Moldavie, une affaire à deux qui se concrétise d’abord par un prêt d’argent important de Julius, destiné à l’achat d’un terrain où pourrait s’établir une galerie d’art-hangar à ferraille, et que le Roumain détourne à son profit pour construire une COOP. Cette histoire sordide, qui me rappelle un fait divers criminel, est élevée au rang d’une sorte de fable et d’une façon de poème rappelant les thèmes de Cavafy, du subtil esthète convoitant de belles brutes, etc.
Très surpris en bien par les romans d’Antonin Moeri et de Jean-Yves Dubath que j’ai trouvés dans mon courrier de ces derniers jours, à mon retour de Toscane. Achevé le Dubath ce soir. Très étonnant petit roman proustien, tenu et tendu, cristallisant un vrai chagrin et une vraie petite tragédie illustrant le choc des cultures, comme on dit. L’histoire d’un esthète artiste (Julius), considéré comme un « Leonor Fini helvète », qui s’entiche d’un jeune Roumain faisant le trafic d’objets de toute sorte entre la Suisse et la Roumanie. Parfaite illustration de la montée aux extrêmes du mimétisme destructeur. Julius est prêt à renoncer à ses dessins « à chair » de nus masculins, qu’il n’ose montrer à Basile, pour envisager la peinture de tableautins alpestres que celui-ci pourrait revendre en Moldavie, une affaire à deux qui se concrétise d’abord par un prêt d’argent important de Julius, destiné à l’achat d’un terrain où pourrait s’établir une galerie d’art-hangar à ferraille, et que le Roumain détourne à son profit pour construire une COOP. Cette histoire sordide, qui me rappelle un fait divers criminel, est élevée au rang d’une sorte de fable et d’une façon de poème rappelant les thèmes de Cavafy, du subtil esthète convoitant de belles brutes, etc.
°°°
Quant au livre d’Antonin, qui me semble son premier vrai roman, il marque lui aussi une étonnante extension des qualités de perception et d’expression de l’écrivain, dont les influences littéraires multiples (de Robert Walser, de Thomas Bernhard ou de Peter Handke, notamment) tendent à se fondre dans une écriture plus personnelle.
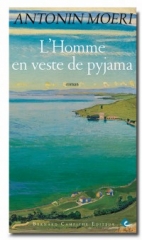
Après un premier regard traversant un peu sceptique, c’est avec un intérêt croissant, et même plus vif que pour ses derniers livres, que j’ai continué de lire L’Homme en veste de pyjama, qui me semble maîtriser sa matière (romanesque en l’occurrence) avec plus de verve et d’originalité, de qualités inventives dans l’écriture et de pénétration, quant au thème, que dans ses ouvrages précédents. Il y va ! Il s’en donne !
Ce vendredi 17 novembre. – Encore un peu secoué ce soir, et la jambe droite très douloureuses, après avoir failli m’écraser moi-même contre le mur de pierre de taille avec notre transporteur à chenilles que je manipulais en marche arrière et que je n’ai pu arrêter après avoir été déséquilibré.
On imagine le tableau : JLK crevant de s’écraser lui-même ! Mais Sophie, attirée par mes cris, a juste eu le temps de retenir la machine qui n’a fait, de sa chenille gauche, que me remonter le long de la jambe droite, avant de lâcher un soupir de résignation…
°°°
L’alcool est à la fois aiguiseur de couteaux et démon décréateur, agent de dilution et de dispersion à la funeste façon de la drogue, comme il en va de l’obsession sexuelle. Une dose de trop et c’est la vague, puis la noyade dans le vague de l’indétermination. Une fois de plus : question d’équilibre et d’énergie résistante – de refus de sombrer
°°°
Autant la positivité béate m’insupporte, autant j’en viens à me défier de la négativité à tout crin de certains, dont on dirait que le pire les réjouit. Je suis décidément un réaliste, et la réalité n’est pas si noire et désespérée que le prétendent ceux-là, ni aussi mornement merveilleuse que le prétendent les euphoriques.

En fait, il me suffit de revenir à nos fenêtre grand ouvertes, puis de faire un tour dans mes bibliothèques pour retrouver le sens commun qui m’est propre, hérité des miens et de ceux en qui j’ai reconnu mes bons conseillers, de Tchékhov à Annie Dillard, en passant par le Bon Will et René Girard, entre tant d’autres.
°°°
Un rêve m’a permis cette nuit de m’entretenir bien amicalement avec un maître à voir qui dessinait comme personne : que des choses justes et belles. Il m’a rappelé notre maître de dessin du collège, un Monsieur Gauthey aux cheveux assez longs mais toujours cravaté de laine, qui m’a aidé à mieux voir la peinture et m’a encouragé dans mes premiers tâtons. C’est lui, je crois qui m’a fait aimer Utrillo, le premier de mes peintres préférés. Son souvenir m’est plus tendre que celui d’aucun(e) de nos profs de l’époque.
°°°
Ensuite j’ai repris la lecture de Fleur Jaeggy. Ensuite j’ai composé un poème sur le thème de l’enfant au toton :
L’enfant au toton
Quand le temps est fini,
nous continuons de veiller;
les objets restés seuls
se sentent un peu à l’abandon,
mais qui peut en parler ?
Nul ne l’a appris à l’enfant.
Nul ne sait ce que dit la chaise
à la lampe allumée,
dans la pièce d’en haut,
où le silence paraît régner.
L’enfant seul contredit
ce que tous ont l’air de penser:
tous enterrés vivants,
tous satisfaits d’on ne sait quoi,
tous repus de néant,
- aveuglés de leurs seuls regards.
L’enfant seul fait tourner la table
tandis que nous veillons...
°°°
Le jeune écrivain est assez naturellement con. Puisse-t-il rester jeune.
Ce jeudi 23 novembre. – La visite de nos jeunes Américains nous a permis, une fois de plus, d’évaluer la qualité de nos liens familiaux, sans la moindre ombre ni le moindre trouble, non plus qu’aucune sentimentalité excessive. Nous sommes justes, me semble-t-il. Toutes nos relations, autant avec S. et F. qu’avec J. et G., sont équilibrées et justes.
Ce mardi 28 novembre. – J’ai repris et achevé ce matin ce poème qu’on peut dire tranquillement métaphysique, n’est-ce pas, à la fois tout limpide et obscur, mélange de jour blanc et de trou noir, qui suscite aussitôt de bonnes réactions dès que je le mets en ligne – comme quoi…
Au bord du ciel
On sort afin de prendre l’air.
Le cosmos est tout près :
il suffit de lever les yeux.
Quatrième dimension:
le temps se verra conjugué
à son corps défendant.
De l’abîme inversé
s’étoilent les cosmogonies.
Tu ne t’es pas vu naître,
toi qui prétends tout expliquer
mais on t’a raconté
le dais du ciel à neuf étages,
le Seigneur à l’attique
et les atomes inquiets -
on parle de carnage...
On chine dans le savoir,
et par le ciel au ralenti
les bolides vont clignotant
dans la lumière noire.
On croit voir l’infini,
et nos atomes, nos étoiles
ajoutent au récit
du grand livre des vents.
Le ciel n’est peut-être qu’un mot,
mais en est-on capable ?
(À La Désirade, cette nuit de novembre 2017.)
À l’atelier de la ruelle du Lac. – Chaque fois que je passe en ce lieu, qui m’est un autre territoire d’immunité, je me dis que je pourrais vivre une autre vie au milieu de tous ces livres, comme je l’ai vécue, seul, au Grand Chemin puis à la Malmeneur, dans les années 70, ou dans mon antre des escaliers du Marché, jusqu’en 1982, avec un peu de whisky et quelques biscuits, à l’écart, tout ça comme nous le sommes en harmonie à La Désirade ou comme je le suis, seul là encore, à l’isba. À chaque fois, cependant, que j’y reviens, me prend comme une paradoxale nostalgie du présent, si j’ose dire – thème possible d’un autre poème.
Le hasard, à l’atelier, me fait tomber sur Ariel de Sylvia Plath, qui me parle aussitôt. Comme Fleur Jaeggy et Laura Kasischke, Plath est une espèce de fée-sorcière - autre thème de poème.
°°°
Annie Dillard écrit que les poètes lisent de la poésie et que les romanciers lisent des romans, mais ça se discute. Et j’aime assez cette formule : «ça se discute ». Non pas « ça dépend», que je trouve mol et presque lâche, et surtout pas «des goûts et de couleurs », mais « ça se discute », qui va vers l’éclaircie - et décidément je me sens éclaireur.
°°°
Au contraire de Guido Ceronetti, je pondère, et le relativisme féminin de Lady L. n’est certes pas étranger à cette façon de ne pas tout pousser au noir et à la catastrophe, qui ajoute finalement à l’irrespirable et à l’invivable.

Commentaires
Brillant ! Quelle belle traversée de tous ces livres. J'en ai lu certains , mêmes impressions. Je retiens les autres. Merci Vraiment. Un blog qui donne envie.
Merci de votre attention, chère Christiane. Et belle fin d'année sous les cocotiers enneigés.