
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.


Celui qui s’est éteint sous ses diplômes / Celle qui répète qu’on est comme on naît / Ceux qui sont retraités de naissance / Celui qui montre son savoir à celle qui n’en veut rien savoir / Celle qui tient un registre de Pensées Positives / Ceux qui en ont toujours su assez à les en croire / Celui qui reconnaît qu’il a encore tout à découvrir en matière de physique des trous noirs / Celle qui se targue de savoir qu’elle ne sait rien sauf la recette de la gelée de coings / Ceux qui titubent dans la clairières aux fées de la Connaissance / Celui qui a cessé de lire « pasque ça sert à rien » / Celle qui s’est trouvé un hobby où « y a pas besoin de réfléchir » / Ceux qui ont le cœur comme du biscuit sec / Celui qui a tout misé sur le déplacement de son bureau en façade sud du building de l’Entreprise / Celle qui attend sa nomination de responsable du Planning des Locaux de l’Entreprise / Ceux qui caftent à la cafétéria / Celui qui prend une femme de ménage de couleur pour mettre de l’ambiance dans l’immeuble du Facho / Celle qui défend la concierge mulâtre malgré ses positions rétrogrades au niveau du couple / Ceux qui estiment qu’un livre est un outil qui permet de rompre notre part de glace / Celui qui se figure le Paradis comme une Grande Librairie donnant sur la mer / Celle qui aime la fraîcheur sucrée des matins de janvier à Venice Los Angeles / Ceux qui voyagent autour de leur chambre On the Road / Celui qui se trouve chez lui partout même chez lui / Celle qui aime la musique des conversations avec les divorcés / Ceux qui ont cultivé leurs souvenirs érotiques dès leur jeune âge et même parfois avant / Celui qui s’adresse à ses concitoyennes et concitoyens en pensant connes et connards / Celle qui affirme que Marc Levy écrit pour tous sans avoir jamais ouvert aucun de ses livres ni vu les films qu’ils ont inspiré / Ceux qui évoquent le « parfum d’éternité » des Classiques qu’ils se promettent de lire quand ils auront le temps, etc.
Image : Philip Seelen
 À propos des cuistres et de Jacques Mercanton à Pattaya...
À propos des cuistres et de Jacques Mercanton à Pattaya...
Le problème de la critique littéraire de type universitaire, notamment en Suisse romande, c’est qu’elle est le fait de types, ou de typesses, qui n’ont rien vécu, ou qui ne laissent rien filtrer ce qu’ils ont (un peu) vécu dans leur approche et leur interprétation des textes.
Or ces gens-là, corsetés dans leurs préjugés moraux ou scientistes, tout ficelés dans leurs bretelles théoriques ou leurs jarretelles pratiques, prétendent non seulement sonder le tréfonds du sous-texte et détailler ses moindres composants génétiques (le problème essentiel de la couleur de l’encre et de la marque du laptop), au détriment croissant du contenu patent ou latent du texte, sans parler de l’éventuelle visée de l’auteur, mais montrer, subventions à l’appui (dans l’accumulation capitale desquelles il excellent en tant que chercheurs), qu’ile en savent infiniment plus que l’autrice Une telle ou l’auteur Untel.
Rabelais les avait joliment épinglés du temps des sorbonnicoles et autres sorbonnagres, et Molière a renchéri contre les savantasses de son siècle, maison s’étonne que la saine moquerie se fasse si rare en nos temps de prétendue liberté d’esprit et de prétendue dérision d’un peu tout. Hélas, où sont les jeunes insolents qui renoueraient, même en Suisse romande, avec la verve irrespectueuse des sieurs Burnier et Rambaud dans leur mémorable Roland Barthes sans peine ou dans La Farce des choses ?
Or le constat devrait stimuler le désir de pallier à ce manque, dans la foulée d’autres entrepreneurs de démolition, de Léon Bloy dans son Exégèse des lieux communs, à Karl Kraus en son effort de dénazification avant la lettre de la langue allemande. On cherche satiristes et pasticheurs ! Les offres sont à envoyer au Centre de Rumination sur les Langueurs Romandes à droite quand vous sortez de l’autoroute Lausanne - Geneva Airport.
Ce qu'attendant, nous nous résignons à prendre connaissance, bientôt, du nouvel essai de décryptage socio-linguistico-génétique des sieurs Maggetti et Meizoz, qui planchent ces jours sur un inédit apocryphe des Mémoires de Jacques Mercanton évoquant la dernière virée du Maître dans les bars de go-go boys de Pattaya, à la veille de ses 80 ans...
En mémoire d’ Adrien Pasquali C'est un petit livre dense et déchirant que Le pain de silence d'Adrien Pasquali, où s'exprime la souffrance si difficilement dicible de la non-communication. La situation est à la fois banale au possible et terrifiante. Trois êtres vivent ensemble que tout réunit quotidiennement, et qui ne trouvent rien à se dire. Le père, Italien de souche, est ouvrier dans les chantiers de montagne. Rentrant le soir, il ne paraît capable que de marmonner deux ou trois phrases répétitives, entre son arrivée au pas lourd et la cigarette de fin de repas. La mère, maladive, se recroqueville pour sa part dans son intérieur où elle «fait» la poussière en robe de chambre avant de retourner au lit, non sans donner rageusement la chasse aux mégots de son conjoint. Par rapport au monde extérieur, tous deux se font petits en sorte d'échapper au «harcèlement vipérin» de voisins prompts à leur rappeler qu'«on n'est pas à Naples, ici», surenchérissant alors dans le genre suissaud en s'effrorçant de «parler plus doucement».
C'est un petit livre dense et déchirant que Le pain de silence d'Adrien Pasquali, où s'exprime la souffrance si difficilement dicible de la non-communication. La situation est à la fois banale au possible et terrifiante. Trois êtres vivent ensemble que tout réunit quotidiennement, et qui ne trouvent rien à se dire. Le père, Italien de souche, est ouvrier dans les chantiers de montagne. Rentrant le soir, il ne paraît capable que de marmonner deux ou trois phrases répétitives, entre son arrivée au pas lourd et la cigarette de fin de repas. La mère, maladive, se recroqueville pour sa part dans son intérieur où elle «fait» la poussière en robe de chambre avant de retourner au lit, non sans donner rageusement la chasse aux mégots de son conjoint. Par rapport au monde extérieur, tous deux se font petits en sorte d'échapper au «harcèlement vipérin» de voisins prompts à leur rappeler qu'«on n'est pas à Naples, ici», surenchérissant alors dans le genre suissaud en s'effrorçant de «parler plus doucement».
Or c'est dans cet univers confiné, voire irrespirable, du «chacun pour tous, tous pour personne» que doit vivre l'enfant jamais bordé, jamais caressé ni même regardé et qu'un bloc de silence oppressant sépare de ses parents. «Jamais personne ne s'est penché sur mon lit», remarque le garçon qui fait plutôt office de garde-malade aux petits soins de sa mère dolente, incapable de s'extérioriser et s'interdisant toute forme de jeu. Est-ce vraiment sa mère qui, un jour, lui a dit cette terrible petite phrase, «sans doute n'as-tu jamais été un enfant», ou bien sa propre douleur a-t-elle cristallisé ces mots qu'il retrouve dans les yeux tristes de celle qui l'a mis au monde ? Peu importe à vrai dire, car tout ce passe ici dans une sorte d'infra-langage où les mots ont d'ailleurs peu de rapports vivants avec les choses.
Rarement on aura donné, au silence de la non-communcation, une présence aussi palpable, aussi matérielle, aussi tangiblement physique que dans ce livre qui tend essentiellement à la transmutation, physique elle aussi (montée des corps paralysés), mais à la fois affective et spritituelle du non-dit en parole ouverte. Avec une sorte de rage obsessionnelle, travaillant en vrille comme le forage discursif d'un Thomas Bernhard, l'écriture d'Adrien Pasquali paraît ici du dernier recours, qui ressasse et rassaisit les éléments de la relation manquée en quête d'un pardon mutuel ou d'une guérison. D'abord un peu rebutante, même astringente dans ses tâtons phénoménologiques, la litaniqe de Pasquali (qui ne compte qu'un point intermédiaire entre deux coulées de prose, comme si l'arrêt risquait de faire le jeu du silence ou de la mort) trouve bientôt son rythme naturel et sa nécessité vitale, haletante et de plus en plus maîtrisée du point de vue musical.
De la hargne première qui dit sa révolte contre un engluement rappelant celui du Roquentin de La Nausée, le narrateur en déficit de tendresse (qui affirme cependant manquer moins de l'amour qu'il n'a pas reçu que de celui qu'il n'a pas donné) tend à un retournement salvateur, traversant les mots et les choses, qui le fait rejoindre l'enfance de son père et les espérances déçues de sa mère, pour renaître symboliquement de la poussière des jours. La fin du livre d'Adrien Pasquali, orientée par cette fragile et pure lumière intérieure, rejoint alors le silence après l'avoir fertilisé, et nous atteint par delà les eaux sombres.
Adrien Pasquali, Le pain de silence. Zoé, 123pp.
Adrien Pasquali s'est donné la mort à Paris le 23 mars 1999, à l'âge de 40 ans
Flash back sur un hommage post mortem, daté de 2005, à Saul Bellow.
C’est l’un des romanciers majeurs du XXe siècle qui s'est éteint récemment en la personne de Saul Bellow, à l’âge de 89 ans à Brookline (Massachussets), cinq ans après la naissance de sa dernière fille, Naomi, née en 1999 ! Ce nouveau rameau jeté au formidable tronc de la vie et de l’oeuvre du fringant vieillard précédait de peu la parution d’un livre d’une merveilleuse liberté, marquant une fois de plus, dans le mouvement tourbillonnant de la vie, la fusion de l’intelligence et de l’émotion en pleine pâte. L’ouvrage s’intitulait Ravelstein (2002) et parlait de nos fins dernières avec autant de truculence que de gravité, le narrateur (double présumé de Bellow) brossant le portrait de son ami Ravelstein (double du grand humaniste réactionnaire Allan Bloom) en train de mourir du sida. Mélange de roman foisonnant et de débat sur les grandes questions traitées comme en dansant (« Dieu m’apparut très tôt. Il avait la raie au milieu. Je compris que nous étions apparentés parce qu’il avait créé Adam à son image »...), autoportrait « en creux » et déclaration d’« amour vache » à la vie, ce livre dégageant une immense sympathie donnait une belle idée de la constante capacité de l’écrivain à se dépasser et se renouveler sans se renier pour autant, comme l’illustrent les bonds successifs de son oeuvre. Celle-ci ponctue la deuxième moitié du XXe siècle de livres qui fondent, d’une part, le roman juif américain (lequel sera chez Bellow plus américain que juif), et déploient une fresque humaine d’une prodigieuse porosité, nourrie par le milieu populaire d’émigrés juifs dans lequel l’écrivain a passé ses jeunes années, à Chicago. Après deux premiers romans assez sages, L’homme en suspens (1944) et La victime (1953) encore marqués par la vision du “souterrain” de Kafka et Dostoïevski, la première explosion du talent de Bellow s’est manifestée dans Les aventures d’Augie March (1953), biographie épique et rhapsodique d’un orphelin d’origine russe, rappelant Huckleberry Finn en version juive, et qui ressaisit la langue avec une volubilité tentaculaire et une voix sans pareille. En contrepoint, très significatif des antinomies propres à Bellow, suivra le bref et beau roman mélancolique Au jour le jour (1956), dont le protagoniste est un quadra rejeté par son père et en crise existentielle. Nouvelle brusque rupture d’un grinçant comique, ensuite, avec Le faiseur de pluie (1959) et sa dérive africaine d’un milliardaire fuyant son milieu comme un personnage à la Simenon. Après quoi viendra cet autre très grand livre: Herzog (1964), dont le héros concentre en lui toutes les contradictions et figure, selon Philip Roth, « le plus grande création de Bellow, le Leopold Bloom de la littérature américaine », marquant en outre la première plongée de Bellow dans l’océanique réalité du sexe. Roman de formation ramassé sur cinq jours de l’été 64, Herzog est le plus ambitieux et le plus beau, le plus profus des romans de Bellow, très marqué par les sources européenes (notamment de Thomas Mann, Italo Svevo et Robert Musil) mais restant curieusement assez peu lu du public de langue française... Si la reconnaissance du prix Nobel de littérature, en 1976, a consacré l’oeuvre d’un formidable romancier doublé d’un essayiste de haute volée, dont l’esprit critique n’a cessé de s’exercer contre toutes les manifestations du « crétin américain », du maccarthymse de droite au politiquement correct de gauche, la réception de Saul Bellow, en France notamment, demeure en effet sporadique alors que des auteurs de moindre format y sont célébrés. Or, tant par sa substance que par son empathie, l’intelligence anti-académique de sa perception et l’humour shakespearien qui la traverse, l’oeuvre de Saul Bellow, dont on recommandera encore les nouvelles réunies dans Mémoires de Mosby et le petit régal d’insolence d’ Une affinité véritable , reste à redécouvrir après la dernière révérence du vieux rebelle. « Regardez-moi, je vais partout ! Je suis un Christophe Colomb de quartier ! » s’exclamait crânement Augie March. Alors, oublions le quartier clôturé et sécurisé de Bush & Co, pour retrouver l’Amérique généreuse de Saul Bellow !

Théo a les mains de son âge, quoique pures encore de ce qu'on appelle des fleurs de cimetière, et se mettre à présent à les dessiner vraiment serait un recommencement de purification par le geste, comme au temps de leur dire bonsoir sur le drap quand on a dix ans et qu'on est bien coiffé et bordé, ce que ne fut jamais Théo en son enfance ravagée par la guerre, mais il priait alors de ces mêmes mains avec des gestes appris de sa mère disparue ou de ce qu'on lui a dit alors de ce passé resté confus, sans père non plus, aux soins d’un cher oncle excentrique mais bon dans les brouillards de Londres - souvenirs tendres du vieux Cary et de ses oiseaux, de vilains souliers troués, de soupières fumantes et de froids ardents le long des hangars.
Dans une vie antérieure, Théo se verrait assez bâtisseur de cathédrales : une paire de mains parmi d’autres, obéissant à Dieu sait quel plan.
Cette question des mains l’a toujours intrigué. Que les mains puissent avoir leur façon de penser et leur agissement point forcément réfléchi, en tout cas distinct de la Raison, lui apparaît comme un fait aussi étrange que ses propres goûts et dispositions en la matière.
Son oncle Cary fut le premier à le constater et à parler de don, puis à le signaler à son compère Gulley Jimson, ce gibier de police dont Théo se rappelle les longues mains fines jurant sur ses hardes de peintre crevant la faim, et voici que lui reviennent les farouches recommandations du vieil artiste le houspillant à chaque fois qu’il s’en revenait rôder aux abords de son antre du bord du fleuve.
« Tout art est mauvais, petit ! » lui répétait-il, « et maintenant filez !»
 Cependant Théo se faufilait jusqu’au pied de l’immense toile dont le peintre venait de retoucher le serpent bleu, non sans poursuivre son invective : «L’art, la religion et la boisson, voilà trois trucs qui vous démolissent un pauvre bougre, mais filez donc et pensez plutôt à devenir un Monsieur ! »
Cependant Théo se faufilait jusqu’au pied de l’immense toile dont le peintre venait de retoucher le serpent bleu, non sans poursuivre son invective : «L’art, la religion et la boisson, voilà trois trucs qui vous démolissent un pauvre bougre, mais filez donc et pensez plutôt à devenir un Monsieur ! »
Or Théo ne voyait, à ce moment-là, que les mains du vieil artiste qui frémissaient encore d’avoir ajouté quelque infime touche verte dans la coulée blanche de la chair de notre mère Ève...
(Extrait d'un roman en chantier)

Celui qui attend les résultats / Celle qui se demande quand le verbe s’angoisser est devenu ce qu’il est / Ceux qui se massent à la frontière sud / Celui qui espère avoir son « entrée » dans l’Encyclopédie chinoise / Celle qui reprend la théorie du complot à son compte avec l’arrivée dans le quartier des Bleuets des réfugiés sûrement de mèche avec le califat / Ceux qui parlent fort dans le souterrain au point que ça s’entend dehors / Celui qui veut sortir de l’euro pour entrer dans la pesète / Celle qui a fait un prêt à son coiffeur Tsipras qui propose maintenant de la raser gratis / Ceux qui analysent la situation géopolitique et en tirent une théorie du chaos qui éclaire tout / Celui qui ne sait comment gérer son épouse Frieda qui fait de l’évasion fiscale à son insu / Celle qui collecte des dons pour le soutien des épouses larguées par les chercheurs en littérature romande / Ceux qui consacrent une minute de compassion aux migrants de la Méditerranée avant de poursuivre leurs travaux en génétique du sous-texte / Celui qui se met en peine de se farcir les 616 pages de Tout peut changer de Naomi Klein en prenant garde de ne pas se le lâcher sur le pied gauche après s’être amoché le pied droit avec les 476 pages du magistral Tu dois changer ta vie de Peter Sloterdijk / Celle qui a entendu dire que Naomi Campbell avait publié un essai sur le gaz de schiste et tout ça / Ceux qui vont installer une hotte de ventilation dans le cagibi qu’ils louent aux Syriens clandestins / Celui qui admoneste la requérante d’asile qu’il a surprise à voler Le Temps au tea-room Chez nous en lui faisant comprendre que chez nous on ne vole pas le temps / Celle qui a mis tous ses œufs dans le même panier qu’elle couve maintenant du regard / Ceux qui invoquant la situation internationale punaisent sur leur yourte le feuillet portant ces mots en turkmène :« Non, nous ne jouons plus au loto », etc.
Peinture: Pierre Lamalattie

De son côté, Lady Light s’inquiète du sort de Katmandou.
Après que Jonas lui eut appris que Chloé, spy-doctor spécialisée en chirurgie dramatique, et Cécile, forte de sa riche expérience des amenées d’eau en zones sinistrées, Lady Light n’eut de cesse, tous les jours, d’obtenir de nouvelles informations précises sur les séquelles de la catastrophe et le travail effectif des filles de Théo et Léa sur le terrain.
Comme l’ont vérifié tant de fois ses proches, l’extrême souci d’exactitude et de précision de la vieille aveugle a toujours été une composante essentielle de son approche personnelle, comme l’illustre, aussi bien, le récit qu’elle a fait récemment à Jonas de cet épisode saisissant de l’obscurcissement soudain du ciel par la sombre nuée de milliers de renards volants au soir de l’assassinat du nouveau prince, un jour qu’elle se trouvait à Katmandou avec Christopher.
De même montra-t-elle le plus vif intérêt lorsque Jonas lui rapporta, quelques mois auparavant, les détails d’une action à laquelle avait participé Cécile en Guinée-Bissau , consistant en l’installation d’un vaste réseau de canaris à robinets, auxquels Florestan le mal rasé, au titre d’ingénieur polyvalent, avait amené de significatives améliorations.
Lady Light, prodigieusenent attentive aux détails insolites, cocasses ou mystérieux, du monde en tant que tel, ne l’était pas moins, et plus encore peut-être, à la singularité des gens, à leurs coutumes et à leurs douleurs, à leurs croyances et mécréances, à ce qu’ils enduraient par la faute de leurs semblables ou, comme il en allait des sans-abris de Katmandou, à ce qu’ils subissaient en groupe ou cas par cas des suites d’un désastre échappant à toute planification humaine.
Du fait de sa propre expérience médicale, que ses rallonges d’activité auront fait avoisiner le demi-siècle, Lady Light ne s’étonna guère de la gabegie politique et policière qui avait freiné l’aide aux sinistrés, ainsi que le rapportait Cécile dans l’un de ses courriels à Jonas,mais un détail des récits de la jeune humanitaire free lance la frappa plus précisément, observé le soir suivant la première secousse de haute magnitude, lorsque Cécile et Flo le mal rasé s’étaient trouvés autour d’un feu en compagnie d’une trentaine de locaux sur Jamal Sadak Road où, tout à coup, les fils électriques liés à un pylône s’étaient mis à trembler, signe précurseur connu d’une possible réplique du séisme.
Quant aux gens, estimait en outre Lady Light, ils resteront toujours, et où qu’on aille, aussi indécrottablement touchants qu’imbéciles, tel l’inénarrable Clancy, factotum et surveillant autoproclamé de son immeuble de Brooklyn Heights quand, l’entendant parler de la tragédie de Katmandou avec Jonas, dans l’ascenseur à poulies les descendant de leur cinquième étage, il crut bon de marmonner , à sa façon de prophète chafouin, que sans doute les Népalais avaient dû pécher gravement pour que Dieu leur infligeât ainsi crainte et tremblement…
Katmandou s’était considérablement développé depuis les années où, cheveux longs et idées vagues, des milliers de jeunes compatriotes de Lady Light (dont certains de ses camarades de fac en mal deNirvana) avaient débarqué là-haut pour y fumer le chillum et prononcer des incantations dans quelque ashram, avant de poursuivre sur Goa.
Or ces menées orientalisantes des sixties, plus ou moins enjolivées par la tradition orale et divers livres-cultes, n’avaient pas eu la moindre influence sur le choix de Cécile et Chloé de s’engager avec leurs compagnons, mais les sanctuaires effondrés, les boutiques de la vieille ville réduites en miettes, les quartiers dévastés à côté d’autres qui semblaient avoir été protégés par qui sait quelle puissance supérieure dont le sieur Clancy semblait entrevoir le motif des décisions, et surtout les gens, plus ou moins affolés ou affichant au contraires des airs insouciants, qui affluaient en masse sur l’esplanade de Tundikhel pour fuir leurs bâtisses menacées d’effondrement, ne les avaient pas moins touchées les premiers jours, avant la mise en place d’un début d’action concertée où elle s’étaient senties parties utiles d’une vrai mouvement de bénévolence collective (surtout Chloé requise dans l’arrière-pays par les services d’urgence) qu’elles avaient largement commentée dans leurs courriels quotidiens à Léa, sans en rien laisser filtrer sur Facebook.
À propos de la réaction de l’insortable Clancy : La lectrice et le lecteur auront peut-être conclu à la stupidité exceptionnelle d’un individu particulier en prenant connaissance du jugement du dénommé Clancy, incriminant la responsabilité des Népalais dans le déclenchement du séisme du 25 avril 2015 et de ses répliques. Or l’explication punitive de Clancy, inspirée par une conception traditionnelle de la Justice divine, fut maintes fois reprise, et dans toutes les langues, sur la Toile, par les internautes de l’Oecumène mondial également convaincus que Dieu n’en finit pas de châtier l’Infidèle, alors que d’autres opinions non moins assurées invoquaient la vengeance de Gaïa ou le contrecoup, scientifiquement avéré, des atteintes réitérées aux sols profonds, par les prédateurs multinationaux de l’or noir et leurs suppôts. Mais sait-on seulemnent s’il ya du pétrole en Himalaya ?
(Extrait d'un roman en chantier)
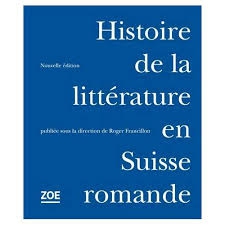
La nouvelle édition de l’Histoire de la littérature en Suisse romande (Zoé, 2015) illustre le conformisme et le copinage qui règnent dans nos régions, juge l’écrivain Sergio Belluz. Bravo à cet esprit indépendant, après Etienne Barillier dans Soyons médiocres ! d'avoir cassé le morceau contre les cuistres et les éteignoirs de la fac des Lettres de Lausanne et environs, foyer morose de l'entreprise en son mouroir du Centre de Recherches sur les Lettres romandes. À lire dans Le Temps du jeudi 25 juin 2015.

Etre écrivain en Suisse romande? Hors de l’Université, point de salut
Par Sergio Belluz
Ce «en» Suisse romande, c’est la grande nouveauté de cette Histoire de la littérature en Suisse romande (Genève-Carouge: Zoé, 2015), avec l’inclusion du polar, de la science-fiction, de la BD, de la chanson et des «études de genre» dernier cri. Du solide travail universitaire: un index scrupuleux (on y trouve Sacha Distel, c’est dire), une bonne bibliographie, et mille sept cent vingt-huit pages cofinancées par l’Office fédéral de la culture, les cantons romands, quatorze cantons suisses alémaniques, dont Uri, Schwyz, Glaris, Appenzell Rhodes-Extérieures (par solidarité protestante?) et «Unterwald-Le-haut» (sic), le tout complété par la Loterie Romande, des banques et des fondations, dont la Fondation Sandoz (Maurice Sandoz a droit à sa grosse notice). Au final, combien de millions pour ce ravalement de façade.
Car il s’agit d’une mise à jour des quatre volumes publiés chez Payot-Nadir dans les années 1996-1999. On a rafraîchi les trois premiers, et c’est surtout le quatrième, La Littérature romande aujourd’hui (de 1968 à 1999), qui a été retravaillé dans les quatre cents dernières pages, moins d’un quart de l’ouvrage: de nouveaux auteurs y sont entrés, et on a complété les notices des autres. L’ambition: «Un ouvrage de référence qui fasse le point sur l’état de nos connaissances dans ce domaine et qui envisage dans la continuité historique la production littéraire romande du Moyen Age à nos jours», selon l’introduction de l’historien Roger Francillon, auteur de la plupart des brillantes synthèses qui introduisent chaque partie.
Premier problème: parler, par exemple, de «production littéraire romande» au Moyen Age souligne l’anachronisme du terme «romand», un concept politico-culturel limité dans le temps (1830-1970, en gros).
Francillon, dans le premier chapitre, évoque, d’ailleurs, la «vie religieuse de Suisse française» (p. 12) et, dans la partie «Au temps des réformateurs», remarque que le terme de «Romandie» a été inventé au XXe siècle (p. 35). François Rosset, de l’Université de Lausanne, parle de «Suisse occidentale» (p. 159) et de «la vie intellectuelle de la Suisse francophone au XVIIIe siècle» (p. 170).
Deuxième problème: le titre. La BD, la chanson ou les études de genre sont-elles à leur place? S’agit-il de littérature lorsqu’on parle des réformateurs (Calvin ou Viret) ou des médecins (Tissot ou Tronchin)? Ne pouvait-on pas resserrer la grosse partie sur les pasteurs et leurs bisbilles, tout sauf littéraires? Et que vient faire ici l’article «Les écrivains étrangers en Suisse romande» (Rolland, Istrati, Chardonne, Rilke, Gide, Cocteau), dans lequel on trouve aussi Stravinsky, assez peu écrivain… Un titre englobant du style «Histoire de la vie culturelle en Suisse de langue française» aurait été plus adéquat, sur le modèle du brillant La Suisse romande au cap du XXe siècle: portrait littéraire et moral de Berchtold (Lausanne: Payot, 1966).
Troisième problème, majeur celui-là: quels sont les critères pour définir ce qui est littéraire? Si chaque histoire de la littérature a sa part d’arbitraire et d’idéologie ambiante, il y a deux méthodes pour l’envisager: en tant que phénomène de communication, et alors toute production littéraire est intéressante, sans jugement de valeur; ou avec des critères précis et on écarte ce qui n’en fait pas partie. Ici, on alterne allègrement les deux, dans un conformisme et un copinage universitaire qui sont une constante de nos régions. Maryke de Courten, dans son chapitre sur Cingria, remarque qu’il «ne s’est jamais soucié de systématiser sa pensée. Est-ce pour la même raison qu’il a été ignoré par l’intelligentsia romande, pour qui le sérieux a longtemps été la valeur la plus sûre?» (p. 716). L’intelligentsia romande n’a pas changé, hélas: dans cette Histoire de la littérature en Suisse romande, l’hilarant Henri Roorda, un de nos plus grands écrivains, entre Allais et Vialatte, n’a droit qu’à dix renvois et une misérable notice dans le chapitre «L’Ecrivain et l’école»; Anne Cuneo est noyée dans «Le Roman et l’histoire», au mépris de ses brillants récits autobiographiques; Jean-Louis Kuffer (quinze renvois) est expédié vite fait comme «lecteur passionné» malgré son journal littéraire, une référence; Janine Massard, auteure de douze livres magnifiques sur une Suisse intime et populaire, fait l’objet de huit petits renvois, tout comme Jean-Michel Olivier, sa verve et son humour, qui n’ont droit qu’à une modeste notice.
En revanche, Daniel Maggetti, Jérôme Meizoz ou Adrien Pasquali, contributeurs universitaires de cette Histoire, font l’objet de plus de trente citations à l’index et de trois notices chacun…
En littérature suisse de langue française, sans université pas de talent ni de salut. Et l’avenir est sombre: le chapitre final, qui explore les possibles développements de notre littérature, s’intitule, sans rire: «Connexions, filiations et transversalités».
Post scriptum perso: Lorsque je me suis pointé en Lettres, en 1966, ce fut pour entendre la face de carême du Doyen de l'époque. Gilbert Guisan, nous annoncer que ceux qui aimaient la littérature allaient déchanter en ces lieux, vu qu'on y étudierait une Science de manière scientifiquement scientifique. Depuis, lors, après la bigoterie protestante, la bourdieuserie est devenu la doctrine des nouveaux chiens de garde, réduisant la littérature à un sociologisme réducteur qui a fait école partout. Il faudra revenir un jour sur l'entreprise de formatage savantasse, menée à grands frais par des chercheurs ramuziens autoproclamés, que constitue l'édition critique des Oeuvres complètes de Ramuz, parues chez Slatkine, véritable sottisier du pionnicat pseudo-scientifique gouverné par Roger Francillon et Doris Jakubec, Daniel Maggetti et autres joyeux drilles aux faces de fossoyeurs...
Mais quel bonheur de lire et d'écrire loin de ces bonnets de nuit !
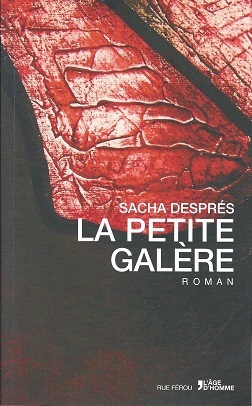
Sacha Després signe, avec La petite galère, un premier roman d’une densité émotionnelle et d’une qualité d’écriture rares. Avec Quentin Mouron, Mélanie Chappuis, Antoine Jaquier, Max Lobe, Dunia Miralles et Julien Bouissoux, notamment, la jeune romancière achoppe à une réalité sociale et psychologique très actuelle en maîtrisant une langue-geste tissée d'oralité.
On ressort sonné de la lecture de La petite galère de Sacha Després, dont le crescendo dramatique aboutit à un dénouement réellement déchirant où réalité brute et folle détresse, violence et désarroi, souffrance incarnée et projections fantasmatiques se bousculent dans une mêlée qui prend aux tripes et au cœur.
Or le plus étonnant est que, d’un imbroglio affectif et psychologique exacerbé par l’abjection d’un des protagonistes – type de pervers narcissique bien cadré -, et par la haine vengeresse qu’il suscite, la romancière parvienne à tenir jusqu’au bout le fil (barbelé) d’un récit concis et cohérent, tout à fait intelligible en dépit de l'ambiante confusion des sentiments.
Très remarquable tableau d’époque, sur fond de crise sociale et de dérives individuelles, La petite galère, qui se déroule dans une Zone Urbaine Sensible de la région parisienne, détaille les tribulations de deux sœurs affectivement et sensuellement fusionnelles (Marie dite La Jolie, née le lendemain de la mort de Claude François, et Laura, sa cadette de seize ans, contemporaine du Club Dorothée…), marquées par le suicide de leur mère et confrontées, avec l’aide minable du chèque mensuel de leur père, à ce qu’on appelle la liberté.
Dès les premières « séquences » du roman, dont la découpe narrative évoque à la fois un storyboard cinématographique et une chronique très habilement agencée et datée par de brèves allusions aux événements du monde, l’écriture de Sacha Despés impressionne par son mélange d’efficacité et de sensibilité délicate, de vigueur et de finesse.
D’un monde présumé inculte, et sans une once de démagogie, elle dégage les mêmes sentiments délicats qu’a évoqués le cinéaste Abdellatif Kechiche dans L’Esquive, merveille de finesse et d’humour, ou encore Germinal Roaux dans Left foot right foot, alors que, littérairement parlant, l’on est ici dans la foulée d’un Olivier Adam ou d’une Virginie Despentes, ou encore d’un Samuel Benchetrit, sans références ni influences explicites au demeurant.
D’un point de vue stylistique, pour la manière très concentrée et souvent poétique de traiter ses très courtes phrases, Sacha Després rappelle aussi les récits noirs d’un Louis Calaferte ou les nouvelles incisive d’une Annie Saumont qui a capté, la première, les tournures de la langue des banlieues.
Là-dessus, il faut parler, en détail, du contenu de ce livre prenant et riche de mille observations pertinentes, parfois unilatéral dans son regard sur le sexe dit fort (tous les hommes du roman rivalisent de nullité), mais dont la rage des personnages féminins se justifie ô combien...
La Prairie
C’est un signe avant-coureur d’humour réjouissant que de voir un lieu tel qu’un grand ensemble bétonné d’une Zone Urbaine Sensible baptisé La Prairie. Bien entendu,le titre de Petite galère, dans le contexte de La Prairie, fait référence implicite à la petite maison de Michael Landon dont les épisodes agrestes réjouirent les téléspectateurs du tournant des années 70-80. Mais je retiens pour ma part l’ironie du nom, comme de voir un asile de vieux baptisé L’étoile du matin. Cerise sur le gâteau : lorsque, après une prise d’otages dans le collège de la cité, la narratrice constate le soir : « La Prairie passe à la télé. »…
Des gens peu « people »
Autant qu’elle a le sens du dialogue, souvent elliptique, Sacha Després a le don de silhouetter un personnage, sans le caricaturer, à quelques exceptions près. Au premier plan : Laura et Marie, leurs parents Caroline et Charles, le prof de français quadra-séduisant Wilder et l’ami de Marie Jacky Branlard, dit Jack.
On est là entre prolos et Français très moyens. Laura, 16ans, portée sur l’écrit perso, est déjà femme dans sa tête et son ventre, avec les infos utile de son aînée Marie, 26ans, barmaid et placeuse à l’Opéra Bastille, qui voulait devenir artiste et, à défaut, se lie à un plasticien bidon avant d’en pincer pour Jack, si « différent ».
De Caroline, employée des PTT et mère à 18 ans, on ne sait pas trop de choses avant son suicide, sinon qu’elle aura été aussi immature et perdue que son plouc de conjoint.
Charles, en effet, genre rocker ringard, n’a « jamais été à l’aise avec les sentiments », et sa seule défense est de traiter sa femme et ses filles de cinglées.
Wilder, première facette du pervers narcissique soft, incarne le prof esthète porté sur la nymphette ou la bourgeoise snob, selon l’occasion.
Jack, second avatar hard du pervers narcissique éduqué à la dure par un militaire et reproduisant la violence dominatrice d’icelui + les excuses hypocrites du dominant à « conscience politique », est à la fois un branleur et un vampire. Du point de vue romanesque, le lascar sort du lot par son abjection.
La story
Culturellement de la génération des consommateurs de films et de séries télévisées, comme un Quentin Mouron, Sacha Després se donne la peine de filer une intrigue qui tienne la route, à la fois dans le synchronique et le diachronique.
Au présent de l’indicatif, la story – prioritairement celle de Laura – détaille une éducation sentimentale et sexuelle qui pourrait être aussi morne qu’un couloir de béton ou convenue qu’une cave à tournantes, mais la romancière corse son récit par de subtils glissements à travers le temps (bien daté par la citation d’événement d’actu précis) et les lieux ou les niveaux de réalité, entre réel glauque et fantasmes ou projections onirico-spirites.
Traversée des banlieues perçues comme un sinistre no woman’s land, le roman emprunte aussi ses codes au conte érotique (à la limite de l'esthétique convenue à mon goût), avec un point de fuite relevant du fantastique, marqué par la figure fantomatique de Clothilde.
En arrière-plan, quelques portraits vivement dessinés : Djamila l’Algérienne qui se débrouille avec quatre enfants et se console dans les bras de Touria, laquelle a fait de la prison pour s’être violemment défendue contre son jules agressif, désormais sur une chaise roulante. La mère bourgeoise de Nelly la rebelle, et celle-ci. Ou Alejandro l’artiste de pseudo-avant-garde, qui réinvente (40 ans après...) le happening sanglant alors que son collègue « découvre » l’art scatophile.
Thèmes
Au départ et au milieu de tout ça, quoi ? Banal au possible : le manque d’amour. Misère affective sur fond de médiocrité culturelle. Quelques petites phrases résument la situation. Au réveillon de ses douze ans, Laura s’entend dire par son père : « Tu sais ma grande, tu as été une erreur, autant que tu le saches ». À 4heures du mat, le 1er janvier 2000 quand les filles retrouvent leur mère suicidée aux médocs : « Caroline ne verra pas l’an 2000 ». Ou pour le couple « incarcéré » par ses enfants : « Ils auront désormais quelque chose à gérer ».
Autre thème : la déglingue sociale. Et pour exemple, l’état du collège, un « foutoir ». Tableau sévère : pp. 52/53. On se rappelle le livre de François Bégaudeau...
Et pour avaler ces arêtes: l’amour et le sexe. Assez miraculeusement, la génération de Youporn reste romantique « au fond », quoique très libre en apparence. Mais en l’occurrence, la « pureté » est du côté des filles, même jugées salopes par les mecs qui en usent. Pour en parler, Sacha Després ne manque pas d’humour. Ainsi quand Laura y va de son blow job dans la loge de l’opéra Bastille : «Le sexe du prof a un gout de cacahuète ». Ou non moins joli : « La bite est brûlante. On pourrait y faire cuire un œuf ».
Dans la foulée, le thème du ressentiment s’exacerbe dès l’apparition de Jack, qui deviendra très moral à proportion de la fermeté de Laura à lui résister. Là s’esquisse un personnage typique de l’époque qui pourrait nourrir tout un roman balzacien sur le simulacre moralisant…
En outre, là-dessous se développe comme une modulation réitérée, en milieu pseudo-libéré, de la guerre des sexes.
Enfin, le triple thème de l’amour, de la folie et de la mort structure les relations de Laura, Marie, Caroline et Clothilde, d’une manière à la fois claire et confuse, s’agissant d’une réalité évidemment impossible à démêler.
De l’oral et à l’écrit
Comme dans le premier livre de Quentin Mouron, Au point d’effusion des égouts, ou comme dans 49, rue de Berne de Max Lobe ou Ils sont tous morts d’Antoine Jaquier, notamment, l’atout majeur de La Petite galère est le langage, et plus exactement une sorte de langue-geste combinant l’oral et l’écrit, sans référence directe à Céline mais bel et bien dans cette filiation intégrant le parler contemporain. Sacha Després n’abuse pas, heureusement,du verlan, mais quand les garçons du collège parlent de Laura, dite Lo, dite biatche, cela donne ça et ça sonne juste et musical. :«Téma la biatche /comme elle béflan grave / j’lui mettrais bien une cartouche à la teuch / j’suis trop en chien de meuf ».
La phrase de Sacha Després, brève et qui claque, vaut aussi par sa concentration de sens et d’émotion. Lorsque Laura considère l’intérieur tendance ethno de Jack l’intello rêvant de gérer le JT, le constat est sans appel :« L’asticot ne fait pas le ménage ».
Mais l’écriture est aussi un thème implicite de la narration, puisque Laura griffonne et que c’est par des lettres érotiques que Marie, à la place de Laura et pour celle-ci, séduit et attire Wilder le lettreux sadien sur les bords.
Bref, La petite galère est un premier roman signalant un vrai talent, et cette chose essentielle pour un écrivain, qu’on pourrait dire un noyau dur et doux à la fois. L’on se gardera, pour autant, de bêler au chef-d’œuvre. Dans un contexte publicitaire écervelant, un tel livre doit être lu au lieu d’être adulé du fait de la jeunesse de son auteur ou de l’actualité de sa thématique. Actuellement, notamment par le fait des réseaux sociaux, la parution d’un roman fait figure de performance sociale ou festive qu’acclament d’innombrables « j’aime », après quoi c’est l’oubli. Nombres de premiers romans, ces dernières années, ont fait pschitt à parution et sont restés, ensuite, sans suite précisément.
Sacha Després vaut mieux que ça, je crois. On lui souhaite d’en « baver grave » sur la suite…
Sacha Després. La Petite galère. L’Âge d’Homme, 194p. 2015

C’est par l’affabulation que la jeune Olga attaqua le mensonge.
Les éteignoirs du Pôle des Lettres, et tant d’autres prétendus connaisseurs de l’oeuvre de Nemrod, l’ont traitée cent et mille fois d’affabulatrice, croyant ainsi l’abattre, alors que c’était rendre le plus bel hommage à la fantaisie imaginative, pour ne pas dire au génie d’Olga dont on sait, par ailleurs,qu’elle n’a jamais écrit elle-même – ce qui s’appelle écrire.
L’affabulation a d’abord revêtu, pour la jeune Olga des temps nouveaux de l’oppression menée au nom de l’Avenir Radieux, un caractère de nécessité vitale. Dès ses premières années à Lipce Reymontovskie, et grâce à la malice supérieure du vieux Boryna,mais aussi à l’inflexible mentorat du Père Venceslas, Olga aura trouvé, dans la confabulation, l’arme de résistance la mieux appropriée au mensonge institué, par force d’Etat, sous ses innombrables et délétères avatars.
Olga le sait pour l’avoir vu et vécu, et Jonas l’a constaté lui aussi sur le terrain bien des années après : que les gens de Lipce Reymontovskie n’ont jamais cru aux promesses de l’Avenir Radieux dont ils étaient contraints, par les commissaires idéologiques drillés dans les villes, de répéter à voix haute les contre-vérités. Cependant la plupart des villageois se contentaient de ne point moufter ou, au contraire, opposaient au discours un contre-discours, le plus souvent à usage interne.
Or tout autre fut la parade d’Olga dès ses douze ou treize ans, à l’école buissonnière de Boryna le conteur et de Venceslas l’oblat éclairé, tout à fait à l’insu des instructeurs obligatoires du Soviet local, et sans que ses sept frères ne s’en avisent non plus sur le moment, se contentant de voir en elle l’énergumène un peu dingo qu’ils chérissaient par ailleurs ; et ce qu’on pourrait ajouter,au risque de sauter les étapes, c’est que cette façon, par Olga, de travestir la réalité pour toucher au plus vrai – car c’est de cela qu’il s’agit, on l’a compris -, ressortit à un réflexe de défense que Rachel aura développé à sa façon, dans de tout autres circonstances, à l’imitation des conteurs hassidiques, là se trouvant sans doute la clef de l’entente immédiate qui rapprocha les deux femmes sans que le pauvre Nemrod ne s’en aperçoive.
L’alchimie des vraie rencontres reste à étudier finement, qui permettra de mieux saisir le pourquoi et le comment des affinités entre personnes que rien apparemment ne semblait rapprocher, comparable cependant avec cette parenté, guère plus explicable, par le philistin, que Jonas dit à fleur de peau.
Ainsi de la rencontre et de l’immédiate reconnaissance réciproque de Jonas, précisément, et de Christopher, ou de la complicité non moins immédiate solidarisant Olga et Marie, ou Marie et la Maréchale, ou la Maréchale et le Monsieur belge, ou le Monsieur belge et Théo, ou encore Théo et Olga, à l’insu de Nemrod.
Ledit Nemrod, en dépit d’un rhizome terrien tenace ,aura mis bien du temps, ainsi, avant de percer le sens réel de l’ironie d’Olga, qu’il a pris pour un trait de la présumée intelligence artiste dupeuple polonais ataviquement porté à l’exaltation et, pour des raisons historiques objectives (la pauvre Pologne dépecée, etc.), à l’autodérision, elle aussi caractéristique de la polonitude. De même n’a-t-il guère perçu, par la peau, la défiance instinctive de Marie envers toute forme de mensonge pieux, et moins encore la réserve tendre, sur fond d’inflexibilité acquise par expérience, qui a fait Rachel se tenir de plus en plus à l’écart des cris et des démonstrations de détresse non vécue.
Mais autant Olga fut, dès le premier regard, de la famille de Rachel, au corps plus ou moins défendant de Nemrod, autant elle s’est sentie en phase, sous d’autres aspects, avec Sam le scrutateur universaliste des milieux naturels, naturellement, donc, familier de la flore et de la faune des Tatras, alors qu’il y aura tout un retour amont à consentir, de la part de Nemrod, avant de laisser libre cours à son humour personnel de très vieille souche celte voire néolithique, allez savoir…
Complément indispensable à la défense illustrée des affabulations d’Olga la prétendue mythomane : La première légende d’Olga l’exilée, fuyant son pays dans les années 60 alors que l’autre Europe, autant que l’Union des soviets socialistes, jouissaient encore d’un indéniable prestige dans les milieux plus ou moins évolués des arts et de la culture du Vieux Continent récemment libéré de la « peste brune », est celle, à forte nuance romantique, d’une théâtreuse avant-gardiste fuyant la grisaille des instituts d’Etat notoirement empêtrés dans une esthétique rétrograde voire académique. Des tunnels creusés sous le Rideau de Fer lui auraient permis, la nuit, avec deux camarades aussi authentiquement révolutionnaires qu’elle, de gagner le monde dit libre par abus de langage – de fait elle commencera par agonir le monde capitaliste en se présentant comme une prolétaire des planches, impatiente de transmettre le savoir populaire dans l’esprit du grand Bertolt Brecht, etc. C’est la version gauchiste que la jeunePolonaise sert le plus volontiers dans les milieux artistico-intellectuels qu’elle approche sans tarder, visant les communautés libres de préférence pour y dérouler son sac de couchage de l’Armée rouge. La réalité est naturellement tout autre, vu qu’Olga, effectivement affiliée, en qualité de scénographe déjà pointue, à une troupe d’avant-garde en tournée festivalière, a profité d’une escale en Lorraine pour échapper aux camarades surveillants, avant de gagner les bords du Haut-Lac en stop et de requérir l’asile selon la procédure la plus régulière en qualité d’étudiante en lettres sincèrement anticommuniste. Les versions de son exil connaîtront d’autres variantes au gré de ses fréquentations et autres tribulations, sa préférée restant celle de l’agent double, descendante directe de la princesse Irina Vsievolodovna Ticonderoga (d’où ses yeux verts tirant sur le violet dans ses sursauts de démonisme érotique), grandie au pied des Beskides et fuyant la Pologne de ses ancêtres (dite parfois Christ des nations par ceux-ci) à bord de la Bugatti blindée du comte Tadzio de Moravagine, subitement victime d’un arrêt de cœur dans une auberge du Haut-Adige - reprenant alors seule le volant et croisant par hasard (le Destin, n’est-ce pas…) le chemin du jeune exilé valaque Dragomir, dans les jardins de Trieste, avant d’initier le rustre aux délices de l’amour, bref tout un kitsch apprécié des assistantes en lettres rêvant d’aventure et autres courriéristes people déjà en vogue à l’époque – et quelle douce époque était-ce avant que les vérités mensongères ne s’en viennent tout affadir et asphyxier…
(Extrait d'un roman en chantier)
 Retour sur Elizabeth Costello, de J.M. Coetzee, avant de lire L'Eté de la vie, autre merveille récente.
Retour sur Elizabeth Costello, de J.M. Coetzee, avant de lire L'Eté de la vie, autre merveille récente.
Est-il possible de rester humain sans verser dans l'humanitarisme ? Peut-on récuser toute foi religieuse et tout système philosophique, toute croyance en un mot sans conclure à l'absurde et au désespoir ? Et comment un romancier peut-il démêler "le bien" et "le mal", à l'observation du monde contemporain, sans se transformer en prêcheur ?
De telles questions apparemment naïves, et beaucoup d'autres de la même nature, ne cessent de se poser, à la fois explicitement et plus souvent "entre les lignes", dans le dernier roman traduit de l'écrivain sud-africain J.M. Coetzee, consacré par le prix Nobel de littérature. Rien pour autant d'un traité d'éthique ou d'un essai philosophique dans Elizabeth Costello, portrait en mouvement d'une romancière vieillissante, un peu mal embouchée comme on sait que l'est l'auteur, un peu fatiguée aussi d'avoir à répondre à ceux qui n'attendent d'elle qu'un Message.
Les lecteurs d' Au coeur de ce pays (Nadeau, 1981) ou de Michael K. sa vie, son temps (Seuil, 1985), d' En attendant les barbares (1987) ou de Disgrâce (Seuil, 2001) savent que J.M. Coetzee n'a jamais délivré de message. Aux premières loges de l'Apartheid, il choisit de transposer son observation de la réalité dans une autre dimension, qu'on peut dire universelle, de la fable ou du poème "panique". Jamais il n'aura endossé, en tout cas dans ses romans, le rôle du partisan ou du maître à penser. Cela ne signifie pas du tout qu'il ait renoncé à "penser", bien au contraire, ni qu'il se réfugie "au-dessus de la mêlée". Chaque roman de Coetzee témoigne d'un souci de "dire l'humain" dans toute sa complexité, et c'est dans la même optique qu'il développe, avec Elizabeth Costello, une observation à multiples points de vue qui tient compte aussi - et c'est très important -, de l'influence sur l'individu du temps qui passe. Sans qu'on puisse le dire "relativiste", ce roman d'une romancière pour qui tout est bel et bien devenu plus relatif avec l'âge, nous fait percevoir presque physiquement la différence de jugement d'une femme encore jeune (la belle-fille d'Elizabeth, prof de philo très catégorique et remontée à bloc contre ses "radotages") et de cette diva littéraire décatie de 67 ans qui apparaît, à son propre fils, comme un vieux phoque de cirque à dégaine de Daisy Duck. Cela étant, le lecteur découvre progressivement que le plus vif, le plus lucide, le plus conscient, le plus rebelle, le plus "jeune" des personnages reste probablement cette vieille enquiquineuse au coeur d'enfant qui trimballe sa carcasse de colloques en conférences sans cesser de gamberger.
Un outil de connaissance
Lorsque le lecteur la rencontre, au printemps de 1995, dans une université de Pennsylvanie où elle doit recevoir le plus prestigieux des prix littéraires nord-américains et, à cette occasion, prononcer une conférence sur "le réalisme", Elizabeth Costello, romancière australienne, est déjà une institution internationale surtout connue pour un livre paru en 1969, intitulé la maison de la rue Eccles et reprenant la narration du célébrissime Ulysse de Joyce du point de vue de Marion Bloom. Ce qu'elle dit alors sur "le réalisme" est certes intéressant, mais le plus important dans ce premier chapitre, comme dans tout le livre, est évidemment ce qu'elle vit, observe (la comédie des profs, la spécialiste de son oeuvre qui drague son fils pour se rapprocher d'elle), endure (son blabla et celui des autres) et déduit. Tout cela est vu par une sorte de caméra légère que l'auteur confie tantôt au fils de la romancière (coach improvisé après avoir subi le sort douloureux de fils d'artiste...) et tantôt reprend en main comme une espèce d'appareil détecteur ou de sonde. Un peu à la manière de Kundera, le roman se construit ainsi par touches phénoménologiques, avec des effets de réel probants, comme lorsque Elizabeth se casse le nez sur Paul West à l'occasion d'un colloque où elle a résolu de stigmatiser l'un de ses romans.
De la même façon, le chapitre saisissant consacré à l'approche du Problème du mal, à propos de ce qu'un romancier peut dire de l'abjection absolue (l'exécution des conjurés liquidés par Hitler, décrite avec un diabolique raffinement par Paul West dans Les Très Riches heures du comte von Stauffenberg), ou la confrontation de la romancière au tribunal de quelque Jugement Dernier (A la porte), modulent une réflexion de haute volée qui s'incarne à tout coup dans ce qu'un Henry James appelait le "cercle magique de la fiction". Un Post-scriptum inspiré, faisant écho à la terrible Lettre de Lord Chandos de Hofmannstahl, par la voix de la femme de celui-ci, place enfin tout le roman dans l'enfilade en miroir des siècles, à l'enseigne d'un amour non sentimental rappelant le "milk of human kindness" de Shakespeare, avec cet hommage à la simple vie qui suggère que "toute créature est une clé pour toute autre créature"...
John Maxwell Coetzee. Elizabeth Costello. Traduit de l'anglais (Afrique du sud) par Catherine Lauga du Plessis. Editions du seuil, 367p.
Où il est suggéré que rien n’est plus à craindre que le ricanement.
En mission ces jours à Katmandou où Chloé, qui l’y a précédée avec l’Irlandais dans un premier vol de secours, lui a demandé de la rejoindre fissa, Cécile se rappelle l’histoire du croyant soufi qui arrive à la porte du Paradis, tout étonné de se retrouver là.
N’en déplaise aux ricanants affectant la dignité humanitaire, Cécile se demande à l’instant, devant les ruines encore fumantes de la cité népalaise qui s’est déplacée de plusieurs mètres sous l’effet du séisme, pourquoi lui revient cette histoire du croyant soufi, qu’elle tient de Jonas qui la tenait de Sam à qui le Tout Vieux Monod l’aura racontée lors de quelque escale dans le désert, mais c’est comme ça : à l’instant le croyant soufi est à la porte du Paradis et se demande de quel droit, pécheur qu’il fut de son vivant, il va fouler l’herbe du Jardin, et s’en informe auprès du Portier qu’il y a là.
« Est-ce parce que j’ai bien prié et jeûné que je me trouve ici ? » , demande-t-il donc au Portier. Et celui-ci : « Que non pas ».
« Alors pourquoi, mon frère ? ». À quoi le Portier répond : « Parce qu’une nuit d’hiver, à Bagdad, alors qu’il faisait très froid, tu as recueilli un petit chat perdu que tu as réchauffé dans ton manteau ».
Cécile n’a jamais rencontré le Tout Vieux Monod de son vivant, et son souvenir de Sam reste surtout celui de sa voix affectueusement grondeuse et de ses mains intelligentes, mais elle revoit l’air songeur de Jonas après qu’il lui a narré l’épisode du croyant soufi, comme une autre fois, la tenant d’Olga, il lui a raconté la scène du petit valet de ferme de Lypce Reymontovskie réchauffant sur son cœur un oiselet tombé du nid.
On entend d’ici les ricanements : et ce niais de romancier veut nous faire croire que sa mijaurée se la jouant secouriste se laisse distraire, devant les ruines de cette cité ravagée, par des réminiscences de contes de commères alors que ça crie encore et que ça pue, et que ça crève alentour - non mais vous voyez le tableautin ?
Cependant Cécile, arrivée la veille à Katmandou en compagnie de Florestan le mal rasé, se rappelle à présent, le temps d’une autre échappée mentale, la supplique de l’enfant russe mourant telle que la lui a recopiée Olga dans un courriel :« Mon petit papa, quand on recouvrira ma tombe, émiette dessus un croûton de pain afin d’attirer les petits oiseaux, que je puisse les entendre voleter et me faire une joie de ne pas être seul là en bas». Et les ricanements de redoubler.
Mais Cécile les ignore autant que le romancier car,autant que celui-ci, Christopher ou Chloé, sans parler de Jonas, elle sait ce qu’ils signifient.
Cécile, on se répète, n’a pas connu le Tout Vieux Monod de son vivant, mais ce que Théo lui a rapporté à son propos lui est revenu à maintes reprises, notamment au fil de ses études d’arabisante désormais familière de la mystique et de la poésie soufies, et le rire de Sam qui, lui a dit Léa, ressemblerait comme une goutte d’eau claire dans le désert au rire du Tout Vieux Monod, ce bon rire des bonnes gens lui remonte au cœur dans la foulée, garant à ses yeux de la meilleure défense contre toute forme de ricanement.
À propos du séisme survenu au Népal le 25 avril 2015 : D’un autre point de vue, on eût pu dire que la présence de Cécile et Chloé à Katmandou, durant ces journées terribles, constituait la projection directe, quoique relevant de la fiction, de l’émotion réelle éprouvée par le romancier qui suivait sur la Toile, jour après jour, la relation des séquelles de la catastrophe dans laquelle avait été englouti un hôpital fondé par des amis de Léa – mais là encore pas de quoi ricaner.
(Extrait d'un roman en chantier)

Celui qui ne craint rien plus que le ricanement / Celle qui forte de la lecture du Docteur Faustus de Thomas Mann sait à quoi s’en tenir / Ceux qui ricanent de tout sauf d’eux-mêmes /Celui qui pratique la suspicion systématique sans douter de rien / Celle qui n’arrive pas à rire franchement de l’acquisition d’une Opel Kapitän par le Congolais d’à côté / Ceux qui ont un petit rire sec non moins méchant / Celui qui souille tout ce qu’il prétend nettoyer tiptop / Celle qui ne croit pas un croyant ne croyant pas comme elle / Ceux qui l’avaient bien dit et le répètent à l’envi : qu’ils l’avaient bien dit, ah ah / Celui qui a passé sept ans de sa carrière dans le bureau du ricanant Igor / Celle qui explique à Armand que sans doute Igor avait « des problèmes » / Ceux qui ont connu cet Igor de son vivant qu’ils ont également trouvé « à plaindre » / Celui qui rit par saccades au point qu’on croit à une crise / Celle qui rit du bout des lèvres genre bec de canard coincé / Ceux qui ne sourient jamais que de travers / Celui qui croit savoir de quel démon il s’agit / Celle qui préfère la rucola / Ceux qui sont plutôt du genre ricancaniers / Celui qui qui n’a jamais froid dans le dos pour cause de rire ou de sourire / Celle qui hésite toujours entre le « ah,ah » et le « eh,eh » voire le « uh,uh » / Ceux qui ricanent forcément à l’évocation de l’Appel du 18 juin vu que Pompidou était clairement de droite / Celui à qui on ne la fait pas, ah ça / Celle qui ne rira bien que si le dernier ricane / Ceux qui n’ayant fait que ricaner leur vie durant se retrouvent au milieu des ricanants de l’hospice et ça c’est pas marrant même quand Monsieur Duplomb essaie de faire rire l’assemblée, etc.

Moi j’aime les vieux sans le vouloir…
Ma grand-mère paternelle, solide matriarche vaudoise du genre biblique, citant donc volontiers les sentences de l’Ancien Testament, m’a recommandé la première de ne jamais commencer une phrase par moi-je.
Or c’est par malice évidente que j’amorce ces propos, censés traiter le thème de la solidarité que devraient susciter les troisième et quatrième âges, comme on dit, en déclarant tout net que moi j’aime les vieux, mais sans le vouloir, n’en faisant pas un devoir, pas plus que je ne me sens obligé d’aimer les jeunes, les grabataires, les chômeurs en fin de droit ou les femmes en espérance.
Tout un langage contemporain, qu’on pourrait dire la langue de coton des temps qui courent, s’est fait le palliatif d’un effondrement croissant des relations qui, naguère, allaient de soi, entre les membres d’une même communauté. On prononce le mot comme une sorte d’incantation, possiblement assortie de majuscules : Solidarité en est un.
L’idée qu’on ait à se sentir, aujourd’hui, solidaire des vieux, en évitant surtout de prononcer ce terme infamant, me semble surtout significative d’un état de non-relation, qui ne saurait se guérir vraiment par des postures et des obligations convenues.
Je conçois tout à fait qu’on puisse se sentir solidaire d’un peuple en détresse ou d’une classe de la population en état de précarité. Je me rappelle les élans de solidarité qui se sont manifestés, dans la population de notre pays, à l’initiative d’une institution significative de la tradition généreuse de celui-là, à l’enseigne de la Chaîne du Bonheur.
Des lendemains du terrible hiver 1956 (j’avais 9 ans), je me rappelle la solidarité du peuple suisse à l’égard des réfugiés hongrois, dont les enfants apparaîtraient bientôt dans nos classes ; et rien de plus spontané, non plus, que la solidarité qui se manifesta, à travers les années, à l’endroit des sinistrés d’Agadir ou de Fréjus, plus récemment envers les victimes des tsunamis.
Mais parler de solidarité avec les personnes âgées, n’est-ce pas esquiver l’essentiel d’une relation fondamentale ? N’est-ce pas admettre déjà leur enfermement dans une catégorie à part ? N’est-ce pas réduire leur situation à un phénomène social ?
Bien entendu, l’exclusion des vieux, l’abandon des vieux, la solitude des vieux relèvent d’un phénomène de société, comme on dit, qui appelle une réaction significative, comme on dit encore, de la communauté. Mais à l’instant même où, dans nos régions, le traitement de la mendicité par l’interdiction est envisagé comme un devoir d’hygiène publique, je me refuse, pour ma part, à réduire mon amour des vieux à un dossier, fût-il estampillé du terme positif de solidarité.
La solidarité avec« nos aînés », comme on dit encore, va pour moi de soi, mais je refuse de limiter ma relation à ce «programme». J’en veux bien plus. L’amour est trop grand pour se réduire à cela. La réalité physique et métaphysique de la filiation, la relation affective et poétique de la filiation, la bonté et la beauté de la filiation, le grand récit fluvial de la filiation et les innombrables petites histoires personnelles qui en découlent sont trop grandes pour être canalisées dans cette conduite forcée d’un devoir stipulé.
Moi j’aime les vieux parce qu’ils m’ont appris à vivre, avec eux mais aussi contre eux, comme j’aime les jeunes parce qu’ils me revivifient par leur reconnaissance autant que par leurs remises en question.
Je ne me sens ni vieux ni jeune. J’ai certes, à 61 ans, l’âge de mes artères, bientôt l’âge de la retraite, comme on dit, mais je me sens aussi vif et curieux, allègre, aimant, que je l’étais à vingt-cinq ans, commençant à peine de rajeunir, ou que l’était le plus jeune octogénaire qu’il m’aitété donné de rencontrer : le peintre et écrivain polonais Joseph Czapski, rescapé du massacre de Katyn et continuant de peindre après avoir perdu la vue, comme le nonagénaire Georges Haldas, aujourd’hui, continue de dicter ses livresdans sa propre nuit, l’esprit et le cœur alertes.
« Il faut toute une vie pour devenir jeune », disait à peu près Picasso, et ce n’est enaucun cas une déclaration de jeunisme : c’est l’appel à une lente transformation intérieure qui nous rapproche peu à peu de l’essentiel.
Moi j’aime les vieux parce qu’ils deviennent, peu à peu, mes enfants. Depuis quelque temps, je reviens tous les jours à mon vieux paysan-philosophe Gustave Thibon, dont la lecture m’a réchauffé dans ma vingtaine, glacé que j’étais par celle de Marx et Lénine. Et de ce bon Thibon je lis ce matin ceci : « Nous n’aimons que nos enfants, nous ne nous penchons que sur ce qui sort de nous. Et notre père n’existe pour nous que si, par un mystérieux travail, il est devenu notre enfant ». Or je me rappelle, à ce propos, l’un des plus beaux moments de ma vie, avec celle qui la partage, lorsque notre premier enfant, de quelques mois, fut amené à mon père mourant, un dimanche de printemps. Pure grâce de la filiation…
Devons-nous nous sentir solidaires de nos parents et de nos enfants ? Et faudra-t-il qu’on nous impose un « devoir de mémoire » pour se rappeler tout ce que nous devons à ceuxqui nous ont engendrés et accompagnés ?
Moi j’aime le quartier de mon enfance et notre maison modeste, et les modestes maisons des parents de nos parents où, souvent, nous allions passer nos dimanches. Ces coutumes d’une communauté qui, jadis, tenait bien ensemble, et que je me garde d’idéaliser au demeurant, se sont perdues pour beaucoup, mais je vois aujourd’hui l’attachement de nos enfants à leurs propres aïeux, et Dieu sait que nul devoir extérieur ne les y pousse.
Moi j’aime me rappeler mon grand-père maternel lucernois lisant chaque soir, à la Stube,sa Bible et un livre en l’une des sept langues qu’il avait acquises dans ses pérégrinations d’employé des hôtels d’un peu partout.
Moi j’aime me rappeler le huitantième anniversaire de ma grand-mère maternelle, fleurie par tous les pauvres du quartier et de la ville qu’elle avait aidés sans être elle-même une nantie, et mon grand-père ronchonner en trouvant que ces floralies représentaient bien de la dépense. Moi j’aime les vieilles dames épanouies autant que les vieux râleurs. Je n’éprouve aucun devoir de trouver les vieux parfaits.
Moi j’aime les vieux sans le vouloir…
La Désirade, ce 1er septembre 2008.
(Ce texte a paru dans le recueil intitulé Instants et mouvements, publié par l'association Pro Senectute, avec des images d'Hélène Tobler)
Image: Robert Indermaur.

Celui qui fixe des mezouzah aux chambranles de son nouvel appart de Brooklyn / Celle qui sur Facebook se dit en couple avec Jake dit The Snake<img> dont la dégaine à kippa de travers est sympa / Ceux qui se rappellent vaguement les histoires de pierres tombales fracassées de leurs aïeux ukrainiens / Celui qui lit sur le sachet de thé la sentence selon laquelle « même quand la minorité se réduit à un seul homme la vérité est la vérité » / Celle dont le compagnon chercheur en chimie succombe soudain d’un souffle au cœur après sept sessions d’analyses à Tchernobyl / Ceux qui font leur aliyah mais ne se décident pas à quitter leBronx et constatent que « ce sont des choses qui arrivent » / Celui qui se rappelle le manteau à col de loutre qu’il a déniché un jour glacial de 1991 chez Ya’akov le vieux tailleur de Brooklyn qui le lui a cédé pour 5 dollars / Celle qui reproche à son conjoint de ne faire face à ses émotions qu’en les fuyant / Ceux qui saupoudrent leur conversation de mots en hébreu afin de faire sentir leur connivence avec Dieu / Celui qui découvre grâce à son amie ukrainienne qu’il n’a pas besoin d’avoir un avis sur tout / Celle qui appelle son ami juif sexa son gros ours / Ceux qui restent positifs dans le prétendu quatre étoiles de Kiev dont la chambre qu’ils occupent n’a même pas de minibar / Celui qui n’a jamais vu tant de moustaches qu’à Kiev après la chute du communisme / Celle qui a laissé le froid revenir dans sa vie / Ceux qui refusent les édulcorations factices / Celui qui consate soudain que sa seconde épouse depuis avant-hier le considère comme un clone de son premier mari / Celle dont les pieds sont restés pris dans le ciment de son ancienne vie/ Ceux qui n’ont plus que leurs yeux pour prier, etc.
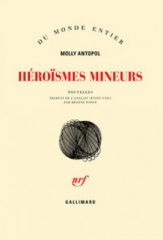 (Cette liste renvoie à la lecture des nouvelles du (magnifique) premier recueil de Molly Antopol, intitulé Héroïsmes mineurs (The Unamericans) et paru récemment chez Gallimard dans la collection Du monde entier)
(Cette liste renvoie à la lecture des nouvelles du (magnifique) premier recueil de Molly Antopol, intitulé Héroïsmes mineurs (The Unamericans) et paru récemment chez Gallimard dans la collection Du monde entier)

Comment Cécile et Chloé, chacune en son campement volant, travaillaient de concert à la réparation du monde.
Une enfance enchantée n’est pas forcément incompatible avec l’aménagement d’une conduite d’eau en zone de sécheresse, et Cécile, qui avait eu dès se deuxième année, en la personne de Théo, un agréable cheval de promenade à elle seule, transformable selon les jours et les régions en mulet (pour gagner les hauts d’Anniviers) ou en zébu, avait développé, très tôt, la double capacité de se mettre en joie tous les matins à l’appartion du Lapin Blanc que figurait son père en pyjama bleu, et de compatir au sort des malheureux qui n’avaient ni cheval ni terrier plein de victuailles, ni de contes à entendre tous les soirs, mais la misère et la faim dans le monde dit réel.
Jonas adolescent fut le premier amoureux de Cécile enfant, qui continue de l’aimer comme s’ils n’avaient cessé de s’épouser à travers les années de multiples façons, dans une suite de jeux de rôles dont ils sont restés seuls, avec Chloé et feu Christopher, à connaître les règles.
Le petit complot de résistance active date d’une première réunion trinitaire à 3400 mètres d’altitude, en plein jour blanc cerné de brouillards, au bord du cratère du volcan au nom d’Irazu, à l’aplomb d’un lac acide vert toxique.
Les trois initiateurs de cette première conspiration douce, à savoir Cécile et ses amis-pour-la-vie Jonas et Christopher, rejoints par Chloé la nuit suivante sur Skype, revenaient alors d’un pèlerinage au sanctuaire de la Negrita, Vierge noire dont Jonas avait relevé le cousinage avec la Madone balafrée de Czestochowa devant laquelle il s’était inclin. dix ans plus tôt en compagnie d’Olga. Ils avaient ensuite traversé les forêts de brouillards proches du Cerro de la Muerte afin d’observer le vol de pariade du quetzal que Christopher avait, un peu sentencieusement, donc à l’opposé de son naturel ordinaire », qualifié de « resplendissant oiseau divin des Mayas, des Incas et des Aztèques ».
Ce langage de guide touristique marquait, plus que de l’ironie, absolument étrangère à la complexion mentale de Christopher, son intention bien plus proifonde, positivement humoristique, de commenter à l’avance ce que l’épaisseur du brouillar annonçait, à savoir l’effacement par la froide grisaille, des couleurs de l’oiseau dont ils ne verraient ni le vert iridescent du pluamge, ni la gorge écarlate , ni même la pointe de ses plumes rectrices longue comme un bras.
 Or, le fait de ne point voir l’oiseau mythique dont les plumes orbnaient le divin Quetzalcoatl, inspirerait précisément les conspirateurs en leur premieère conférence au bord du gouffre où il fut décidé de travailler, désormais et partout, fût-ce dans le plus épais brouillard des circonstances, à la réparation du monde commencée par la restitution, aux choses et aux êtres, de leurs couleurs, à la lutte contre ceux-là, dont un Nitchevo, qui ne voyaient plus que la noirceur de tout, enfin et surtout à la restauration et la préservation d’un temps permettant de voir, de ses simples yeux de mortel, et par exemple du sommet du métaphorique Irrazu, les deux plus grandes mers de l’Atlantico et du Pacifico, et l’entier de la Planète alentour – à réparer elle aussi et peut-être avant tout.
Or, le fait de ne point voir l’oiseau mythique dont les plumes orbnaient le divin Quetzalcoatl, inspirerait précisément les conspirateurs en leur premieère conférence au bord du gouffre où il fut décidé de travailler, désormais et partout, fût-ce dans le plus épais brouillard des circonstances, à la réparation du monde commencée par la restitution, aux choses et aux êtres, de leurs couleurs, à la lutte contre ceux-là, dont un Nitchevo, qui ne voyaient plus que la noirceur de tout, enfin et surtout à la restauration et la préservation d’un temps permettant de voir, de ses simples yeux de mortel, et par exemple du sommet du métaphorique Irrazu, les deux plus grandes mers de l’Atlantico et du Pacifico, et l’entier de la Planète alentour – à réparer elle aussi et peut-être avant tout.
Et Christopher, entouré de Cécile et Jonas, avait constaté tout haut ce qu’ils pensaient de concert : « À un moment ou à un autre, même ce qu’il y a de plus caché, de plus craintif, se montre, à condition de lui laisser le temps. À un moment ou à un autre, toute chose se manifeste ».
Compléments documentaires sur les activités mondiales du nouveau mouvement dit de la Résistance douce : Loin de se réduire à ce que ses détracteurs qualifèrent de Sweet Attiude, le mouvement amorcé le 11 septembre 2001 en plein brouillard impropre à la navigation aérienne, sur un volcan du Costa Rica, par Cécile, Jonas et Christopher, peu suspects par ailleurs d’aucune complicité avec aucune faction politique instituée ou défendue par la force, allait se propager en multipliant les alliances, durant les années suivantes, à proportion de la conviction croissante que, merde, « tout ça ne pouvait » pas durer. Jamais borné à la dialectique ancienne des exclusions et autres trahisons pragmatiques, ledit mouvement, dont Nitchevo le catatrophiste décria trop aigrement l’optimisme-malgré-tout, ne se rangea pas pour autant dans la mouvance mellifluente de l’obsolète New Age, mais préfigura un nouveau dolce stil nuovo dont ce roman en chantier se propose, n’est-ce pas, de défendre et d’illustrer l’esprit…
(Extrait d'un roman en chantier, p.100)
Olga déjouait la tyrannie de Nemrod avec élégance.
Le despotisme de l’homme de lettres est à géométrie variable et multiples ruses pas toujours faciles à déjouer, mais en la matière Nemrod était plutôt du genre massif et matois, non sans panache à l’ancienne.
Marie, en tout cas, n’avait pas détesté les premiers avatars, d’un véhément romantisme, du jeune émule du comte de Lautréamont oscillant entre la fronde libertaire et l’expressionnisme lyrique à foucades. L’idée d’une carrière lui était alors absolument étrangère et cette pureté se retrouvait dans les premiers manifestes poétiques que représentaient Exacerber l’étincelle ou Foudres viscérales. En outre, le mélange de fraîche forfanterie et de gaucherie rugueuse du lascar, autant que son charme frotté de sauvagerie où Marie flairait aussi la bête d’amour, avaient touché Rachel et même Sam, en dépit de la prévention naturelle de celui-ci à l’encontre des gens de lettres, et la vigueur affirmée et non dogmatique de la révolte de Nemrod, tranchant sur la fade moiteur satisfaite du milieu académique et littéraire de ces années-là, lui avaient acquis d’autres sympathies encore, notamment de Léa et de Théo.
Quant à l’égomanie de Nemrod, déjà pressante et parfois oppressante, Marie s’y était faite à proportion d’autres aspects du personnage, qui la valorisaient au contraire. Ainsi avait-elle accepté les règles de plus en plus contraignantes de l’organisation quotidienne du poète liée à son Ascèse de Création, exigeant, dès leur installation dans le pavillon en banlieue, une pièce, à lui seul dévolue, pourvue d’une table, des rames d’un certain papier, tout un assortiment de crayons et de plumes, d’encres et de buvards, une rose pour la semaine et des cigares.
Tout le temps de leur première cohabitation, Marie se sera chargée de ce qui touchait à la matérielle, dont on peut s’épargner de détailler les nombreux aspects au motif qu’il s’agit là des personnages d’un roman, mais l’amour et l’eau fraîche des premiers temps n’empêcheraient pas, bientôt, les amants de se désaccorder parfois, soit que Marie eût fait le moindre bruit pendant les heures absolument silencieuses qu’exigeait l’Ascèse de Création, soit que Nemrod se fût senti pris à la gorge par l’excessif silence de la page blanche.
Quant à Olga, sa force, à la fois instinctive et acquise d’expérience, aura été, d’une part,d’acclimater à sa façon l’orgueil, sinon la vanité, du littérateur, et ensuite de ne jamais se livrer à aucune comparaison ni aucune compétition entre eux.
Olga se fait une assez haute idée des choses de l’art, mais la pose artiste lui a toujours paru pendable et souvent miteuse, comme elle l’a très clairement signifié à Nemrod chaque fois qu’il donnait dans ce travers.
Olga ne se considère artiste en aucune façon, quand bien même sa manière, tellement élégante et délicate, de résister au despotisme parfois grossier de Nemrod, relèverait bel et bien d’une sorte d’art de vivre ignoré de beaucoup de prétendus créateurs. Il ne serait pas exagéré de parler, à ce propos, d’un véritable art de la pointe, en matière de diplomatie relationnelle, comparable à celui que nous verrons Jonas pratiquer avec les gens, ou Christopher en sa spécificité rarissime. Telle étant l’aristocratie naturelle observable à tous les étages de la société, à distinguer clairement de tout guindage d’origine ou d’arrivisme, et de toute arrogance écervelée.
A cet égard, il est indéniable que les rodomontades à la fois irréfléchies, crânes et touchantes, du premier Nemrod des temps de Marie, auront passé grâce à l’humour de Rachel et aux bourrades de Sam, le protégeant de la cuistrerie ambiante, ou de la muflerie, des milieux dont il peinait à se distinguer ; après quoi le soin d’Olga serait d’affiner encore le rustaud.
L’angoisse de Nemrod, face au Gros Animal que figure la société, tenait en partie à son extraction de fils de terreux. Se voyant lui-même en petit Poitevin de rien du tout fuyant les cours de fermes, il aura dû prendre sur lui, comme on dit, pour s’affirmer plus difficilement, en France snob, que ce ne fut le cas pour Olga débarquant à Cracovie des plaines croûtées de merde sèche de Lipce Reymontovskie.
Mais le Nemrod fondamental est ailleurs, et l’attachement fidèle, voire inconditionnel, d’Olga à l’auteur de L’Ouvroir, tient à ce qu’elle appelle son Noyau, et peu importe qu’il soit lié à tel ou tel secret : là se trouvant aussi bien le cœur et le moyeu mystérieux du génial faiseur.
Olga est à peu près seule à avoir parié, malgré ses errances et autres complaisances, pour le meilleur de cet apparent histrion, tenant de l’Arlequin transformiste et du faussaire à double jeu plus profond qu’on ne l’aurait subodoré. Mais Olga s’en est tenue mordicus à cette intuition première selon laquelle il y avait, dans la vie et l’œuvre de Nemrod, ce Noyau d’où partait son cri de saurien préhistorique quand il lâchait son foutre, ou son remerciement au ciel lorsqu’il bouclait une vraie page d’écriture.
À propos des périodes successives marquant l’évolution de l’œuvre de Nemrod, hétéronymes compris : Pour ce Nemrod fondamental, dont elle se fichait orbitalement que son Noyau relevât de l’essence ou de l’existence, Olga s’était montrée prête à faire la vaisselle et à rincer ses caleçons ou, plus tard, à lancer un plan marketing indispensable à ses livres devenus vendeurs, à dater de Quelques Petits Riens et tout au long de ses périodes successives, de l’érotisme haut de gamme à son fameux Retour au Quotidien, jusqu’à la nébuleuse des hétéronymes. Contrairement à ce qu’il en allait pour Nemrod, le jeu social amusait Olga, qui y associait volontiers ses amis ou Jonas quand il en avait le loisir. Nemrod se disait agoraphobe, tout en se faisant un devoir de rencontrer son public, mais c’était pour son propre agrément à elle, ou celui de la Maréchale l’accompagnant, qu’Olga multiplia les tournées de dédicaces de salons en salons, dès la flambée de Quelques Petits Riens, calant assez de rendez-vous à son auteur pour le retenir en signature, et l’exténuer si possible, pendant qu’elle découvrait, en bonne compagnie, les régions d’abord proches et de plus en plus lointaines, ensuite, au fil des nouvelles traductions du livre-culte, jusqu’en Islande telle fois, avec Cécile, ou avec Rachel à la Foire de Pétersbourg, au Japon ou sur des paquebots à croisières réservés aux seniors. Est-ce à dire qu’ainsi Olga se vengeait, d’une certaine façon, de la tyrannie que Nemrod lui avait bel et bien fait subir parfois ? Ou bien récupérait-elle les dividendes de sa mise initiale ? Mesquines remarques, objectera le romancier d’un ton ferme. Bien plutôt, Olga jouait le jeu. Tirait certes les ficelles, mais se réjouissait aussi loyalement, pour Nemrod, de la reconnaissance de ses livres de plus en plus grand public, du mémorable Féminaire, cent fois réimprimé et traduit, à la série policière de l’Inspecteur Bartleby, sous son premier pseudo de Nancy Dolan, en passant par les « romans durs » de sa période néo-réaliste à la Tchékhov. Pourtant, insistaient les échotiers mal intentionnés et autres critiques envieux, Nemrod n’avait-il pas trahi la cause de la Littérature avec une grande aile ? Foutaises, répondait Olga, et d’ailleurs vous n’en avez que faire, faux derches que vous êtes, qui ne lisez jamais et n’aimez rien.
(Extrait d'un roman en chantier, p.82)
Peinture: Claude Verlinde

Le Nemrod érotomane a toujours fait rire Olga.
Nemrod a cru dominer les femmes. Ses écrits érotiques de la période suivante étaient censés dire quelque chose de décisif à ce propos, signifiant un regain de crânerie dans l’affirmation d’une indépendance phalloïde retrouvée.
Les figures du Fouet retenu et de la Fente ignorée devaient alors structurer un nouveau Pacte amoureux, expliquait Nemrod dans le préambule à son Eros furieux, dont les proses libertines rompirent avec la période minimaliste de Quelques Petits Riens - tout cela dont se gaussaient Olga et Marie, puis Rachel et Flora, au fil de très médisants téléphonages.
Autant Jonas avait excellé dans son gorillage du Nemrod se targuant d’humilité rurale, puis d’ancestrale sagesse terrienne, à l’époque de Quelques Petits Riens, autant Olga et ses amies s’amusèrent à persifler le néo-libertin assimilant la Femme à la Mort et se proposant conséquemment de la neutraliser par le défi glacial ou, tout au contraire, de l’enculer à cru.
Nemrod, aux estrades, se grisait de s’entendre proférer des énormités qu’il se figurait subversives en diable, naturellement reçues comme telles par les niaises et les jobards des milieux divers, sans parler des médias qui raffolèrent de ces écarts verbaux, cités jusque dans les tabloïds ou parut une fameuse image de l’écrivain nu sur un rivage torride, entre les filles-chattes Doudou et Suleika, son membre juste flouté
Olga et la Maréchale daubèrent sur l’hypocrisie du floutage, de plus en plus répandu en ces années de croissant exhibitionnisme tous-ménages, non sans noter avec satisfaction la colère vive de Nemrod, bonnement piégé par son ostentation.
Ainsi, comme il s’était trouvé dépassé, après le succès monstre de Quelques Petits Riens et des Eloges du moindre, par le goût, devenu mode, du peu de chose, préludant à l’extension du domaine de l’insignifiance et du n’importe quoi, Nemrod découvrait-il à présent l’écoeurante banalisation de l’interdit et l’acclimatation de ce qu’il vivait encore, lui, à la façon des vrais bicandiers d’un Rabelais.
Quoiqu’il en fût, et malgré l’ironie de la situation puisque, aussi bien, et par consentement mutuel, ils ne s’étaient plus touchés depuis des années, Olga continuait d’administrer, à l'enseigne de la florissante firme Nemrod & Co, les biens-fonds et mobiliers de son amant et ami-ennemi littérateur dont le dernier pavé de cette période, intitulé Féminaire, lui gagna soudain un nouveau public très élargi, souvent indigné d’ailleurs, de femmes entre deux âges et,pour ses parties explicitement sado-masochistes, de jeunes filles impatientes d’être ficelées, menottées à quelque radiateur à nuances grises ou même fouettées.
Or Nemrod n’avait pas cherché réellement le scandale, Olga le savait, et même Clément Ledoux, si souvent sévère à son égard, convenait de cela que cet auteur par ailleurs si littéraire, n’est-ce pas, semblait fait pour anticiper engouements et tendances sans le vouloir vraiment, à la façon d’une sorte de médium que le succès rattrapait à son corps plus ou moins défendant, suscitant à tout coup la folle la jalousie de ses pairs.
(Extrait d'un roman en chantier)
Peinture: Leonor Fini.

À propos de Trois goutte de sang et un nuage de coke, faux vrai thriller socio-policier à double fond poético-philosophique.
Le quatrième livre de Quentin Mouron a l’air d’un roman américain, plus précisément d’un thriller comme il en pullule, plus exactement encore d’un roman noir à résonances littéraires : le Crime et châtiment le Dostoïevski est d’emble cité en exergue, et l’on pense évidemment, en le lisant, à Non, ce pays n’es pas pour le vieil homme de Cormac McCarthy, ne serait-ce que par l’un de ses deux protagonistes, shérif, se nomme Paul McCarthy… De même l’autre protagoniste, le détective cocaïnomane prénommé Franck, peut-il rappeler divers personnages ambivalents voire pervers du genre, par exemple des films d’un Abel Ferrara.
Cependant oublions un instant ces références ( et il y en aura bien d’autres) pour souligner le fait que, d’abord et avant tout, Trois gouttes de sang et un nuage de coke est un roman de Quentin Mouron, et sûrement le plus abouti à ce jour.
À savoir qu’il est illico marqué par la papatte de Quentin, découlant d’un regard acéré sur le monde et les gens, reconnaissable à une écriture à la fois percutante et ciselée. En outre,comme dans ses trois premiers livres, Quentin Mouron aborde de grand thèmes qui lui tiennent à cœur, à savoir :la dégradation de la société et l’atomisation des individus, la solitude qui en découle et la perte du sens fondant une vie, notamment.
De la génération suivant celle de Michel Houellebecq, le jeune auteur (né en 1989) pratique en outre une manière de narration-réflexion lestée de traits critiques voire polémiques, comme dans La Combustion humaine, qui rappelle à la fois les nouvelles d’un Ballard ou les romans, justement, de Michel Houellebecq. Comme devant, l'on relèvera, ici et là, quelque trait sentencieux frisant la dissertation ou le pédantisme. Péché de youngster, dont il se moque d'ailleurs lui-même...
Dès la première road-story de Quentin Mouron, intitulée Au point d’effusion des égouts (ce titre faisant allusion à Antonin Artaud), l’évocation d’une traversée panique des States exhalait déjà le mélange de tristesse et de rage d’un très jeune homme aussi poreux que teigneux, dans un récit à l’écriture déjà bien affirmée par ses rythmes et ses sonorités, ses images et ses formules frappées comme des médailles, dans la postérité de Céline.
Or on retrouve le regard du jeune routard « cadrant » l’église de Trona, symbole de spiritualité déglinguée, dansl’évocation d’une autre église-bunker, transformée en locatif, ou dans les banlieues sinistres ou socialement sinistrées des alentours de Boston. De même retrouve-t-on l’humanité ordinaire, souvent morne ou déclassées, desdites interzones suburbaines, dans ce nouveau roman qui accentue leur aspect mortifère.
Dans la filiation de Notre-Dame-de-la Merci,premier vrai roman de Quentin, Trois gouttes de sang et un nuage de coke développe et approfondit la composante« tchékhovienne » de son observation, où la tendresse empathique (côté Paul Mc Carthy surtout) le dispute à une vision plus acide de la société des simulacres et des masques, sur fond de décadence sociale et culturelle, évidemment liée à la désastreuse vision du monde du néolibéralisme diluant.
Comme dans son roman canadien,l’auteur campe ici des personnages d’une réelle épaisseur humaine, dégagés de tout manichéisme moralisant mais illustrant bel et bien, de façon diverse, une aspiration à certaine pureté.
Celle-ci est explicitement revendiquée par Franck le dandy, lecteur du Sâr Péladan (cet extravagant contempteur de la décadence fin de siècle, auteur visionnaire de livres lumineusement illuminés) et patron d’une agence privée, qui rêve de quelque crime gratuit relevant des beaux-arts, en lequel l’auteur, non sans ironie parodique, campe une sorte de meneur de jeu provocateur, qui se sert du grotesque pour mieux renvoyer moralisme et hypocrisie dos à dos. La scène finale, très théâtrale, marquant la confrontation du brave shérif supposé blanc comme neige et du « privé » jouant les pervers, oscille entre les grimaces de Dürrenmatt et de James Ensor...
Or on se gardera de chercher, dans Trois gouttes de sang et un nuage de coke, la conclusion trop rassurante d’un polar conventionnel, ni non plus l’arrière-plan « théologique » d’un Cormac McCarthy.
Néanmoins, jouant parfaitement lejeu du thriller socio-criminel, ce roman bref et dense, au scénario bien filé et très intéressant par ses observations et ses digressions, impose une fois deplus, et de façon plus ample et pénétrante que précédemment, l’intelligence d’un regard incluant les désarrois et les dégoûts d’une époque, non sans ménager des clairières d’immunité propices aux sentiments tendres et à la pensée vivace...
Quentin Mouron, Trois gouttes de sang et un nuage de coke. La Grande Ourse, 211p.

Au point d'effusion des égouts: Un premier roman qui « arrache ». En vrille étincelante, entre Los Angeles et le bout de nulle part.
Quentin Mouron : un nom à retenir, illico et pour plus tard. Presto à cause du premier roman de ce lascar, Vaudois et Canadien de 22 ans, dont la « papatte» d’écrivain pur-sang et la vivacité d’esprit saisissent. Plus exactement: « la palpite », selon l’expression de Louis-Ferdinand Céline dont le jeune auteur rappelle à l’évidence la « petite musique ». À savoir le rythme de la phrase : jazzy, précise, scandée, serrée, teigneuse. Pour parler de quoi ? De la Californie mythique et réelle où il débarque seul à vingt ans, après une enfance de Robinson dans les bois canadiens, avec ses parents. De Los Angeles et de son « ciel plus grand qu’ailleurs ». Du rêve qui se vend et qu’on vous reprend. Des gens qui tricotent leur névrose et « se guettent le cœur ». Des déserts, de Las Vegas, de la frime et de la déprime, de l’amour aussi. Enfin du retour en Suisse où son entourage pépère lui demande : et maintenant ? Ceci pour la trajectoire trop résumée.
Alors un livre du genre « sur la route, le retour » ? Absolument pas. On pourrait s’y tromper à la dégaine de Quentin, style rocker ou jeune premier de série télé, mais un masque peut en cacher un autre. Il l’écrit précisément ailleurs: « Je porte toujours deux masques : le premier pour les autres, le second pour moi-même ».
Or Quentin Mouron n’a rien non plus, pour autant, du phraseur lettreux se complaisant dans les reflets. Dès les premières pages de ce premier récit-roman, ni journal de voyage ni confession, le lecteur est pris par la gueule. L’enjeu est à la fois existentiel et poétiquel. Le récit ne sera pas évasion mais invasion. Tout dans le détail. Le titre, emprunté à Antonin Artaud, dit à la fois le goût et le dégoût du monde. Ramuz disait autrement : « Laissez venir l’immensité des choses ». Et déferlent alors sensations, observations, notations.
Débarqué par le ciel rouge à Los Angeles, à peine sorti de l’enfance (« j’avais pour moi les sortilèges et les rondeurs, le sourire franc – la gueule d’une pièce »), le narrateur note : « C’est une erreur de chercher l’essence dans l’analyse, postérieurement, « au réveil ». Il faut sentir le soir même, toutes voiles dehors, le vent chaud du désert et l’émotion qui brûle la gorge – le feu du ciel. Et le délire ». Et de se dire alors « pas fait pour les voyages ». Comme il dira plus tard qu’il n’aime pas aimer ! Et de « céder aux anges » en tombant à la renverse. Dans la foulée les sentences cristallisent comme dans Voyage au bout de la nuit : « Quand je joue, je sais pourquoi je joue, quand je vis, je ne sais pas pourquoi je vis ». Et voilà que les personnages défilent. Force de Quentin : le portrait au doux acide. À commencer par le cousin Paul, petit flic humilié, qui vit de « compensations ». Auquel succède, après une sorte de « trou noir » de vertige fiévreux, la cousine Clara chez laquelle le jeune voyageur va passer plus de temps en plein quartier de Westlake à « blancheur d’hôpital », entre « petites maladies » et « ciel en cage », thérapeutes et gourous. Clara qui accuse son « ex » de toutes les turpitudes érotomanes. Clara qui paraît un soir en voie de se libérer avec son jeune cousin, mais qui rentre brutalement dans l’ordre le lendemain: "Au fond c'est l'habitude du malheur qui nous le rend incontournable". Clara que l’éventuelle vie sexuelle de son cousin fait paniquer. Clara qui lui demande lors d’une séquence un peu folle, le jour de l’anniversaire du garçon, de cesser de se branler. Clara qui finira par s’ouvrir les veines…
Et Laura, plus tard, dont le prénom rappelle l'amour imaginaire de Pétrarque, en version macdonaldisée. Laura que le narrateur trouve plutôt moche mais que son regarde « profond, troublé, marin », touche et qu’il finit par aimer follement, à proportion du rejet qu’elle lui oppose. Clara la folle. Laura la froide. Et plus tard, d’abord à Trona, bled perdu dont l'église-container symbolise la déréliction, puis à Las Vegas où il le retrouve, l’inénarrable Norbert, Bavarois à femmes vasectomisé et foireur qui entrainera le narrateur dans une folle bringue sur une musique démente, « une façon de grincement fabuleux qui vous étire le monde – on se voyait en kaléidoscope ». Autant d’évocations, de L. A. à Vegas via Trona qui se constituent en fresque verbale acerbe et hypersensible à la fois, semée de réflexions saisissantes de lucidité et de désarroi mêlés. Lors d’une conversation, Quentin me confiera qu’il a été aussi à l’aise, dans ses lectures, avec San Antonio qu’avec Céline, autant en phase avec Harry Potter qu’avec Madame Bovary, son livre-fétiche dans lequel il partage surtout les douleurs de Monsieur. Et d’évoquer, aussi, la folie physique qui l’aura pris, en écriture, à l’écoute de John Coltrane !
Ce n’est pas tout : car Au point d’effusion des égouts s’achève sur une douzaine de pages remarquables, comme assagies du point de vue de la phrase (moins de « célinisme » endiablé…), sur le thème du retour à la normale, pour ne pas dire à la morne norme. Ah vous êtes artiste ! Ah vous écrivez ? Ah vous êtes parti en voyage !? Et maintenant, vous êtes bien avancé ? Et qu’allez vous faire !? Mélancoliques et graves, tendres et sourdement violentes, ces pages confirment mon sentiment que Quentin Mouron pourrait faire, à l’avenir, de grands livres.
Au point d’effusion des égouts marque, déjà, un début éclatant. Avec sa forme étrangement « compactée», comme on le dit d’un fichier d’ordinateur, il requiert une lecture très attentive (nullement fastidieuse au demeurant) qui permet d’en extraire toute la substance. On pense aussi à l’image proustienne de ces fleurs en papier comprimées, qui se déploient en beauté dès lors qu’on les plonge dans l’eau.
« Je m’aperçois partout », écrit Quentin Mouron en se repassant les images de son périple initiatique. « Chez tous les hommes que je rencontre ». Et d’ajouter : « Les mœurs, c’est la burqa des peuples. Ils sont semblables dessous. Pas identiques. Semblables. Les paumés de Trona avaient mes traits, mes traits aussi à Vancouver, chez les Chinois. Ma gueule à Chicago. Ma pomme à Montréal. Et Phénix, San Diego, Tijuana – ma pomme encore. Je me suis miré jusqu’au fond des déserts. Je me suis aperçu sur les crêtes. Retrouvé dans les grottes. Contemplé sur les lacs. On ne se débarrasse pas du monde en invoquant les moeurs. On ne se débarrasse pas de soi en invoquant le monde ».
Quentin Mouron. Au point d’effusion des égouts. Préface de Pierre-Yves Lador. Olivier Morattel, 137p.
(Cet article constitue la version "longue" d'un papier paru le samedi 17 décembre dans le quotidien 24Heures.)

Comment Olga dépasse certaine angoisse viscérale.
Le premier quart d’heure de chaque jour que vit Olga est plombé, avant l’aube, par une désespérance englobant toutes les sphères de la réalité en tant que telle, jusqu’aux élémentaires particules que nous sommes. Le sentiment dominant de ce moment de noir absolu revient à dire que rien ne vaut plus la peine, que tout est fichu d’avance : qu’il n’y a plus qu’à tirer l’échelle ainsi que le serinent les écrits du camarade Nitchevo, après quoi le vif lui revient et plus rien ne l’en fera démordre dès l’arrivée de la lumière.
La nature de ce mauvais quart d’heure est composite, moins liée qu’on ne pourrait croire à l’état du monde ou à la décrépitude indéniable qui atteint la sexa malgré l’exercice de la barre et son recours à divers cocktails de plantes médicinales, qu’à une conscience plus vertigineuse du néant de toute chose.
Olga s’est toujours défendu de prendre sur elle les misères mondiales et plus encore d’affecter l’air miné de celles et ceux qui feignent, en public ou sur Facebook, d’être touchés personnellement par le sort des victimes de tel ou tel conflit stratégiquement entretenu pour telle ou telle raison non avouée (le pétrole, etc.), entre autres séismes forcément injustes impliquant l’aveugle fatalité. Ce n’est pas cynisme de sa part, mais plutôt claire conscience d’un état de fait contre lequel elle, pas plus queThéo, ne peut quoi que ce soit.
Elle vient de penser à Théo parce que lui seul, dans son proche entourage, partage avec elle la mémoire des ruines.
Elle se rappelle l’azur translucide de ce jour-là, se reflétant dans les eaux denses du Haut-Lac à la surface duquel se découpaient aussi les sombres créneaux des monts de l’autre rive, lorsque, peu après leur rencontre fortuite à la proue du grand bateau blanc dont elle venait de humer la chaude odeur d’huile des machines, Théo, se penchant vers elle pour abriter, de ses deux grandes mains d’artiste, les siennes en train d’essayer d’allumer une cigarette malgré le vent du large, lui avait dit comme ça, contre toute attente et comme s’ils étaient complices, alors qu’ils se connaissaient à peine du Maldoror et de l’arrière-boutique de la Maréchale, que toute cette splendeur lustrale était faite pour aiguiser, voire exacerber ce qu’on pouvait dire, ou plutôt ce qu’elle et lui pouvaient dire, avait-il précisé de sa voix grave marquée par son traînant accent anglo-batave, la mémoire des ruines.
L’expression un peu lettreuse avait fait sourire Olga, qui se dit alors qu’un Nemrod eût pu la formuler, même n’ayant pas vraiment connu les ruines, tandis que Théo s’était bel et bien trouvé, et à deux reprises, d’abord à Amsterdam puis à Londres, perdu dans les décombres exhalant l’âcre odeur de brûlé, comme elle-même, sa main dans celle du vieux Boryna, avait vu, de ses yeux vu, la Grande Place de la capitale polonaise réduite à un champ de gravats dont les plus hauts vestiges de murs n’excédaient pas sa taille d’enfant de trois ans.
Cependant l’accablement pesant sur Olga au moment de l’éveil, avant l’aube, ne relève pas de ces couches-là de la plus ou moins claire conscience, mais d’une sensation plus récente, physique et plus encore, comparable à une sorte de trou noir existentiel provoquant en elle un irrépressible vertige.
C’est en elle, c’est une faille en elle qui fonde assurément son extrême et noire lucidité, et cela fait sa vulnérabilité à chaque éveil, qui se retourne ensuite en force à mesure que la lumière rétablit les nuances et détails de tout ce qui constitue ce qu’on appelle « la vie ».
La remontée qui s’ensuit marque ce qui pourrait se dire son retour de jeune âge de tous les jours, qui la fait s’entendre avec Cécile et Chloé aussi bien qu’avec Marie ou la Maréchale, ou tout aussi gaiement saluer les oiseaux et les jolis coiffeurs.
(Extrait d'un roman en chantier)
Peinture: Lucian Freud
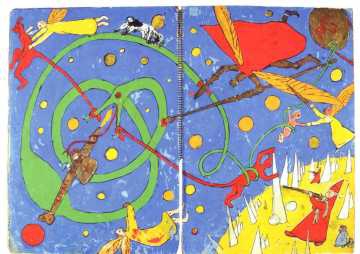
Celui qui révèle au grand jour que le tyran est un despote / Celle qui met en garde les vierges du Texas contre cet Assange qui aurait violé des Laponnes / Ceux qui lancent des bruits de chiottes dans les couloirs de l'Hospice/ Celui qui estime que la Banque du Vatican n’est pas un oxymore moins performant que le Marché de l’Art / Celle qui estime Assange et Snowden peu fair-play à l’égard d’ une nation sincèrement désireuse d’arrêter de fumer / Ceux qui invoquent la Dette chaque fois qu’on évoque Homère l’écrivain aveugle ou Œdipe le boiteux complexé/ Celui qui lance une alerte à la blonde / Celle qui affole les boussoles en perdant le nord /Ceux qui sont à l’affût des canons / Celui qui rappelle à la cantonade qu’il existe des phoques tropicaux dans le golfe du Mexique / Celle qui en pince pour le phoque moine / Ceux qui lancent le javelot de la critique au front de la Raison crédule / Celui qui sous le nom nordique de Kierkegaard lança l’alerte au Christ trahi par la chrétienté taxée d’insipide limonade et de marivaudage écoeurant / Celle qui détient un solide paquet d’actions de grâce à la banque du Saint-Esprit / Ceux qui placent leur confiance à un taux nettement en baisse / Celui qui estime que trahir la trahison n’est traître qu’aux yeux des traîtres / Celle qui planque ses écomnomies dans un chausson aux pommes / Ceux qui ont un bas de haine contre les banquiers / Celui qui entend moraliser les transactions en blanchissant le blanchiment / Celui qui conclut une affaire win-win avec son conseiller fiscal de l’Opus Dei / Celle qui mise sur la valeur Dieu Le Père & Fils / Celle qui se fait coffrer les mains dans le sac / Ceux qui estiment puériles ces attaques visant le bon vieux Crédit Agricole et Culturel ouvert aux Sports / Celui qui te recommande de profiter de la crise humanitaire / Celle qui relit Alerte à Champignol / Ceux qui n’ont pas de secrets d’Etat pour Maman / Celui qui va de confession en confessée / Celle qui a dépassé sa cote d’Arlette / Ceux qui vendent la mèche des chauves qui nous tondent,etc.
Peinture: Friedrich Dürrenmatt

Celui qui remercie celle qui l'a félicité d'être de ceux qui se congratulent / Celle qui répond pas de quoi à celui qui lui a dit service après qu'elle l'a remercié de lui sourire sans rien lui demander / Ceux qui bavent de bonté / Celui qui a l'air de s'excuser quand il demande pardon / Celle qui n'ose pas dire au Monsieur belge que le service n'est pas compté à la Buvette des sapins / Ceux qui sourient tellement qu'on leur voit les dents de derrière / Celui qui n'a cessé de répéter faut travailler la première moitié de sa vie et faut profiter la seconde / Celle qui répétait volontiers chez nous c'est chez nous avant l'ouragan venu de l'étranger/ Ceux qui te recommandent de profiter quand tu vas au Biafra / Celui qui a peur de traverser les villages de l'arrière-pays bernois vu que même le silence a l'air de s'y ennuyer/ Celle qui ouvre une onglerie dans la laiterie désaffectée de Nidau où Robert Walser passa jadis comme un pas grand-chose qu'il était sans qu'on lui lance des pierres ça faut pas toujours exagérer / Ceux qui ont fomenté la ruine de l'onglerie où la Picarde olé olé attire nos ménagères / Celui qui reproche aux sapins jurassiens leur garde-à-vous à la frontière / Celle qui a un gros bobo dans son lit genre ex-rebelle sybarite et qui ronfle / Ceux qui font remarquer au pasteur germanophone récemment installé chez nous qu'on ne dit pas des gens bons mais de bonnes gens / Celui qui n'a pas trouvé de port dans ce pays où les fleuves ne font que passer / Celle qui dit à l'ado fugueur maintenant on te tient / Ceux qui se retrouvent au zoo de Bâle pour un colloque entre hominiens / Celui dont la rêverie au long cours fut amorcée par les portulans de son aïeul Emile par ailleurs placeur au théâtre municipal / Celle qui sanglote au lieudit Les Enfants Noyés dont l'ancien étang a été drainé pour l'extension du parking du bar Aux Âmes Perdues / Ceux qui préfèrent Ernest Hello le mystique à Virginie Despentes la miss toc / Celui qui aura toujours préféré la compagnie de Londubec et Poutillon à celle des profs de philo de centre gauche et autres raseurs genre psys concernés de centre droite / Celle qui s'est sentie exclue des conciliabules de Barabo et Poumani d'où son repli sur le tricot /Ceux qui sont tellement bons qu'on leur voit le coeur brodé sur le tricot, etc.
(Cette liste a été établie en marge de la lecture de la monumentale bio de Jean-Pierre Martin consacrée à Michaux Henri et parue chez Gallimard en 2003).

Celui que sa cougar tient en laisse dans les coursives du thonier / Celle dont les cheveux roses en jettent dans l'aréopage des gars tout latex / Ceux qui le font dans le caniveau genre néo-bobos socialistes de droite portés sur l'échange des valeurs avec les potières lectrices de L'Huma / Celui qui lit Demain les chiennes de Démone de la Réunion / Celle qui aboie sans soif / Ceux qui se la jouent hot-dogs entre adultes consentants / Celui qu'on dit le Casanova des boxers bisontins sans raison précise à vrai dire / Celle qui coupe son teckel en deux pour passer la douane de Kennedy Airport / Ceux qui gardent le chien de leur cousine de Sienne / Celui qui a une tête de molosse et une queue de colosse donc peu d'intérêt pour les chercheuses en étude genre / Celle qui sans vergogne déclare qu'elle a les crocs en débarquant dans le living de Doris la végétarienne lectrice de Jean d'Ormessier / Ceux qui appellent à souper Guillaume et les filles / Celles qui sont accros à Downton Abbey et déplorent la mort prématurée du beau Pamuk victime du même ictus que le cardinal Daniélou dans une série concurrente / Celui qui lit et relit le fameux roman Celle du baigneur en se demandant ce qu'Ariane peut bien trouver à ce bellâtre de Solal / Celle qui traitée au Monoï se promène nue devant l'étal de tomates qui en pâlissent d'envie / Celles qui ont fait le Kénya et Phuket avant de se retrouver en Haute-Autriche avec ce raseur de Schlemmer lésinant sur le triolisme à la musulmane / Ceux qui étudient la lutte des classes dans les dortoirs de banlieues / Celles qui hésitent à proposer la moralisation des tournantes qui risque de donner des arguments au Front populiste / Celui qui offre un violon à son doberman Salieri qui joue déjà la Kleine NachtMusik sans partition / Celle dont même les chatteries ont du mordant / Ceux dont le roquet Sarko partage les ambitions républicaines et plus si affinités / Celui qui conseille la lecture de Boris Cyrulnik à son barzoï déprimé / Ceux dont le cynisme ne fait que mordre / Celles qui donnent la patte à poussière à qui en voudra, etc.

Ce matin dans Le Figaro, sur une pleine page, l'historien Jacques Julliard, éditorialiste de Marianne, expose sa conception de l'identité française en réponse aux questions de Vincent Trémolet de Villers. Les lecteurs romands que nous sommes en prennent sympathiquement connaissance à fleur de dunes, avec le port de Sète pour horizon bleuté...
 Sur la langue française: "L'identité française, c'est d'abord une langue, la nôtre. Elle est un signe de ralliement, une culture, un esprit. Je me souviens d'un séjour d'un an aux Etats-Unis. Au retour, quand je suis arrivé à l'aéroport de Montréal, au Québec, et que j'ai entendu parler français dans le haut-parleur, j'ai eu un tel saisissement que je me suis mis à pleurer".
Sur la langue française: "L'identité française, c'est d'abord une langue, la nôtre. Elle est un signe de ralliement, une culture, un esprit. Je me souviens d'un séjour d'un an aux Etats-Unis. Au retour, quand je suis arrivé à l'aéroport de Montréal, au Québec, et que j'ai entendu parler français dans le haut-parleur, j'ai eu un tel saisissement que je me suis mis à pleurer".
 Sur la littérature: "L'identité française, ensuite, c'est la littérature. Je m'inquiète qu'elle soit de moins en moins enseignée à l'école. Que les fables de La Fontaine ne soient plus apprises aux enfants. Que Les Châtiments de Victor Hugo prennent la poussière. Et je répète là ce que j'ai écrit dans Marianne: si je devais choisir entre la littérature française et la gauche, si la gauche me donnait l'impression de rompre avec cette nourriture essentielle que sont les livres, je choisirais la littérature. Et ce n'est pas un propos de mandarin. J'ai connu un paysan qui n'avait lu qu'un livre dans sa vie, c'était Les Misérables: il était cultivé.
Sur la littérature: "L'identité française, ensuite, c'est la littérature. Je m'inquiète qu'elle soit de moins en moins enseignée à l'école. Que les fables de La Fontaine ne soient plus apprises aux enfants. Que Les Châtiments de Victor Hugo prennent la poussière. Et je répète là ce que j'ai écrit dans Marianne: si je devais choisir entre la littérature française et la gauche, si la gauche me donnait l'impression de rompre avec cette nourriture essentielle que sont les livres, je choisirais la littérature. Et ce n'est pas un propos de mandarin. J'ai connu un paysan qui n'avait lu qu'un livre dans sa vie, c'était Les Misérables: il était cultivé.
Pour Jacques Julliard, l'identité française est aussi une histoire et un territoire, et ne saurait appartenir qu'aux identitaires.
S ur l'ouverture au monde: "Certes, il y a aujord'hui une désolante tendance identitariste qui fait fi de l'ouverture au monde de notre pays. Cette ouverture que la Révolution a consacrée et qui existait déjà avec certains rois de France. Ce "souci du monde" fat aussi parti de notre identité. Il n'empêche: je ne voispas pourquoi la France serait le seul pays à ne pas avoir droit à une identité"...
ur l'ouverture au monde: "Certes, il y a aujord'hui une désolante tendance identitariste qui fait fi de l'ouverture au monde de notre pays. Cette ouverture que la Révolution a consacrée et qui existait déjà avec certains rois de France. Ce "souci du monde" fat aussi parti de notre identité. Il n'empêche: je ne voispas pourquoi la France serait le seul pays à ne pas avoir droit à une identité"...
Cf. Le Figaro du vendredi 5 juin 2015, p.16.
 Celui qui traite son épouse Frieda à moitié paralysée mais encore assez lucide, 87 ans au compteur, de vieille tomate / Celle qui prétend avoir tenu ses promesses faites à Dieu Le Fils le jour de sa communion solennelle à l’église catholique Saint-Christophe jouxtant les studios de Radio-Lausanne à la grande époque de l’inspecteur Picoche / Ceux qui font les quatre cents coups dans le pavillon Les Poulains de l’Etablissement médico-social Au Point du jour / Celui qui se rappelle l’odeur croupie des bras du ruisseau de la Vuachère au printemps des écrevisses / Celle qui a serré son trousseau dans une certaine malle qu’elle a déclarée maudite après que sa mère Fernand née Roduit eut éconduit son septième prétendant / Ceux qui en venaient au mains au cinéma Bio au temps des westerns à 50 centimes / Celui qui se rappelle assez exactement le sentiment de délivrance qu’il a éprouvé lorsqu’il a ouvert la cage des treize perruches qu’on lui a offertes pour son neuvième anniversaire coïncidant avec l’arrivée des réfugiés hongrois / Celle qui faisait payer vingt centimes à ses enfants quand leur échappait le moindre merde-chier / Ceux qui logeaient une quinzaine de saisonniers italiens dans les anciens poulaillers du domaine / Celui qui a vu l’incendiaire Gavillet de près quand on l’a emmené menotté et penaud après que les gendarmes l’eurent localisé dans le bois de la Scie sur dénonciation du taupier Jolidon/ Celle qui ne supporte plus les provocations verbales de son cousin célibataire et seul parent restant lui lançant à travers la cafétéria de l’Asile de Vieux : « Tu pines ou tu dînes ? » / Ceux qui se gaussent de l’amour des deux vieux gays en n’osant pas les taxer tout haut de vieilles pédales comme au bon vieux temps / Celui qui officiait en tant que placeur au cinéma Le Colisée dans la caisse duquel il prélevait de quoi se payer ses cigares Brissago / Celle qui prétendait qu’il suffirait d’un regard coulé de ses yeux à la Carmen pour faire chuter le nouveau pasteur du quartier probablement puceau et moralisant à l’extrême / Ceux qui se défonçaient au LSD au pied des nouvelles tours de la Cité des Oiseaux avant de se baigner nus dans la piscine entourée de barbelés / Celui qui se souvient très exactement de l’odeur des classes de l’école primaire à chaque rentrée / Celle qui se tordait les chevilles sur ses patins vissés tandis que le bel Alfredo tournait gracieusement autour d’elle sur la glace du petit lac artificiel des hauts de ville/ Ceux qui levaient la tête toutes les fins de samedi après-midi en suivant les évolutions du boulanger Thomas se livrant à l’acrobatie aérienne à l’aplomb du stade olympique, etc.
Celui qui traite son épouse Frieda à moitié paralysée mais encore assez lucide, 87 ans au compteur, de vieille tomate / Celle qui prétend avoir tenu ses promesses faites à Dieu Le Fils le jour de sa communion solennelle à l’église catholique Saint-Christophe jouxtant les studios de Radio-Lausanne à la grande époque de l’inspecteur Picoche / Ceux qui font les quatre cents coups dans le pavillon Les Poulains de l’Etablissement médico-social Au Point du jour / Celui qui se rappelle l’odeur croupie des bras du ruisseau de la Vuachère au printemps des écrevisses / Celle qui a serré son trousseau dans une certaine malle qu’elle a déclarée maudite après que sa mère Fernand née Roduit eut éconduit son septième prétendant / Ceux qui en venaient au mains au cinéma Bio au temps des westerns à 50 centimes / Celui qui se rappelle assez exactement le sentiment de délivrance qu’il a éprouvé lorsqu’il a ouvert la cage des treize perruches qu’on lui a offertes pour son neuvième anniversaire coïncidant avec l’arrivée des réfugiés hongrois / Celle qui faisait payer vingt centimes à ses enfants quand leur échappait le moindre merde-chier / Ceux qui logeaient une quinzaine de saisonniers italiens dans les anciens poulaillers du domaine / Celui qui a vu l’incendiaire Gavillet de près quand on l’a emmené menotté et penaud après que les gendarmes l’eurent localisé dans le bois de la Scie sur dénonciation du taupier Jolidon/ Celle qui ne supporte plus les provocations verbales de son cousin célibataire et seul parent restant lui lançant à travers la cafétéria de l’Asile de Vieux : « Tu pines ou tu dînes ? » / Ceux qui se gaussent de l’amour des deux vieux gays en n’osant pas les taxer tout haut de vieilles pédales comme au bon vieux temps / Celui qui officiait en tant que placeur au cinéma Le Colisée dans la caisse duquel il prélevait de quoi se payer ses cigares Brissago / Celle qui prétendait qu’il suffirait d’un regard coulé de ses yeux à la Carmen pour faire chuter le nouveau pasteur du quartier probablement puceau et moralisant à l’extrême / Ceux qui se défonçaient au LSD au pied des nouvelles tours de la Cité des Oiseaux avant de se baigner nus dans la piscine entourée de barbelés / Celui qui se souvient très exactement de l’odeur des classes de l’école primaire à chaque rentrée / Celle qui se tordait les chevilles sur ses patins vissés tandis que le bel Alfredo tournait gracieusement autour d’elle sur la glace du petit lac artificiel des hauts de ville/ Ceux qui levaient la tête toutes les fins de samedi après-midi en suivant les évolutions du boulanger Thomas se livrant à l’acrobatie aérienne à l’aplomb du stade olympique, etc.

Une intensité réjouissante marquait les derniers échanges d'Olga et Jonas.
Olga savourait la pulpe bien mûre des griottes dont Théo lui avait laissé la veille un plein sachet, tout en déchiffrant le dernier SMS-fleuve de Jonas.
Elle lui évoquait tous les jours, depuis quelque temps, les pages nouvelles de L'Ouvroir, comme s'il s'agissait de composants de sa propre vie, et le fils de Nemrod en redemandait, toujours curieux de ce qui sortait de l'atelier paternel en dépit de l'océan qui les séparait au propre et au figuré.
De son côté, Jonas parlait des gens qu'il avait rencontrés depuis que, par l'entremise de Lady Light, il avait fait la connaissance d'un vieil ami-amant de celle-ci, au surnom de Mister John.
Une compréhension éprouvée des gens, saine et toujours sereine de jugement, caractérisait ce Mister John avec lequel il avait fait, sur sa demande, le pèlerinage en divers lieux chers à son souvenir, à commencer par le Broadway Automat et le Radio Music City Hall.
Un soir qu'ils étaient sortis ensemble, Mister John s'appuyant au bras de Jonas après l'avoir prié de s'accorder à sa marche ralentie par le grand âge, ils s'étaient arrêtés d'un même accord pour se laisser pénétrer par la vision crépusculaire de la rue.
Jonas la décrivait à Olga dans ce SMS d'un lyrisme urbain assez rare chez lui: "La nuit était tombée et les lumières de Broadway répondaient à toutes nos prières simples. Très haut dans les airs, il y avait de grandes affiches brillamment éclairées représentant des héros ensanglantés, des amants criminels, des monstres et des desperados armés. Les noms des films et des boissons gazeuses, des restaurants et des cigarettes étaient écrits dans un feu d'artifice de lumière, et au loin on distinguait les dernières lueurs du jour au-delà de l'Hudson River. Les immenses buildings à l'est de la ville étaient éclairés et semblaient être la proie des flammes".
Pas plus qu'Olga Jonas ne prétendait écrire, ce qui s'appelle écrire, au sens tyrannique où le vivait Nemrod, mais les commodités du système SMS (Save My Soul), entre autres vecteurs pratiques de l'échange synchrone, lui convenaient dans la mesure où, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, sauf quand il pratiquait ses apnées matinales, le subtil appareillage lui permettait, à fines pressions de ses doigts, d'atteindre Olga ou le mecton de Chloé, dit aussi l'Irlandais, le Monsieur belge à Canberra ou Théo dans son Isba, Cécile à la sortie de sa séance hebdomadaire de Taï-tchi ou Rachel pour évoquer, une fois de plus, feu le vieux Sam éternellement jeune à leur souvenir partagé.
Le seul nom de l'Hudson avait rappelé à Olga sa propre découverte de Brooklyn Heights, des années auparavant, quand Lady Light avait commencé de perdre la vue, puis elle avait évoqué, dans un SMS aussi développé que le précédent de Jonas, la très belle séquence de la mort du père, dans L'Ouvroir, révélant une facette de la sensibilité de Nemrod qu'elle avait toujours pressentie mais qui s'exprimait ici de manière si simple et si tendre qu'elle semblait d'une voix jamais entendue, même par Jonas au moment de sa dernière réconciliation d'avec la vieux sanglier.
Précisions techniques sur le réseautage des protagonistes du roman en cours: En tant que facilitateur des relations entre ses personnages, le romancier se faiit un plaisir malin de multiplier les arborescences narratives leur permettant de communiquer sans se trouver forcément engagés dans le même épisode. Pour sa part, sans quitter sa table, ou de n'importe quel lieu connecté, fort de son Samsung Galaxy III ou de sa tablette iPad Maxitech, il se plaît à relayer ou relancer les messages intercontinentaux, tels que ceux de Jonas et Olga, mais aussi les communications plus proches, par exemple de Théo et Léa (il est en ville et elle lui demande de lui ramener une botte de radis ou le dernier roman de ce Marcus Goldman dont tout le monde parle), entre autres courriels adressés par les protagonistes du roman. De surcroît, les nouvelles ressources de la narration panoptique auront ouvert une brèche temporelle permettant aux personnages du roman de converser librement avec leurs homologues d'ouvrages parus dans les années ou les siècles passés, n'excluant pas ainsi la rencontre virtuelle d'Olga la cougar et de Julien Sorel au saut du lit, entre cent autres exemples imaginables par la lectrice ou le lecteur.
(Extrait d'un roman en chantier)

Celui qui explique que le Sepp va revenir à la maison après que tous ces étrangers ont failli lui contacter la corruption / Celle dont la trisaïeule venait aussi d'Ulrichen où un prêtre italie l'a connue au sens de la Bible et la rejetée ensuite donc voilà qu'elle a dû partir avec la petite alors qu'il faisait son innocent là-bas / Ceux qui estiment que les soucis de la FIFA viennent de tous ces responsables de couleur ceci dit sans vouloir critiquer / Celui qui déclare dans son article du Temps de ce matin qu'il est injuste, au sens libéral du terme, de sous-entendre que M. Blatter aurait trempé en de certaines eaux malpropres sans avancer le début d'une preuve confirmée par un notaire genevois, alors que les médias bas de gamme et l'opinion publique ne savent rien et se contentent de caqueter au contraire des journaux responsables tel Le Temps se fiant à des sources semblables à l'eau Valser descendue des alpages d'où vient aussi M. Blatter par ailleurs proche des actionnaires du titre / Celle qui fait fi des fions fusant sur la FIFA / Ceux qui estiment qu'après le départ de ce vendu de Blatter tout va changer à la FIFA sauf si Le Temps dit le contraire donc on reste attentif / Celui qui rappelle que le Sepp a grimpé là-haut à la force de la poignée en économisant sou par sou et se trouve donc confronté aux jalousies comme l'Administration du téleski d'Ulrichen ainsi est l'homme / Ceux qui insinuent qu'il faut deux Platini pour rouler un Blatter ou le contraire selon les cantons / Celui qui a fait son école de recrue avec un Roger Blatter devenu l'as du badminton dont parle Le Temps dans ses pages économiques / Celle qui a préparé une poésie d'accueil pour le retour de Sepp auquel devrait assister le conseiller fédéral Maurer également intéressé dans les fonds secrets du Qatar / Ceux qui se réjouissent de la victoire de Stan que Rodgère a saluée comme d'un ami, etc.

Ce qu'Olga recherche auprès des chiens et des livres.
Le sens commun de la Maréchale, autant que les intuitions et la débonnaireté de Clément Ledoux auront toujours valu à la Polonaise, dès son installation au Vieux Quartier, le meilleur accueil qui soit. Avec ceux-là, jamais Olga n'a eu besoin d'affabuler. Au milieu de leurs livres et de leurs chats, elle s'est tout de suite sentie chez elle, et l'amitié gourmande qui s'est développée dans l'arrière-boutique des Fruits d'or lui est un refuge plus précieux que celui d'aucun cénacle à prétention mondaine. Pour ne citer qu'un détail, elle a reconnu, chez le couple déjà bien enveloppé à l'époque, et non moins solidement installé dans les murs cassés de l'ancienne trappe à bouquins séditieux de l'anar Volker, cette qualité de douceur et de rude bonté filtrant par ce qu'elle a aussitôt désigné, chez l'un et chez l'autre, par l'expression, littéralement traduite de sa langue, des yeux-qui-rient.
Certains chiens rient aussi, rien qu'avec les yeux, dont Olga se souvient avec une tendresse particulière, comme de certains passages lumineux de certains livres.
Christopher assis devant elle, au Maldoror, silencieux et souriant absolument, incarnant à la fois l'enfant mystérieux et l'ami secret, diffusait la même sorte d'aura tenant à la fois de l'animal et de l'angélique messager, comme de ses chiens les plus personnels et de quelqes livres.
Le zoophile n'a rien compris à l'animal, qui entend le soumettre comme un esclave ou comme un objet, sans que l'animal soit supposé le mordre ou lui dire son fait. De même le pédomane abuse-t-il de son pouvoir d'enlaidir, qui fait insulte à la surnaturelle animalité de l'enfant.
L'enfant, sans désir jamais d'en avoir un à elle, le chien, se multipliant par tous les noms plus ou moins légendaires qu'elle leur a donnés, et les livres, dont tous les titres se réduisent ce matin à celui de L'Ouvroir dont elle va reprendre tout à l'heure la dactylographie des feuillets couverts de l'encre bleue de Nemrod, auront en somme constitué la trinité profane d'Olga, sans l'empêcher d'apprécier la crème soubise et le pot-au feu de la Maréchale, autant que les SMS-fleuves que Jonas lui envoie jour et nuit de Brooklyn Heights.
(Extrait d'un roman en chantier)
Peinture: Stanislaw Ignacy Witkiewicz.