


À propos de Bouboule, premier long métrage de Bruno Deville. À voir (absolument) ces jours
prochains en salle.
Dès l’apparition de Bouboule, tendre tas de rose chair pantelante aux seins flasques, bouille d’ange souriant pataud-piteux, entre un docteur grondeur et sa mère désolée, Bruno Deville impose une présence hors norme, merveilleusement incarnée par le jeune David Thielemans, 12 ans.
Chouchouté par sa mère un peu perdue (Julie Ferrier), moqué par ses deux sœurs plus à la coule que lui , souffre-douleurs de certains de ses camarades, en manque de présence paternelle, Kevin, alias Bouboule, croit trouver un modèle auprès de Patrick, le vigile de supermarché (Swann Arlaud) dont le chien de commando Rocco deviendra son ami.
Premier long métrage du réalisateur à double nationalité belge et suisse, Bouboule n’est pas un film « sur » l’obésité mais l’histoire d’un enfant empêtré dans son corps qui tâche de s’affirmer par mimétisme viril. Si ses modèles se révèlent décevants, voire minables, Bouboule n’en franchit pas moins une étape personnelle marquante en dépit de ses mentors menteurs et de son lamentable paternel. Evitant toute simplification et tout pathos, dans une tonalité oscillant entre dérision et tendresse où l’image et la musique (signée –M-, alias Mathieu Chédid) se fondent en unité poétique, Bouboule est un film touché par une sorte de grâce profane.
Entretien avec Bruno  Deville
Deville
- Quelle a été la genèse de Bouboule ?
- Ce projet me tient à cœur depuis longtemps, dont le thème a d’ailleurs nourri un premier court métrage, La Bouée, qui évoquait déjà le vécu d’un enfant obèse de 8 ans dans une forme inspirée par la chanson Ces gens-là de Jacques Brel, sans véritable histoire. Or ce film de diplôme reflétait ma propre expérience. De fait, dans mon enfance et mon adolescence, je me suis souvent trouvé moi-même en surpoids du fait de problèmes thyroïdiens non décelés à l’époque, et je garde aujourd’hui, y compris sur mon corps, les cicatrices de l’obésité. Je sais ce que c’est que d’être humilié à cause de celle-ci, je sais la difficulté de se montrer en maillot de bain à la piscine quand on est obèse, je me rappelle les moqueries de mes camarades aux vestiaires, j’ai détesté mon corps et continue, à 38 ans, de le surveiller dans la glace.
Pourtant je n’avais pas l’intention de faire un film « sur » l’obésité. Très marqué par Toto le héros du réalisateur belge Jaco van Dormael, j’avais envie de traiter mon sujet dans cette optique poétique, plutôt que sur le mode du social-réalisme à la manière des frères Dardenne.
Après La Bouée, qui a fait un joli parcours dans les festivals, j’ai réalisé un autre court métrage, Viandes, avec Antoine Jaccoud qui m’avait déjà coaché pour mon travail de diplôme et a écrit par ailleurs, lui-même, une pièce traitant del’obésité. Je suis donc retourné vers lui avec mon matériau autobiographique et nous avons commencé, vers 2005, à travailler ensemble sur le projet de Bouboule.
Parallèlement, je me suis documenté auprès de certaines institutions, comme l’USADE, prenant en charge les enfants et adolescents sujets à des problèmes cardiovasculaires liés à l’obésité, et j’ai filmé nombre de ceux-là en recueillant leurs témoignages. Une fois encore, cependant, il ne s’agissait pas de réaliser un documentaire de plus mais de raconter l’histoire d’un gosse dont le talon d’Achille était le surpoids. À ce thème s’en est ajouté un autre, qui remonte à ma rencontre d’un maître-chien, prénommé Patrick et spécialisé dans le dressage des chiens decombat. L’idée d’évoquer alors son univers, en relation avec l’obsession actuelle de l’ultra-sécurité, a germé etm’a fourni le complément de l’histoire avec le personnage du vigile. Face au gosse en déficit de virilité, encore fragilisé par l’absence du père – que j’ai connue moi aussi -, le vigile Patrick incarne ainsi le modèle ultra-masculin qui va permettre àBouboule de se construire. À partir de là, avec Antoine Jaccoud, nous avonscommencé de travailler sur les deux personnages contrastés de l’ado candide et du vigile faux-dur.
 -- Dans quelles circonstances êtes-vous tombé sur David Thielemans, le formidable interprète de Bouboule ?
-- Dans quelles circonstances êtes-vous tombé sur David Thielemans, le formidable interprète de Bouboule ?
- Le casting du rôle a été très long et parfois éprouvant. Hitchcock disait qu’il ne faut pas tourner avec des enfants, des animaux ou des bateaux, trois « acteurs » imprévisibles. Je n’en ai pas moins affronté deux contraintes dont l’une, avec les enfants, m’a fait revivre des moments personnels difficiles quand je demandais aux gosses de s’impliquer devant la caméra, auxquels il arrivait de paniquer ou même des’effondrer.
Sur quoi, un peu par hasard, comme je me trouvais avec un collaborateur à Bruxelles, David est apparu dans un groupe d’enfants sortant de l’école. Je l’ai tout de suite abordé et lui ai dit ce que je cherchais. Croyant d’abord que je la lui jouais « caméra cachée », il a vite compris que c’était du sérieux et m’a conduit chez sa mère avec laquelle il vivait en relation fusionnelle. Le lendemain, après une heure et demie d’essais, alors qu’il n’avait jamais joué jusque-là, je l’ai trouvé formidable en sa belle candeur, avec ce regard que j’aime beaucoup, comme absent, les yeux mi-clos, qu’on retrouve d’ailleurs chez Swann Arlaud devenu notre vigile. Comme Bouboule, il y avait chez lui ce mélange d’ingénuité de l’enfant qu’on peut encore surprendre, et la détermination du môme blessé par la vie. Par ailleurs, sa mère était très proche du personnage du scénario, et le père absent complétait le tableau. Pendant les huit semaines de tournage, séparé de sa mère pour la première fois de sa vie, David a sûrement vécu la première grande expérience de sa vie sans comprendre pour autant ce qu’est un acteur. S’il a assimilé tous les dialogues du film en très peu detemps, avec l’aide de sa répétitrice, et s’il a pigé les règles du plateau, mon travail a été de lui expliquer ce que vit Bouboule. Ainsi, pendant tout lefilm, David joue Bouboule sans rien composer. Cela donne, je crois, quelquechose d’aussi touchant que vrai.
- Qu’en est-il du travail sur l’image, essentielle dans ce film ?
- Lorsque j’étais enfant, je me suis créé des espèces de « bulles » trans-digestives liées à la nourriture, que jetenais à recréer visuellement par la magie des images. Je voulais éviter une poétisation artificielle « plaquée », en recréant ces« bulles » par les situations. Ainsi l’apparition de l’éléphant est-elle liée à ce moment où Bouboule se régale sur un banc, son plaisir de manger lui faisant « voir des trucs », comme il le dit à son copain.C’est dans cette optique que nous avons travaillé la colorimétrie et les cadrages de tout le film, avec le chef opérateur Jean-François Hensgens, la décoratrice Françoise Joset et la costumière Elise Ancion, notamment. J’avais,en point de mire, le travail des photographes Martin Parr et Gregory Crewdson, dont j’aime particulièrement les climats tendres-acides aux couleurs saturées,qui restituent le mélange de réalité et d’irréalité auquel je tenais.
- La musique de-M- va dans le même sens…
- J’en ai rêvé, et quand j’ai rencontré Matthieu Chedid, auquel j’avais envoyé quelques images qui l’ont immédiatement accroché,je lui ai dit que je ne voyais aucun musicien contemporain qui puisse, mieux que lui, ajouter à mon film sa magie tendre, à la fois fragile et vibrante. Malgré son agenda de star, il a trouvé le temps de ciseler la musique de bout en bout et de composer la chanson de Bouboule. Cette rencontre tient du miracle autant que celle de David Thielemans, s’ajoutant à ma complicité amicale avec Antoine Jaccoud et à ma nouvelle collaboration avec Jean-François Hensgens, entre autres. Je pense d’ailleurs qu’un film est fondamentalement une oeuvre collective.
- Qu’en est-il du regard sur le monde que vous portez à travers Bouboule ?
- En fait, je n’ai pas la prétention d’exprimer une « vision du monde » personnelle. J’aborde de nombreux thèmes importants, dans ce film, tels que la différence liée au surpoids, la violence, le racisme, la carence affective, la construction de soi ou la sécurité, mais je ne délivre aucun message à caractère édifiant : je laisse parler mes personnages avec leur mélange de trivialité et de drôlerie, leur bêtise et leur bassesse éventuelle, mais aussi leur candeur et leur humour – toute leurhumanité.


 La lecture de Tchékhov est pour moi vivifiante, peut-être plus encore que celle de Dostoïevski ou de Tolstoï, en cela qu’elle est pure de toute idéologie religieuse ou politique, et qu’elle achoppe à des vies fragiles ou égarées,souvent même perdues. Il y a chez lui une attention aux gens, de toutes espèces, pauvres ou riches, qui va, sans exagération, vers plus d’empathie et de compréhension.
La lecture de Tchékhov est pour moi vivifiante, peut-être plus encore que celle de Dostoïevski ou de Tolstoï, en cela qu’elle est pure de toute idéologie religieuse ou politique, et qu’elle achoppe à des vies fragiles ou égarées,souvent même perdues. Il y a chez lui une attention aux gens, de toutes espèces, pauvres ou riches, qui va, sans exagération, vers plus d’empathie et de compréhension. Le portrait très nuancé, sévère mais juste, de Gide par Simon Leys, dans son Protée et autres essais, où il fait la part du grand homme de lettres et du vieillard maniaque courant après les petits garçons, m’intéresse autant que ses développements sur Stevenson, Confucius, Don Quichotte ou Orwell. C’est le type de l’honnête homme que ce grand passeur disparu récemment, dont je vais lire tous les écrits qui me sont encore inconnus.
Le portrait très nuancé, sévère mais juste, de Gide par Simon Leys, dans son Protée et autres essais, où il fait la part du grand homme de lettres et du vieillard maniaque courant après les petits garçons, m’intéresse autant que ses développements sur Stevenson, Confucius, Don Quichotte ou Orwell. C’est le type de l’honnête homme que ce grand passeur disparu récemment, dont je vais lire tous les écrits qui me sont encore inconnus.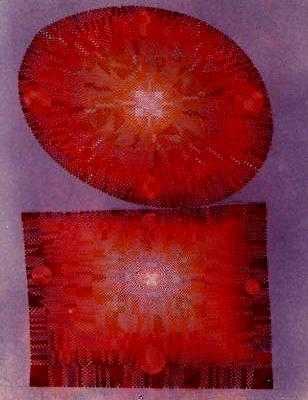
 Locarno, all’Alba, ce mercredi 6 août. - Départ ce matin vers midi. Passons par Ulrichen où je m’arrête au cimetière dans lequel repose notre lointain aïeul l’abbé toscan qui engrossa la mère-grand de notre grand-mère – illico chassée des lieux pour inconduite -, montons au col du Nufenen dont je découvre les majestueuses hauteurs, puis gagnons Locarno en tirant la langue aux automobilistes immobilisés par les calamiteuses files d’attente du sud du Gotthard. Tout au long de la route, je lis à ma bonne amie, entre autres, le petit roman de Bertrand Redonnet, Le Diable et le berger, toujours très Maupassant poitevin et néanmoins très Redonnet, charnel de langue et rebelle de ton. Enfin nous avons retrouvé notre point de chute de l’Alba avec reconnaissance, le sourire amical des employées portugaises et de la patronne à perruque de bronze noir, la piscine bleu Hockney et la vue sur le lac et les monts – la terrasse de Da Luigi et, ce soir, la Piazza Grande où quelque 8000 spectateurs assistaient à Lucy de Luc Besson, genre BD d’anticipation où je m’étonne de ne m’être pas ennuyé une minute en dépit de l’ineptie de la chose.
Locarno, all’Alba, ce mercredi 6 août. - Départ ce matin vers midi. Passons par Ulrichen où je m’arrête au cimetière dans lequel repose notre lointain aïeul l’abbé toscan qui engrossa la mère-grand de notre grand-mère – illico chassée des lieux pour inconduite -, montons au col du Nufenen dont je découvre les majestueuses hauteurs, puis gagnons Locarno en tirant la langue aux automobilistes immobilisés par les calamiteuses files d’attente du sud du Gotthard. Tout au long de la route, je lis à ma bonne amie, entre autres, le petit roman de Bertrand Redonnet, Le Diable et le berger, toujours très Maupassant poitevin et néanmoins très Redonnet, charnel de langue et rebelle de ton. Enfin nous avons retrouvé notre point de chute de l’Alba avec reconnaissance, le sourire amical des employées portugaises et de la patronne à perruque de bronze noir, la piscine bleu Hockney et la vue sur le lac et les monts – la terrasse de Da Luigi et, ce soir, la Piazza Grande où quelque 8000 spectateurs assistaient à Lucy de Luc Besson, genre BD d’anticipation où je m’étonne de ne m’être pas ennuyé une minute en dépit de l’ineptie de la chose. All’Alba, ce dimanche 10 août. – En songeant ce matin à mon projet de papier sur L’Ami barbare, magistralement remanié et amélioré par JMO, le mot de légende me vient, qui en amorcera la première phrase : la légende est une manière, pour l’homme, d’exorciser la mort en transformant le plomb de la vie quotidienne en or, etc.
All’Alba, ce dimanche 10 août. – En songeant ce matin à mon projet de papier sur L’Ami barbare, magistralement remanié et amélioré par JMO, le mot de légende me vient, qui en amorcera la première phrase : la légende est une manière, pour l’homme, d’exorciser la mort en transformant le plomb de la vie quotidienne en or, etc. All’Alba, ce jeudi 14août.- Nous avons rejoint ce midi nos amis Jasmine et Pascal Rebetez dans un grotto de Verscio où nous avons bien mangé (polenta à la tessinoise) et passé de bonnes heures. Pascal me raconte une histoire assez tordante à propos de Godard, à qui il demandait un jour – à propos d’un projet de film pour l’Expo – ce qu’il en serait des droits d’auteurs des innombrables citations émaillant le film. Alors Godard (bonne imitation par Pascal de l’accent traînant de celui-ci) de répondre : « Ben quoi, ils peuvent me faire un procès, c’est sûr ; et s’ils me font un procès, je fais un film du procès… »
All’Alba, ce jeudi 14août.- Nous avons rejoint ce midi nos amis Jasmine et Pascal Rebetez dans un grotto de Verscio où nous avons bien mangé (polenta à la tessinoise) et passé de bonnes heures. Pascal me raconte une histoire assez tordante à propos de Godard, à qui il demandait un jour – à propos d’un projet de film pour l’Expo – ce qu’il en serait des droits d’auteurs des innombrables citations émaillant le film. Alors Godard (bonne imitation par Pascal de l’accent traînant de celui-ci) de répondre : « Ben quoi, ils peuvent me faire un procès, c’est sûr ; et s’ils me font un procès, je fais un film du procès… » Ensuite à La Sala pour y voir Homo Faber, le dernier film de Richard. L’intro de celui-ci, mordante à souhait à l’égard desperroquets, est intéressante, et j’ai été bonnement émerveillé de revoir la chose sur grand écran, tant les trois femmes et les images sont belles, et puissante la mélodie du texte de Frisch.
Ensuite à La Sala pour y voir Homo Faber, le dernier film de Richard. L’intro de celui-ci, mordante à souhait à l’égard desperroquets, est intéressante, et j’ai été bonnement émerveillé de revoir la chose sur grand écran, tant les trois femmes et les images sont belles, et puissante la mélodie du texte de Frisch. Piazza Grande, ce vendredi 15 août. – Repris complètement, ce matin, mon texte sur L’Ami barbare, dont Isabelle Falconnier, qui me l’a commandé pour L’Hebdo, s’est dit enchantée ce soir. Je me suis efforcé de bien mettre en rapport fiction et vérité, faits et légende,en soulignant la verve épique du livre. Je ne crois pas avoir forcé la note, tout en laissant filtrer mon enthousiasme alors que la première mouture du livre, ce printemps, m’avait laissé perplexe à certains égards – mais ce diable de JMO a écouté cet emmerdeur de JLK et fait honneur à notre ami le barbare…
Piazza Grande, ce vendredi 15 août. – Repris complètement, ce matin, mon texte sur L’Ami barbare, dont Isabelle Falconnier, qui me l’a commandé pour L’Hebdo, s’est dit enchantée ce soir. Je me suis efforcé de bien mettre en rapport fiction et vérité, faits et légende,en soulignant la verve épique du livre. Je ne crois pas avoir forcé la note, tout en laissant filtrer mon enthousiasme alors que la première mouture du livre, ce printemps, m’avait laissé perplexe à certains égards – mais ce diable de JMO a écouté cet emmerdeur de JLK et fait honneur à notre ami le barbare…

 À La Désirade, ce vendredi 4 juillet 2014 – Très intéressé, cet après-midi, par le premier volet de la série documentaire consacrée à l’Amérique par Oliver Stone, qui s’est attaché à des aspects méconnus de l’histoire contemporaine, à commencer par les tenants et les aboutissants du recours à la bombe atomique, avec un accent porté sur le rôle du vice-président Wallace, écarté par Truman au profit des vautours anticommunistes. Je suis impressionné par la virulence autocritique du propos, qui tourne même, parfois, au procès radical à la Michael Moore, jusqu’à l’excès me sembe-t-il. Du moins rompt-on avec les pieux mensonges…
À La Désirade, ce vendredi 4 juillet 2014 – Très intéressé, cet après-midi, par le premier volet de la série documentaire consacrée à l’Amérique par Oliver Stone, qui s’est attaché à des aspects méconnus de l’histoire contemporaine, à commencer par les tenants et les aboutissants du recours à la bombe atomique, avec un accent porté sur le rôle du vice-président Wallace, écarté par Truman au profit des vautours anticommunistes. Je suis impressionné par la virulence autocritique du propos, qui tourne même, parfois, au procès radical à la Michael Moore, jusqu’à l’excès me sembe-t-il. Du moins rompt-on avec les pieux mensonges… Ce que j’apprécie énormément chez Peter Sloterdijk est son regard panoptique et la remarquable porosité de sa perception, à la fois d’un dialecticien très libre et d’un historien de la philosophie, d’un écrivain et d’un véritable poète dans ses visions et autres mises en rapport.
Ce que j’apprécie énormément chez Peter Sloterdijk est son regard panoptique et la remarquable porosité de sa perception, à la fois d’un dialecticien très libre et d’un historien de la philosophie, d’un écrivain et d’un véritable poète dans ses visions et autres mises en rapport. À La Désirade, ce dimanche 6 juillet. – Il est probable que mon entretien avec Jean Ziegler, paru le 25 juin dernier dans 24heures, aura été ma dernière contribution à notre « grand quotidien », et je le note sans aigreur mais non sans mélancolie, tant m’attriste la dérive de nos pages culturelles dans la démagogie clientéliste et l’insignifiance à tous égards. J’y vois la fin d’un monde, et plus particulièrement la disparition d’une société lettrée, mais je ne tirerai pas pour autant l’échelle derrière moi. En outre je vais consacrer quelques heures, aujourd’hui, à la transcription de mon entretien avec Bruno Deville, à propos de Bouboule, son premier long métrage, qui sera sans doute ma dernière production journalistique à tire de mercenaire. Après quoi je ne serai plus, décidément, « sur un plateau »…
À La Désirade, ce dimanche 6 juillet. – Il est probable que mon entretien avec Jean Ziegler, paru le 25 juin dernier dans 24heures, aura été ma dernière contribution à notre « grand quotidien », et je le note sans aigreur mais non sans mélancolie, tant m’attriste la dérive de nos pages culturelles dans la démagogie clientéliste et l’insignifiance à tous égards. J’y vois la fin d’un monde, et plus particulièrement la disparition d’une société lettrée, mais je ne tirerai pas pour autant l’échelle derrière moi. En outre je vais consacrer quelques heures, aujourd’hui, à la transcription de mon entretien avec Bruno Deville, à propos de Bouboule, son premier long métrage, qui sera sans doute ma dernière production journalistique à tire de mercenaire. Après quoi je ne serai plus, décidément, « sur un plateau »…  J’ai ces jours, travaillant à La Vie des gens, le sentiment de revenir à la fiction comme au moment où la matière du Viol de l’ange a commencé de cristalliser, en été 1995, à l’époque du massacre de Srebrenica. C’est grâce à ce roman que j’ai commencé à dire « plus de choses », à proportion de la liberté que ménage, précisément, la fiction.
J’ai ces jours, travaillant à La Vie des gens, le sentiment de revenir à la fiction comme au moment où la matière du Viol de l’ange a commencé de cristalliser, en été 1995, à l’époque du massacre de Srebrenica. C’est grâce à ce roman que j’ai commencé à dire « plus de choses », à proportion de la liberté que ménage, précisément, la fiction. Pensé ce matin à une liste dédiée à Ceux qui tombent des nues, inspirée par le chaos des derniers événements du monde : crash en Ukraine, agression israélienne dans la bande de Gaza, Berlusconi blanchi, construction d’un pont à Hong-Kong, chasse au trésor, lecture des Ombres du métis de Sébastien Meier, meurtre de Chloé, etc. L’idée m’en est venue en repensant à ces divers événements comme issus d’un mauvais rêve alors qu’ils émanent de la plus ordinaire réalité, comme les enfants nés malformés dont parle Annie Dillard dans Au Présent. Très bon sujet pour ce dimanche orageux.
Pensé ce matin à une liste dédiée à Ceux qui tombent des nues, inspirée par le chaos des derniers événements du monde : crash en Ukraine, agression israélienne dans la bande de Gaza, Berlusconi blanchi, construction d’un pont à Hong-Kong, chasse au trésor, lecture des Ombres du métis de Sébastien Meier, meurtre de Chloé, etc. L’idée m’en est venue en repensant à ces divers événements comme issus d’un mauvais rêve alors qu’ils émanent de la plus ordinaire réalité, comme les enfants nés malformés dont parle Annie Dillard dans Au Présent. Très bon sujet pour ce dimanche orageux. Je fais ces jours retour à Tchékhov, avec le recueil de récits traduits etprésentés par André Markowciz sous le titre Le violon de Rotschild. Très intéressé par la préface de Gérard Conio, qui évoque une dimension spirituelle, voire évangélique, souvent méconnue de cet écrivain classé témoin lucide mais en somme désenchanté, voire cynique. À propos de Tchékhov, Dimitri parlait, comme de Céline, de la vision du médecin qui constate, prend en compte les maux dont souffrent ses semblables et, sans illusions, les décrit et envisage la meilleure façon d’y remédier. C’est la vision du réformiste patient, combien plus honnête et constructive que celle durévolutionnaire. À cela s’ajoutant l’homme de cœur, enquêtant au bagne alorsqu’il crève de tuberculose, chrétien de fait plus que de foi ou de théorie.
Je fais ces jours retour à Tchékhov, avec le recueil de récits traduits etprésentés par André Markowciz sous le titre Le violon de Rotschild. Très intéressé par la préface de Gérard Conio, qui évoque une dimension spirituelle, voire évangélique, souvent méconnue de cet écrivain classé témoin lucide mais en somme désenchanté, voire cynique. À propos de Tchékhov, Dimitri parlait, comme de Céline, de la vision du médecin qui constate, prend en compte les maux dont souffrent ses semblables et, sans illusions, les décrit et envisage la meilleure façon d’y remédier. C’est la vision du réformiste patient, combien plus honnête et constructive que celle durévolutionnaire. À cela s’ajoutant l’homme de cœur, enquêtant au bagne alorsqu’il crève de tuberculose, chrétien de fait plus que de foi ou de théorie.  À La Désirade,ce jeudi 24 juillet. – Je pensais ce matin au côté sale de la réalité, à propos des Ombres du métis de Sébastien Meier. Saleté des images de Gaza. Saleté de la mort. Saleté des corps tombés du ciel en Ukraine, encore visibles sur les images de la télé. Saleté des tas de cheveux à Auschwitz (souvenir de1966). Saleté des tabloïds. Saleté des photos de l’abject journal Détective. Et tout de suite, à lire Les ombres du métis : saleté de la prison, de la promiscuité, de la vulgarité brutale des échanges entre prisonniers - et cette sensation d’être pris au piège, littéralement empêtré, comme les personnages de Tchékhov ou de Simenon sont pris au piège et empêtrés.Mais curieusement, comme chez Tchékhov ou Simenon, toutes proportions gardées évidemment, la saleté de l’univers des Ombresdu métis se révèle, peu à peu, porteuse d’émotion et de vérité, à l’opposé d’une réalité propre-en-ordre, blanchie (au sens du blanchiment de l’argent) par le refus de voir ce qui est, l’hypocrisie et le mensonge.
À La Désirade,ce jeudi 24 juillet. – Je pensais ce matin au côté sale de la réalité, à propos des Ombres du métis de Sébastien Meier. Saleté des images de Gaza. Saleté de la mort. Saleté des corps tombés du ciel en Ukraine, encore visibles sur les images de la télé. Saleté des tas de cheveux à Auschwitz (souvenir de1966). Saleté des tabloïds. Saleté des photos de l’abject journal Détective. Et tout de suite, à lire Les ombres du métis : saleté de la prison, de la promiscuité, de la vulgarité brutale des échanges entre prisonniers - et cette sensation d’être pris au piège, littéralement empêtré, comme les personnages de Tchékhov ou de Simenon sont pris au piège et empêtrés.Mais curieusement, comme chez Tchékhov ou Simenon, toutes proportions gardées évidemment, la saleté de l’univers des Ombresdu métis se révèle, peu à peu, porteuse d’émotion et de vérité, à l’opposé d’une réalité propre-en-ordre, blanchie (au sens du blanchiment de l’argent) par le refus de voir ce qui est, l’hypocrisie et le mensonge.
 La lecture de Pascal Quignard, dont je viens de commencer le prochain livre, Mourir de penser, tout en reprenant Les Désarçonnés et Rhétorique spéculative, me stimule beaucoup dans mes écrits du matin. À certains moments, j’ai l’impression que ce que je lis est écrit spécialement pour moi comme, parfois,on peut le ressentir de la musique de Schubert. Plus j’y reviens et plus je me dis que, dans ses largeurs propres, et surtout dans ses profondeurs, c’est le meilleur styliste français actuel, plus constant et plus pur, plus profond surtout, qu’un Pierre Michon ou qu’un Philippe Sollers, si remarquables que soient aussi ces deux là.
La lecture de Pascal Quignard, dont je viens de commencer le prochain livre, Mourir de penser, tout en reprenant Les Désarçonnés et Rhétorique spéculative, me stimule beaucoup dans mes écrits du matin. À certains moments, j’ai l’impression que ce que je lis est écrit spécialement pour moi comme, parfois,on peut le ressentir de la musique de Schubert. Plus j’y reviens et plus je me dis que, dans ses largeurs propres, et surtout dans ses profondeurs, c’est le meilleur styliste français actuel, plus constant et plus pur, plus profond surtout, qu’un Pierre Michon ou qu’un Philippe Sollers, si remarquables que soient aussi ces deux là. À La Désirade, ce mercredi 25 juin. – Gracieuse surprise de ce matin, sur le rebord extérieur de la nouvelle grande fenêtre de ma chambre : ce petit rouge-queue frais émoulu, descendu de son nid sous la solive, qui me regarde, un peu effaré, puis se lance dans un premier vol. Or j’étais en train de lire, au même moment, le prochain livre de Pascal Quignard, Mourir de penser, et plus précisément cette page : «Soudain j’en suis sûr. Je le sais. Je n’ai plus le choix. Il faut que j’aille travailler là-haut. Il faut que je me sépare de ceux qui sont en bas. Il faut que, dans l’impatience d’être seul, je saute hors du monde.
À La Désirade, ce mercredi 25 juin. – Gracieuse surprise de ce matin, sur le rebord extérieur de la nouvelle grande fenêtre de ma chambre : ce petit rouge-queue frais émoulu, descendu de son nid sous la solive, qui me regarde, un peu effaré, puis se lance dans un premier vol. Or j’étais en train de lire, au même moment, le prochain livre de Pascal Quignard, Mourir de penser, et plus précisément cette page : «Soudain j’en suis sûr. Je le sais. Je n’ai plus le choix. Il faut que j’aille travailler là-haut. Il faut que je me sépare de ceux qui sont en bas. Il faut que, dans l’impatience d’être seul, je saute hors du monde. Le propos de mes Tours d’illusion est la remise en cause du format, et plus précisément duformatage, à tous égards. Or je suis en train d’étendre cette sortie à tout ce qui procède de la répétition stérile ou de l’automatisme parasitaire, en me référant implicitement à Max Dorra (auquel j’ai emprunté l’image des tours d’illusion) et à Pascal Quignard (mes lectures de ces jours), autant qu’à Gustave Thibon (L’Illusion féconde) ou à Peter Sloterdijk, notamment.
Le propos de mes Tours d’illusion est la remise en cause du format, et plus précisément duformatage, à tous égards. Or je suis en train d’étendre cette sortie à tout ce qui procède de la répétition stérile ou de l’automatisme parasitaire, en me référant implicitement à Max Dorra (auquel j’ai emprunté l’image des tours d’illusion) et à Pascal Quignard (mes lectures de ces jours), autant qu’à Gustave Thibon (L’Illusion féconde) ou à Peter Sloterdijk, notamment.

 Héliopolis, ce 23 mai. - Nous avonsfait cet après-midi escale à Sète, dont j’aime décidément l’aspect de petite ville portuaire à canaux et ruelles, point trop policée et d’un grand charme avec ses maisons à trois étages aux façades à la fois élégantes et décaties, l’étagement de ses places ombragées et de ses « marches » ascendantes, jusqu’au Mont Saint-Clair; et l’heure passée à la librairie de L’Echappée belle a été des plus fructueuse, dont nous avons ramené une quinzaine de nouveaux livres. Riches de notre butin, nous nous sommes ensuite arrêtés sur une terrasse jouxtant le marché couvert, ma bonne amie se plongeant aussitôt dans un essai sur la démocratie de Dominique Schnapper (L’Esprit démocratique des lois) tandis que je tombais illico sous l’emprise du verbe cinglant et coloré d’In Kali Jean Bofane, dont le nouveau roman, Congo Inc., comme il avait commencé de nous le raconter à Lubumbashi, suit la trajectoire d’un jeune Pygmée découvrant, en lisière de forêt vierge, l’univers virtuel des jeux vidéo et de la puissance par procuration, fasciné par la technologie et quittant bientôt sa forêt natale pour la jungle urbaine de Kinshasa.
Héliopolis, ce 23 mai. - Nous avonsfait cet après-midi escale à Sète, dont j’aime décidément l’aspect de petite ville portuaire à canaux et ruelles, point trop policée et d’un grand charme avec ses maisons à trois étages aux façades à la fois élégantes et décaties, l’étagement de ses places ombragées et de ses « marches » ascendantes, jusqu’au Mont Saint-Clair; et l’heure passée à la librairie de L’Echappée belle a été des plus fructueuse, dont nous avons ramené une quinzaine de nouveaux livres. Riches de notre butin, nous nous sommes ensuite arrêtés sur une terrasse jouxtant le marché couvert, ma bonne amie se plongeant aussitôt dans un essai sur la démocratie de Dominique Schnapper (L’Esprit démocratique des lois) tandis que je tombais illico sous l’emprise du verbe cinglant et coloré d’In Kali Jean Bofane, dont le nouveau roman, Congo Inc., comme il avait commencé de nous le raconter à Lubumbashi, suit la trajectoire d’un jeune Pygmée découvrant, en lisière de forêt vierge, l’univers virtuel des jeux vidéo et de la puissance par procuration, fasciné par la technologie et quittant bientôt sa forêt natale pour la jungle urbaine de Kinshasa.  Au Cap d’Agde, ce lundi 26 mai. – J’ai marché tôt ce matin sur la plage en profitant du premier soleil de huit heures, resongeant à ma lecture du dernier roman de Jean Bofane, tout à fait intéressant et plus encore, sans qu’il me transporte comme je l’ai été à la lecture de 2666 de Roberto Bolano. Néanmoins il y a chez l’auteur une verve et un travail sur le langage qui fait de lui un voleur et un violeur de notre chère langue française, tel que nous en avons fait l’éloge, en riant pas mal, lors du congrès de Lubumbashi où nousnous sommes connus en octobre 2012.
Au Cap d’Agde, ce lundi 26 mai. – J’ai marché tôt ce matin sur la plage en profitant du premier soleil de huit heures, resongeant à ma lecture du dernier roman de Jean Bofane, tout à fait intéressant et plus encore, sans qu’il me transporte comme je l’ai été à la lecture de 2666 de Roberto Bolano. Néanmoins il y a chez l’auteur une verve et un travail sur le langage qui fait de lui un voleur et un violeur de notre chère langue française, tel que nous en avons fait l’éloge, en riant pas mal, lors du congrès de Lubumbashi où nousnous sommes connus en octobre 2012. Ludwig Wittgenstein : « Le visage est l’âme du corps. On peut tout aussi peu voir de l’extérieur son propre caractère que sa propre écriture. J’ai une relation unilatérale à mon écriture, qui m’empêche de la considérer sur le même pied que les autres écritures et de les comparer entre elles ».
Ludwig Wittgenstein : « Le visage est l’âme du corps. On peut tout aussi peu voir de l’extérieur son propre caractère que sa propre écriture. J’ai une relation unilatérale à mon écriture, qui m’empêche de la considérer sur le même pied que les autres écritures et de les comparer entre elles ».