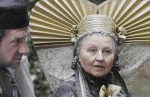

À propos du dernier chef-d'oeuvre d'Alexandre Sokourov. À voir 7 fois sur DVD !
Il est rare, et même rarissime aujourd'hui, qu'une oeuvre d'art développe une quête de sens au moyen d'une forme conjuguant les images et les mots, une vision de poète comme prolongée par les échos sonores du monde extérieur et d'une conscience en train de se parler, la réinterprétation profonde d'une destinée mythique et la rencontre du démoniaque et du sublime - or tel est le miracle, telle est la merveille du Faust d'Alexandre Sokourov, assurément le plus abouti, dans son expression formelle (à la hauteur de La Mère et de Père et fils, mais encore plus poussé dans sa composition "picturale" et son travail, inouï, sur la bande son) et le plus profond dans son approche de la figure prométhéenne du savant préfigurant, dans les derniers plans, la quête de puissance de l'homme contemporain. Le film conclut d'ailleurs une tétralogie modulant de multiples aspect de la volonté de puissance, dont Staline, Hitler (dans le saisissant Moloch) et l'empereur japonais Hiro Hito constituent les figures historiques. En l'occurrence, la fable ancienne du Dr Faustus, reprise par Goethe, est assez fidèlement revisitée par Sokourov, qui combine plus précisément le premier et le deuxième Faust du poète allemand.
 S'il a décroché le Lion d'or de la 68e Mostra de Venise, en 2011, cet indéniable chef-d'oeuvre a été projeté en catimini en nos contrées, conformément à la logique marchande et décervelante de l'Usine mondiale à ne plus rêver - alors que Faust est lui-même un prodigieux rêve éveillé sans que l'intelligence du sujet ne soit jamais diluée par son expression. Comme souvent aujourd'hui, c'est par le truchement de la version en DVD qu'il nous est donné de pallier les lacunes de la distribution, et l'on appréciera particulièrement, dans les suppléments de cette version, les explications de deux germanistes français de premier plan, l'historien Jean Lacoste et le philosophe Jacques Le Rider.
S'il a décroché le Lion d'or de la 68e Mostra de Venise, en 2011, cet indéniable chef-d'oeuvre a été projeté en catimini en nos contrées, conformément à la logique marchande et décervelante de l'Usine mondiale à ne plus rêver - alors que Faust est lui-même un prodigieux rêve éveillé sans que l'intelligence du sujet ne soit jamais diluée par son expression. Comme souvent aujourd'hui, c'est par le truchement de la version en DVD qu'il nous est donné de pallier les lacunes de la distribution, et l'on appréciera particulièrement, dans les suppléments de cette version, les explications de deux germanistes français de premier plan, l'historien Jean Lacoste et le philosophe Jacques Le Rider.
 En outre, le DVD permet à chacun de voir le film au moins sept fois, 1) Pour la story découverte en toute innocente simplicité; 2) Pour l'image (le formidable travail de Bruno Delbonnet) qui contribue pour beaucoup au climat du film entre réalisme poétique et magie symboliste; 3) Pour la bande sonore, reproduisant le marmonnement intérieur continu de Faust et constituant un véritable "film dans le film" où voix et musiques ne cessent de se chevaucher; 4) Pour la conception des personnages, avec un usurier méphistophélique extrêmement élaboré dans tous ses aspects, et une Margarete angéliquement présente et fondue en évanescence (rien au final de l'"éternel féminin" qui sauve), sans oublier Faust lui-même en Wanderer nietzschéen; 5) Pour la thématique (les langueurs mélancoliques de la connaissance tournant à vide, le désir et nos fins limitées, le sens de notre présence sur terre, l'action possible, etc.) 6) Pour le rapprochement éventuel de cet itinéraire initiatique avec des parcours semblables - on pense évidemment à Dante visitant l'Enfer avec Virgile, et pour l'interprétation détaillée de la pièce de Goethe ; 7) Pour la story revue dans toute sa complexité de poème cinématographique, où tout fait sens...
En outre, le DVD permet à chacun de voir le film au moins sept fois, 1) Pour la story découverte en toute innocente simplicité; 2) Pour l'image (le formidable travail de Bruno Delbonnet) qui contribue pour beaucoup au climat du film entre réalisme poétique et magie symboliste; 3) Pour la bande sonore, reproduisant le marmonnement intérieur continu de Faust et constituant un véritable "film dans le film" où voix et musiques ne cessent de se chevaucher; 4) Pour la conception des personnages, avec un usurier méphistophélique extrêmement élaboré dans tous ses aspects, et une Margarete angéliquement présente et fondue en évanescence (rien au final de l'"éternel féminin" qui sauve), sans oublier Faust lui-même en Wanderer nietzschéen; 5) Pour la thématique (les langueurs mélancoliques de la connaissance tournant à vide, le désir et nos fins limitées, le sens de notre présence sur terre, l'action possible, etc.) 6) Pour le rapprochement éventuel de cet itinéraire initiatique avec des parcours semblables - on pense évidemment à Dante visitant l'Enfer avec Virgile, et pour l'interprétation détaillée de la pièce de Goethe ; 7) Pour la story revue dans toute sa complexité de poème cinématographique, où tout fait sens...

1) LA STORY. PAS LOIN DE GOETHE - C'est du haut du plus pur azur qu'on tombe d'abord en chute planante: d'un ciel à nuées où se trouve suspendu un miroir magique dont se détache une espèce de ruban-oiseau qui plonge sur un paysage de hautes montagnes rappelant les décors romantiques à la Caspar David Friedrich, jusqu'à un bourg entourée de murailles, tout là-bas. Et voici que, soudain, en gros plan obscène, apparaît un vilain boudin sexuel masculin au-dessus duquel, dans un ventre éviscéré, deux hommes sont en train de détailler les organes. On distingue aussitôt un coeur dans la main de celui qui est nommé Docteur Faust par son assistant, du nom de Wagner, naïvement inquiet de savoir si l'âme du cadavre est dans ce coeur, dans la tête du cadavre ou dans ses pieds. Du même coup nous entrons dans la pensée de Faust par le truchement de son marmonnement, qui nous apprend qu'il a faim, qu'il en a marre, qu'il a le sentiment d'avoir fait les plus savantes études de physiologie et de théologie et de philosophie pour rien. Et de transporter alors sa famine mélancolique dans le cabinet voisin de son père chirurgien-mécanicien en train de torturer un malheureux sur un chevalet, reprochant à son fils de se poser trop de questions et de ne pas travailler assez. Mais Faust, n'en pouvant plus des scies paternelles (un plan très singulier rappelle dans la foulée le rapport père-fils du film Père et fils) se pointe chez un usurier auquel il propose une certaine bague très précieuse, que le type - à gueule immédiatement inquiétante de diable (!) maigre - refuse de monnayer, poussant donc Faust à regagner son logis. Or c'est là que, peu après, le personnage sapé en gentleman le rejoint pour lui rendre la bague oubliée, siffler au passage une fiole de ciguë préparée par Wagner pour un usage qu'on devine réservé à Faust, et saisir le scientifique docteur de stupéfaction en survivant contre toute attente. Des traits humoristiques vont ponctuer, dès ce moment là, les menées de Méphisto que la ciguë ne tue pas mais fait venter affreusement et chier à grand fracas - ce qu'il fera loin des regards, dans l'église voisine. Ensuite, c'est dans une sorte de grande piscine-buanderie pleine de femmes mouillées et plus ou moins nues que le tentateur entraîne Faust, qui va remarquer l'adorable Margarete tandis que Méphisto, en butte aux moquerie de ces dames, baigne son corps immonde à torse informe et très gros derrière d'âne sans fesses, queue de cochon, et "rien devant". Dans la rue retrouvée par les deux compères, on voit au passage le père de Faust, en train de se débarrasser d'un mort, se déchaîner soudain contre l'usurier qu'il a visiblement "reconnu", mais Faust n'a plus désormais que la douce figure de Margarete en tête, qu'il fera tout pour retrouver avec l'aide de son démoniaque associé. Cela ne se fera pas avant que, dans une trépidante taverne remplie d'étudiants, une querelle provoquée par Méphisto, n'aboutisse au meurtre involontaire de Valentin, le frère de Margaret, par un Faust évidemment manipulé. Le désir fou de passer n'était-ce qu'une nuit avec l'angélique jeune fille le conduira plus tard à signer le pacte qu'on sait de son sang, bref tout ça suit d'assez près le canevas du drame goethéen et de l'opéra, plus connu du public français, de Gounod, mais c'est sur la fin, après la nuit d'amour peuplée de démons, la fuite à travers une faille dantesque en compagnie d'un Méphisto en armure, et l'anéantissement physique du Diable (après la mort de Dieu, on ne va pas faire de jaloux) par Faust à coups de pierres, que le héros, de plus en plus prométhéen de dégaine, genre moine nietzschéen à chevelure romantique, se retrouve sur le finis terrae d'un volcan bientôt transformé en glacier - et c'est parti pour Dieu sait où, à l'enseigne d'une volonté de puissance soudain déchaînée contre laquelle l'écho de la voix de Margarete ne peut visiblement rien...
2. UN POEME VISUEL. SOKOUROV PEINTRE.
La première surprise du Faust de Sokourov, visuellement parlant, tient à son format: comme d'un écran de télévision rectangulaire, aux angles arrondis, intégré dans un fond noir. Il y a là comme la mise en abyme d'une lanterne magique. L'effet est immédiatement saisissant quand le regard plonge du ciel vers le décor peint des montagnes et du bourg où va se passer l'histoire, évoquant Brigadoon. Dès qu'on pénètre, ensuite dans le cabinet de dissection du physiologiste, l'hyperréalisme onirique kitsch vire au réalisme clair-obscur des maîtres flamands où les bruns marrons et les verts morbides donnent le ton. On a parlé de Jérôme Bosch à propos de l'esthétique du film, mais ses composantes fantastiques (notamment le corps de Méphisto et les démons de la scène d'amour) ou symboliques (une cigogne dans la rue, un lapin dans l'église) me semblent plutôt obéir à une logique onirique autonome, dont les multiples références (aux visages de Rembrandt ou aux écorchés de Goya) sont toujours intégrées, par delà la "citation" appuyée. Par ailleurs, les cadrages et l'image de Bruno Delbonnel (chef op d' Amélie Poulain, soit dit en passant) s'inscrivent parfaitement dans le langage de Sokourov, avec un côté vieux "livre d'images" convenant à merveille au sujet. Enfin, et c'est l'essentiel du point de vue du traitement des images en vue de leur effet sur la tonalité psychologique, symbolique ou métaphysique des séquences , le travail sur les couleurs (inspiré par les théories de Goethe) émerveille, comme souvent chez Sokourov, par sa façon de rendre naturel le plus extrême artifice. Comme un Kaurismäki, ou comme un Pedro Costa, mais dans son registre poétique propre imprégnant tous ses films de la même douceur mélancolique, Sokourov est un peintre de cinéma autant qu'il est musicien et poète de cinéma. Le choc visuel de certaines séquences, comme la reptation quasi organique des protagonistes dans le "terrier" du Diable, ou l'irradiation soudaine du visage de Margarete, confinant à une apparition mystique, modulent tous les registres de la narration, entre le démoniaque (jamais gore pour autant) et le sublime (évitant la suavité sulpicienne). Enfin il faudrait parler longuement du regard posé par Sokourov sur la nature, qui ressortit ici au romantisme allemand autant qu'à l'effusion russe...
3. UN POEME MUSICAL. A spiritual voice.
Tous les films d'Alexandre Sokourov ont cela de particulier que leur bande sonore déploie comme une espèce de film dans le film, parcouru par une sorte de voix murmurante dont le meilleur exemple est peut-être Spiritual voices où la voix de Sokourov évoque (notamment) la vie de Mozart sur fond de paysages imperceptiblement mouvants. Dans Faust, le marmonnement du protagoniste se module dès la première scène de la dissection où Wagner le harcèle à propos de la localisation de l'âme humaine dans le corps, et va se poursuivre sans discontinuer en multipliant les citations directes du texte de Goethe. Or son murmure se combine, naturellement, avec les voix de tous les protagonistes, à commencer par les sarcasmes et les pointes, les piques, les vannes et autres méchancetés de Méphisto oscillant entre séduction et scatologie, cajoleries et menaces. À part ce concert de voix, on remarquera aussi la fonction "spatiale" de la bande sonore, qui ne cesse d'élargir le champ et sculpte pour ainsi dire l'espace de la représentation, faisant éclater et interférer le mental des personnages et leur entourage. En parfaite fusion avec l'image, le "bruit du film" contribue pour beaucoup, enfin, à la magie de l'oeuvre, sans diluer son intelligibilité.
4. DRAMATIS PERSONAE. Les protagonistes et leurs interprètes.
 Les adaptations de textes littéraires au cinéma sont souvent décevantes, par édulcoration, notamment dans le traitement des personnages. Rien de cela dans le Faust de Sokourov, dont le protagoniste est à la fois crédible et dessiné comme en ronde-bosse, tout en découlant d'une interprétation très personnelle. Le Faust de Sokourov (campé à merveille par Johannes Zeiler à la dégaine d'intello romantique inquiet et volontaire, genre Streber goethéen) apparaît immédiatement comme un type physiquement affamé et métaphysiquement insatisfait, comme tiré en avant par on ne sait quelle force. Savant renommé, il a le sentiment que toutes ses études n'ont servi à rien. Il y a chez lui du nihiliste tenté par le suicide et du conquérant en quête d'il ne sait trop quoi. D'entrée de jeu, il est prêt à mettre en gage une bague magique à pierre philosophale, auprès d'un usurier qui le bluffe en lui faisant comprendre que la sagesse ne fait plus recette alors que lui-même "veut tout". Quand il voit, peu après, le même personnage survivre à la ciguë, c'est parti pour la sainte alliance à l'envers (et à tâtons avant la signature du pacte), qui le mènera dans le lit de Margarete et bien plus loin: au bord du monde dont on sent qu'il s'impatiente de le conquérir.
Les adaptations de textes littéraires au cinéma sont souvent décevantes, par édulcoration, notamment dans le traitement des personnages. Rien de cela dans le Faust de Sokourov, dont le protagoniste est à la fois crédible et dessiné comme en ronde-bosse, tout en découlant d'une interprétation très personnelle. Le Faust de Sokourov (campé à merveille par Johannes Zeiler à la dégaine d'intello romantique inquiet et volontaire, genre Streber goethéen) apparaît immédiatement comme un type physiquement affamé et métaphysiquement insatisfait, comme tiré en avant par on ne sait quelle force. Savant renommé, il a le sentiment que toutes ses études n'ont servi à rien. Il y a chez lui du nihiliste tenté par le suicide et du conquérant en quête d'il ne sait trop quoi. D'entrée de jeu, il est prêt à mettre en gage une bague magique à pierre philosophale, auprès d'un usurier qui le bluffe en lui faisant comprendre que la sagesse ne fait plus recette alors que lui-même "veut tout". Quand il voit, peu après, le même personnage survivre à la ciguë, c'est parti pour la sainte alliance à l'envers (et à tâtons avant la signature du pacte), qui le mènera dans le lit de Margarete et bien plus loin: au bord du monde dont on sent qu'il s'impatiente de le conquérir.
Je ne sais si Sokourov est ferré en théologie, mais son Méphisto est un avatar satanique saisissant (dans lequel se coule sinueusement un Anton Adajinsky à figure et corps de spectre expressionniste), à la fois suave et insidieux comme une vieille maîtresse, entreprenant et mesquin (on se rappelle le démon "de petite envergure" de Fédor Sologoub), visqueux et vicieux. Plus on essaie de s'en débarrasser plus vite il revient comme l'éclair, entremetteur et semeur de trouble. On sait que le "diabolo" est le grand disperseur par vocation et le vampire des âmes; il a ici quelque chose de gogolien et de judéo-allemand aussi bien question cinéma, du côté de Murnau; et l'allusion se prolonge avec la création, par Wagner l'acolyte, de l'homoncule dans son bocal. Enfin, la jeune Margarete (Isolda Dychauk) est vue, par Sokourov, comme une créature infiniment douce, soumise à sa mère acariâtre et à la sainte religion, mais néanmoins sensible à l'amour et répondant aux avances du prestigieux docteur Faust. Dans une séquence bonnement irradiante, où son visage semble appeler et réfracter une lumière pour ainsi dire divine, mais à vrai dire plus proche des extases du New Age que de l'iconographie chrétienne, Sokourov joue merveilleusement de ce qu'on peut dire le fantasme pur de la beauté féminine, comme tant de peintres se sont employé à représenter la Laure de Pétrarque ou la Béatrice de Dante. Un commentateur des Inrocks y a vu une icône orthodoxe. On ne saurait en être plus loin! On est bien plutôt ici dans l'idéalisation romantique plus ou moins wagnérienne, et d'ailleurs le corps de Margaret ne sera guère plus incarné lors de la nuit fameuse, réduit à d'évanescentes chairs et à un triangle de mousse blonde.
Enfin: pas une mégastar là-dedans, mais des comédiens de haute volée et merveilleusement dirigés (dont Hanna Schygulla) distribués dans ce qu'on peut bien dire un casting de rêve, en détournant le cliché de l'expression purement commerciale et pour mieux souligner la fusion parfaite des interprètes et de leurs personnages.
(À suivre)

 À relire aujourd'hui la pièce, d'Ibsen, on constate toujours sa force critique dévastatrice, qui pourrait s'appliquer aux faux semblants actuels. Or Thomas Ostermeier peine à transposer le puritanisme d'une époque à l'autre. Dans la pièce, le pasteur Manders est évidemment un ecclésiastique norvégien de 1882, mais le même type existe aussi de nos jours, suave et pleutre, moralisant et vicelard. On le sent très fort dans le personnage du pasteur de Fanny et Alexandre d'Ingmar Bergman, comme chez nombre de romanciers américains contemporains. Mais quoi de commun entre le Manders d'Ibsen et le clergyman fade, lisse, creux et criseux campé par François Loriquet ? Ne chargeons pas le comédien, qui "fait le job", tandis que toute l'attention d'Ostermeier se porte sur la seule relation, oedipienne jusqu'à l'hystérie, liant Madame Alving (Valérie Dréville, remarquable au demeurant) et son fils paumé-cassé Osvald (Eric Caravaca, excellent lui aussi). Dans une optique freudienne réductrice, sur fond de débâcle sociale et psychologique, les deux personnages semblent jouer une pièce à part. Alors qu'Ibsen se défendait d'avoir écrit une pièce nihiliste, c'est bien une dévastation complète qu'illustre en crescendo la mise en scène d'Ostermeier.
À relire aujourd'hui la pièce, d'Ibsen, on constate toujours sa force critique dévastatrice, qui pourrait s'appliquer aux faux semblants actuels. Or Thomas Ostermeier peine à transposer le puritanisme d'une époque à l'autre. Dans la pièce, le pasteur Manders est évidemment un ecclésiastique norvégien de 1882, mais le même type existe aussi de nos jours, suave et pleutre, moralisant et vicelard. On le sent très fort dans le personnage du pasteur de Fanny et Alexandre d'Ingmar Bergman, comme chez nombre de romanciers américains contemporains. Mais quoi de commun entre le Manders d'Ibsen et le clergyman fade, lisse, creux et criseux campé par François Loriquet ? Ne chargeons pas le comédien, qui "fait le job", tandis que toute l'attention d'Ostermeier se porte sur la seule relation, oedipienne jusqu'à l'hystérie, liant Madame Alving (Valérie Dréville, remarquable au demeurant) et son fils paumé-cassé Osvald (Eric Caravaca, excellent lui aussi). Dans une optique freudienne réductrice, sur fond de débâcle sociale et psychologique, les deux personnages semblent jouer une pièce à part. Alors qu'Ibsen se défendait d'avoir écrit une pièce nihiliste, c'est bien une dévastation complète qu'illustre en crescendo la mise en scène d'Ostermeier. 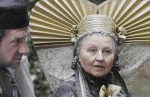

 S'il a décroché le Lion d'or de la 68e Mostra de Venise, en 2011, cet indéniable chef-d'oeuvre a été projeté en catimini en nos contrées, conformément à la logique marchande et décervelante de l'Usine mondiale à ne plus rêver - alors que Faust est lui-même un prodigieux rêve éveillé sans que l'intelligence du sujet ne soit jamais diluée par son expression. Comme souvent aujourd'hui, c'est par le truchement de la version en DVD qu'il nous est donné de pallier les lacunes de la distribution, et l'on appréciera particulièrement, dans les suppléments de cette version, les explications de deux germanistes français de premier plan, l'historien Jean Lacoste et le philosophe Jacques Le Rider.
S'il a décroché le Lion d'or de la 68e Mostra de Venise, en 2011, cet indéniable chef-d'oeuvre a été projeté en catimini en nos contrées, conformément à la logique marchande et décervelante de l'Usine mondiale à ne plus rêver - alors que Faust est lui-même un prodigieux rêve éveillé sans que l'intelligence du sujet ne soit jamais diluée par son expression. Comme souvent aujourd'hui, c'est par le truchement de la version en DVD qu'il nous est donné de pallier les lacunes de la distribution, et l'on appréciera particulièrement, dans les suppléments de cette version, les explications de deux germanistes français de premier plan, l'historien Jean Lacoste et le philosophe Jacques Le Rider.  En outre, le DVD permet à chacun de voir le film au moins sept fois, 1) Pour la story découverte en toute innocente simplicité; 2) Pour l'image (le formidable travail de Bruno Delbonnet) qui contribue pour beaucoup au climat du film entre réalisme poétique et magie symboliste; 3) Pour la bande sonore, reproduisant le marmonnement intérieur continu de Faust et constituant un véritable "film dans le film" où voix et musiques ne cessent de se chevaucher; 4) Pour la conception des personnages, avec un usurier méphistophélique extrêmement élaboré dans tous ses aspects, et une Margarete angéliquement présente et fondue en évanescence (rien au final de l'"éternel féminin" qui sauve), sans oublier Faust lui-même en Wanderer nietzschéen; 5) Pour la thématique (les langueurs mélancoliques de la connaissance tournant à vide, le désir et nos fins limitées, le sens de notre présence sur terre, l'action possible, etc.) 6) Pour le rapprochement éventuel de cet itinéraire initiatique avec des parcours semblables - on pense évidemment à Dante visitant l'Enfer avec Virgile, et pour l'interprétation détaillée de la pièce de Goethe ; 7) Pour la story revue dans toute sa complexité de poème cinématographique, où tout fait sens...
En outre, le DVD permet à chacun de voir le film au moins sept fois, 1) Pour la story découverte en toute innocente simplicité; 2) Pour l'image (le formidable travail de Bruno Delbonnet) qui contribue pour beaucoup au climat du film entre réalisme poétique et magie symboliste; 3) Pour la bande sonore, reproduisant le marmonnement intérieur continu de Faust et constituant un véritable "film dans le film" où voix et musiques ne cessent de se chevaucher; 4) Pour la conception des personnages, avec un usurier méphistophélique extrêmement élaboré dans tous ses aspects, et une Margarete angéliquement présente et fondue en évanescence (rien au final de l'"éternel féminin" qui sauve), sans oublier Faust lui-même en Wanderer nietzschéen; 5) Pour la thématique (les langueurs mélancoliques de la connaissance tournant à vide, le désir et nos fins limitées, le sens de notre présence sur terre, l'action possible, etc.) 6) Pour le rapprochement éventuel de cet itinéraire initiatique avec des parcours semblables - on pense évidemment à Dante visitant l'Enfer avec Virgile, et pour l'interprétation détaillée de la pièce de Goethe ; 7) Pour la story revue dans toute sa complexité de poème cinématographique, où tout fait sens...
 Les adaptations de textes littéraires au cinéma sont souvent décevantes, par édulcoration, notamment dans le traitement des personnages. Rien de cela dans le Faust de Sokourov, dont le protagoniste est à la fois crédible et dessiné comme en ronde-bosse, tout en découlant d'une interprétation très personnelle. Le Faust de Sokourov (campé à merveille par Johannes Zeiler à la dégaine d'intello romantique inquiet et volontaire, genre Streber goethéen) apparaît immédiatement comme un type physiquement affamé et métaphysiquement insatisfait, comme tiré en avant par on ne sait quelle force. Savant renommé, il a le sentiment que toutes ses études n'ont servi à rien. Il y a chez lui du nihiliste tenté par le suicide et du conquérant en quête d'il ne sait trop quoi. D'entrée de jeu, il est prêt à mettre en gage une bague magique à pierre philosophale, auprès d'un usurier qui le bluffe en lui faisant comprendre que la sagesse ne fait plus recette alors que lui-même "veut tout". Quand il voit, peu après, le même personnage survivre à la ciguë, c'est parti pour la sainte alliance à l'envers (et à tâtons avant la signature du pacte), qui le mènera dans le lit de Margarete et bien plus loin: au bord du monde dont on sent qu'il s'impatiente de le conquérir.
Les adaptations de textes littéraires au cinéma sont souvent décevantes, par édulcoration, notamment dans le traitement des personnages. Rien de cela dans le Faust de Sokourov, dont le protagoniste est à la fois crédible et dessiné comme en ronde-bosse, tout en découlant d'une interprétation très personnelle. Le Faust de Sokourov (campé à merveille par Johannes Zeiler à la dégaine d'intello romantique inquiet et volontaire, genre Streber goethéen) apparaît immédiatement comme un type physiquement affamé et métaphysiquement insatisfait, comme tiré en avant par on ne sait quelle force. Savant renommé, il a le sentiment que toutes ses études n'ont servi à rien. Il y a chez lui du nihiliste tenté par le suicide et du conquérant en quête d'il ne sait trop quoi. D'entrée de jeu, il est prêt à mettre en gage une bague magique à pierre philosophale, auprès d'un usurier qui le bluffe en lui faisant comprendre que la sagesse ne fait plus recette alors que lui-même "veut tout". Quand il voit, peu après, le même personnage survivre à la ciguë, c'est parti pour la sainte alliance à l'envers (et à tâtons avant la signature du pacte), qui le mènera dans le lit de Margarete et bien plus loin: au bord du monde dont on sent qu'il s'impatiente de le conquérir. 


