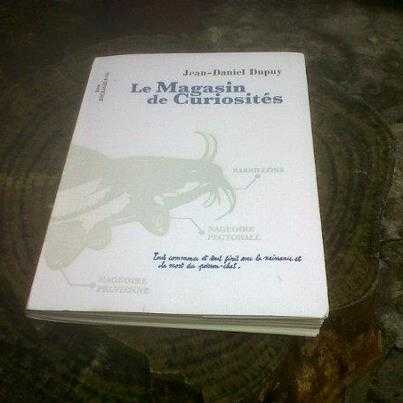
À découvrir: Le magasin de curiosités, de Jean-Daniel Dupuy
Les alluvions du Temps, comme ceux des autres grands fleuves que forment les rivières nourries par les torrents et dès les sources parfois où des fées jettent baguettes et escarboucles – les alluvions charrient des trésors que de jeunes mendiants et de vieilles antiquaires se disputent et qui finissent en petits tas le long des rues pauvres, sur les étals des foires ou dans les brocantes, les boutiques plus luxueuses, parfois même les ventes aux enchères internationales où tel angelot baroque du XVIIe se vendra des milliers de dollars après avoir été dégoté dans un bric-à-brac de Séville ou aux puces madrilènes qu’on appelle là-bas El Rastro.
Le grand écrivain espagnol Ramon Gomez De La Serna a consacré tout un ouvrage au Rastro (paru en 1914 et réédité maintes fois, jusqu’en 2002 aux éditions Galaxia Gutenberg/Circulo de Lectores, avec les photographies de Carlos Saura) , mais c’est dans L’Homme perdu (André Dimanche, 2001) que Jean-Daniel Dupuy a trouvé le déclencheur poétique d’un roman actuellement en chantier, dont un extrait a été publié en juillet 2010 dans Le Passe-Muraille sous le titre de Noctogrammes, et d'où il a tiré un chapitre autonome pour en faire l’objet d’un livre récement paru, Le magasin de curiosités, admirablement typographié et adorné par les éditions AENCRAGES & Co de Baume-les-Dames.
La mise en vente du Magasin de curiosités du sieur Tristan Lhomme, tenancier de la maison depuis 55 ans, et la présentation, à cette occasion, de huit de ses Lots, du numéro 021 (Matériel de tricheur) au numéro 555 (Bestiaire excentrique), est à la fois l’occasion de déployer les multiples « décors » à transformations d’un Locus Solus féerique, et de développer une suite de récits oniriques marquant le même goût « pour l’étrange et l’inédit » que les objets collectionnés, tels le « matériel de dévampirisation », les jeux de triche sophistiqués (dont la pièce à triple face), les ouvrages rares (Propriétés du vice du fameux Athanor Erdanase), et tout un fatras zoomorphique ou para-industriel (les « mécanique de peur ») qui apparaît au fil des rêves hantés par des personnages récurrents à commencer par Elle, qui s’appelle tantôt Barizza, Annayala ou Sonietcha, selon la couleur du songe ou son parfum.
Tout cela pourrait parfois sembler gratuit, mais une intense poésie se dégage progressivement de cette rêverie à la topologie recoupant parfois celle d’Invention des autres jours (Attila, 2009), par exemple lorsqu’on franchit la rivière Suave ou qu’on se pointe à l’Hôtel Moderne. En outre un réjouissant esprit de sédition couve et court à travers le livre, contre la Force d’Occupation dont on a compris dès la première page qu’elle fonde « la réalité du monde».
« Je collectionne de mots, des vagues de souvenirs, des fleurs sauvages et des eaux fortes, des présupposés, des phases de lune, des utopies noctures, des armes, des graines de beauté, des flacons d’ivresse, des bleuités, des susdits, des objets petits et gros », annonce Tristan Lhomme au seuil du Magasin de Curiosités qui a « fonction de contredire la réalité du monde, la soumission, l’oubli et la mort ». Et de préciser : « Archaïque architecture des songes, cette boutique n’aurait jamais dû exister : elle contrariait l’ordre des choses »
Il y a de l’auberge espagnole dans Le magasin de curiosités, qui demande au lecteur une participation de fantaisie et d’imagination, un brin de folie aussi, de l’attention vive et le sens de l’humour sans brides. Si l’auteur fournit les résilles « dont l’unique fonction est de capturer le visible », encore faut-il un moindre effort pour déceler la part invisible du livre, interroger « la nature de la luminescence observé chez le hareng mort » ou tirer enseignement de la « constante insurrection des poissons-chats qui survivent au fond des lacs. »
Pourquoi le commerce de l’eau est-il déclaré interdit dans la cité capitale, et que vise le mouvement insurrectionnel déclenché à l’enseigne du refoulement des ténèbres ? C’est la question que pose aussi ce livre au doux délire puissamment évocateur et parfumé (notamment par un distillateur asiate raffiné), dont les trouvailles poétiques et les images, les multiples figures narratives ou musicales et rythmiques, plastiques pour l’exercice de l’œil ou biotoniques pour celui du mental, du parapsychique ou de l’hypermnésique, font florès.
« Tenia tan mala memoria, que un dia se olvido de que tenia mala memoria, y empezo a recordarlo todo », écrivait Ramon Gomez de La Serna. Ce que le poisson-chat traduit en ces mots avec l'aide de Sophie Kuffer: «Il avait tellement mauvaise mémoire qu’un jour il oublia qu’il avait mauvaise mémoire, et commenca de se souvenir de tout »… Jean-Daniel Dupuy. Le Magasin de curiosités. AEncrages & Co, 54p.
Jean-Daniel Dupuy. Le Magasin de curiosités. AEncrages & Co, 54p.


 - Quel est, Michael Steiner, le point de départ de ce nouveau film ? Pourquoi vous être intéressé aux Miss, et qu’en est-il de l’intrigue ?
- Quel est, Michael Steiner, le point de départ de ce nouveau film ? Pourquoi vous être intéressé aux Miss, et qu’en est-il de l’intrigue ?
 « Vous êtes le jury ! », scandent les affiches géantes du Prix du public, qui pourrait bien revenir à ce film. À moins que la Piazza plébiscite plutôt Quelques heures de printemps du Français Stéphane Brizé, grand moment d’émotion pure et dure, filtrée par une Hélène Vincent bouleversante et un Vincent Lindon saisissant lui aussi de vérité.
« Vous êtes le jury ! », scandent les affiches géantes du Prix du public, qui pourrait bien revenir à ce film. À moins que la Piazza plébiscite plutôt Quelques heures de printemps du Français Stéphane Brizé, grand moment d’émotion pure et dure, filtrée par une Hélène Vincent bouleversante et un Vincent Lindon saisissant lui aussi de vérité. Et la compétition internationale dans tout ça ? Sans préjuger des décisions d’un jury de « pros » présidé par le très estimé réalisateur thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, elle a réservé de belles découvertes. À commencer par Starlet du quadra américain Sean Baker, belle confrontation entre deux femmes, la vieille dame à chihuahua et Jane la jeune défoncée. Autre paire émouvante dans un film de haute sensibilité : les deux protagonmistes de Der Glanz des Tages des Autrichiens Tizza Covi et Rainer Frimmel. Ou dans un registre plus frais : les deux glandeurs, genre Vitelloni, de Mobile Home du Belge François Pirot. Du couple on passe au trio, toujours en finesse, dans Une Estonienne à Paris d’Illmaar Raag, avec Jeanne Moreau.
Et la compétition internationale dans tout ça ? Sans préjuger des décisions d’un jury de « pros » présidé par le très estimé réalisateur thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, elle a réservé de belles découvertes. À commencer par Starlet du quadra américain Sean Baker, belle confrontation entre deux femmes, la vieille dame à chihuahua et Jane la jeune défoncée. Autre paire émouvante dans un film de haute sensibilité : les deux protagonmistes de Der Glanz des Tages des Autrichiens Tizza Covi et Rainer Frimmel. Ou dans un registre plus frais : les deux glandeurs, genre Vitelloni, de Mobile Home du Belge François Pirot. Du couple on passe au trio, toujours en finesse, dans Une Estonienne à Paris d’Illmaar Raag, avec Jeanne Moreau. Côté Suisses, le désolant pseudo-docu Image Problem de Simon Baumann et Andreas Pfiffner semble d’avance hors-course, alors que la grande fresque poético-philosophique de Peter Mettler, The End of Time, aux images splendides mais flatteuses à la Yann Arthus Bertrand, paraît déplacée dans cette sélection…
Côté Suisses, le désolant pseudo-docu Image Problem de Simon Baumann et Andreas Pfiffner semble d’avance hors-course, alors que la grande fresque poético-philosophique de Peter Mettler, The End of Time, aux images splendides mais flatteuses à la Yann Arthus Bertrand, paraît déplacée dans cette sélection…

 En compétition internationale, ce premier long métrage de Niccolò Castelli (né en 1982 à Lugano) relève de la chronique actuelle focalisée sur de très jeunes gens, rappelant donc Ken Park de Larry Clark, en plus lisse ou, plus près de nous, Garçon stupide de Lionel Baier, en moins aigu et personnel, et la série de Romans d’ados. Alignant avec lyrisme des images qui exaltent la jeunesse dancingo-sportive (entre compète de ski, folles courses de rollers et matches de hockey) sur un rythme scandé par le rock et le rap, genre vidéo-clip, Castelli rend bien le labyrinthe urbain de Lugano cerné de paysage sublimes mais n’échappant pas à une menace latente.
En compétition internationale, ce premier long métrage de Niccolò Castelli (né en 1982 à Lugano) relève de la chronique actuelle focalisée sur de très jeunes gens, rappelant donc Ken Park de Larry Clark, en plus lisse ou, plus près de nous, Garçon stupide de Lionel Baier, en moins aigu et personnel, et la série de Romans d’ados. Alignant avec lyrisme des images qui exaltent la jeunesse dancingo-sportive (entre compète de ski, folles courses de rollers et matches de hockey) sur un rythme scandé par le rock et le rap, genre vidéo-clip, Castelli rend bien le labyrinthe urbain de Lugano cerné de paysage sublimes mais n’échappant pas à une menace latente. Emotions sur la Piazza Grande
Emotions sur la Piazza Grande Rappelant le mérite d’Otto Preminger (dont la rétrospective fait le plein des salles) qui a tourné avec lui Carmen Jones en 1954, où tous les rôles de l’opéra de Bizet sont chantés par des Noirs, Harry Belafonte s’est livré à une belle profession de foi à la gloire de l’art rapprochant les hommes. Or la veille, le même message, assorti d’une minute de silence en hommage aux civils Maliens massacrés ces jours, avait été adressé au public de la Piazza par le grand cinéaste africain
Rappelant le mérite d’Otto Preminger (dont la rétrospective fait le plein des salles) qui a tourné avec lui Carmen Jones en 1954, où tous les rôles de l’opéra de Bizet sont chantés par des Noirs, Harry Belafonte s’est livré à une belle profession de foi à la gloire de l’art rapprochant les hommes. Or la veille, le même message, assorti d’une minute de silence en hommage aux civils Maliens massacrés ces jours, avait été adressé au public de la Piazza par le grand cinéaste africain 
 Une visite, en janvier 2000, à propos du Journal.
Une visite, en janvier 2000, à propos du Journal.
