
Succès « classique » immédiat avec Le nouveau testament, pièce étincelante à voir au Théâtre Kléber-Méleau, à Lausanne.
Une fois de plus, la formule « maison » fait gazer l’usine, si l’on ose dire. Sur un texte avec lequel on le sent pleinement en phase (la double thématique de l’âge et de la sincérité le touchent à l’évidence), Philippe Mentha règle une mise en scène claire et nuancée, quant à la direction d’acteurs, avec sept autres comédiens tous coulés dans leur personnage. A ces atouts s’ajoutent ceux de l’ «emballage cadeau» traditionnel, avec un superbe décor art nouveau signé Jean-Marc Stehlé, des costumes de Patricia Faget et des éléments musicaux griffés Nino Rota.
Programmer Sacha Guitry ne revient-il pas à flatter le public, avec ce qu’il faut de bagatelle saupoudré de bons mots à la parisienne ? On pourrait le croire, tant l’image du brillantissime acteur-auteur reste liée à la figure du tombeur de haut vol dont on répète les formules fleurant le cynisme. Comme un Courteline, un Feydeau ou un Labiche, le théâtre de Guitry est souvent réduit aux dimensions du « boulevard », décrié après la Deuxième Guerre mondiale. Mais on revient à ces « vieilles lunes » pour y découvrir des auteurs moins superficiels qu’on avait cru. Le nouveau testament en est la meilleure preuve, même si l’on y rit beaucoup, chose naguère suspecte…
La vie des Marcelin n’a pourtant rien de rigolo au moment où le rideau se lève : le docteur et sa femme, la cinquantaine passée, ne partagent plus que les mondanités. Monsieur aimerait mettre sa vie «en révolution», engageant alors une nouvelle secrétaire, mais Madame, qui a déjà un jeune amant, ne voit pas d’un bon œil la jolie élue. L’hypocrisie règne d’ailleurs tous azimuts, et c’est un véritable tissu de mensonges dans lequel l’intrigue va soudain faire un trou gros comme ça à la faveur de la lecture inopinée du testament de Marcelin par sa femme et ses amis, qui le croyaient noyé. Passons sur le détail…
On sait Philippe Mentha fan de Molière. Or on retrouve du contempteur de la tartuferie, dans une société aux règles tombant en désuétude, chez le Guitry à la fois cinglant et philosophe, comme apaisé par l’âge, ciselant ici une galerie de portraits d’une réelle densité. Les scènes où le docteur vieillissant parle avec son ancienne amante, femme de son plus proche ami, ou avec la jeune fille qui ne sera pas sa maîtresse, comme le craint sa femme, puisqu’elle est… le spectateur verra bien qui, dégagent une réelle émotion, tendre et nostalgique.
Finissons par les fleurs aux huit comédiens réunis : Mentha (Marcelin) en tête, donne le ton de la justesse, Juliana Samarine (Lucie Marcelin) y ajoute une frémissante force fragile, entre angoisse de vieillir et désir de jouir encore, Juan Antonio Crespillo (son jeune amant) campe un irrésistible bellâtre piaffant, Virginie Meisterhans (la jeune secrétaire) éclate de juvénile crânerie, Caroline Cons (l’ancienne chérie du docteur) séduit autant par sa grâce survivante, Maurice Aufair (mari pataud de la précédente) ronchonne comme il faut, enfin Edmond Vuilloud compose une valet de chambre snob à souhait tandis que Lise Ramu dessine une silhouette de secrétaire sévère qui fait contre mauvaise fortune sourire résigné : vieillir se fait aussi dans l’inégalité. Poil au nez.
Bref, mordant mais amical, Sacha Guitry fait une fois de plus assaut d’esprit, mais aussi de cœur, et le public savoure le cocktail.
Lausanne-Renens, ch. De l’Usine à gaz. Ma-me-je, 19h : Ve-sa, 20h.30. Li, 17h.30. Relâche lundi Location : 021 625 84 00, ou 021 619 45 45.
Photo: Carole Parodi
-
-
Next stop Paradise

Du mode de locomotion le mieux approprié à l’accomplissement d’un symbolique dernier voyage. Des images longtemps enfouies qui resurgissent à la faveur de cet étrange périple au bord du ciel.
Le paradis ce serait: le paradis ce sera de rouler en Grosschen jusqu’au Vieux Quartier, en Grosschen ou en Minimax à l’abri des blindages, en Minimax ou, si tout est détruit, par la ligne souterraine du Littlebig.
Je dis Grosschen parce que je suis de nature optimiste. Optimiste mais non écervelé ou inconséquent. Je dirai plutôt: optimiste malgré tout. Capable tout à fait de me représenter le pire, et par exemple la destruction complète de tout ce qui fut, avec la conviction cependant qu’une certaine partie du Vieux Quartier sera toujours debout et la cathédrale, la cathédrale et le jardin aux volières.
La Grosschen serait idéale pour accomplir vite ce très long voyage, et d’abord pour la beauté du geste. La Grosschen bat en effet tous les records de ce point de vue.
 Voir l’immense piécette à nacelles rouler, au déclin du jour, sur une autoroute déserte ou dans une forêt à l’heure du silence, est un enchantement. Lorsqu’elle est immobile, la Grosschen évoque, à l’évidence, la Grande Roue du Prater de Vienne, mais on comprend, au moindre mouvement, qu’elle est incomparable, surtout du fait de ses possibilités infinies de remodulation, non seulement mécanique mais cinesthésique, et cela compte pour le fidèle disciple de Baudelaire que je suis.
Voir l’immense piécette à nacelles rouler, au déclin du jour, sur une autoroute déserte ou dans une forêt à l’heure du silence, est un enchantement. Lorsqu’elle est immobile, la Grosschen évoque, à l’évidence, la Grande Roue du Prater de Vienne, mais on comprend, au moindre mouvement, qu’elle est incomparable, surtout du fait de ses possibilités infinies de remodulation, non seulement mécanique mais cinesthésique, et cela compte pour le fidèle disciple de Baudelaire que je suis.
Je m’explique en deux mots: il n’y a qu’à bord de la Grosschen qu’on puisse entendre si distinctement la couleur précise de tel parfum ou détailler telle gamme de goûts à l’oeil nu.
Contrairement au Minimax, blindé et bruyant, ou au Littlebig sujet à pannes souterraines, la Grosschen marque le top du génie humain qui associe l’archaïque roue de moulin, le cerceau de nos enfances et l’accélérateur de particules dernier modèle.
Or tel est mon voeu Monsieur Dieu: qu’au moment où, la Grosschen me transporte au Vieux Quartier et que Vous me laissiez prolonger d’une vie ou deux, le temps au moins d’écouter une fois encore la Black and tan fantasy auprès des quelques vrais amis en compagnie desquels le temps n’a jamais existé.
Par avance je me réjouis de ce voyage immobile où tout me sera rendu comme à l’enfant derviche que le Barbare décapite. Tout me sera rendu parce que tout me sera dû à ce moment-là, je n’aurai pas de compte à rendre, Monsieur Dieu connaît ce langage: je n’aurai pas besoin de Lui faire un dessin.
C’est aussi bien par pur désir que je crayonne à présent ce portrait de mon amour à la nacelle. Combien d’ici je nous vois, mon amour et moi, prendre place à bord de la Grosschen. Jamais mon amour ne m’accompagnait au Luna Park, mais cette fois ce sera cette fois ou jamais, et c’est depuis le premier jour qu’il n’y a plus de jamais entre nous.
A bord de la Grosschen nous rassemblerons, dans le désordre, tous les fragments de l’Imago. Il me suffira de penser ceci et ceci sera, de désirer cela et cela sera. J’inscrirai le mot Donau dans la case de sélection sensible du computeur de bord et tout aussitôt je me retrouverai dans les gazons exquis de l’enfant Danube où nous plongions nos corps de garçons élastiques, l’été de nos quatorze ans, ignorants du dernier coup de flingue du vieil ado désespéré, ce 2 juillet 1961 devenu jour de la saint Hemingway - mais je racontais à Thomas ses chasses et ses corridas tandis qu’il tirait sur sa Chesterfield d’un air de corsaire -, la Grosschen fera son effet quand elle s’immobilisera dans le chemin privé de la typique villa de notable du Doktor sûrement enterré, et je tâcherai de reconnaître mon bel ami sous les traits du nouveau Doc à l’americaine, yes it’s me, do you remember nos bains de minuit dans le lac de Constance ? et son odeur de gosse de riche n’aura pas changé qui sonne toujours comme du Telemann dans la salle de bain matinale où nous comparons nos dotations, Kölnwasser 4711, belle prestance et cette autorité transmise du chamane de province, mais la Grosschen ne pourra s’attarder, juste une dernière sèche comme lorsque nous nous planquions dans les trouées de sangliers, tschuss Tom, see you, et ce sera reparti pour le paradis. L’agrément de la Grosschen tient à sa double maîtrise des phénomènes ondulatoires et corpusculaires. Un rêveur jeté dans l’espace sur son rocking chair tournant, qui prend connaissance dans un journal des dernières nouvelles du siècle tout en écoutant l’Andante du Quintette à cordes en ut majeur de Schubert peut figurer, dans sa double relation à l’espace (cherra-t-il, cherra-t-il pas ?) et au temps (fonce-t-il amont ou aval ?), la situation du voyageur en Grosschen et son aperception nouvelle des deux infinis.
L’agrément de la Grosschen tient à sa double maîtrise des phénomènes ondulatoires et corpusculaires. Un rêveur jeté dans l’espace sur son rocking chair tournant, qui prend connaissance dans un journal des dernières nouvelles du siècle tout en écoutant l’Andante du Quintette à cordes en ut majeur de Schubert peut figurer, dans sa double relation à l’espace (cherra-t-il, cherra-t-il pas ?) et au temps (fonce-t-il amont ou aval ?), la situation du voyageur en Grosschen et son aperception nouvelle des deux infinis.
De là-haut nous découvrons l’océan de notre mémoire, et dans la botte d’icelui: l’aiguille trotteuse de notre première montre d’enfant.
Je me souviens pour ma part que ma première montre n’avait que des chiffres peints et se mangeait, fourrée de chocolat noisette. C’est pourquoi j’aime tant voir passer les cargos de cacao dans mes rêveries antillaises, et que me trouble la nature double de l’oeil de l’écureuil.
Nous avons détesté, mon amour et moi, la pléthore des écureuils du Schubertpark de Vienne, mais combien de documents photographiques attestent l’intensité paisible des heures que nous avons passées là-bas à nous couler l’un dans l’autre, là-bas et dans la chambre du grand bouleau.
Monsieur Dieu comprend cela, qui nous entendait remuer dans le berceau de feuilles, accoudé mine de rien à son bar à liqueurs, Monsieur Dieu ressentait pleinement la félicité de ces deux corps se buvant l’un l’autre à lentes lèvres dans la pénombre ocellée de la chambre de bois comme suspendue dans la maison de feuilles, et pour Lui rendre justice je le dis: Monsieur Dieu se sentait, aux moments d’effusion, comme le pur lapin de lune quand il bondit sur le ventre du nouveau pubère visité par la sirène, premier coup de queue et quelle surprise si Madame Mère levait le drap, mais maintenant, mon amour et moi, tout se fond dans le goût d’un mot soupiré que Monsieur Dieu fait semblant de ne pas entendre, le sachant notre secret.
Je fais confiance au Grand Mécanicien capable de concevoir une merveille de la catégorie de la Grosschen. C’est à la fois le Leonardo de l’Homérie et le Niels Bohr des algorythmes polyphoniques, mais rien dans les mains rien dans les poches, et quelle ingénuité malgré son grand savoir, quelle ingénuité dans la conception du moindre détail combinant l’utile et l’agréable de la Grosschen. On ne va pas en faire le catalogue, mais quelles trouvailles que l’allume-cigare à carillon tibétain ou que l’éventail à confettis. Combien tout cela me rappelle la fête du Bois de nos enfances...
Ensuite que roulant donc vers le Vieux Quartier, se développe en effet une autre analogie visuelle qui me remplit de la musique des voltigeurs, et c’est alors l’ivresse de la fête des enfants qui me comble, et mon amour.
Elle s’y revoit comme de cette après-midi: elle a sa jolie robe blanche à rubans. Moi j’ai l’air toujours un peu patate de l’enfant timide, mais je suis fier de ma casquette de pirate et je m’inscris à la poste américaine en tâchant de ne pas me faire voir de l’instite qui décrie ce marché d’amour.
Tu paies un franc, le type aux casiers te donne un numéro que tu épingles visiblement sur ta personne, ensuite de quoi tu pars à la chasse à la femme de ta vie. Tu repaies un franc si tu en repères une pour lui laisser un billet doux que le type glisse dans le casier au numéro de l’élue, et tu attends de voir si ça mord en regardant les voltigeurs dans le méli-mélo de toutes les musiques.
De la poste américaine ne me reste que le goût doux-amer des premières petites défaites, car il va de soi que celle qui m’attire se gêne autant que moi, ou que j’en invite deux à la fois par distraction, qui ne voient pas que je les observe de derrière le stand d’un marchand de gaufres avant que de me refondre dans la foule, mais le temps que j’attends me remplit de musiques, et c’est cela aussi que par avance je remercie Monsieur Dieu de me permettre d’écouter avec elle dans le mouvement berçant de la Grosschen en route pour le Vieux Quartier.
Et là je retrouve tout comme c’était: j’ai repéré de loin le beffroi de la cathédrale et les apôtres aux couleurs passées; une arête du contrefort de la colline a résisté à la tempête de temps en sorte que toutes les hautes étroites vieilles bâtisses médiévales de nos vingt ans continuent de défier le vide; et là-bas je distingue les silhouettes pensives de mes amis dans le jardin aux volières.
Ce serait, ce sera cela le paradis: l’anneau qui nous unit facilitera tout déplacement dans les dimensions aléatoires et nous épargnera le ricanement du Mauvais et de ses légions mortifères.
Je ne me demande pas ce que nous faisons là. Il n’y a plus de pourquoi qui tienne. On a compris que le Vieux Quartier figurait le haut lieu de nos premières amours et de nos vingt ans ingénus et bêtes, mais il y a tellement plus encore dans ces murs décatis et ces velours, ces arches et ces escaliers, ces passerelles, ces latrines en plein ciel, ces alcôves, ces terrasses étagées dans le chèvrefeuille, ces chambres proches où l’on s’est aimés, et tout nous est rendu jusqu’à l’instant dernier où l’on se rappellera que c’est là que tout a commencé, mon amour, quelque part dans quelque bar.
Le paradis c’est que c’était un village. Le paradis c’est que c’était un jardin. Du haut de leur ciel peint les anges enviaient nos peines de coeur et notre lancinant mal de vivre, ou nos corps tendres, nos tendres âmes.
Il n’est point besoin de descendre de la Grosschen pour y goûter encore: tout nous est rendu dans l’instant, tous les rôles et chaque voix appropriée.
 Le paradis c’était ta voix sous les draps étoilés par nos ébats, mon amour de ce moment-là, tandis que sonnait le marteau du rétameur au chant de baryton léger, dans la cour d’à côté, le paradis c’était de s’aimer au milieu de tout ça.
Le paradis c’était ta voix sous les draps étoilés par nos ébats, mon amour de ce moment-là, tandis que sonnait le marteau du rétameur au chant de baryton léger, dans la cour d’à côté, le paradis c’était de s’aimer au milieu de tout ça.
Il y a cent personnages aux fenêtres du Vieux Quartier l’instant suivant le coup de feu signifiant que l’étudiant désespéré s’est fait sauter la tête au numéro treize, puis on en parle dans les cafés, puis on repeint les murs ensanglantés, puis c’est l’hiver, on gèle, puis le printemps revient et c’est l’été où des jeunes gens tout nus dévalent l’escalier pour en faire voir au bourgeois.
Le paradis c’était notre bohème au Vieux Quartier, me dis-je en actionnant les leviers de la Grosschen et voici que, levée toute mélancolie, la roue se remet à tourner.
Alors, et peut-être pour toujours, avec mon amour, nous nous laissons emmener.
Monsieur Dieu, laissons-lui ça, est un machiniste stylé. Il n’y a plus de temps maintenant. Tout nous a été rendu et nous nous dirigeons vers la mer.
Nous y arriverons ce soir, sûrement à l’instant du rayon vert. Nous nous trouverons, même si c’est tard, un petit hôtel pas cher comme nous les aimions bien. La nuit venue nous nous attarderons dans la véranda pour écouter l’océan. Mais cela encore d’important mon amour: ne pas oublier d’envoyer une carte aux enfants. -
Coups de coeur
Anne-Marie Jaton au débotté
Georges Simenon. Lettre à mon juge. Le Livre de poche. «Georges Simenon est souvent cantonné dans le rayon policier, alors que les tragédies du quotidien de ce grand écrivain révèlent, sur le simple ton du constat, l’inquiétante fragilité humaine. Lettre à mon juge m’est particulièrement cher, parce que ce roman nous rappelle que nous pourrions tous, demain, être saisis de vertige, devenir des assassins, et que nous aimerions alors qu’au moins un homme sur la terre nous comprenne avant de nous juge
 r. On se sent ainsi tout proche de Charles Alavoine, respectable médecin qui a tué sa maîtresse après avoir été dominé par les femmes. »
r. On se sent ainsi tout proche de Charles Alavoine, respectable médecin qui a tué sa maîtresse après avoir été dominé par les femmes. »J. M. Coetzee, Elizabeth Costello. Points Seuil, 348p. «Après la série de romans à valeur de fables politiques qui ont fait sa célébrité mondiale et lui ont valu le Nobel, Coetzee a signé plusieurs livres plus personnels. Il y a sans doute de lui dans la célèbre romancière vieillissante de ce roman que j’aime parce que la protagoniste réfléchit sur ce que sont la littérature, la lecture, les mots qui nous façonnent et nous « guident », s’y interroge sur la compassion, la charité, l’ « obscénité » liée à la guerre plus qu’au sexe, la vérité
 qui réside peut-être simplement dans l’existence de grenouilles grandes comme le petit doigt de la main...»
qui réside peut-être simplement dans l’existence de grenouilles grandes comme le petit doigt de la main...»La patience du brûlé de Guido Ceronetti. La Patience du brûlé. Albin Michel, 452p. «Rien de convenu ou d’attendu dans ces Carnets de voyage 1983-1987 d’un observateur acerbe de la « pollution » contemporaine, au sens le plus large, que lit un ami en prison et que j’essaye de relire à travers les yeux de celui-ci : fragments, tristesse du monde, fulgurances, compréhension de tout enfermement et de toute amputation, drôleries de marionnettiste, œuvre d’un écrivain terriblement aigu, immergé, à s’y noyer, dans une écriture-océane, où alternent les moustiques, Yom Kippur, Goya, le thé et les fraises, qui
écrit que « nous sommes des êtres fragiles et terrifiants, faibles et effrayants »…
Anne-Marie Jaton, professeure de littérature française à l'Université de Pise, a signé de nombreux ouvrages, notamment sur Lavater et Cendrars, dont les derniers sont consacrés à Nicolas Bouvier et à Charles-Albert Cingria, parus dans la collection Le Savoir suisse. Elle en prépare un nouveau sur Raymond Queneau.
-
Magiciens de l'écart
Rose-Marie Pagnard et Jean-Marc Lovay déploient, aux marges du fantastique et de l’art brut, des univers dont la logique délirante rejoint nos sources populaires.

Depuis qu’il a commencé de rêver éveillé plume en main, en rédigeant d’abord une Epître aux Martiens entre deux joints et trois virées, qui lui valut illico le prix Georges-Nicole à vingt ans mais ne fut publié qu’en 2004, Jean-Marc Lovay n’a cessé de refaire le monde à sa façon, en défaisant de plus en plus celui qui nous impose ses lois pour imposer celles de ses imaginations et de sa langue, celle-ci et celles-là s’engendrant mutuellement.Dans Les régions céréalières (Gallimard, 1977), de façon plus ample et plus construite qu’en son anarchisante épître initiatique nourrie de contre-culture d’époque, Lovay développa une fresque aux allures d’allégorie poético-politique rappelant les fables de Kafka et préfigurant celles d’Antoine Volodine, sans la profondeur de celui-là ni le discours critique de celui-ci, mais au fil d’une anti-logique personnelle qui allait, du Convoi du colonel Fürst à Asile d’Azur, entre dix autre titres, se délester de plus en plus des liaisons intelligibles, au profit des images proliférantes et des rythmes, des sonorités, des moulures et des tournures d’une écriture à la fois musicale et picturale, dont les mots évoquent plus qu’ils ne signifient. Poète plus que romancier, Lovay anime ses personnages comme le ferait un manipulateur malicieux de marionnettes oniriques; il y a chez lui d’un rejeton alpestre de Michaux ou de Roussel; d’un orphelin de Rousseau largué au bord d’une autoroute, soignant sa mélancolie avec le vieux fonds d’humour et de sens esthétique des sculpteurs sur bois du Lötschental ou des découpeurs de frises en papier du pays d’En-Haut.
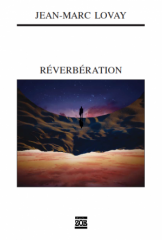
Réverbération serait alors ce balbutiement facétieusement vengeur d’un illuminé écolo-bricolo de souche plus helvète qu’on ne croirait, enfui de toutes les églises dans sa chapelle de chaman des hauts gazons.
La filiation romantique
Un vénérable critique prétendait que l’essentiel de la littérature romande sortait de la cinquième des Rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, mais beaucoup de nos écrivains ont également bu aux sources du romantisme allemand et de la tradition des contes, comme l’illustre à merveille l’œuvre de la Jurassienne Rose-Marie Pagnard, par ailleurs férue de magies nordiques.
La fascination qui se dégage de son dernier roman, Le conservatoire d’amour, tient d’ailleurs beaucoup au climat retrouvé des contes de notre enfance, avec le mélange de charme et de cruauté, de détails hyperréalistes et de glissements incessants du concret à l’abstrait ou de la poésie à l’effroi, de l’évanescent au trivial, du cocon familial à la scène de crime. La baguette magique de sa plume autorise la romancière à faire un château d’une maison en préfabriqué et de mêler, avec un humour cerné d’à-pics, les éléments apparemment abracadabrants, mais agencés dans une marqueterie narrative surfine, d’un roman initiatique à dormir debout, les yeux grands ouverts. Comment concilier la gestion d’une fabrique de lits (ressource ès Finance de la famille Gesualdo-Von Bock) et l’amour de la musique ? La question se pose pour Gretel et Gretchen, jeunes filles-enfants choisissant d’enfreindre l’interdit paternel de s’inscrire au Conservatoire, qu’elles rejoignent après avoir fugué et où elles subiront diverses épreuves rappelant là encore les contes cryptés qui passionnent les émules du Dr Freud. Les sentiers du désir y recoupent à tout moment ceux des tabous du sexe et des sortilèges de la passion, où s’affrontent anges et démons sans qu’on sache toujours qui est qui, tel Hänsel oscillant entre l’objet d’amour incestueux et le rejeton d’un secret de famille. D’une écriture ensorcelante, les pages de Rose-Marie Pagnard ont un arrière-goût de pain d’épice peut-être dangereux pour la santé mentale des nains de jardin, mais leur étrange beauté rejoint celle de L’Institut Benjamenta de Robert Walser, sous le signe de la poésie et de l’exorcisme artiste.
Jean-Marc Lovay, Réverbération. Zoé, 267p.
Rose-Marie Pagnard, Le conservatoire d’amour. Le Rocher, 269p.

Une autre Suisse
La Suisse propre sur elle et bien ordonnée, terrienne d’origine et pragmatique de tradition, s’est toujours méfiée des artistes et des écrivains, ces « originaux ». Deux grands créateurs du XXe siècle, l’écrivain Robert Walser et le peintre Louis Soutter, ont pourtant marqué la littérature européenne et les arts plastiques de leurs traces à la fois hagardes et géniales, hors de tout académisme et à l’écart des modes - tous deux à la frontière de la norme sociale et de l’équilibre psychique. Or qu’ont-ils en commun et qu’ont-ils à nous dire ? Peut-être ce qu’on pourrait dire le Waldgang, ce chemin en forêt qui trace un réseau de sentiers entre passé et présent, villes et campagnes de cette Europe miniature que figure la Suisse. Des Grisons de Fleur Jaeggy au Jura de Zouc, ou du labyrinthe halluciné de Wölffli aux rhapsodies verbales de Peter Weber, une autre Suisse, tellurique et ingénue, sauvage et prodigue de poésie obscure ou fulgurante, ouvre des échappées à ce que Dürrenmatt disait, non sans provocation, notre prison sans barreaux…

