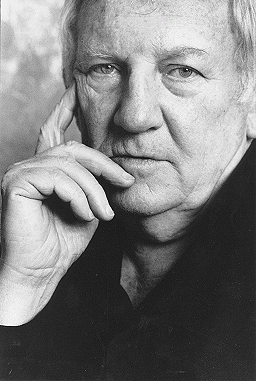A La Désirade, ce vendredi saint, 2008.
Il a fait tout le jour une tempête blanche qui nous a noyés dans un océan de neige tourbillonnante dont les vagues, portées par les vents déchaînés de nulle part et de partout, battaient les murs de La Désirade, et je me suis rappelé la scène hallucinante du naufrage, dans L’Homme qui rit de Victor Hugo, durant laquelle un bateau s’enfonce lentement dans la mer étale, après le déchaînement des éléments, dans le blanc silence immense duquel monte la litanie crescendo de la prière des naufragés.
En contraste absolu, je reçois à l’instant, cet écho à mon évocation de la mer à l’ouest d’Ouessant, de la peinture de notre amie Frédérique, qu’elle a brossée aujourd’hui et qui me rappelle que c’est à minuit prochain que, dans l’eau de la nuit, brûlera le feu pascal. Bonnes Pâques à tous, créants et mécréants...
Frédérique Kirsch-Noir : Les naufrageurs, 2008.
-
-
Hugo Claus le maître flamand

Le plus grand auteur belge d’expression néerlandophone est mort à Anvers à l’âge de 78 ans.
C’est un des plus grands écrivains européens, à la fois romancier et dramaturge, nouvelliste et poète, doublé d’un créateur polymorphe (peintre et cinéaste) qui vient de disparaître en la personne de Hugo Claus. Il y a quelques années avait paru, dans un de ses derniers recueils, une nouvelle saisissante intitulée Une somnambulation, évoquant le « cancer verbal » vécu par le protagoniste atteint de la maladie d’Alzheimer, dont Claus souffrait lui-même et avait finalement demandé d’être délivré par euthanasie, conformément à la loi belge. En automne dernier, il n’en avait pas moins signé, avec 400 autres personnalités flamandes, une pétition s’opposant à la partition de la Belgique. Considéré comme le plus grand romancier, poète et dramaturge belge néerlandophone, Hugo Claus avait atteint une notoriété internationale avec Le Chagrin des Belges, éducation sentimentale et fresque historique à la fois ravageuse et lyrique d’une sombre période (1939-1947), traduite en français en 1985 et adaptée au cinéma par Claude Goretta. Le romancier y stigmatisait un tabou de l’histoire de la Belgique lié à la collaboration flamande et « rexiste », notamment. Eternel rebelle, distribuant volontiers ses propres tracts-poèmes dans la rue, Claus s’inscrivait dans la longue tradition frondeuse qui va de Till l’espiègle (Till Ulenspiegel en flamand) aux grotesques d’Ensor ou au cinéma belge actuel, lui-même ayant signé deux longs métrages (dont Sacrement) et de nombreux scénarios, alors que son théâtre compte plus de quarante pièces, publiées à Lausanne, aux éditions L’Age d’Homme, avec l’ensemble de sa poésie. De celle-ci, le grand critique Gaëtan Picon avait écrit qu’elle « brûle d’un feu trop vif pour prêter son incandescence au métal d’une autre langue ».
Né à Coutrai, près de Bruges, en 1929, dans la filiation d’une grande tribu flamande, Hugo Claus était de ces créateurs hors norme plus faits au feu de la vie qu’au lustre des académies, qui avait participé aux aventures avant-gardistes, surtout en matière picturale, dans la mouvance du groupe Cobra, ainsi qu’en témoigne l’ouvrage intitulé Hugo Claus imagier. Non sans coquetterie, Claus nous disait un jour qu’il était un grand peintre méconnu écrivant à ses heures…
A notre goût, l’expressionnisme de ses romans et de ses nouvelles sonde cependant plus profond que son univers plastique, dans le tréfonds des détresses et des délires non alignés, avec de mémorables merveilles relevant de la littérature universelle. Dès A propos de Dédé (1969), le ton acide et suavement tchékhovien était donné, relancé par Une douce destruction (1988), plus radical que le présumé chef-d’œuvre du Chagrin des Belges. Or la pleine mesure du génie de Claus serait ensuite marquée par L’Espadon (1989), L’empereur noir (1993), exaltant le regard terrible de l’enfant sur notre drôle de monde, et plus encore La Rumeur (1997), peut-être le sommet de l’œuvre narrative, qui fait revivre une communauté déglinguée style Deschiens en Flandre profonde, ou enfin Le dernier lit (1997), autant de livres constituent les moments mémorables de cette oeuvre, du côté de William Faulkner ou de Flannery O’Connor. Charnel et mystique, fraternel et révolté, sensuel et glacial, Hugo Claus, délivré de la maladie, survit dans ses livres.Cet hommage a paru dans l'édition de 24 Heures du 20 mars 2008.
-
Rembrandt soleil de chair

Le dernier Greenaway, ou l’aura de l’immanence
Rembrandt, comme Goya ou Velasquez, ne faisait pas de cadeaux à ceux qui le payaient pour être célébrés en grandes pompes pompières : il les arrangeait sur la toile comme ils étaient: vilains, vicieux, mafflus, bouffis, sournois, lippus, gros baiseurs et truies jouisseuses sous le manteau - de vraies horreurs magnifiques, cela du moins quant il peignait la société se disant bonne ou se croyant haute et défilant pour la galerie comme la milice amstellodamoise nocturne du fameux tableau dit La ronde de nuit (datant de 1642), qui figure à la fois une parade de coqs bourgeois et de frères humains filmés en nuit américaine - pour dramatiser un complot ? peu importe. Ce qui compte est la chair de tout ça et la construction de tout ça, aboutissement d’une traversée de la chair et d’une inexorable montée vers la composition. La chair sublimée existe évidemment chez Rembrandt, de Titus au Christ ou des autoportraits aux bouleversants vieillards, mais on n’est pas ici chez le Rembrandt transcendental: on campe dans l’immanence, dans l’amour et la mort, puis la luxure et la mort, la société et son théâtre. Et puis c'est ici la lecture triviale d'un cinéaste frotté de sociologie soupçonneuse et de psychanalyse à la mords-moi... mais un peintre est là aussi, un artiste ma foi.
La Ronde de nuit est un enchevêtrement prodigieux de compositions et de lumières que Peter Greenaway déconstruit à sa façon tout un film durant, avec des acteurs qu’il a préalablement plongés dans une solution d’huile et de miel et de foutre et d’or dont le secret de la formule initiale s’est évidemment perdu mais qui trouve ici un équivalent passable, en plus mou et en trop maniéré à mon goût ici et là. Greenaway n’est évidemment pas Rembrandt, mais celui-ci n’en est pas moins honoré par celui-là en dépit de ce que caquètent quelques fines bouches. De fait, tout Rembrandt n’est certes pas là, les moments où l’acteur (un Martin Freeman charnel et poudreux de lumière, d'une extraordinaire mobilité expressive) se met à dessiner sont aussi pénibles que lorsque l'Amadeus de Forman composait son Requiem à vue, mais l’ensemble est un vrai morceau de peinture cinématographique qu’on pourrait dire « par osmose », comme si Rembrandt peignait réellement contre nature – ce qu’il faisait évidemment.
 Qu’est-ce que ce complot que Peter Greenaway évoque en s'efforçant de percer à jour cette scène des poseurs malcontents de l’artiste ? C’est la foire aux vanités des faux-culs mais plus encore que cela : c’est l’insupportable aveu de la chair guindée par l’uniforme, tellement plus obscène dans ses postures et ses falbalas que la scène d’un homme et d'une femme nus faisant l’amour à l’italienne. Il y a des petite bouches qui se tortillent et des critiques voyant là de l’obsession, du fantasme ou je ne sais quoi. Ils oublient la vieille increvable rabelaisienne et toute bonne santé des Flandres et la splendeur étalée de la chair ouverte, qui est autant d’une femme mûre que d’une carcasse de bœuf dont Goya, Soutine et Bacon perpétueront la boucherie, sublimée en l'occurrence par la « musique » que module ici une bande-son constituant une œuvre en elle-même...
Qu’est-ce que ce complot que Peter Greenaway évoque en s'efforçant de percer à jour cette scène des poseurs malcontents de l’artiste ? C’est la foire aux vanités des faux-culs mais plus encore que cela : c’est l’insupportable aveu de la chair guindée par l’uniforme, tellement plus obscène dans ses postures et ses falbalas que la scène d’un homme et d'une femme nus faisant l’amour à l’italienne. Il y a des petite bouches qui se tortillent et des critiques voyant là de l’obsession, du fantasme ou je ne sais quoi. Ils oublient la vieille increvable rabelaisienne et toute bonne santé des Flandres et la splendeur étalée de la chair ouverte, qui est autant d’une femme mûre que d’une carcasse de bœuf dont Goya, Soutine et Bacon perpétueront la boucherie, sublimée en l'occurrence par la « musique » que module ici une bande-son constituant une œuvre en elle-même...