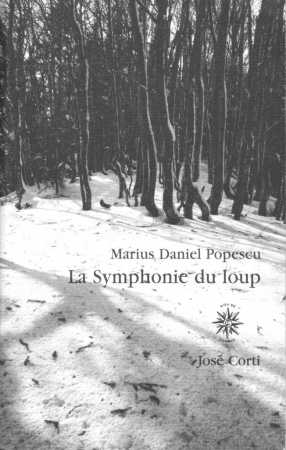Echos de Sylvie Germain, Etty Hillesum et Paul Celan.
« Frappée d’une évidence soudaine : c’est ainsi que je veux écrire. Avec autant d’espace autour de peu de mots. Je hais l’excès de mots. Je voudrais n’écrire que des mots insérés organiquement dans un grand silence, et non des mots qui ne sont là que pour dominer et déchirer ce silence. (…) Je voudrais tracer ainsi quelques mots au pinceau sur un grand fond de silence. Et il sera plus difficile de représenter ce silence, d’animer ce blanc, que de trouver des mots. Il s’agira de trouver un juste dosage entre le dit et le non-dit, un non-dit plus gros d’action que tous les mots que l’on peut tisser ensemble. (…) Chaque mot serait comme une pierre milliaire ou un petit tertre au long des chemins infiniment plats et étendus, de plaines infiniment vastes ». (1)
***
« Loué sois-tu, Personne.
Pour l’amour de toi nous voulons
Fleurir.
A ta
Rencontre.
Un rien
étions-nous, sommes-nous resterons-
Nous, fleurissant :
La rose de Rien,
De Personne ». (2)
***
« Par-dessus, par-dessus les piquants de la rose des vents, par-dessus les pointes des barbelés de tous les camps, par-dessus les ronces du temps, par-dessus les couronnes d’épines lacérant le cœur des victimes – le psaume du silence.
Le psaume du silence, composé d’une multitude de mots de pourpre : sang, et sueur de sang, et larmes de sang des victimes innombrables, ces roses de Rien, de Personne qui sans fin jonchent notre mémoire, écorchent notre conscience ». (3)
Ces citations sont tirées 1) d’Une vie bouleversée, Journal 1941-1943 (Seuil, 1985), d’Etty Hillesum, et de 2) Strette de Paul Celan (Poésie/Gallimard, 1999), insérées dans 3) Les échos du silence de Sylvie Germain (Albin Michel, 2006)
JLK : Lago delle streghe, huile sur toile, 2007.
-
-
Welcome au bout de nulle part
Bruno Ulmer documente, dans Welcome Europa, l’errance désespérante de jeunes migrants que la détresse pousse à se prostituer. Un film d’une grande humanité et d’une force expressive saisissante. A voir à Paris. Interview.
Ils sont huit, Kurde ou Marocain, Roumains ou Algérien. Ils ont quitté leur terre ingrate en espérant trouver, dans l’Euro-Paradis, un travail qui les fasse vivre et leur permette d’aider leur famille. Au lieu de cela, faute de papiers et du fait de leurs faciès: c’est en enfer qu’ils ont abouti. Bruno Ulmer, ancien urgentiste des hôpitaux, lui-même né au Maroc et préoccupé par les problèmes de migration et d’identité, leur a consacré ses premiers documentaires (Casa Marseille Inch’Allah, sur les clandestins marocains, et Petites bonnes, traitant de l’esclavage domestique) relayés par des livres et une association d’entraide. Dans la même visée du témoignage engagé, Welcome Europa relève du «cinéma vérité».
- Pourquoi vous intéresser à la prostitution masculine des clandestins?
- Parce que le thème, tabou, a été très peu documenté. On a beaucoup parlé des migrants qui se reconstruisent, mais pas assez de ceux qui, solitaires et sans cadre légal, se retrouvent acculés, sans être homosexuels, à ce que j’appelle une prostitution de survie. Pour ceux-ci, qui ne trouvent pas de travail et ne veulent pas risquer le vol ou le deal, la prostitution semble une solution « facile ». Or, du point de vue de l’identité, on constate que c’est destructeur et même fatal.
- Comment avez-vous choisi vos huit « acteurs » ?
- Lorsque j’ai convaincu ma productrice d’Arte, Hélène Badinter, que le sujet valait d’être documenté, j’ai beaucoup voyagé en Europe, de Grèce en Espagne et d’Italie aux Pays-Bas, pour repérer lieux et types. En effet, il y a une sorte de déterminisme des errances, par nationalités, de même qu’il y a une typologie du clandestin solitaire. Dans la foulée, en liaison avec des associations, et parfois par hasard, j’ai repéré mes « acteurs ». Avec mon seul cameraman, nous avons gagné leur confiance, les avons parfois aidés financièrement, mais sans payer leur participation. Le contrat précisait que jamais nous ne les filmerions en présence d’un client.
- Les séquences sont-elles parfois « jouées » ou « répétées » ?
- Aucune fiction, sauf l’épisode de la lettre initiale du Kurde écrivant à sa mère, ni aucune « interprétation ». Nous étions sans cesse sur le qui-vive et ne filmions, caméra sur l’épaule et sans lumière, que les scènes parlantes. Comme les jeunes « oubliaient » la caméra, nous avons obtenu ces séquences « données » par la vie.
- Le film n’apporte aucun commentaire sociologique ou statistique. A quoi correspond ce choix ?
- Tout ce qu’il y a à dire est modulé par ce que les « acteurs» disent ou ce que disent leurs visages et leurs gestes. J’ai choisi de filmer en pellicule pour raccourcir la profondeur de champ, car ils vivent dans ce monde flou et mouvant. En contrepoint, ce que j’appelle les « confessions », en gros-plan, est pris en vidéo noir-blanc qui accentue l’expression des regards et sculpte la lumière des visages. Je ne suis pas là pour juger mais pour témoigner. Je ne cherche pas à « esthétiser » le sujet, mais je crois que le documentaire participe de l’art cinématographique, que je vis aussi en tant que peintre.
- Avez-vous gardé le contact avec les protagonistes de Welcome Europa ?
- Dans la mesure du possible, mais certains ont été renvoyés dans leur pays, comme le jeune Allal, mineur, qui allait s’intégrer à Marseille et qu’on a renvoyé à Tanger alors que ses parents vivent à mille kilomètres de là, ou Igor le Roumain, incarcéré après notre rencontre, relâché et renvoyé dans son pays. Mehmet le Kurde, qui apparaît comme le fil conducteur du récit, et n’a jamais touché lui-même à la prostitution, a obtenu un statut de réfugié politique et trouvé du travail. Je lui ai d’ailleurs laissé le mot amer de la fin : «J'ai bien compris que, pour que certains vivent, il fallait que d'autres meurent.»
Durée du film : 1 h. 30.
-
Ceux qui vont de l'avant
 Celui qui finit les phrases des autres / Celle qui injurie les téléphonistes / Ceux qui dérobent les ornements floraux / Celui qui se dit la réincarnation du Grand Cordelier / Celle qui mâche des crayons / Ceux qui sentent le vieux / Celui qui ne sort jamais sans son couteau suisse / Celle qui arbore des souliers verts / Ceux qui ne supportent pas les patois préalpins / Celui qui combat ses pellicules / Celle qui reprend son nom de jeune fille / Ceux qui prônent la circoncision généralisée / Celui qui bouscule les parallèles (dit-il) / Celle qui pense que les SMS sont cancérigènes / Ceux qui se douchent quand ils ont voyagé avec un Africain (disent-ils) / Celui qui boit les paroles de François Hollande / Celle qui pense que Jean Ferrat devrait se raser la moustache / Ceux qui savant Santiano d’Hughes Aufray par cœur / Celui qui ouvre les yeux sous l’eau / Celle qui bat la mesure en argumentant / Ceux qui espèrent que le prochain Saint Père sera latino / Celui qui se dit un sosie de Bourvil / Celle qui est jalouse des seins de sa fille coiffeuse / Ceux qui brûlent les lettres adressées à leur conjoint / Celui qui se vante de tuer des corneilles / Celle qui vise bas / Ceux qui n’iront jamais en Allemagne, etc.
Celui qui finit les phrases des autres / Celle qui injurie les téléphonistes / Ceux qui dérobent les ornements floraux / Celui qui se dit la réincarnation du Grand Cordelier / Celle qui mâche des crayons / Ceux qui sentent le vieux / Celui qui ne sort jamais sans son couteau suisse / Celle qui arbore des souliers verts / Ceux qui ne supportent pas les patois préalpins / Celui qui combat ses pellicules / Celle qui reprend son nom de jeune fille / Ceux qui prônent la circoncision généralisée / Celui qui bouscule les parallèles (dit-il) / Celle qui pense que les SMS sont cancérigènes / Ceux qui se douchent quand ils ont voyagé avec un Africain (disent-ils) / Celui qui boit les paroles de François Hollande / Celle qui pense que Jean Ferrat devrait se raser la moustache / Ceux qui savant Santiano d’Hughes Aufray par cœur / Celui qui ouvre les yeux sous l’eau / Celle qui bat la mesure en argumentant / Ceux qui espèrent que le prochain Saint Père sera latino / Celui qui se dit un sosie de Bourvil / Celle qui est jalouse des seins de sa fille coiffeuse / Ceux qui brûlent les lettres adressées à leur conjoint / Celui qui se vante de tuer des corneilles / Celle qui vise bas / Ceux qui n’iront jamais en Allemagne, etc. -
Prix Robert Walser au Loup
La Symphonie du Loup, de Marius Daniel Popescu, publiée aux éditions Corti, a été distinguée à l’unanimité du jury du Prix Walser 2008. Les moutons noirs sont à la fête!

-
Le quotidien sacralisé
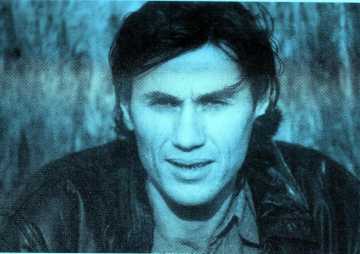
Sur l'édition préoriginale de La Symphonie du Loup, de Marius Daniel Popescu
L’une de mes plus grandes joies, en tant que lecteur de métier, a toujours été d’assister à l’éclosion d’une œuvre nouvelle. Dans un monde qu’Armand Robin disait celui de la « fausse parole », où la dévaluation et la prostitution du langage atteignent aujourd’hui des proportions universelles, l’émergence d’une voix réellement singulière, modulée en style sans pareil, me touche toujours autant que la redécouverte de tel ou tel grand livre. C'est dire que je ne cherche pas la nouveauté pour elle-même, à l’imitation de tant de jobards se pâmant devant le dernier gadget au goût du jour, mais l’expression, imprévisible à tout coup, d’une perception renouvelée des choses et des mots.
J’aurai vécu un tel choc à la découverte des livres de Thomas Bernhard, puis à celle d’Antonio Lobo Antunes, et plus récemment dans l’amorce d’un livre soudain jailli comme d’une source, sous la plume de Marius Daniel Popescu, poète et prosateur d’origine roumaine (né à Craiova en 1963 et vivant à Lausanne depuis 1990) qui ne savait pas, il y a dix ans de ça, un mot de français. Or c’est à la cristallisation d’une langue-geste originale, d’un style à la fois limpide et percutant, et d’un art de la narration jouant sur l’expression orale et l’alternance de multiples strates vocales, qu’on assiste ici. Plus encore, c’est à la transmutation d’un regard, à la fois candide et grave, et à l’affirmation, tendre et violente, d’une pensée incarnée que nous confronte l’écrivain.
A propos des quatre premiers recueils de Marius Daniel Popescu parus en Roumanie, les auteurs d’une anthologie de la poésie roumaine des années 80 et 90 écrivaient que « l’idéal de cette poésie transparente est de révéler la métaphysique des faits de chaque jour ». Ce qui frappe en effet, chez Popescu, tient à sa façon de « sacraliser » la plus humble réalité sans la désincarner pour autant, avec les mots les plus usuels. Les mots sont pour lui les signes rituels d’une sorte de baptême où chaque chose serait requalifiée au plus simple et au plus juste, dans une lumière épurée.
Humainement parlant, peu d’individus que j’aie rencontré m’auront jamais donné l’impression de se payer moins de grands mot que Marius Daniel Popescu. Littérairement parlant, peu d’auteurs des nouvelles générations me semblent capables de dire autant que lui avec si peu d’effets de rhétorique. Par son mélange de limpidité et de véhémence, de porosité extrême à la vie de tous les jours et de pulsations rythmique et mélodiques marquant chaque phrase, Popescu m’apparaît, dans la centaine de pages inédites que je connais de lui, comme un capteur d’émotion et un enlumineur de réalité dont il faut attendre beaucoup.
Ce texte accompagnait la publication, sous le titre Les couleurs de l’hirondelle, des premières pages inédites de La Symphonie du Loup à venir, publiées dans le numéro 43-44 du Passe-Muraille, en décembre 1999.Photo JLK