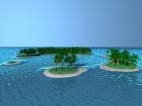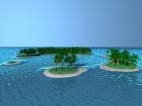
(Extrait)
C’est dans le vol à destination de Toronto, où j’étais invité au colloque Cendrars consacré à La Légende de Novgorod, cette année-là, que je fis un peu mieux la connaissance de Lina Bögli. J’avais entendu parler, déjà, de cette candide figure d’institutrice voyageuse toute vouée au service de la Véritable Jeune Fille, dont le récit des pérégrinations était paru dans les premières décennies du XXe siècle. Je m’étais procuré le petit livre en bibliothèque à la veille de mon départ pour le Canada et j’en avais amorcé la lecture au bar Elvetino de l’Intercity de Genève, me retrouvant du même coup dans la ville de Cracovie chère à mon souvenir ; et tout aussitôt j’avais reconnu, dans la décision soudaine prise par Lina Bögli de faire le tour du monde, au cap de la trentaine, l’élan qui avait lancé mes propres aïeux aux quatre coins du monde - je revoyais ainsi, dans la Stube (la salle à manger) familiale de nos vacances d’enfants, à Lucerne, le Grossvater nous désignant alternativement les trois murs percés de fenêtres sur le sud, l’est et l’ouest, ou la paroi du nord à la grande photographie sépia représentant les pyramides de Gizeh devant lesquelles il avait posé en compagnie de sa jeune épouse en robe blanche semblant de soie floche dans le vent lourd, chacun très digne sur son chameau ; Grossvater qui nous racontait un soir les rues de Budapest où tel de ses sept frères avait appris le métier de confiseur, un autre soir les vignes de Californie où deux de ses cousins s’étaient établis, d’autres fois encore le Rajahstan ou l’Afrique du Nord dont l’Oncle Fabelhaft ramenait ses tapis, ses bourses en pis de chamelle de la tribu Reguibat et ses affabulations de long flandrin à lunettes de grand-duc.
A trente ans, en 1892, l’institutrice bernoise Lina Bögli avait craint de s’encroûter dans la famille polonaise qui l’employait à Cracovie, comme, à vingt ans, je m’étais impatienté de rejoindre les hippies nudistes de Goa.
Dans les lettres à son amie Lisa qui constituent le récit de son voyage, Lina explique que son projet représente une échappatoire « au vide de l’existence d’une femme seule » autant que le défi de réaliser ce qui semblait alors réservé au seul sexe dit fort. « Pour un homme, écrit-elle ainsi, la situation est moins triste : il peut entreprendre ce qu’il veut pour rompre la monotonie de sa vie ; oui, être un homme, ce serait la liberté ! » Et d’ajouter après s’être demandé ce qu’elle-même ferait si elle était un homme : « Je ferais sûrement de grands voyages pour apprendre à connaître les humains et les pays ». Sur quoi la conclusion s’impose à ses yeux: « Je ne suis nécessaire à personne, je n’ai point de parents qui pourraient se tourmenter pour moi. Donc je pars ! »
Dans le bar du train à deux étages glissant en douceur le long de la rive à millionnaires du lac Léman, direction l’aéroport de Genève, la main à portée de mon Nokia et mes cartes de crédit prêtes à servir, j’essayais de me figurer, ce matin-là, ce qu’avait représenté réellement l’équipée de Lina Bögli.
Nos aïeux nous l’avaient raconté : la Suisse d’alors n’était pas riche, aussi devait-on souvent chercher ressource hors de nos frontières, et c’était une plus haute tradition de précepteurs et de gouvernantes, après tant de régiments de mercenaires que relayaient désormais les brigades hôtelières, qui se perpétuait sur des réseaux aux points de chute sporadiques mais plus sûrs qu’on ne croirait.
C’est que l’Anglais, en 1892, a déjà fait pas mal pour que le Suisse s’avise enfin de la ressource nouvelle de son paysage de montagnes hautes et de lacs lustraux, longtemps mal jugé; l’Anglais et le Suisse ont entrepris de construire ensemble force palaces sur les hauteurs, et le Suisse retrouve volontiers l’Anglais de par le monde où l’établit son empire. Lina Bögli elle-même, dans les premières années de son voyage autour du monde, ne jure d’ailleurs que par l’Anglais, dont elle blâmera plus tard, en revanche, la froideur cynique.
Il n’en reste pas moins qu’à l’instant de partir, dûment chapitrée par son entourage qui n’y voit qu’une lubie folle, Lina Bögli vacille, hésite et même en vient à paniquer dans le bureau maritime où elle va retirer son billet pour Brindisi, quand un Signe du Ciel lui est adressé in extremis…
« Tout à coup, raconte Lina à Lisa, je me sentis si complètement seule, je fus prise d’une telle angoisse de l’inconnu que je me décidai à rentrer chez moi (…) J’étais donc sur le point de quitter le bureau, quand le mot de Vorwärts (en avant !) frappa mes oreilles. Je me retournai : le commis venait de rentrer dans le bureau ; voyant ma surprise, il répéta poliment : « Le bateau que vous prendrez est le Vorwärts »
Ce seul nom plein d’allant de Vorwärts, dont elle apprendra plus tard qu’il fut aussi la devise de l’explorateur Nansen, suffit ainsi à réconforter la jeune voyageuse : « Je me sentis comme traversée d’un courant électrique. Mon découragement et ma peur s’en étaient allés. J’étais redevenue entreprenante ; la mer ne m’effrayait plus ; les êtres humains ne m’intimidaient plus. Je crois fermement qu’à ce moment-là Dieu m’a ordonné d’aller de l’avant. Et désormais Vorwärts sera ma devise ! »
A présent je flottais au-dessus des nuages de l’Atlantique, autant dire que je n’y étais pour personne, juste accroché aux lettres que Lina Bögli avait écrites un siècle plus tôt à son amie Lisa.
La plaisante arnaque académique à laquelle je me trouvais convié à mon corps plus ou moins défendant, consistant à prononcer, à Toronto, un speech de vingt minutes sur le thème de l’authenticité discutée de La légende de Novgorod, ce poème mythique de Blaise Cendrars qu’un lettré bulgare avait miraculeusement retrouvé (ou fabriqué) dans sa version russe, m’apparaissait maintenant dans une perspective plus réjouissante encore. De fait, Lina Bögli était un personnage de Cendrars, ou plus exactement : elle participait de cette Suisse non académique et néanmoins sagace et curieuse de tout que je m’enorgueillis de défendre et d’illustrer à ma façon, comme je m’y étais notamment employé en poussant une pointe d’investigation à Sofia, en franc-tireur, auprès du Bulgare dont j’avais recueilli, libations aidant, d’exclusives révélations… que je lui avais promis de taire. Du moins en avais-je fait état, sous le sceau du secret, à mon amie Adeline Le Dantec, LA spécialiste de la question qui trouvait dans mes conclusions un motif de plus de taire les siennes. Un prêté valant un rendu, elle m’avait donc proposé, enceinte jusqu’aux yeux ce mois-là, de la remplacer à Toronto à ce qu’elle-même avait appelé, avec son sourire suave, le Colloque des Menteurs.
Lina Bögli, pour sa part, n’affabulait pas le moins du monde, mais la minutie terre à terre de ses petits rapports n’en avait que plus de sel. A l’instant je l’imaginais cinglant vers l’Orient de notre enfance, que Grossvater nous désignait à la fenêtre de la Stube donnant à l’Est, là-bas vers le couvent des franciscains du bout de la rue et les Alpes, les Carpates et la mer d’Aral. Mais la route de Lina Bögli bifurquait vers Aden la poussiéreuse et bientôt elle débarquerait à Colombo pour y déplorer « trop de degrés de chaleur, trop de serpents et trop de mendiants ».
Au début de son voyage, Lina Bögli est encore une provinciale vite effarouchée, dont les principes et les préjugés marqueront toujours les jugements en dépit d’une évolution perceptible. Il y a un petit soldat chez elle, et de la monitrice de patronage. A plusieurs reprises elle invoque l’exemple des anciens Suisses à la bataille, et pour ce qui est de son modeste sort elle s’en remet au « Père des orphelins », ce Dieu qui présente le considérable avantage, pour une voyageuse, d’être là partout où elle va, jusque chez les mangeurs de chair humaine et les polygames barbus. On remarque chez elle le mélange du paternalisme colonial à l’anglaise et l’attachement plus typiquement helvétique à certaine rectitude travailleuse et certaine réserve décente dont elle relèvera ici et là les manquements les plus choquants.
Révulsée par la « partie indigène »de Colombo, Lina Bögli trouve « un goût de térébenthine » à la mangue, et les bananes « trop farineuses », qui lui font regretter « les honnêtes pommes, poires et prunes » des vergers de la mère patrie. Sans être du genre à se lamenter, elle laissera cependant filtrer, de loin en loin, un persistant mal du pays. « Ist’s auch schön im fremden Lande/Doch zur Heimat wird es nie » (c’est aussi beau à l’étranger, mais jamais autant qu’au pays), se récite-t-elle comme le font encore maints Helvètes hors de nos frontières. Pourtant, à la différence du touriste moyen de nos jours, Lina Bögli se mêle un peu plus à la vie des pays qu’elle visite, n’était-ce qu’en y travaillant, jusqu’à réaliser parfois de véritables reportages sur le terrain. C’est ainsi qu’elle ne craindra pas de « briser la glace » pour soutirer les confidences de tel vieux Maori, cannibale en retraite, qui finit par lui avouer, remis en appétit par l’insistante curiosité de la jeune femme avide de détails, qu’il goûterait volontiers de sa tendre chair…
Cette savoureuse partie du récit de Lina Bögli coïncidant avec la distribution des mornes barquettes de blanquette de cuisine d’hôpital du lunch, m’a fait imaginer alors, autre vision cocasse, un Blaise Cendrars cloué pour dix heures dans cette infirmerie volante, ou Charles-Albert Cingria vitupérant l’étroitesse des sièges et refusant de se ceinturer la panse, tous deux fumant des bolides avant de réclamer de l’Absinthe à température stratosphérique. Or nous restions là, bridés comme des poulets, sanglés et surveillés, tandis que Lina Bögli se consacrait à la Jeune Fille australienne en ces années du tournant de siècle où Blaise et Charles-Albert découvraient le monde.
A son arrivée en Australie, le « vaste jardin » d’Adelaide réjouit d’autant plus Lina Bögli qu’elle n’y découvre « ni cabarets ni bouges ». Le pays a l’air neuf, la jeune fille y est une terre vierge à sarcler. « Chez les races de couleur, notera-t-elle plus tard, le Chinois est l’élève le plus satisfaisant ». Cependant, quittant Sydney après quatre ans de séjour, la diligente institutrice dit regretter surtout « cet être aimable et aimant, pour lequel j’ai travaillé, que j’ai tour à tour grondé et si tendrement aimé, la jeune fille australienne ».
A Toronto j’allais tomber, le lendemain, sur la réincarnation masculine de Lina Bögli en la personne d’un certain Jack, instituteur trentenaire aux cheveux rouges à la Harry Potter et aux yeux bleu islandais, le regard d’une âme sereine, le geste noble et le discours ardent, racontant à trente mômes de toutes les couleurs, devant un affût de canon jouxtant la vénérable Université, les aventures d’Etienne Brûlé le Français frayant avec l’Indien Missisauga et le suivant jusqu’au lac Huron, devançant les premiers trappeurs québecois.
« Si vous, enfants, êtes libres aujourd’hui, scandait Jack à l’attention de ses ouailles transies par le vent du nord et presque au garde-à-vous, si nous sommes tous Canadiens aujourd’hui, vous d’Afrique et moi d’Irlande, vous de Chine ou d’Italie et moi du Donegal, vous fils de pêcheurs indonésiens et moi rejeton de maudit gratte-pierre et de fouille-tourbe, si tous ensemble nous sommes devant cet affût c’est parce que ce canon historique a tonné pour Muddy York, dite aussi Hogtown et Toronto la vertu !»
A l’instant des questions, les sages petites mains se sont levées et Jack, aussi gravement attentionné que l’eût été Lina Bögli, a répondu à chacune et chacun ; et comme je m’étais approché et qu’à mon tour je levai la main, le même Jack m’a mêmement éclairé sans quitter des yeux ses enfants impatients de Tout Savoir ; et le même soir nous nous retrouvions, avec Jack aux yeux clairs, dans ce café de Little Poland où je savais pouvoir trouver certaine vodka au miel propre à nous réchauffer l’âme ; et sous l’effet de celle-là me revint le soupir de Lina justifiant son départ des îles Samoa, qui ne pouvait qu’attendrir Jack le pur.
Elle fut âpre et bonne, cette première nuit de Toronto, dont mes pairs lettrés du lendemain ne sauraient jamais rien. Elle fut celle aussi de la grande menterie à la Cendrars, mais sans papiers. Elle suivit la déclinaison des points cardinaux chère à Grossvater, mais dans le beau désordre de la poésie qui incite à chanter la neige dans la touffeur d’août et nous ferait évoquer les lagons en titubant au petit matin glacial le long de Yonge Street, tout résolus à marcher de concert jusqu’à Tobermory où nous portaient nos rêves enfantins de goélettes englouties.
A Jack les larmes sont venues bien avant l’ivresse, quand je lui racontai, reprenant le récit de Lina Bögli par la fin, l’énorme émotion qui saisit l’institutrice à la vision des milliers d’immigrants européens en loques débarquant à Castle Garden et parqués là des semaines durant ; et l’idée vint aussitôt à mon compère de commander un verre spécial à la mémoire de Lina la probable abstinente, les aïeux de Jack ayant précisément rallié le Nouveau Monde en ce début d’été 1902 dont parlait la voyageuse.
L’ingénuité de Jack me touchait autant que celle de Lina Bögli, et plus encore leur commune curiosité et leur idéaliste ferveur. Ainsi ne m’étais-je pas étonné de l’enthousiasme avec lequel le jeune homme allait accueillir mon récit de la voyageuse enquêtant, à Salt Lake City, auprès des jeunes Suissesses prises au piège des tribus polygames des Mormons, avec l’arrière-pensée d’en dénoncer le pauvre sort, puis découvrant au contraire l’excellence de celui-ci, la haute moralité des patriarches à plusieurs nids et l’édifiante amitié liant entre elle les pieuses épouses.
Raconte encore, me pressait Jack, comme je l’avais demandé tant de fois à Grossvater, à l’Oncle Fabelhaft ou à Blaise Cendrars. Et c’est ainsi qu’en récits alternés nous avions fait défiler, sur les murs du bouge polonais, les mirages de glace fumante et les nuages de sable roux, Jack modulant le lancinant appel du huard et moi lui répondant par le hoquet du lagopède, Jack m’apprenant qu’en langue indienne chicoutimi signifie « aussi loin que profond » et moi lui révélant alors comment Lina Bögli, tentée par les Samoa, en repoussa finalement la trop suave coupe.
C’est en février 1897 que Lina Bögli découvre les îles Samoa, figurant aussitôt à ses yeux le paradis terrestre. Mais plus encore que le lieu, ce sont ses habitants, aussi sages et gentils que beaux, qui vont la porter ensuite à l’irrésistible désir de les embrasser tous et de s’installer au milieu d’eux. « Je n’ai jamais eu ma part des plaisirs de la jeunesse » a soupiré Lina dans une de ses lettres à Lisa, et voici que l’image même de la jouvence éternelle lui est donnée par ce peuple paisible et nu, dont la civilité l’émerveille. « Je crois, écrit-elle à ce propos, que les voyages nous dépouillent un peu de notre vanité en nous donnant l’occasion de nous comparer à d’autres nations ou à d’autres races que nous avions jugées inférieures »…
(Suite dans Journal des lointains, No 1. Revue trimestrielle consacrée aux voyages, éditée par Marc Trillard aux éditions Buchet Chastel)
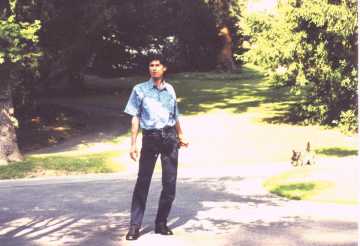
 Marius Daniel Popescu, La Symphonie du loup, José Corti, 400 p.
Marius Daniel Popescu, La Symphonie du loup, José Corti, 400 p.

 Lyonel Trouillot. L’amour avant que j’oublie. Actes Sud, 182p.
Lyonel Trouillot. L’amour avant que j’oublie. Actes Sud, 182p.