
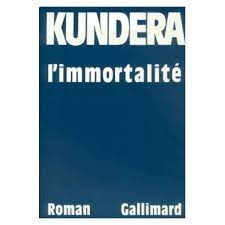 À propos de L’Immortalité de Milan Kundera, en janvier 1990.
À propos de L’Immortalité de Milan Kundera, en janvier 1990.Cette nouvelle année de lecture commence merveilleusement, avec un grand livre: le meilleur, à notre goût, de Milan Kundera. Poursuivant les fugueuse variation romanesque sur quelques interrogations majeures qui tissent son œuvre, de La Plaisanterie à L’Insoutenable légèreté de l’être, en passant par Le Livre du rire et de l’oubli, notamment, le romancier atteint ici le sommet de son art avec une liberté d’invention qui aère l’extrême densité de son propos.
Équilibrant admirablement ses idées et les sentiments de ses personnages, avec le mélange d’humour et de mélancolie qui lui est propre, Kundera, en héritier des Lumières, traverse les apparences de notre fin de siècle. Hâtez-vous de le lire lentement !
On entre dans ce roman comme dans une sorte de palais de reflets tout plein d’échos et de résonance. Il semble à la fois qu’on y patine et qu’on y vole, mais ce n’est pas un rêve. Même si l’on sait que c’est un roman, aussitôt on n’y croit, et quoi que suivant le romancier comme un « cicerone » à la Fellini ou comme Hitchcock vous balançant un clin d’œil entre deux séquences, on marche comme un gosse à qui un conteur la bâillerai belle…
Cela étant, Kundera se situe à l’opposé du « roman d’évasion », comme on dit. Bien plutôt, c’est un roman d’invasion que L’immortalité, qui nous fait plonger au cœur du réel. Qui sommes-nous en vérité dans le labyrinthe truffé de faux-semblants de la vie contemporaine ? À quoi tenons-nous vraiment ? Qu’est-ce que l’amour vrai ? Que restera-t-il en vérité de nos vies ? Telles sont les interrogations qui nourrissent ces pages à la fois denses et captivantes, échappant à la futilité autant qu’à l’intellectualisme jargonnant.
Le roman, Kundera l’a toujours pratiqué comme une méditation poétique sur la vie, où les idées sont confrontés à l’expérience humaine. À l’opposé des romanciers à thèse, c’est un maître de la pensée incarnée. À la lumière de ses mises en scène, le moindre geste pèse parfois plus lourd qu’une opinion, exprimant notre être profond, notre « thème » dominant.
Liberté prise
Cela commence au bord de la piscine d’un club de gymnastique parisien, où l’auteur ferre son premier personnage, comme ça, mine de rien, parce que cette dame, à tel moment, a eu un geste qui l’a ému. Et de lui donner un nom, Agnès, et de lui prêter une vie qu’il lui reprendra cruellement en fin de roman, non sans enrichir son œuvre de l’un de ses plus beaux personnages féminins.
De son chapeau à destins, le romancier fera surgir ensuite Paul et Laura, époux légitime et sœur d’Agnès, puis le polichinelle médiatique dans Laura s’est entichée Racer et l’amant secret mon secret d’Agnès – un peintre raté surnommé Rubens –, enfin cet étrange personnage qui dialogue avec Kundera au coin de plusieurs chapitres, dont le nom d’venarius davel Marius et les menées de joyeux terroriste évoque un redresseur de torts philosophique à la Chesterton.
Ajoutez à ces quelques personnages contemporains ceux de Goethe et de Hemingway, qui ont quelques bonnes conversations dans l’au-delà, la brave femme du grand poète allemand et Bettina Brentano son encombrante groupie, et vous aurez la distribution presque complète de cette vaste conversation polyphonique où l’on saute d’un siècle à l’autre avec la même souplesse qu’on change de sujet ou d’atmosphère.
Jamais, du point de vue littéraire, Kundera n’avait atteint un tel bonheur formel, sa composition tenant de la fugue et du montage labyrinthique à la Escher, avec les ruptures les plus savantes et mille reprises toutes naturelles d’apparence.
Désillusionniste
Dans une société saturée d’image – où l’ « imagologie » a remplacé les idéologies, à en croire Kundera – et d’opinions prêtes-à-porter, l’individu déraciné vit de plus en plus dupe de son reflet et des conventions sociales, sous les bannières brandies de l’anticonformisme. Mais il y a les rebelles, aussi. Refusant de se payer de mots, Agnès, que sa sœur Laura prétend froide, quitte l’illusoire harmonie conjugale, à la recherche des chemins écartés qu’ellle parcourait jadis avec son père, le seul homme qu’elle est vraiment aimé.
De la même façon, Goethe repousse les avances exaltées de Bettina, obsédée par la volonté d’entrer dans l’Histoire à ses côtés. On reprochera plus tard à Goethe sa pusillanimité face à l’ardente égérie, mais Kundera, pour sa part, démystifie le pur amour de Bettina qui n’aime pas tant le poète que son propre amour égocentrique. Ainsi l’Homo sentimentalis a-t-il substitué, dans l’Europe courant des troubadours aux romantiques, via Cervantès, l’amour sublime à la tendresse quotidienne incarnée. Isolde figure l’amour idéal, parce qu’inatteignable, tandis que la femme de Goethe, qu’il préférait à Bettina, passe pour « saucisse » aux yeux de la postérité ; et Kundera de prêter à Goethe des propos très sages sur l’immortalité littéraire avant de lui permettre de retourner dormir et « savourer la volupté du non-être total »…
L’ultime beauté
Une fois encore, cependant, Milan Kundera ne nous enseigne pas de leçon. Développant une réflexion en continu sur l’identité de l’homme, sur la perte du sens de la réalité qui affecte nos contemporains, sur la soumission de l’homme à la machine et aux stéréotypes collectifs, ou sur la part de hasard et de liberté qui nous est accordée, il multiplie les interrogations quitte a bousculer les préjugés de ses personnages, tout en leur montrant une égale amitié. Laura et Bettina, pour exaltéées qu’elle soient, nous touchent ainsi, comme nous touche Rubens l’amant désabusé qui a cru que vivre intensément suffirait à combler ses aspirations. Lorsque Paul, en outre, ânonne à la suite d’Aragon que « la femme est l’avenir de l’homme », sans y croire à vrai dire, Kundera se garde de toute moquerie convenue. Ce qui ne l’empêche pas de déplorer le manque d’humour de nos contemporains…
« L’humour ne peut exister que là où les gens discernent encore la frontière entre ce qui est important et ce qui ne l’est pas, fait-il dire au professeur Avenarius. Cette frontière, nous la voyons courir dans L’immortalité comme un fil d’or. Quant à l’humour de Milan Kundera, il nous fait mieux accepter un désespoir métaphysique que nous ne partageons pas forcément, et que pondère également la dernière image du livre, où il est question de « l’ultime trace, à peine visible, de la beauté ».
Milan Kundera, L’immortalité, traduit du tchèque par Eva Bloch et revu par l’auteur. Éditions Gallimard, collection Du monde entier, 412 pages.
(Article paru le 15 janvier 1990 dans le quotidien 24 Heures)