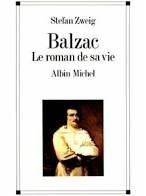(Lectures du monde, 2020)
NOUVEL-AN. - Comme il faisait tout gris ce premier matin de l’année et que nous savions qu’il faisait grand bleu un peu plus haut, nous avons décidé de passer à l’étage supérieur où j’avais envie, de surcroît, de me régaler d’une de ces fondues jamais aussi bonnes qu’aux jours d’hiver, et c’est ainsi qu’à midi, en vieux amoureux accompagnés du chien Snoopy, nous nous sommes retrouvés à l’auberge de la Poste des Diablerets où avait afflué une multitude d’amateurs de beau temps égaillés sur les parkings et les pistes.
Quant à la fondue, la classique « des Ormonts», nous l’avons sagement arrosée de thé crème ou nature, pour cause d’incompatibilité probable avec nos médicaments, et tant qu’à raviver d’anciens tendres souvenirs, nous sommes rentrés «par les hauts» via les Voëttes où nous avons salué au passage le chalet Mona, en contrebas de la route gelée ; et c’est au col séparant les deux vallées que, marchant le long d’un chemin écarté, sans douleurs ou presque, je me suis retrouvé devant un grand enclos dans lequel cinq ou six beaux grands poneys shetland, dont plusieurs en longs cheveux et bien membrés, tournaient en rond non sans me considérer de loin jusqu’à ce que le plus grand, la crinière sur les yeux, s’avance carrément sur moi jusqu’à me laisser lui gratter le chanfrein - formidable présence de ce premier jour de l’an… (À la Maison bleue, ce 1er janvier 2020)
PESSOA. - La première séquence de mon journal de lecture s’intitule Poésie a contrario. La deuxième sera : Présumée innocence, ainsi amorcée : « On dirait qu’on serait un chevrier des hautes terres, là-haut au bord du ciel où tout serait comme au début des temps où l’on chantait dans l’innocence, et ce conditionnel de notre enfance supposée serait le vœu ou plus simplement encore en deçà de toute intention : le jeu; et les mots de ce jeu se donneraient comme en en dépit voire au défi de la grammaire, l’école dans nos montagnes restant irrégulière quoique vive l’envie d’apprendre les noms des choses et scrupuleux nos instituteurs.
Les mots et les dessins d’enfants sont ce qu’ils sont dans un aléatoire auquel on demande moins qu’à l’esquisse d’un arbre, et ce qu’on appelle innocence relève de la même incertitude et le plus souvent de l’innommable balbutié et cela bégaie comme une strophe d’Alberto Caeiro, ou cela se cherche dans les rues basses de la ville embrumée de mélancolie et l’on est censé se laisser couler au nom de ce qui n’est peut-être que du voulu poétique »...
TRANSITS. – Se pose la question du passage, chez Czapski, du dessin à la toile, en précisant mieux ce qui définit et limite le dessin – et plus particulièrement le dessin de Czapski -, et ce qui va vers le tableau, le plus souvent difficilement à en croire les multiples notations du peintre sur ses chutes et rechutes, comme on passe de la note de journal à un début de récit ou de fiction romanesque à quoi l’on pourrait comparer le tableau abouti.
L’ENVOL. - Je reviens à L’opéra du monde d’Audiberti et c’est pour mieux moduler, là encore, ma relation à la présence et à la sensation, à l’apparition impromptue ou à la saisie fulgurante, cadeau «du ciel» ou prise du chasseur à vive enjambée, dans le mouvement et comme au vol.
JACTANCE. - Notre ami RJ s’agite passablement à propos de l’affaire Matzneff, où je sens qu’il aimerait m’entraîner, comme il l’a essayé à propos de David Hamilton, en m’envoyant le sinistre Olivier Mathieu – un mégalomane négationniste de la pire espèce -, mais il va de soi que je ne me mêlerai pas de ce faux débat entre vieillards plus ou moins libidineux invoquant le droit d’abuser des enfants et des adolescents sous couvert de liberté d’expression.
De fait, j’ai ces jours bien mieux à faire, et notamment à pénétrer plus avant dans le labyrinthe infini de Fernando Pessoa que j’ai commencé d’évoquer dans mon journal de lecture.
Ceci dit je suis curieux de voir jusqu’à quelles extrémités va se développer ce qu’on appelle déjà «l’affaire Matzneff», à laquelle RJ a tenté de me «préparer» lors de notre dernière soirée chez Yushi avant que je ne lui fasse entendre que je n’y prendrais aucune part… (Ce samedi 4 janvier)
DU GÂCHIS. -Tout ce qui a été gâché au lieu d’être reconduit et développé, le plus souvent sous l’effet de la vanité ou de ce que les Grecs appelaient l’hybris. Dans mon rapport avec la société le gâchis a commencé avec la sottise provinciale de BC, le premier à me tuer virtuellement, il a continué avec la bêtise supérieurement idéologique et suicidaire de VD qui a tout emporté en brûlant ses vaisseaux non sans tenter de m’anéantir dans la foulée, et le mal a tout contaminé et tout fait exploser en particules dissociées constituant finalement la No Society...
AMIEL & CO. - Je reçois, ce midi, pas moins de quatre exemplaires de la volumineuse 43e livraison des Moments littéraires dans laquelle figurent les douze pages de mon Journal des Quatre vérités.
J’en ai remercié vivement Gilbert Moreau et vais lire ce pavé avec un intérêt sûrement proportionné aux surprises que j’en attends, optimiste à tout crin que je suis…
Et voilà bien la surprise, tout à fait inouïe me semble-t-il à première lecture, sous le nom de François Vassali, avec un texte d’un seul tenant de quatorze pages, intitulé Port-sommeil et qu’on dirait un écho de deux de mes lectures récentes, à savoir Le visionnaire de Julien Green et Le livre de l’intranquillité de Bernardo Soares, modulé par une voix sans pareille.
Aussitôt j’ai repensé à la société secrète des veilleurs, que cet auteur inconnu me semble incarner par excellence dans sa lancinante et crépusculaire rêverie, et sur laquelle je reviendrai à propos du Visionnaire de Julien Green et du Livre de l’intranquillité de Soares/Pessoa, mais aussi du Thrène de Sylvoisal et du grand poème khmère de Christophe Macquet…
INTRANQUILLE. - Il faut se ressaisir, se dit-il: tu dois changer ta vie, se répètent-ils depuis un temps qui ne se compte plus ; TU DOIS, IL FAUT, et cela leur tient lieu de leurre, se dit l’un des leurs mais qui est-il au juste ? L’intranquillité ne serait-elle pas qu’une pose, se demande l’un d’eux au dam des ingambes de la confrérie du Commentaire se tenant les coudes et se réclamant à trop bon compte du secret ! Les anges aussi ont bon dos.
GREEN AGAIN. - La lecture du Journal intégral de Julien Green me recentre pour ainsi dire. De tous les journaux intimes que j’ai lus c’est celui que j’aime le plus, à la fois pour son calme et sa précision, son honnêteté et son ton - ce dernier trait me semblant le plus important.
Rien du littérateur à la Gide là-dedans, et d’ailleurs les pages que je lis ce matin marquent la fin décidée (en 19329 d’une rupture amicale après la révélation du double jeu de l’immoraliste, probablement jaloux de la jeunesse et du génie de Green, que je découvre pour ma part avec cinquante ans de retard ! Bref, il y a une sérénité chez JG qui me convient.
L’OEIL DE L. - Lady L. a fini hier une toile restée longtemps inachevée, que j’aime beaucoup. Ma bonne amie a une vraie vision, parente en somme de celle de Thierry Vernet dans son regard sur la réalité – en l’occurrence une forêt abritant une petite maison…
PROSERIES. - Revenant ce matin au dernier livre que m’a envoyé Lambert Schlechter, je tombe sur une page saisissante consacrée aux mères des cracheurs de feu du Sichuan, page 49, après avoir relevé, page 42, une phrase évoquant mes «obsession matterhornienne à l’aquarelle », alors que je n’ai jamais peint de Cervin à l’eau. Je l’ai fait remarquer illico à l’Auteur, qui m’a promis une correction dans le prochain (!) tirage. Tout en le lisant, et parfois à voix haute en prenant Lady L. à témoin, je me disais : mais qui donc, aujourd’hui, peut lire ces «proseries», à part des gens de mon espèce en voie probable de disparition ?
Or il y a là-dedans une poésie rare, d’inégale densité mais constante et souvent plus vivante, moins répétitive que les « minutes heureuses » de Georges Haldas auquel, soit dit en passant, je devrais revenir un de ces quatre. (Ce samedi 18 janvier)
MON JOURNAL. - Il fait clair et net ce dimanche matin sur la baie de Montreux, le lac bleu tendre m’apparaît au-dessus de la frange de pins « méditerranéens », de l’autre côté de la Grand-Rue, qui jouxtent la toiture du marché couvert au-dessus duquel j’aperçois les hauteurs enneigées de la dent d’Oche et du casque de Borée ; au loin plus à l’ouest se profilent les crêtes également couvertes de neige du Jura, et je me sens tout serein devant ce nouveau décor à la fois lacustre et préalpin qui est le nôtre depuis deux mois, serein et préservé du tapage mondial et médiatique où les débats sur moult « affaires » tournent à vide ; Lady L. vient de sortir avec Snoopy que je vois traverser la route à l’aplomb de mon petit balcon à barrière de fer forgé blanc, la rue parcourue le soir de bolides exaspérants (les petit cons font rugir leurs GT de parvenus incultes mal rasés) est ce matin au grand calme dominical et je me rappelle le téléphone, hier, de mon ami Jean Ziegler apparemment enchanté par ma chronique sur son dernier livre et me racontant ses tribulations à l’hosto (il a passé un mois couché, sous morphine, après s’être brisé une vertèbre lombaire) subies en même temps que je me relevais de mon attaque cardiaque…
Tout à l’heure, encore couchés, je lisais à ma bonne amie des passages du Journal de Julien Green que je ne lâche plus depuis novembre dernier, notamment sur sa liberté d’écrivain soucieux de préserver son indépendance (il a 32 ans en 1932, travaille au Visionnaire et revient de Berlin où Robert et lui ont senti la sourde menace d’une violence nouvelle) et sur les talents de « la vie » en matière d’invention romanesque, qui lui fait noter ce paragraphe d’anthologie : « Quel bizarre romancier que la vie ! Comme elle répète ses effets, comme elle appuie de sa lourde main, comme elle écrit mal ! Ou vient, elle revient sur ce qu’elle a dit, elle oublie le plan qu’elle avait en tête, elle se trompe de destinée et donne à l’un ce qui devrait échoir à l’autre, elle rate le livre qu’elle tire à des millions d’exemplaires. Et tout à coup, de magnifiques éclairs de génie, des revirements comme Balzac n’en rêva jamais, une audace de fou inspiré qui justifie toutes les erreurs et tous les tâtonnements ».
En 1932, JG éprouve le même malaise, entre ses amis de droite (dont un Maritain) et de gauche (Gide au premier rang), la même prévention et jusqu’au dégoût que j’ai éprouvés moi-même dès mes vingt-cinq ans et plus que jamais aujourd’hui entre mes amis de droite et de gauche.
Je sais que mon ami (et éditeur) Pierre-Guillaume de Roux vomiz positivement mon ami Jean Ziegler, mais je n’ai le cœur et l’esprit ni de choisir ni d’exclure. Si l’un ou l’autre m’excluait pour le motif que je ne le choisis pas en excluant l’autre, il me perdrait illico ; mais JG pressent aussi, derrière les personnes, l’horreur à venir des partis, et comme le temps est déjà au pressentiment de la guerre les positions se durcissent et s’exacerbent entre les catholiques «politisés» ou les maurrassiens et les «compagnons de route» à la Gide qui se dit capable de « mourir pour l’URSS » sans se douter , le pauvre, de ce qui l’attend.
Or Green, en poète intuitif et en réaliste anglo-saxon, voit très bien ce qui cloche dans les raccourcis idéologiques de ces messieurs, tout pareils à ceux que j’ai observés dès ma vingtième année dans les groupuscules de gauche et chez les paroissiens de droite, et ensuite à L’Âge d’Homme dès qu’on passait du domaine littéraire aux arguties théologico-politiques.
PG s’est offusqué de ce qu’on publie le journal « intégral » de Julien Green, affirmant que la «part d’ombre» d‘un individu n’a pas à être dévoilée, mais l’écrivain lui-même a autorisé cette publication après sa mort et la disparition de ses proches, afin qu’on sache «tout de lui», et ce « tout », certes gratiné quant aux détails de ses cavalcades nocturnes, n’a rien pour autant de ce qu’on peut dire une «part d’ombre» puisqu’il parle de cul en restant bien net et clair au contraire, peut-être choquant pour les belles âmes mais sans chercher à provoquer, n’écrivant d’ailleurs que pour lui, quitte à nous livrer un tableau de ses mœurs et de son époque qui a valeur de constat.
Il s’en explique d’ailleurs le 14 novembre 1993 dans son journal expurgé intitulé Pourquoi suis-je moi ? (1993-1996), en toute sérénité rétrospective : « Voici la vérité sur moi-même : J’étais fait pour l’amour. Point. La sexualité chez moi n’a jamais pu envahir l’amour. Il s’agit de deux réalités sans rapport. La frénésie sexuelle que j’ai connue, dont j’ai eu ma part, n’a jamais pu se faire passer pour l’amour. Faire l’amour est une expression qui à mes yeux ne signifie rien. L’amour naît en nous, mais il ne se fabrique pas. On peut tomber amoureux d’un visage, parce que dans le visage se lit et se raconte l’amour, la grande histoire de l’amour que beaucoup ne connaissent pas. L’appareil sexuel n’a à nous offrir que la sensation. Faire raconter à la sensation ce qui dépasse tout est une façon de se jouer la comédie à soi-même », etc.
Et c’est exactement ce que se dit le lecteur honnête en découvrant, dans le journal «intégral», le récit honnête et parfois crûment décrit des épisodes sexuels du Julien trentenaire, qui drague et baise à qui mieux mieux, souvent d’ailleurs en compagnie de son amant Robert, mais aime celui-ci d’un amour réel et réciproque, attentif et infiniment tendre, qui n’a rien à voir avec les «passes» d’un soir. Pour qui a vraiment connu l’amour et ne se joue pas la comédie, tout cela semble aller de soi, surtout pour moi qui l’ai vécu à ma façon.
Je n’en suis qu’à la page 530 du premier volume du journal intégral de Julien Green, qui en compte 1330, j’ai lu parallèlement ses romans de la même époque, à savoir Moïra et Mont-Cinère, Minuit et Le visionnaire sur lequel il est précisément en train de travailler en 1932, je découvre ce très grand écrivain (en lequel Jacques Maritain voyait le plus grand auteur français de son époque, dont il soulignait l’identité américaine…) à l’approche de mes 73 ans et c’est très bien comme ça, d’ailleurs le journal n’a pas pris une ride et je le lis comme si j’avais dix-huit ans, l’intelligence de la vie en plus…
DE LA PUBLICATION. - JG, au micro d’un Bernard Pivot, assez superficiel et niais le questionnant sur son Journal et faisant allusion aux méchancetés qu’il doit y avoir dans l’original, lui répond qu’il n’y en a aucune (ce qui me fait sourire) tout en relevant la différence décisive qu’il y a entre journal rédigé et journal publié ; et je me demande alors si je ne pratique pas trop, moi-même, l’autocensure, en tout cas depuis que j’ai publié L’Ambassade du papillon ; puis je me dis que je n’ai guère de secrets sauf par rapport à mes filles et à ma bonne amie, auxquelles je dois une réserve que je puis, peut-être , m’appliquer à moi-même – d’ailleurs je l’ai bien précisé dans mon Journal des Quatre Vérités…
Cela étant, il serait peut-être intéressant qu’un jour je «vide mon sac», dans un carnet Top Secret, à propos de mon inavouable privacy, n’était-ce que pour en souligner l’innocence ou le comique genre Little Boy – la bombe…

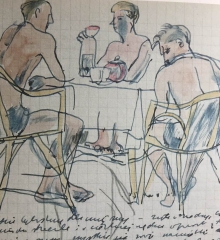

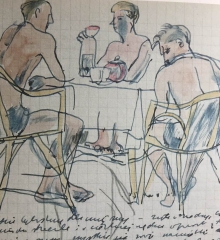


 Anouilh le situait à la hauteur de La Fontaine. Non seulement un délicieux conteur: un nouvelliste admirable et un grand romancier méconnu; un clown triste sans illusions sur notre drôle d'espèce.
Anouilh le situait à la hauteur de La Fontaine. Non seulement un délicieux conteur: un nouvelliste admirable et un grand romancier méconnu; un clown triste sans illusions sur notre drôle d'espèce.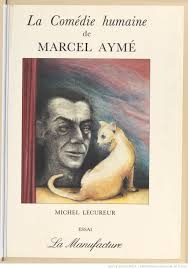


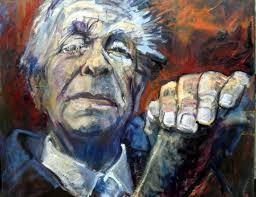
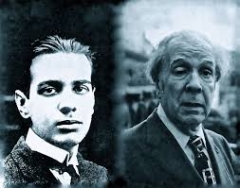
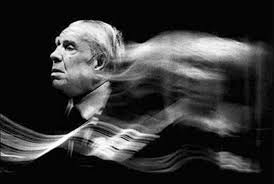

 (Lectures du monde, 2021)
(Lectures du monde, 2021)