

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.


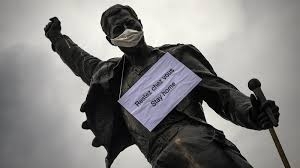

À Montagnola, ce 15 août 2002. - A l’instant, sortant du musée Hermann Hesse et me retrouvant à la terrasse jouxtant l’arrêt de la poste, ma bonne amie m’apprend, sur mon portable, que maman a été victime ce matin d’une hémorragie cérébrale. Elle est tombée en se lavant et ma soeur l’a trouvée gisant sur le carrelage vers midi, avant d’appeler l’ambulance. Elle est depuis lors dans un coma que les médecins disent irréversible, et ses heures semblent comptées. J’annule aussitôt mon voyage en Bretagne et je rentre. Le sommelier doit se demander quel chagrin d’amour me fait ainsi chialer sur mes trois décis de Merlot.
°°°
Ma petite mère qui regarde, me suis-je dis tout de suite, du côté de son amoureux dont elle est séparée depuis presque vingt ans. Ma petite maman de samedi dernier dans sa robe bleue et avec ses cheveux coupés courts, comme jamais elle avait osé, et qui lui allaient si bien. Ma petite innocente qui va rejoindre son innocent...
De la solitude. – Tu me dis que tu es seule, mais tu n’es pas seule à te sentir seule: nous sommes légion à nous sentir seuls et c’est une première grâce que de pouvoir le dire à quelqu’un qui l’entende, mais écoute-moi seulement, ne te désole pas du sentiment d’être seule à n’être pas entendue alors que toute l’humanité te dit ce matin qu’elle se sent seule sans toi…
Je me souviens...
(Noté dans le train du retour)
Je me souviens d’elle dans la cuisine de la maison, auprès de l’ancien petit poêle à bois, tandis que je regardais les photos du Livre des desserts du Dr Oetker.
Je me souviens d’elle en bottes de caoutchouc, maniant une batte de bois, dans la buée de la chambre à lessive.
Je me souviens de ses photos de jeune fille en tresses.
Je me souviens d’avoir été méchant avec elle, une fois, vers ma quinzième année.
Je me souviens de sa façon de nous appeler à table.
Je me souviens de son assez insupportable entrain du matin, quand elle ouvrait les volets en les faisant claquer.
Je me souviens de ses angoisses lorsque sa fille cadette ou son fils aîné furent accidentés dans le quartier. Son «Mon Dieu!» au téléphone.
Je me souviens de sa façon de dire «pendant la guerre».
Je me souviens quand elle nous lisait Papelucho, la série des Amadou ou Londubec et Poutillon.
Je me souviens de l’avoir surprise toute nue, une fois, en entrant par inadvertance dans la chambre à coucher des parents: je me souviens de sa forêt...
Je me souviens de nos dimanches matin dans leur lit.
Je me souviens de sa façon de nous seriner l’importance de l’économie.
Je me souviens de sa façon de critiquer l’avarice de Grossvater, tout en prônant l’économie.
Je me souviens du chalet de Grindelwald.
Je me souviens de la maison de pierre de Scajano.
Je me souviens de nos baignades à Rivaz.
Je me souviens de nos pique-niques en forêt.
Je me souviens du grand baquet de bois, pour les grands, et du petit baquet de fer, pour les petits.
Je me souviens de la lampe de chevet que lui avait offert, sur ses patientes économies (une pièce de cent sous après l’autre), un ouvrier de chez Schindler, où elle était comptable et qui l’avait à la bonne.
Je me souviens de son explication rapport aux «pattes» qu’elle suspendait à la lessive: ...
Je me souviens de sa discrétion (timidité) et de son indiscrétion (naïveté)
Je me souviens de sa lettre à Kaspar Villiger, ministre des finances.
Je me souviens de ses bas opaques.
Je me souviens de ses larmes.
Je me souviens du cahier jaune qu’elle a rédigé à mon intention après la mort de papa.
Je me souviens de sa façon de me recommander de ne pas trop travailler.
Je me souviens de sa façon de faire les comptes.
Je me souviens de sa façon de préparer les «paie» de nos filles.
Je me souviens de ses récents trous de mémoire.
Je me souviens de ses chèques Reka.
Je me souviens de sa querelle, à propos de la facture de l’entretien d’une pierre tombale de sa belle-mère que sa belle-soeur ne voulait pas l’aider à régler.
Je me souviens de ses rapports délicats (voire indélicats) avec sa belle-fille Ruth et avec son beau-fils Ramon.
Je me souviens des petits repas de nos dernières années, au Populaire ou à Sauvabelin, où elle me recommandait toujours de ne pas «faire de folies».
De la petite mort. – Parfois on a manqué l’aube, on ne l’a pas vu passer, on n’a pas fait attention, ou plutôt: on était ailleurs, c’est ça: on était partout et nulle part, on était aux abonnés absents, on n’y était pour personne et le jour a passé et ce matin c’est déjà le soir, on est tout perdu – on se demande si l’aube reviendra jamais…
Au CHUV, ce 16 août. - Seul au chevet de maman qui me fait un peu la même drôle de tête que le pauvre Edouard la veille de sa mort, mais plus paisible à vrai dire, lâchant de temps à autre un râle, mais sans signe visible d’aucune souffrance. Ai pris quelques photos. Essayé de prier, mais pas bien réussi je crois. Pense beaucoup à tout ce que nous avons vécu. Très reconnaissant dans l’ensemble. Regrette un peu de ne pouvoir lui parler, comme à papa le dernier jour, mais sa fin sera paisible comme elle le souhaitait.
Un jeune médecin très doux vient de passer. Me dit que ma mère va probablement s’éteindre comme une flamme déclinante. Pourrait faire des poses respiratoires, puis cesser de respirer tout à fait. En tout cas formel: aucun espoir de rémission.
L’humour noir de la situation: se dire qu’elle dort pour toujours, mais plus pour longtemps...
Au CHUV, ce 17 août, 6h. du matin. - Passé la nuit à l’hôpital. La vaillante continue de respirer. Très belle journée d’été en perspective, comme elle les aimait. Lui proposerais bien d’aller se balader au bord du lac ou par les forêts, mais plus jamais. L’air paisible au demeurant. La survie semble devenir «question de jours», mais en moi nulle impatience. Lui ai dit que ça avait été bien d’être son fils et leur fils. Lui reproche un peu d’être là et pas là, mais elle ne bronche pas.
Ma mère ne lira pas mon prochain livre, mais c’est pour elle que je le fais. Des choses qu’on ne réalise pas vraiment: sa mère sur son lit de mort.
Au CHUV, le 18 août. - Encore une journée divine. Maman repose sur le dos, la bouche grande ouverte, soufflant plus fort et de manière plus saccadée qu’hier. Me dis que le corps est plus et moins que le corps, mais où est la frontière ? Plus que le corps en cela qu’il déborde de ses limites apparentes, et moins que le corps en cela qu’il ne fera pas ce que n’imagine pas notre esprit.

Pascal disait que l’homme du futur aurait le choix entre la foi et le chaos. Or, on en est actuellement au simulacre de foi, qui ajoute au chaos.
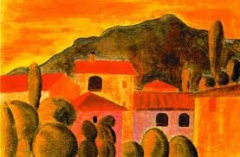
À La Désirade, ce 20 août. - Réveillé ce matin par sa présence. Grande tristesse et flot d’images. Pensé à elle et à tout un monde bon et régulier qu’elle représente à mes yeux. Puis la vision du Matin me rappelle quelle saleté peut être l’humanité. Deux adolescentes ont été assassinées en Angleterre, qui provoquent l’hystérie de la presse à scandale. De cela justement qu’elle avait assez, me disait-elle souvent : de cette saleté du monde.
(15h.-17h.) Toujours à son chevet. Ma sœur Liselotte me dit, non sans humeur, que c’est la première fois que notre mère ne fait pas «vite», selon son expression : «vite» que j’aille en commissions et «vite» que je fasse le frichti.
Diversion. - Autre moment comique pendant que j’attendais dans le couloir: dans une cellule de verre, un jeune médecin neurologue s’entretient avec un vieil oiseau déplumé. «Répétez, Monsieur Duflon: Je prépare mes affaires pour aller me baigner à la piscine. Répétez». Mais le vieux ne répète rien du tout, se contenant de marmonner sans discontinuer. Or le médecin ne désarme pas, mais après trois ou quatre vaines tentative, le voilà qui s’impatiente: «Répétez, Monseiur Duflon: le docteur est un imbécile. Répétez». Mais là encore, la proposition semble tomber à plat. Quant à moi, je suis soulagé à l’idée que maman ait échappé au labyrinthe de l’égarement mental…
Au CHUV, le 23 août. - «Il faut vous attendre à ce que ça se prolonge», me dit-on l’air compatissant. Ainsi la formule «elle risque de mourir» devient «elle risque de vivre». Mais je me sens ces jours comme hors du temps, ou dans un temps déplié come une carte du ciel, où nous sommes si petits.
Celui qui a peur de la nuit / Celle qui rêve qu’elle s’endort enfin / Ceux qui aiment le noir astral, etc.
À La Désirade, ce dimanche 25 août. - Ma sœur m’appelle pour me dire que l’infirmière de garde du CHUV lui a annoncé que maman allait nous quitter. À 13h. Liselotte, qui a eu le temps de la rejoindre à son chevet, m’apprend la mort de maman. Annette, notre sœur aînée, et elle étaient présentes. Je reste seul avec mes larmes.
J’ai toujours été attiré par la tristesse. Non seulement j’ai le don des larmes, mais j’en ai le goût.
De l’attention. – Si le monde, la vie, les gens – si tout le tremblement te semble parfois absurde, c’est que tu n’as pas bien regardé le monde, et la vie dans le monde, et que tu n’as pas assez aimé les gens dans ta vie, alors laisse-toi retourner comme un gant et regarde, maintenant, regarde cela simplement qui te regarde dans le monde, la vie et les gens…
À La Désirade, ce 26 août. - Mon travail pour le journal m’a occupé et distrait depuis la mort de maman, mais ce soir le chagrin, le tout gros chagrin m’a assailli sur l’autoroute, au point que je ne voyais plus où j’allais.
°°°
Passé cet après-midi à la chapelle no 10 du Centre funéraire de Montoie, où maman reposait derrière une vitrine. Elle avait, dans son cercueil, un air et une posture que je ne lui ai jamais vus, de très digne noble duègne espagnole peinte par Goya, mélange de dignité et de sérénité, la peau lisse comme de la pierre et les traits du visage bien détendus, les cheveux bien coiffés, les mains jointes d’une manière un peu forcée. C’est donc une troisième dernière image que je conserverai d’elle, après la petite dame en bleu du divan aux cheveux coupés courts qui lui allaient si bien, et la mourante sur son lit d’hôpital aux airs tour à tour paisibles et tourmentés.

Questions. - Où est-elle maintenant ? Est-elle tout entière disparue ou survit-elle d’une manière ou de l’autre ? Sera-t-elle réduite à cette poignée de cendres que nous allons déposer en terre à côté de la poignée de cendres de son cher et tendre, ou ce qu’on appelle leur âme poursuit-elle quelque part une existence différente, à part leur existence survivant en nous ?
De rien et de tout.- En réalité je ne sais rien de la réalité, ni où elle commence ni si elle avance ou recule, pousse comme un arbre ou gesticule du matin au soir comme je le fais – ce que je sais c’est juste que tu es là, qu’ils sont là et que je suis là, à écouter cette voix de rien du tout mais qui nous parle, je crois…
(Ces pages sont extraites de Chemins de traverse, Lectures du monde 2000-2005, paru en avril 2012 chez Olivier Morattel.)
Images: La mère, de Lucian Freud. Hermann Hesse au chat. Aquarelles de Hesse et JLK.
 En (re)lisant Le scorpion...
En (re)lisant Le scorpion...
C’est un écrivain souvent mal compris que Paul Bowles, paré d'une légende plus ou moins glamour et qui relève au contraire d'une littérature de la surexactitude implacable, comme l'illustrent les nouvelles réunies dans Le scorpion, dont la lecture procure un voluptueux effroi. On croirait y redécouvrir le monde avec les yeux d’un animal ou de quelque primitif. Tout y est comme déplacé par rapport à nos représentations mentales ou morales ; ou plus précisément, tout y est décentré, et ce changement de point de vue nous permet soudain de concevoir, avec un double frisson physique et psychique, l’extrême minceur de la cloison séparant l’état de nature de la civilisation, et le caractère tout relatif de nos convictions les plus profondes. Le sentiment est familier à tout voyageur un tant soit peu attentif, mais en l’occurrence il s’impose au lecteur avec l’intensité trouble de la fascination communiquée, ressortissant à la position même de l’écrivain, qui m’évoque tantôt un oiseau de proie et tantôt un serpent, avec une capacité de se glisser dans chaque peau comme cet esprit migrateur qu’il décrit dans La vallée circulaire.
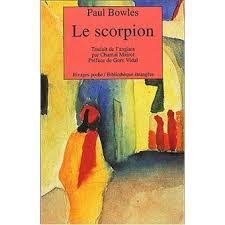
Il y avait de cette objectivité cristalline de vieux lézard altier chez Somerset Maugham, ce même quelque chose de romain et d’impérial (j’entends: de l’empire) qu’on retrouve aussi chez Gore Vidal, et cette même distance qui les sépare tous trois du christianisme. De fait, Bowles paraît complètement étranger à la morale et à la sentimentalité du monde chrétien. C’est un hyper sensitif endurci, avec ce regard implacable de l’enfant qui observe, yeux grands ouverts les paroissiens en train de prier, ou de l’entomologiste, ou plutôt de la mouche scrutant le monde de son oeil à facettes. Cela étant l’observation de Bowles n’est pas innocente. Ce qui l’arrête (et l’excite et le stimule), ces sont les chocs entre nature et culture, ou bien entre modes de vie hétérogènes, entre civilisations opposées, entre sexes, entre divers ages du même sexe.
Nous nous croyons le centre du monde, mais il suffit de parcourir celui-ci pour que nous soit infligé le plus cinglant démenti. Nous croyons avoir conquis la nature, jusqu’au moment où nous tombons entre les mains du présumé bon sauvage, comme il en va du linguiste candide d’En un pays lointain, qui fait figure de symbole. Ce professeur de linguistique, passionné par les variations de langues du Maghreb, et qui fait collection de jolies petites boîtes en pis de chamelle, bon connaisseur par conséquent de ces régions, néglige cependant, lorsqu’il s’en va, seul et de nuit, négocier auprès des redoutables Reguibat, de tenir compte de tout ce qu’il sait d’eux. Civilisé et pacifique, il imagine qu’il va pouvoir “observer” les pillards de plus près. Bon sujet de thèse, n’est-il pas ? Mais voici qu’il touche terre: qu’on l’assaille dès qu’il a mis le pied dans le ravin des nomades, lui coupe aussitôt la langue et le sangle bientôt dans une armure faite de boîtes de conserves, pour en user désormais comme d’un fou. Et le fait est que, finalement, le prof deviendra bel et bien foldingue. Une scène est prodigieuse, dans la nouvelle: lorsque ce malheureux entièrement assujetti, privé de langage alors que c'était sa raison d'être, rencontre un compatriote au cours d'une escale et l'entend parler anglais sans pouvoir lui faire comprendre qui il est ni ce qu'il est de quelque façon que ce soit. On a rarement mieux suggéré l'horreur de vivre en état d'absolue dépendance.
Une fois encore, au demeurant, la préoccupation de Paul Bowles n’a rien de moral. Simplement il observe. Connaisseur des lieux et des gens, il pratique l’understatement comme personne. Ainsi que le relève Gore Vidal, qui le tient pour l’un des plus grands écrivains américains de l’époque en formes courtes, Bowles “parvient à produire ses effets les plus magistraux quand il concentre entièrement son attention sur la surface des choses”. Enfin c’est un poète aux pouvoirs d’évocation saisissants, capable de suggérer tout un monde foisonnant et sauvage tout en restant cristallin, net et tranchant, dur et transparent comme le diamant.
Paul Bowles. Le scorpion (nouvelles). Rivages poche.
A lire aussi: L'écho et Un thé sur la montagne. Rivages poche.




La nouvelle série télévisée romande intitulée Cellule de crise en impose par sa performance technique label suisse. Mais à l’apparence toute lisse, voire froide de ce feuilleton aux situations souvent « téléphonées », heureusement humanisé par l’aura de quelques interprètes, s’oppose la constante et vibrante émotion de The Virtues, merveille du genre à découvrir sur ARTE.
Je me demande souvent ce qui distingue l’art de la fabrication, et j’en reviens toujours à cette conclusion qui vaut pour tous les domaines de l’expression humaine et dans toutes les cultures, qu’un mot dégagé de sa connotation théologique cristallise: la grâce.
La grâce distingue distingue le beau du joli, la grâce distingue le bon du sympa, la grâce distingue le vrai du vraisemblable, la grâce distingue enfin le juste du faux.
Tout cela est évidemment relatif, comme il en va de la distinction du bien et du mal aux yeux du binoclard batave Baruch Spinoza, mais c’est le plus bel exercice, au clavier de l’enfance de tous les âges, que de distinguer les touches noires des blanches, la gradation du do du dessous au do du dessus en passant par l’escalier de la gamme avant de plaquer des accords parfaits selon la technique ou d’esquisser une première mélodie sous l’effet imprévisible de la grâce.
Ce qui distingue l’art de la technique relève de la grâce. Il n’y a pas d’art sans technique, mais l’apparition de la grâce ou sa perception ne relève d’aucune technique, pas plus que ce qu’on appelle l’intuition ou ce qu’on appelle l’inspiration.
Cependant ce discours reste trop abstrait et général. Manque d’exemples et ensuite de nuances. Manque d’objets. Voyons donc ce qu’on a de plus récent, en magasin, aux rayons voisins de la fabrication et de l’art…
Un genre souvent sous-estimé parfois à tort…
Vous, je ne sais pas, mais pour ma part, me prenant peut-être trop au sérieux en tant que «pur littéraire» n’appréciant que le «grand cinéma », je me suis longtemps fait des séries télévisée une idée globalement négative à l’époque des Dallas, Dynasty et autres Urgences.
J’avais tort, et c’est un « grand » du cinéma, du nom de David Lynch, qui me l’a fait découvrir le premier en prouvant qu’on peut faire un film relevant de l’art touché par la grâce, tel Mulholland drive, et ne pas démériter avec une série du genre de Twin peaks.
Paradoxalement, ce n’est pas à la télé, que je ne regarde plus depuis une vingtaine d’années, voire plus (sauf quand je m’embête seul dans les hôtels ou les motels), que j’ai révisé mon jugement en visionnant, depuis quelques années, plus de cent cinquante séries de toutes espèces, mais sur mes divers écrans d’ordinateurs et en ne cessant de prendre des notes, comme il en irait de films d’auteurs ou de livres.
Un excellent conseiller, en la personne de Michael Frei, tenancier de la boutique vidéo lausannoise Karloff (hélas disparue depuis lors) m’a permis d’aller vite au meilleur du genre dont 99% de la production équivaut à de la daube molle selon mes critères.
Cela a commencé avec la mémorable série de docu-fiction intitulée The Wire (Sur écoute) signée David Simon et Ed Burns détaillant en 60 épisodes et sur 5 saisons les multiples aspects de la vie d’une grande ville américain (Baltimore), avec un mélange d’empathie humaine et de perspicacité documentaire qu’on retrouve dans la série des mêmes auteurs intitulé Treme parlant des séquelles de l’ouragan Katrina à La Nouvelle Orléans.
Même si l’on oublie à peu près tout d’une série après l’avoir vue, ce qui nous arrive aussi d’innombrables romans lus, je dois dire que ma connaissance du monde et des gens, des milieux sociaux variés et des sentiments éprouvés par mes semblables s’est pas mal enrichie à la vision de séries aussi différentes les unes des autres que Breaking bad (un chimiste bon père qui réussit un peu trop dans la fabrication de la drogue), de Borgen (une premières ministre danoise et ses tribulations personnelle), de Suits (le micmac des cabinets d’avocats à New York), d’Occupied (récit dystopique d’une invasion de la Norvège par les Russes), de Black Mirror (satire carabinée du monde numérique), de Designated survivor (deux séries américaine et coréenne sur le même thème du remplacement d’un Président victime d’un attentat terroriste par un suppléant improbable), ou plus récemment des mini-séries de premier ordre telles Big Little lies (la maltraitance des femmes) ou The Virtues, pas loin en densité émotionnelle et esthétique d’un chef-d’œuvre de cinéma ou de littérature à la Ken Loach ou à la William Trevor.
Il fut un temps où il eût été inimaginable que la critique littéraire «sérieuse» se penchât sur le contenu des romans dits «de gare» et autres sous-genres du policier et de la science fiction, ou que les spécialistes de cinéphilie accordassent la moindre attention aux feuilletons télévisés.
Or il en va tout autrement aujourd’hui, où le journalisme culturel, plus souvent complaisant qu’à son tour, adapte ses critères à ce qui «cartonne» alors même que la qualité se noie dans la quantité ; mais tout ne va pas pour autant dans le seul sens de la massification et de la facilité, car les techniques se sont affinées et les individualités réellement créatrices – souvent aussi rassemblées en collectifs dans la production des séries – continuent ici et là de nous surprendre, avec des îlots de grâce dans l’océan standardisé.
Une machine rutilante, mais encore ?

Techniquement parlant, la nouvelle série suisse romande intitulée Cellule de crise, à voir ces jours sur la RTS et via Internet, est un objet rutilant qui en jette autant que le jet d’eau de Genève, d’ailleurs omniprésent, sur fond d’âpres reliefs yéménites filmés (il me semble) en Espagne, comme certains westerns. De flamboyantes images extérieures (vues du ciel comprises à drones que veux-tu, comme il en va des séries hollywoodiennes ou bollywoodiennes) en intérieurs clinquants, la Geneva international est là autant que Jedda la saoudite ou Sanaa la yéménite, sans oublier le camp de réfugiés aussi propre sur lui que les stalags de la Liste de Schindler. Cela pour le décor.
Quant au scénario et à sa thématique, combinant la géopolitique et le feuilleton sentimental, il développe un véritable catalogue de «sujets porteurs» qui vont de l’attentat terroriste initial (une peluche explosive tuant le président d’une agence humanitaire en posture de se faire un selfie sympa avec une petite fille) à l’amour lesbien, de la prise d’otages à l’adultère inter-ethnique, de la gabegie politique au Moyen-Orient aux trahisons personnelles pour cause d’arrivisme, de la corruption des pouvoirs (le boss pourri du football mondial) à l’abjection des nuls qu’incarne, tiens, un journaliste relevant de la caricature.
Dans cette mixture de violence géopolitique et de sentimentalité de romance, les thèmes intéressants du projet (notamment la face sombre de l’humanitaire, les jeux de pouvoir multiples et ce que Georges Haldas le Genevois appelait le «meurtre sous les géraniums » se diluent hélas, d’un épisode à l’autre, dans un schématisme politique simpliste, et, pour ce qui concerne les personnages principaux, a priori intéressants et bénéficiant d’interprètes de premier ordre, dans la psychologie la plus superficielle.
Sans une once d’humour et avec des raccourcis narratifs peu crédibles (notamment dans l’imbroglio mélodramatique lié au « terrible secret » du personnage assez tordu qu’incarne André Dussollier, remarquable au demeurant, ou les retrouvailles du clone de Sepp Blatter interprété par Jean-François Balmer et de sa fille cachée au grand cœur humanitaire, campée avec non moins d’intensité par Isabelle Caillat), la mini-série de Jacob Berger (réalisateur) et de ses co-scénaristes François Legrand et Philippe Safir pèche donc, à mes yeux, par manque de sérieux (ou de courage, s’agissant de l’image édulcorée de l’Arabie saoudite) et plus encore de fibre sensible et d’émotion.
Entre douleur pure et beauté du pardon

La découverte, en même temps que celle de Cellule de crise, des quatre épisodes de la mini-série anglaise The Vertues, m’a fait l’effet opposé de celle-là même si le canevas dramatique de départ relève aussi, d’une certaine façon, d’un schéma déjà-vu (l’enfance souillée), notamment dans Mystic river de Clint Eastwood, Philomena de Stephen Frears ou L’Enfance volée de Markus Imhof.
Pour l’essentiel, cependant, comme il en va de tout drame humain ressaisi en profondeur, l’histoire de Joseph, protagoniste de The Virtues merveilleusement interprété par Stephen Graham, ne ressemble à rien tout en revêtant un caractère universel. Le réalisateur Shane Meadows, déjà connu pour This is England, a transcrit dans cette série sa propre douleur longtemps inavouée, restituée ici avec autant de réalisme que de poésie.
Ladite histoire a commencé bien avant que, bouleversé, Jo prenne congé de son petit garçon et de la femme que son alcoolisme maladif a éloigné d’elle, en route pour l’Australie avec le beau-père de remplacement de son fiston: quand, à peu près au même âge que celui-ci, il s’est fait violer par un camarade plus âgé dans l’institution où ses aïeux l’ont casé après la mort accidentelle de ses parents. Fuyant son abuseur et l’internat en question, il s’est réfugié chez une parente de Liverpool et, trente ans durant, sa famille irlandaise le croyant mort depuis longtemps, il n’a cessé de se fuir lui-même sans révéler à quiconque son douloureux secret.

Après le départ de son ex et de son fils, une nuit de biture alcoolique aussi follement joyeuse que désespérée le fait décider de tout plaquer et de regagner l’Irlande du nord où il va retrouver sa sœur mariée à un brave type dont la sœur déjantée, au prénom de Deonna, a vécu elle aussi sa galère en fille-mère de quinze ans dont le gosse lui a été arraché.
Bref: de quoi faire pleurer dans les chaumières ? Bien plus, car, sur fond de mélancolie lancinante (paysages d’une triste beauté à se pendre, et musique de P.J. Harvey à l’avenant), les quatre épisodes, portés par des acteurs d’une formidable vitalité, aussi drôles qu’émouvants, nous arrachent aux conventions stéréotypées des feuilletons pour nous confronter à la vérité vraie de la vie.

Point d’orgue de The Virtues, dont les personnages les plus avariés (le violeur de Jo retrouvé sur son lit de vieux pirate mourant sous un crucifix, et la mère bigote de Deonna) défient toute compassion: c’est pourtant un mouvement final de pardon, dénué de toute suavité convenue, qui en oriente les dernières séquences, rappelant cette grande instance clémente des pièces historiques de Shakespeare, évoqué par Peter Brook dans son éloge du Big Will intitulé La qualité du pardon…
Peter Brook, La qualité du pardon, traduit de l’anglais par Jean-Claude Carrière. Seuil, 2014.
