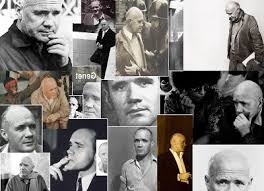À la recherche de Jean Genet, à jamais double, multiple et non moins un,
par JLK
Il est de charitables âmes qui s’inquiètent de ce qu’on puisse récupérer, comme on dit, Jean Genet. Qu’elles se rassurent. Car fût-il récupérable, comme on dit, sur la scène mondaine, Jean Genet s’est échappé depuis toujours de nos estrades et ne nous reste à vrai dire qu’à l’état d’ombre solarisée sur la chaux d’une cellule où se déchiffrent en outre ses quelque mille pages de graffitis sublimes.
Je parle du Genet de Notre-Dames des fleurset du Miracle de la rose, de Pompes funèbres, de Querelle de Brestet du Journal du voleur.Car il y a deux Genet – c’est d’ailleurs lui qui souligne: il y a le Genet inspiré qui a jeté sur le papier, entre 1942 et 1946, le plus souvent en prison, ces cinq éléments d’un prodigieux exorcisme lyrique, et c’est le Genet poète. Puis il y a le Genet argumenteur, le Genet en liberté, le Genet savant, le Genet dialecticien et certes parfois génial (non pas celui du Balconmais celui de L’atelier d’Alberto Giacometti). Bien entendu, l’on trouve du second dans le premier, mais le premier seul est tout à fait possédé, le premier seul funambulise à longueur de pages et sans trace de filet, le premier seul est seul, et c’est d’ailleurs du premier seul que toute sa vie le second se demandera ce qu’il restera ?
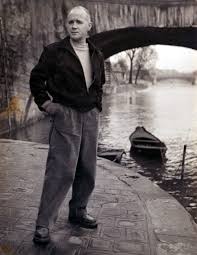
Or à relire par exemple Querelle de Brest, seul vrai roman de Genet et sans doute le plus pur de forme, je m’effarais de ce qu’une fois de plus je n’arrive pas à me détacher de cette histoire sans intérêt de matelot tueur tournant en rond dans cette ville fantôme... Mais c’était de la phrase même que je n’arrivais plus à me détacher. Ce n’était pas tant que je fusse ébloui ou fasciné: plus que le charme de cette incroyable beauté, c’était sa combustion qui me touchait, et je me rappelai alors ce que dit Genet de Dostoïevski à propos des Frères Karamazov. «Humour magistral. Jeu. Mais culotté parce qu’il détruit la dignité du récit. C’est le contraire de Flaubert qui ne voit qu’une explication et c’est le contraire de Proust qui accumule les explications, qui suppose un grand nombre de mobiles ou d’interprétation mais jamais ne démontre que l’explication contraire est admissible. (...) Dostoïevski détruit ce que jusqu’à ce livre on considérait l’ouvre d’art avec affirmation, dignement. Il me semble, après cette lecture, que tout roman, poème, tableau, musique, qui ne se détruit pas, je veux dire qui ne se construit pas comme un jeu de massacre dont il serait l’une des têtes, est une imposture».
Ainsi Querelle qui parodie la candeur canaille des romans populaires et la suavité rigoureuse des traités de morale ou d’apologétique est-il à la fois un bout de feuilleton sordide et son altière négation, une glorification érotique et son retournement sur le vide et la mort, mais également le contraire d’un roman déconstruit. Car il reste un mystère. Pas plus qu’en détruisant l’affirmation, Dostoïevski ne détruit la foi, Genet n’aboutit, en minant le terrain de l’illusion littéraire, à la destruction de la poésie. Les idées de sainteté, de grâce, et plus encore la réalité du mystère et de la beauté faisaient ricaner le vilain Sartre. Mais celui-ci n’a récupéré Genet qu’en partie, et Derrida n’en avait pas fini de tricoter son filet que Genet campait déjà tout ailleurs, figurant définitivement à mes yeux, quoi qu’il fît et pût dire ou écrire, cet homme-humain tel que les Chinois le définissent et que Cingria silhouettait ainsi dans son propre haut langage: «L ’homme-humain doit vivre seul et dans le froid: n’avoir qu’un lit – petit et de fer obscurci au vernis triste, – une chaise d’à côté, un tout petit pot à eau. Mais déjà ce domicile est attrayant: il doit le fuir. A peine rentré, il peut s’asseoir sur son lit, mais, tout de suite, repartir. L ’univers, de grands mâts, des démolitions à perte de vue, des usines et des villes qui n’existent pas puisqu’on s’en va, tout cela est à lui pour qu’il en fasse quelque chose dans l’œuvre qu’il ne doit jamais oublier de sa récupération».

Celle-ci s’oppose antipodiquement, cela va sans dire, à celle dont il était question plus haut, comme le loup sauvage se distingue du chien domestique. L ’œuvre lyrique de Genet figure alors ce saisissant travail de récupération consumante dont il ne reste aucune scorie – au contraire du théâtre et des essais. Ainsi le Genet poète a-t-il tout dit puis il a foutu le camp, fût-il encore et toujours à la recherche de quel grand livre unique à venir.
On voit cela très bien dans le Jean Genetque le romancier américain Edmund White vient de publier après sept ans d’investigations. On voit le gamin blessé à mort quand, le maître d’Alligny-en-Morvan ayant demandé à ses élèves de décrire leur maison, ce qu’il fit mieux que les autres, ceux-ci le désignèrent comme imposteur parce qu’«enfant trouvé». On voit la source de son exil dont procèdent ses fugues et son ressentiment. On voit l’origine du massacre et le besoin réitéré de le vivre et le revivre en fuyant tout établissement et toute relation harmonieuse. On voit à la fois l’exclusion de Genet et sa recherche éperdue d’une famille. On voit l’énorme effort de volonté du jeune Genet pour s’approprier la langue de l’ennemi et le battre sur son propre terrain. On voit le vertigineux désarroi de Genet succédant au jaillissement créateur des cinq premier livres – et la stérilité qui en découle, où la mise en coupe de Sartre n’a qu’un rôle secondaire. On voit l’argumenteur renaître des cendres du phénix poète, et tout à l’opposé de Bataille, qui disait que le premier Genet nous intéresse sans nous passionner, nous pourrions dire alors que le second Genet ne cesse de nous intéresser quand le premier seul nous passionne.
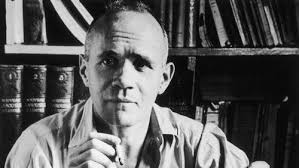
Cela noté, c’est d’un seul Genet que, du récit de White, se dégage la figure, dont nous finissons par admettre et peut-être aimer jusqu’aux traits les plus contradictoires, voire les plus abjects. C’est que là encore, des avatars de l’enfant perdu et de l’adolesent fugueur, du bataillonnaire abruti et du voyageur sans bagages, du délinquant minable et du poète maudit, du faiseur de théâtre ou du penseur fragmentaire, du révolutionnaire transitoire ou du mystique errant, se dégage finalement cette face brûlée et et si vivante d’homme humain qui nous aide à l’œuvre que nous ne devrions jamais oublier de notre propre récupération.
JLK
(Le Passe-Muraille, No 9, octobre 1993)
Jean-Louis Kuffer vous invite à rejoindre le nouveau site numérique du Passe-Muraille déjà riche de plus de 450 textes:
https://www.revuelepassemuraille.ch