
MESSAGERS. - La lecture m’est vitale, et les livres aussi m’arrivent comme des messagers. Pas un hasard ainsi que je trouve, dans les entretiens de Kenzaburo Oé, intitulés L’écrivain par lui-même , ce que je cherchais précisément à ce moment-là.
Le grand écrivain japonais raconte ainsi comment le souci d’attention lui est venu, dès son enfance, et cela rejoint aussitôt ma réflexion actuelle sur l’attention défaillante de la plupart de nos contemporains, éparpillés et distraits par un peu tout et n’importe quoi.
Peu avant sa mort le vieux Maurice Chappaz, allongé sur une espèce de divan russe et couvert d’une capote miliaire, me disait avec son accent valaisan à couper au couteau: « Voyez-vous, ce qui manque vraiment de nos jours, au point que c’en est un péché : c’est l’attention ! »
C’est en m’attardant le long des ruelles du quartier de Kanda, à Tôkyo, où voisinent des milliers d’échoppes de livres essentiellement japonais, que je me suis dit qu’il était merveilleux d’écrire et tout aussi légitime en somme de n’en rien faire, comme je l’ai éprouvé une autre fois dans l ‘Hyper U de Cap d’Agde devant les piles de best-sellers du monde entier, où j’eusse en vain cherché un roman de Oé Kenzaburô en dépit de son prix Nobel…
Ainsi est-ce à partir du moment où l’on entrevoit la totale inanité de l’acte d’écrire, au regard des galaxies ou des multitudes humaines, que la chose devient réellement intéressante et se recharge de sens comme, à Kanda ce même jour, en découvrant, dans telle immense librairie internationale, les milliers d’ouvrages du monde entier accessibles dans toutes les langues, tout Proust en japonais ou tout Kawabata en français…
Au début de ses entretiens avec Oé Kenzaburo, Ozaki Mariko lui cite un de ses poèmes, fameux au Japon, datant de ses dix ans:
« Sur les gouttes de pluie
Le paysage se reflète
Dans les gouttes
Un autre monde se retrouve ».
UN JOUR « SANS ». - Louis Calaferte dans Situation , carnets de 1991 : « Je suis faiblesse dans ce monde de vainqueurs ». Ou ceci à méditer : « Les enfants sont d’abord attentifs à leur sécurité morale ». À distinguer autant de la morale moralisante que de l’immoralisme.
Ou ceci encore : « La poésie, c’est la Joie intérieure, la Force à l’état pur, la Violence de Dieu ». Rien à voir, en effet, avec la poétisation poétique des poètes poétisant en cénacles subventionnés et se remerciant mutuellement d’exister.
Ou cela enfin : « Les doigts entendent » et, cité de Tertullien et me faisant tomber des nues: « Les Tables de la Loi ne sont pas écrites dans la pierre mais dans la nature »
REJET. - Après cinquante pages de L’école des cadavres, je cale et me demande si vraiment je vais m’infliger beaucoup plus de ces éructations contre les « youtres », la France pourrie, la démocratie moisie, l’Amérique encore pire et les Soviets encore plus pires d’ailleurs engendrés par les youtres - et le serpent de la haine de se mordre la queue...
FRISCH. - Dans L’ Esquisse de son troisième journal, qu’il a repris en 1981 après l’achat d’un loft à New York, Max Frisch exprime aussitôt ses sentiments violemment contradictoires à l’encontre de l’Amérique de Reagan (« I LOVE IT / I HATE IT / I LOVE IT / I Don’t KNOW / I LOVE IT»), en affirmant que les USA le font «gerber» (j’aurais plutôt traduit par « vomir », question de génération), cela me ramenant à ce que j’éprouvais l’autre soir en sortant de la projection d’American Sniper, film crédité de pacifisme par certains critiques alors qu’il relance l’idéologie nationaliste armée la plus chauvine et dédaigneuse des autres nations.
Que dirait le pauvre Max s’il revenait en tram bleu sur notre planète orange pour apprendre ce qui s’est passé à New York dix ans après sa mort ? sans parler de la relance impérialiste de Bush et même d’Obama ?
En 1981, il écrit « Ce qu’attendent nos amis américains : un miracle ! Ils veulent être à la fois redoutés et aimés. Si nous n’y parvenons pas, ils considèrent cela comme de l’anti-américanisme ».
Or aujourd’hui, je serais curieux de savoir ce que dirait Frisch du film de Clint Eastwood exaltant le fait d’armes le plus vil (la cible traitée à trois cents mètres de distance, et 300 morts au palmarès du sniper) en réduisant l’adversaire à une horde de sauvages ? Lui qui aimait assez les States pour les critiquer, durement, ne sacrifierait sûrement pas son sens critique au mol consentement actuel qui feint de trouver du pacifisme dans le dernier « film culte « de ce bon vieux Clint si sympa n’est-ce pas…
« RELIGIEUX » ? - Que penser de ce qu’on appelle le «retour du religieux» ? Et d’abord, est-ce un fait avéré ? Qu’observe-t-on en réalité ? Qu’est-ce que ce «religieux» alors que les églises et les couvents se vident ? Les manifestations de masse et les poussées de fanatisme relèvent-ils du «religieux» ? Que penser de tout ça ?
À la fin des années 50, nous nous trouvions, chemises bleues et jambes nues, à chanter crânement autour du feu de camp : «La lutte suprême / Nous appelle tous / Et Jésus lui-même / Marche devant nous/ Que sa vue enflamme / Tous ses combattants / Et soutienne l’âme / Des plus hésitants / Du Christ la bannière / Se déploie au vent / Pour la sainte guerre / Soldats en avant ! ».
Or lequel d’entre nous, aujourd’hui, verserait une goutte de son sang pour la « sainte guerre » ? Et lequel d’entre nous, alors, pensait vraiment ce qu’il chantait ?
SOURCE SUISSE. - La première page de Mon premier livre, tel que nous l’avons pratiqué en première année à l’école primaire, et retrouvé l’autre jour chez un bouquiniste, illustre quatre voyelles (A comme Avion, I comme Iris, O comme Orange et U comme usine), le E étant absent on ne sait trop pourquoi - improbable préfiguration de La Disparition de Perec…
Quant à la thématique dominante, suisse au possible, c’est Nature et Travail, avec l’avion pour aller de l’avant. Ensuite viendront Maman (ma / mi / mo /mu ) et Papa (pa/ pi / po / pu), puis les verbes en page quatre: Papa téléphone et maman tricote. La voyelle E n’arrive qu’en page trois, avec le chien et le soleil…
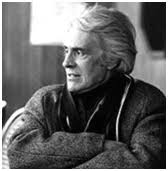
VIEILLIR. - Louis Calaferte dans ses carnets de Situation, en 1991, alors âgé de 63 ans, trois ans avant le grand départ qu’il pressent plus ou moins dans sa carcasse mal en point : « Plus question pour moi de jardiner, à demi impotent que je suis sur mes deux cannes – toute cette beauté printanière m’est tristesse».
Ce qui ne l’empêche pas de noter joliment le lendemain : «La petite pluie serrée grignotait le gravier» .
Mais quelques jours plus tard : «À voir une fois encore toutes ces beauté du printemps, le regret de devoir disparaître à un épais goût d’amertume».
Or j’aimerais ne jamais céder à cette aigre tristesse, même s’il n’est pas de jour où ma carcasse à moi ne grince un peu plus aux jointures, douleurs jambaires et fatigues croissantes, crampes nocturnes et palpitations dès que trop d’alcool dans le sang, souffle en baisse et pertes d’équilibre sur les pavés urbains, déclinant sourdingue et plus capable de rien lire sans lunettes - mais je me rappelle la joie de mon père au jardin alors qu’il en était à sa énième opération, s’excusant presque de tomber mais restant debout d’humeur et de regard, sans se plaindre jamais. Mon père est mort à 68 ans. Je l'aime toujours, mais j'aimerais bien, aussi, lui survivre un peu...
Louis Calaferte : «Toute cette jeunesse en allée… »
Et moi : « Mais non, vieux con : toute cette enfance qui revient »…
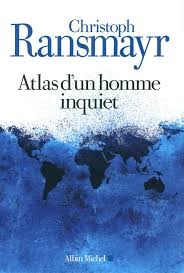
Ce mercredi 8 avril. - En abordant le nouveau livre de Christoph Ransmayr, intitulé Atlas d’un homme inquiet et traduit, garantie de haute qualité, par Bernard Kreiss , tout de suite je me suis trouvé en partance pour le bout du monde, dans les creux vertigineux et sur les lames du Pacifique, direction les îles de Pâques. Ensuite j’ai titubé dans la neige plâtrant le rempart de neuf mille kilomètres de Wànli Chang Chén, quelque part entre Jinshanling et Simatai, où j’ai rencontré ce Mr Fox de Swansea qui se livre là-haut à des recherches sur les chants d’oiseaux, puis je me suis retrouvé sous l’araucaria géant surplombant la tombe ouverte du vieux Senhor Herzfeld, constatant que les graines ruisselant des hautes branches sur les amis réunis figuraient une sorte d’éternité…

J’ÉTAIS LÀ ET JE VIS…. - Christoph Ransmayer dans Atlas d’un homme inquiet, au début de Cueilleurs d’étoiles :« Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego. Alors qu’à l’instant même il paraissait encore très à l’aise avec son plateau chargé de boissons qu’il portait en équilibre au-dessus de l’épaule, l’homme avait trébuché sur un câble reliant la batterie d’une voiture à un télescope guidé par ordinateur. À présent il était couché dans les débris de verres, des bouteilles et des tasses constituant la commande de clients qui s’étaient subitement avisés qu’il valait mieux sortir que de rester collé au bar, ou qui attendaient déjà dehors depuis des heures, debout entre les voitures ou assis sur des chaises pliantes qu’ils avaient pris soin d’emporter, tous occupés à observer à travers les jumelles, au télescope ou à l’œil nu le ciel crépusculaire où scintillaient les premières étoiles ».
Évoquant le tombe d’Homère qu’il retrouve, perdue dans les hauteurs de l’île d’Ios si présente à mon souvenir, Ransmayr écrit ceci encore qui me rappelle la Grèce sous le ciel des Cyclades, telle exactement que nous l’avons connue en nos jeunes années : «À travers le bruissement du vent, j’entendais confusément les si nombreuses voix qui s’étaient élevées au fil des millénaires et jusqu’à aujourd’hui pour affirmer qu’un homme appelé Homère devait forcément être immortel du simple fait qu’il n’avait jamais existé. Nul homme, nul poète ou conteur ne pouvait avoir eu la force d’engendrer à lui seul une foule pareille de héros, de dieux, de guerriers, de créatures vouées à l’amour, au combat, au deuil, nul ne pouvait avoir eu la force de chanter la guerre de Troie et les errances d’Ulysse en usant pour ce faire de tonalités, de rythmes si divers, d’une langue aux nuances si infiniment variées, non, cela ne pouvait avoir été que l’œuvre de toute une théorie de poètes anonymes, d’aèdes qui s’étaient fondus peu à peu en une forme fantomatique baptisée Homère par les générations ultérieures. Dans cet ordre d’idée, un tombeau édifié il y a deux ou trois mille ans sur l’île d’Ios ou sur quelque bande côtière de l’Asie mineure ou du monde des îles grecques ne pouvait être qu’un monument à la mémoire de conteurs disparus. »
Chaque récit de cet Atlas d’un homme inquiet commence par l’incipit m’évoquant la formule «J’étais là, telle chose m’advint», mais c’est ici un « je vis » auquel la traduction française donne le double sens de la vue et de la vie : « Je vis le séjour d’un dieu par 26° 28 ‘ de latitude sud et 105° 21’ de longitude ouest : loin, très loin dans le Pacifique, une île rocheuse prise dans un tourbillon d’oiseaux de mer », « Je vis une silhouette lointaine devant une tour de guet délabrée de ce rempart de près de neuf mille kilomètres de long appelé Wànli Chang Chén – mur inconcevablement long dans le pays de ses bâtisseurs, muraille de Chine dans le reste du monde », « Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant », « Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego », « Je vis une chaîne de collines noires, rocheuses, sur laquelle déferlaient des dunes de sable », « Je vis un taureau de combat noir andalou par un radieux dimanche des Rameaux aux grandes arènes de Séville », « Je vis une jeune femme dans un couloir d’une éclatante propreté du service psychiatrique d’un établissement nommé Hôpital du Danube, un vaste complexe de bâtiments situé à la lisière est de Vienne », et ainsi à septante reprises et en septante lieux de la planète et des temps alternés de la splendeur naturelle et de la guerre des hommes, de la forêt pluviale et d’un chemin de croix, sur une place de village autrichien où un vieil homme qui fait semblant de dormir ne fait pas semblant de mourir, et c’est le monde magnifié malgré le Laos défolié par les bombardiers, c’est l’humanité partout accrochée à la vie : « Je vis une chèvre noire au bord d’un court de tennis envahi par les roseaux », « Je vis un gilet de sauvetage rougeau bord d’un champ d’épaves flottant dans l’océan indien », « Je vis un homme nu à travers mes jumelles de derrière un fourré de buissons ardents poussiéreux où je me tenais caché », « Je vis une femme éplorée dans la sacristie de l’église paroissiale de Roitham, un village des Préalpes autrichiennes d’où l’on avait vue sur des massifs portant des noms tels que monts d’Enfer et monts Morts », « Je vis une étroite passerelle de bois qui menait dans les marais de la mangrove sur la côte est de Sumatra », «Je vis une fillette avec une canne à pêche en bambou au bord de la rivière Bagmati, à Pashupatinath, le secteur des temples de Katmandou », « Je vis des îles de pierres plates émergeant de l’eau lisse du lac Kunming au nord-ouest de Pékin », et chaque fois c’est l’amorce d’une nouvelle histoire inouïe...
Mais où se trouve-t-on donc ? Dans un film de Werner Herzog ou dans un recueil de nouvelles de Dino Buzzati ? Dans un roman de Joseph Conrad ou dans un récit de pêche de Francisco Coloane ? À vrai dire nulle référence, nulle influence, nulle comparaison sont de mise, ou au contraire : des tas de comparaisons et de correspondances, quantité d’images en appelant d’autres et d’histoires nous en rappelant des nôtres, se tissent et se tressent dans ce grand livre hyper-réel et magique à la fois, accomplissant le projet d’une géo-poétique traversant le temps et les âmes, évoquant les beautés et les calamités naturelles avec autant de précision et de lyrisme qu’il module pudeur et tendresse dans l’approche des humains de partout, pleurs et colère sur les ruines et par les décombres des champs de guerre, jusqu’à l’arrivée sur le toit du monde : « Je vis trois moines en train de marmonner dans une grotte surplombant un lac de montagne aux rives enneigées, à quatre mille mètres d’altitude, dans l’ouest de l’Himalaya », etc.
ONFRAY LE JOBARD. - Reprenant hier Bouvard et Pécuchet, je m’esclaffe en retombant sur certaines pages réellement hilarantes, qui me font penser que je suis vraiment tombé pile en comparant Michel Onfray à ces deux jobards.
De fait, la façon du «philosophe», dans Cosmos, de se pâmer devant tel végétal manifestant la volonté de puissance de la nature , ou tel mystère lié à la migration des anguilles, est tout à fait comparable à l’élan des compères découvrant les merveilles du potager et s’exclamant : «Tiens des carottes ! Ah, des choux ! »