Sous les dehors d'un clochard atrabilaire, c'était un écrivain raffiné. À lire, réédité en 1986 : son Journal littéraire, et l’évocation de ses rencontres avec Pierre Perret. Ou encore deux joyaux : Le petit ami et In memoriam. Entre autres…
S’il appartient en somme à la catégorie des grands écrivains mineurs qui ne seront jamais reconnus — mais alors avec passion — que par un nombre relativement modeste de lecteurs, au même titre qu’un Fargue ou qu’un Jouhandeau, qu’un Vialatte ou qu’un Cingria, Paul Léautaud n’en connut pas moins la célébrité de son vivant, et ce presque à son corps défendant, par le truchement d’entretiens radiophoniques avec Robert Mallet dont la diffusion, de novembre 1950 à juillet 1951, obtint un succès phénoménal.
 Presque octogénaire, l’auteur du Petit ami toucha le public, au-delà des seuls cercles littéraires, par sa verve caustique et sa liberté d’esprit, la sincérité sans mélange avec laquelle il parlait de sa vie, et l’alternance de rosserie et d’émotion qui marquait ses propos sur ses pairs les écrivains (de Valéry à Gide, et de Verlaine à Jules Romains) ou sur les animaux, qu’il préférait ordinairement à ceux-là... .
Presque octogénaire, l’auteur du Petit ami toucha le public, au-delà des seuls cercles littéraires, par sa verve caustique et sa liberté d’esprit, la sincérité sans mélange avec laquelle il parlait de sa vie, et l’alternance de rosserie et d’émotion qui marquait ses propos sur ses pairs les écrivains (de Valéry à Gide, et de Verlaine à Jules Romains) ou sur les animaux, qu’il préférait ordinairement à ceux-là... .
Rappelons à ce propos que Léautaud cohabitait en permanence avec une vingtaine de chiens et une trentaine de chats, tous recueillis sur la rue, et qu’il leur a consacré des pages mémorables.
Clarté et naturel
Cela étant, il serait aussi imbécile de se limiter à cette image pittoresque de l’écrivain que de monter en épingle ses pages de libertin, comme s’y sont complaisamment employés d’aucuns l’an dernier, à la parution du Journal particulier évoquant les relations intimes de l’écrivain avec l’indispensable Marie Dormoy ou avec sa maîtresse principale dite Le Fléau. En fait, les « séances » érotiques, assurément très crues (Léautaud, comme toujours, appelle un chat un chat) que l’écrivain consigne dans les marges de son journal, sont plutôt rares, et n’ont d'intérêt que par rapport à l’ensemble de ses observations et, plus encore, à l’économie de son écriture.

« Rien n’a plus de prix pour moi que la netteté, la concision, et c’est si difficile de n’être pas littéraire, le premier mérite à mes yeux », notait- il ainsi tout en reconnaissant qu’il avait « toujours vécu littérairement ».
Un monde en spectacle
Pourtant, que le titre du Journal littéraire de Paul Léautaud n’abuse pas le lecteur, qui lui offre, avec ses quelque 6000 pages, un aperçu de ce que fut la vie a Paris — et non seulement dans le milieu des écrivains —entre 1893 et 1956.
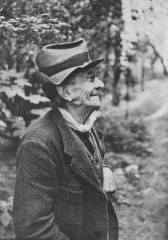
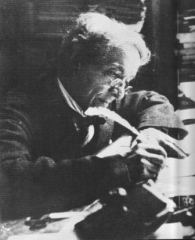
Mais tant qu’à découvrir Paul Léautaud, n’en restez donc pas là. Lisez ses savoureuses chroniques théâtrales (d’admirables pages sur Molière et Shakespeare, notamment), parues chez Gallimard sous le pseudonyme de Maurice Boissard ; lisez Le petit ami, évoquant ses tribulations de garçon abandonné par sa mère ,que les grisettes et les trottins consolent ; enfin lisez illico In memoriam, son chef-d’œuvre qu’il griffonna au chevet de son père à l’agonie, et où l’on trouve la clef de sa personnalité profonde alors que, feignant le cynisme, il observe son paternel "en train de décéder un peu plus"...
 Alceste et Pierrot
Alceste et Pierrot
Pierre Perret avait 20 ans lorsqu’il se pointa, pour la première fois, au portail de la maison délabrée de Léautaud, à Fontenay-aux- Roses. Or il fallait une certaine candeur pour débarquer ainsi chez le vieux misanthrope, d’autant que notre Pierrot lunaire ne connaissait alors, de l’écrivain, que ses fameux « Entretiens ». Cependant sa naïveté, son air pataud et sa ferveur de provincial découvrant Paris, ainsi que leur amour commun de la poésie et du théâtre, auront fait passer aussitôt un courant de complicité entre le jeune artiste et l’écrivain dissimulant son extrême sensibilité sous des allures revêches. À cet égard, le mérite de Pierre Perret est d’avoir perçu, bien mieux que tant de pontes condescendants, que «cet homme pauvre recelait une richesse intérieure insoupçonnée, inconnue de la plupart. Une générosité qu’il dissimulait soigneusement aux yeux de la minorité qui l’approchait. »
La générosité de Léautaud, on la remarque ici dans la curiosité sincère qu’il manifeste envers son jeune visiteur (qui le ravit aux anges en lui révélant les chansons de Brassens) ou quand il l’accompagne un jour dans les librairies du Quertier latin afin del’aider à se constituer un début de bibliothèque.
Hommage amical tout imprégné d’intelligence du cœur, Adieu Monsieur Léautaud est, au surplus, une évocation très vivante de l’écrivain au naturel, sans chichis ni flatterie aucune.
Paul Léautaud, Journal littéraire. Mercure de France, 1986. Entretiens avecRobert Mallet - Le petit ami - In memoriam, Passe-temps, etc. Au Mercure de France.
PierrePerret, Adieu Monsieur Léautaud. Lattès, 1987.
Contrepoint,ce 22 mai 2015.
J’ai découvert le Journal littéraire de Léautaud dans la bibliothèque de la mansarde parisienne que mon ami Germain Clavien m’avait prêtée quelques mois durant, en 1974, rue de la Félicité, dans le quartier des Batignolles. Je gagnais alors un peu de sous en dactylographiant le monumental Journal intime d’Amiel, et je nourrissais une vraie passion pour l’œuvre de Charles-Albert Cingria, qui rencontra maintes fois Léautaud dans le salon de Florence Gould. Si Charles-Albert fut généreux (non moins que lucide) à l’endroit de son pair alcestueux, au point de lui consacrer d’inénarrables portraits (le comparant notamment à une antique tortue broutant sa salade), Léautaud fut plus acerbe,voire injuste, dans son Journal littéraire, à l’égard de ce drôle d’oiseau des îles que figurait à ses yeux Charles-Albert. Après la mort de Cingria, Marcel Jouhandeau évoqua la belle paire qu’il observa lui-même chez dame Gould. Pour ma part, je relis toujours ces trois auteurs avec un égal plaisir.
(Ce texte a paru dans Le Matin en date du 12 février 1987)





