
À propos de la souffrance enfantine filtrée par le Jeune homme de Karl Ove Knausgaard. Un père atrocement normal et la bénédiction du scorpion dans le Judas d'Amos Oz. Qu'une enfance heureuse peut être aussi source de douleur...
S'il est de notoriété universelle que la vérité sort de la bouche des enfants, le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas toujours exprimée et plus rarement encore entendue. On commence certes, dans nos pays moins soumis que naguère à l'omertà des familles et de la société, à écouter les enfants maltraités et les femmes battues, mais une zone reste grise, où la tristesse d'une enfance ne tient pas tant à la brutalité d'un père ou à la méchanceté d'une mère, mais simplement au sentiment lancinant d'un manque d’amour latent ou d’une peur patente, comme celle qui plomba les jeunes années de Karl Ove Knausgaard et de son frère Yngve.
Mais de quoi donc se plaint cet "enfant gâté", comme le qualifiait son père, du genre inflexible, bien-pensant de gauche et ne tolérant pas la moindre contradiction de la part de ses fils ?
On a compris, en lisant La mort d'un père, premier des sept volumes de la monumentale autobiographie romanesque de Knausgaard, que celui-ci et son frère aîné détestaient leur paternel, sans que le portrait de celui-ci ne soit détaillé dans ces quelque 600 premières pages. Or Jeune homme est plus explicite, sans nous proposer pour autant le portrait d'un monstre. Ce qui frappe en revanche, c'est la peur terrible qu'il inspire à l'hypersensible Karl Ove. Parce qu'il le gifle, le pince, lui pique le dos de la pointe de son couteau de cuisine, ou le cogne, le rabaisse ou l’ignore ? Pas seulement. À vrai dire, ses colères froides, sa façon d'humilier l'enfant et de le dominer d'un seul regard tueur ou d'une parole blessante, sont pires que les dégelées d'un paternel brutal mais capable de tendresse.
Nous avons eu, à l’école primaire de Chailly, sur les hauts de Lausanne, un instituteur de cet acabit qui, dans sa blouse blanche immaculée et avec ses cheveux noirs brillantinés, incarnait le maître d’école « sévère mais juste », pratiquant encore l’alternative des mille lignes à recopier ou des coups de baguette, poussant même la rigueur jusqu’à la menace de la fessée à « culotte baissée ». Mon souvenir de ce Monsieur Besson n’est d’ailleurs pas tout négatif, tant il savait aussi nous intéresser à mille choses, mais je lui en voudrai toujours, petite humiliation cuisante, d’avoir accueilli, avec quelle surprise dépitée, la nouvelle de mon examen d’admission au collège réussi, moi qui n’étais que le fils d’un banal employé d’assurances, alors que mon voisin François, rejeton de médecin très en vue, restait sur le carreau contre toute logique sociale, n’est-ce pas…

La force du récit de Jeune homme ne tient pas à la noirceur du tableau, mais à l'accumulation de petits faits mesquins attestant le caractère totalement égoïste et froidement convenable de ce père dénué de toute empathie. Deux exemples : de manière inattendu, le père se pointe dans la chambre du fils en train de se livrer à des patiences, et lui propose de lui enseigner un nouveau jeu de cartes. Et de s’emparer de celui-ci, de jeter les cartes en l’air et d’ordonner au gosse de ramasser. Ou encore, quand Karl Ove emprunte la nouvelle pelle à neige paternelle pour aider son vieux voisin dans un bel élan de charité chrétienne (le garçon a décidé d’être bon dans ce monde méchant), voici le père surgir et injurier son fils coupable d’avoir volé SA pelle, etc. On sait déjà, longuement évoquée dans La mort d’un père, la déchéance finale du personnage, sombré dans l'alcoolisme et crevant auprès de sa propre mère, mais c'est surtout entre les lignes et entre les signes que se forme ici son portrait complété de triste Occidental social-démocrate propre sur lui et glaçant.
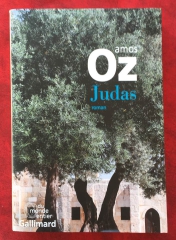 Une enfance plus sombre, à la limite du sordide, fut celle du jeune Shmuel Ash à tête d'homme des cavernes et coeur de tendron, l'un des trois protagonistes du dernier roman d'Amos Oz, sûrement l'un des rares grands livres de cette rentrée d'automne. Or cette enfance, marquée par la mésentente des parents de Shmuel et son confinement dans un corridor moisi lui tenant lieu de chambre, est comme illuminée par un épisode tragi-comique qui rappellera à chacun le confort délicieux de ses convalescences enfantines, quand la maladie fait de vous un roi ou un princesse...
Une enfance plus sombre, à la limite du sordide, fut celle du jeune Shmuel Ash à tête d'homme des cavernes et coeur de tendron, l'un des trois protagonistes du dernier roman d'Amos Oz, sûrement l'un des rares grands livres de cette rentrée d'automne. Or cette enfance, marquée par la mésentente des parents de Shmuel et son confinement dans un corridor moisi lui tenant lieu de chambre, est comme illuminée par un épisode tragi-comique qui rappellera à chacun le confort délicieux de ses convalescences enfantines, quand la maladie fait de vous un roi ou un princesse...
Plus précisément, la piqûre d'un scorpion, à vrai dire assez promptement soignée, pousse l'enfant à s'imaginer mort et recevant l'hommage plein de regrets de ses parents désolés d'avoir été si nuls à son égard, avant le défilé, devant son cercueil, de la parentèle et de ses petites amies également effondrées et repentantes….
« Heureux ceux qui ont souffert étant enfants » écrivait feu mon éditeur et ami Vladimir Dimitrijevic dans la postface dont il gratifia mon premier livre, au déplaisir de notre chère mère qui ne voyait pas en quoi notre enfance avait été souffrante. Or elle avait raison, autant que mon ami qui savait qu'un enfant catastrophiquement sensible peut très bien souffrir dans un environnement stable voire harmonieux.
De la même façon, une enfance objectivement calamiteuse, comme celles de Tchékhov ou de Dostoïevski, ou marquée par la dureté mesquine, comme celles de Jules Renard ou de Knausgaard, peuvent donner lieu à des transposition littéraires « heureuses », dont le petit Marcel Proust, choyé et n'en finissant pas de se délecter de son malheur au fil de la Recherche du temps perdu, est l'exemple inégalable…
Karl Ove Knausgaard. Jeune homme. Denoël, 581p.
Amos Oz. Judas. Gallimard, 347p.