
À propos des monstres d’égocentrisme que sont parfois les écrivains et les artistes, à commencer par Rousseau. Comment l’autobiographie, chez Karl Ove Knausgaard, devient roman à part entière, et non autofiction. Des bas-fonds de Dostoïevski et des petits crabes de Tokyo.
On ne la fait pas aux Anglais pragmatiques qui ont appris, en revenant du tour de l’empire, à se méfier de tous les peuples et de tous les frimeurs, quitte à passer parfois pour des rabat-joie ou des pieds-plats.
C’est le cas de l’historien Paul Johnson, auteur d’une fameuse Histoire du monde moderne, politiquement assez incorrecte, et qui s’est intéressé, avec une jouissance parfois douteuse, aux vices privés et aux vertus publiques d’une douzaine de figures cultes de la pensée et de la littérature contemporaine, dans un ravageur tableau de groupe intitulé Le grand mensonge des intellectuels.
J’y suis revenu en lisant l’autobiographie de Karl Ove Knausgaard, du simple fait que Jean-Jacques Rousseau incarne par excellence l’initiateur du genre en sa forme débarrassée de toute réserve ou pudeur (on est loin des Confessions d’Augustin), poussant parfois l’exhibitionnisme et l’auto-flagellation (de plus ou moins bonne foi) jusqu’à l’hystérie et au scandale, à côtés de quoi l’auteur d’Un homme amoureux paraît un enfant de chœur plein d’égards pour ses semblables.

S’il n’était un merveilleux prosateur, musicien de la langue et incomparable peintre-en-mots, comme le fut un Céline à sa façon, Rousseau ne mériterait, comme individu, que notre mépris. De fait, ce présumé « ami du genre humain » fut un gigolo de la première heure aux manières de rustaud, un opportuniste social prêt à trahir tous ceux qui l’aidèrent, ingrat et se flattant de l’être, se piquant d’éduquer l’humanité entière mais abandonnant tous ses enfants à l’assistance publique sans leur donner même de noms (le premier eut tout de même droit à un numéro), jouant les persécutés alors qu’il fut bien moins inquiété que d’autre tant il était malin.
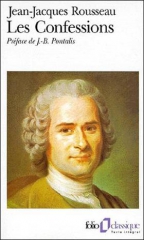
Rousseau, à tout coup, se donne le beau rôle. Même quand il s’accuse de diverses turpitudes, et notamment en matière de sexe, où il innove un prétendu TOUT DIRE qui ne dit pas grand’chose, entre touche-pompon et panpan-cucul, il prend la pose et fait son cinéma, sans beaucoup d’égards pour la vérité (on le sait désormais par de multiples recoupements) mais avec des gesticulations romantiques qui en jettent.
A contrario, alors qu’on a parlé de scandale à propos de Knausgaard qu’une partie de sa famille taxa de Judas, ce qui frappe est l’honnêteté manifeste de son récit où jamais il ne se pose en victime ni en personnage hors du commun, alors même que ce qui le distingue des autres, son combat, sa passion, voire sa folie littéraire, relèvent d’une espèce de devoir sacré.

C’est le soir à Stockholm, Karl Ove est censé rentrer à la maison, il est excédé après avoir passé une heure à « faire tourner les bébés » dans une espèce d’école de rythmique pour tout petits, il fulmine intérieurement après avoir ramené sa fille à la maison et déclaré à sa femme que « plus jamais », il va fumer une clope et voit la merveille de la ville dans laquelle il va se perdre un moment, il pense à son inadaptation à l’époque et à tout ce qu’il a vécu d’extraordinaire en écrivant un livre et après avoir rencontré Linda et vu naître Vanja, il marche dans les rues et se rappelle les heures qu’il a passées sur un banc ou dans un pub avec Dostoïevski qui le met mal à l’aise (il explique pourquoi), il se lance dans une réflexion nourrie par une pensée de Jünger sur le nouvel obscurantisme contemporain, il se rappelle tout à coup (merde !) qu’il a du retard et que sa femme l’attend pour leur soirée de fin de semaine, et voilà qu’il se souvient des premiers de spectacles théâtraux de Bergman qu’il vu avec Linda, laquelle voulait devenir comédienne et qui y a renoncé pour écrire un premier recueil de poèmes, et l’heure tourne, les digressions se multiplient mais pas un instant on en lâche le fil, et c’est la vie qui défile, des bas-fonds de Dostoïevski à cette petite scène énigmatique, vécue à Tôky par Linda alors qu’elle accompagnait une troupe de théâtre, quand un cuisinier japonais choqué par la muflerie des comédiens suédois, “répondit” en offrant, à l’adolescente, un sac rempli de petits crabes vivants...

Pierre Assouline a parlé des livres de Knausgaard comme d’une interminable « lettre à mézigue ». Or Un homme amoureux, pas plus que La mort d’un père, ne relève de la lettre, et moins encore « à mézigue ». Si le « je » de Knausgaard est plus direct que celui du Narrateur de Proust, le moins qu’on puisse dire est que l’auteur ne se cajole pas plus qu’il ne se flagelle ; à vrai dire ce qui importe est ailleurs : dans l’enchantement de ce qu’on pourrait dire, à l’opposé du mentir-vrai d’Aragon, une fiction-vérité ouvrant un véritable espace romanesque.
On y est : comme on est avec le fils en pleurs (une vraie fontaine) dans La Mort d’un père, on est maintenant avec ce père-écrivain un peu emprunté, agacé par les nouveaux codes de comportement « adéquats » du père et de la mère responsables (comme la petite tarde à parler, il faudrait forcément lui trouver un orthophoniste, si possible suédois, et merde !), et parlant sans apprêts de ce qui, précisément, lui semble, dans la vie, dans notre vie, dans les livres et les objets, la lumière sur la ville ou la grâce d’un môme, un enchantement…