
Aujourd’hui s’achève la 63e édition, passionnante, du Festival du film de Locarno. Olivier Père a séduit (presque) tout le monde avec une programmation très contrastée.
« Je connais la plupart des festivals de cinéma, mais Locarno a quelque chose de particulier», déclarait jeudi soir le grand producteur hollywoodien Menahem Golan, gratifié d’un léopard d’or. Et le Mogul aux plus de cents films de saluer la salle archicomble de la FEVI, et de se féliciter que tant de jeunes y soient présents.
Or, la fraîcheur de la jeunesse a bel et bien caractérisé la programmation de cette première édition conçue par Olivier Père. Des films de la Piazza Grande jouant avec les genres prisés par la nouvelle génération (zombies de Rammbock, fantastique de Rubber ou science fiction romantique de Monsters), aux premiers longs métrages de jeunes réalisateurs en compétition (La Petite chambre, Songs of Love and Hate, Beyond the Steppes), le goût du public jeune a été intégré, sans qu’on sacrifie pour autant au « jeunisme » débile ou conformiste.
« Trop pointu, trop élitaire », ont protesté certains confères tessinois. « Moralement indéfendable », a-t-on même lu à propos de L.A.Zombie de Bruce LaBruce, avant qu’une partie du public ne siffle Homme au bain de Christophe Honoré pour ses scènes de sodomie ou que d’autres ne conspuent Bas-fonds, le premier film lesbien trash d’Isild Le Besco.
Pourtant, réduire l’ensemble de cette édition à ces bémols, alors même qu’elle a été allégée de ses anciens appendices les plus élitistes, paraît injuste. Certes exigeante, la programmation d’Olivier Père a drainé un public très dense dans toutes les salles, jouant sur l’éclectisme et les contrastes.
Un festival des gens
Avec beaucoup d’enjouement dans ses présentations, Olivier Père a su accueillir Chiara Mastroianni, Alain Tanner, Nicolas Lubitsch ou Menahem Golan, entre autres, et séduire le public avec une maîtrise parfaite des langues assez rare chez nos amis de l’Hexagone. Du glamour absolu de Lubitsch, dont la fabuleuse rétrospective sera reprise sous peu à la Cinémathèque de Lausanne, au bouleversant Karamay, de XU Xin, nous plongeant au cœur d’une tragédie chinoise contemporaine, Locarno a été une fois de plus un festival de (re)découvertes. Plus encore : il confirme sa vocation de festival des gens, et de tous les âges, aimant le cinéma sous toutes ses formes.
Un autre phénomène, significatif des difficultés rencontrées par le cinéma d’auteur contemporain, a été mis en exergue cette année par des films réalisés avec peu de moyens, tels Monsters (15.000 dollars) ou Beyond the Steppes de Vanja d’Alcantara(1 million et demi d’euros pour une mini-épopée en Asie centrale) dont l’exemple de Lionel Baier, avec le superbe poème cinématographique de Low Cost (Claude Jutra), réalisé en trois mois sur son téléphone portable, constitue l’exemple extrême. Puisse l’Office fédéral de la culture ne pas en tirer de conclusions…
Bref, de Maire en Père, le Festival de Locarno n’a pas sacrifié le « bébé » en changeant l’eau du bain…
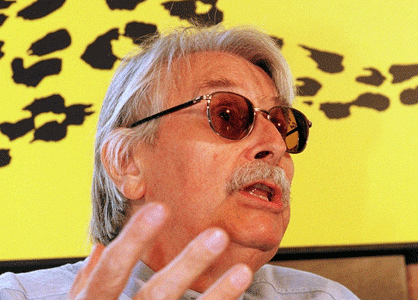


 Road movie dans la déglingue
Road movie dans la déglingue Un cynisme gracieux
Un cynisme gracieux