
Les incantations de Sappho, portées par la voix sublime d’Angélique Ionatos
Le grand art consiste parfois à sublimer les maux de ce bas monde, et c’est à quoi s’est vouée Angélique Ionatos à la première de Sappho de Mytilène, son spectacle dédié tout entier à l’antique poétesse grecque, palliant l’impossibilité de chanter de Katerina Fotinaki pour cause de pharyngite, et la défaillance d’une de ses guitares… Or le public, sans besoin d’aucune «indulgence », a fait un triomphe à cette extraordinaire traversée des millénaires sur les ailes de la beauté pure, où le verbe étincelant de Sappho (adapté en grec moderne par Odysseus Elytis) et les mélodies à la fois suaves et sauvages de la « démoniaque » Angélique, la voix et la présence expressives de celle-ci, et quatre musiciens complices de grand talent se sont fondus en parfaite symbiose.
« J’écris mes vers avec de l’air/Et on les aime/J’ai servi la beauté/Etait-il en effet pour moi quelque chose de plus grand ?/Même dans l’avenir/Je le dis/On gardera de moi le souvenir »… Telle est la « lettre » que rédigeait dame Sappho il y a de ça 2500 ans et des bricoles, qui nous arrive dès le premier morceau (Aérion épéon archomai) de cette suite lyrique faisant alterner douceur extrême et violence, sensualité et mystère, allégresse et fureur, tendresse maternelle (Cléis) ou lancinant érotisme (Pali pali o érotas).
Quinze après sa création, dont une trace enregistrée témoigne, Sappho de Mytilène revit ici avec une palette instrumentale élargie (où s’accentuent l’exubérance orientalo-balkanique autant que les modulations les plus dépouillées) qui doit beaucoup aux talents en fusion d’Henri Agnel (cordes pincées et percussions) et de son jeune fils Idriss (étincelant percussionniste), du clarinettiste Bruno Sansalone et de Katerina Fotinaki à la guitare, à laquelle les dieux seraient avisés de rendre sa voix pour un surcroît de beauté…
Lausanne-Renens. Théâtre Kléber-Méleau, jusqu’au 17 décembre, à 19h (me-je), 20h.30 (ve-sa) et 19h-30 (di). Relâche lundi et mardi. Durée : 1h.30. Location : 021 / 625 84 29 et 021/ 619 45 45
Angélique Ionatos et Nena Venetsanou. Sappho de Mytilène. CD Auvidis/Chorus.
-
-
Tout est foutu, sauf la vie…

Jean-Louis Hourdin et François Chattot chantonnent les lendemains qui déchantent…
S’il est de notoriété millénaire que l’homme est un loup pour l’homme, ce n’est qu’avec l’avènement du communisme réel qu’il est devenu « camarade loup », comme l’écrivait Alexandre Zinoviev, alors que l’homme mondialisé incarne le prédateur à calculette débarrassé de ses vieux complexes.
« Nous avons trop longtemps été des hommes tourmentés par l’humain», s’exclame ainsi le loup « partenaire » du Marché, ainsi que le singent Jean-Louis Hourdin et François Chattot dans un spectacle didactico-burlesque assez épatant, à quelques (brèves) longueurs près, retraçant un siècle et demi de révoltes et de révolutions, par les voix du romantique libertaire Georg Büchner et du dramaturge-poète Bertolt Brecht, en passant par Marx et Engels.
« Nous sommes entourés d’assassins. Nous ne pouvons plus continuer le geste théâtral comme nous l’avons fait jusqu’ici », expliquent les compères Hourdin et Chattot, appelant de leurs vœux «des pratiques nouvelles, avec la rage et la joie au ventre d’amorcer, peut-être, le chemin de nouvelles fraternités (…) » Fort heureusement, le spectacle qu’ils proposent ces jours à Vidy est à la fois plus léger et plus fou que cette déclaration d’intention, tissé de ritournelles chantonnées et de phrases assassines en constant contrepoint avec les textes choisis. Quant à la forme, qui en appelle à la complicité du public en deux lieux successifs (place publique à l’allemande pour Büchner ronéotant des pages de son Messager hessois et les distribuant aux spectateurs debout ; salle de répétition au plancher-planisphère pour la saga marxo-brechtienne à marionnettes très expressives), elle rappelle un peu les belles heures du théâtre politique des années 60-70, entre Avignon et Nancy...
Pour ce qui est des textes cités, ce qui frappe est l’actualité saisissante de certaines pages de Marx, dont la tournure épique frise parfois la poésie, notamment quand il parle de l’argent et du monde froid de l’économie, en rupture avec la chaleureuse société des hommes. Cela étant, c’est bel et bien leur mise en théâtre, et leur prolongation satirique originale (on pense à des émules de Kraus ou de Tucholsky brocardant l’OMC ou le socialisme devenu « bourgeois pour l’intérêt de la classe ouvrière ») qui fait la qualité et l’originalité de ce spectacle de cabaret politico-panique.
Théâtre de Vidy, salle de répétition : « Veillons et armons-nous de pensée » Jusqu’au 17 décembre. A 19h.30 sauf le dimanche (18h.30) Relâche le lundi. Durée : 1h.30. Location : 021/ 619 45 45. www.theatrevidyCet article a paru ans l'édition de 24Heures du 7 décembre 2006. Photo: Mario del Curto
-
Politiquement incorrects

Du Cauchemar de Darwin au franc-tireur Peter Handke
Deux livres viennent de paraître, également intéressants, sans rien de commun apparemment sinon qu’ils dérogent au confort intellectuel des bien-pensants. Discutables ? Peut-être mais surtout : à discuter. De François Garçon : Enquête sur Le cauchemar de Darwin. De Peter Handke : Le Voyage en pirogue ou la pièce du film de la guerre.
Nul besoin de présenter Le cauchemar de Darwin : ce fut le choc du cinéma documentaire, ou supposé tel, de l’année 2005. Dans une fresque saisissante, ce film d’Hubert Sauper révélait le trafic monstrueux, typique du pillage du tiers monde, consistant à rafler de pleins avions de perche du Nil, poisson artificiellement implanté dans le lac Victoria, en Tanzanie ravagée par la faim et le sida, en échange d’armes destinées à alimenter les conflits de la région. César du meilleur premier film, nominé aux oscars, gratifié de recettes mirobolantes pour le genre, ce film est devenu « culte » pour nombre d’altermondialistes, entre autres, qui y voyaient l’exemple du manifeste « citoyen ».
Or voici qu’après avoir écrit, début 2006, un premier article dans Les Temps modernes incriminant l’honneteté intellectuelle de ce film, et lançant une polémique suivie de plusieurs investigations (de Libération et du Monde, notament) sur le terrain, l’historien François Garçon, bon connaisseur du cinéma, s’est lancé dans une vaste enquête en Tanzanie sur les conditions de réalisation de ce film, révélant de drôles de procédés, pour parler gemtiment.
Une cause, estimée bonne, autorise-t-elle les manipulations et les falsifications au détriment de la réalité ? C’est ce que beaucoup ont semblé accepter de la part du cinéaste. Or l’enquête de François Garçon porte à penser que, loin d’aider les Tanzaniens, Sauper, se bornant à les utiliser de façon souvent douteuse, ne vise qu’à flatter la bonne conscience d’Occidentaux qui, de la Tanzanie réelle, se contrefoutent…
Sans prétendre détenir la vérité dernière, François Garçon ouvre un débat qui mérite d’être abordé sans hystérie, qui pourrait d’ailleurs s’étendre à l’objectivité prétendue d’autres « documentaires » à succès du genre de ceux de Michael Moore, ou, de plus sinistre mémoire, aux reportages scandaleux de la série Mondo cane de Jacopetti...
Revoyons-donc Le cauchemar de Darwin, lisons le livre de François Garçon et parlons-en en connaissance de cause… Génocide platonique ?
Génocide platonique ?
Autre sujet de controverse : Peter Handke. Jugé d’avance par d’aucuns, sous prétexte qu’il a montré trop de complaisance envers les Serbes, Peter Handke, interdit de Comédie-Française pour les mêmes raisons, réapparaît aujourd’hui par le truchement d’une grande pièce de théâtre dont la guerre balkanique est le sujet, montée en 2005 au Burgtheater de Vienne, dûment fustigée par les médias autrichiens et donnée aujourd’hui en traduction à La Différence avec une longue non moins qu’excellente préface d’Eryck de Rubercy, sous le titre Le voyage en pirogue ou la pièce du film de la guerre.
« Le thème de cette pièce est difficile à définir », déclare Peter Handke lui-même dans les propos recueillis (en postface) par Chantal Meyer-Plantureux, « il ne s’agit pas que de la Yougoslavie même s’il y a des situations précises qui renvoient aux Balkans. Cette pièce pose des questions universelles : Où est mon pays ? Qui vit dans mon pays ? Est-ce vraiment mon pays ? A qui est ce pays ? Qui est mon ennemi ? Qui est mon ami ? Qui est mon voisin ? Evidemment, ce que j’avais sous les yeux, lorsque j’ai écrit cette pièce, c’était la Yougoslavie, ce pays malheureux. Pourquoi ne pas le dire, cette pièce, c’est l’expression de ma douleur… »
Comme l’indique son titre, ladite pièce met en scène… la mise en scène d’un film sur la guerre balkanique entrepris conjointement par deux grands réalisateurs occidentaux, l’Américain O’Hara (on pense à John Ford) et l’Espagnol Machado (on imagine Bunuel), dix ans après les faits. Le spectacle de la guerre, les multiples récits de la guerre (par le présentateur, le chroniqueur local, l’historien) et les multiples commentaires autorisés sur la guerre (notamment par les « internationaux » d’un tribunal spécial) s’entrecroisent dans une vaste et chaotique représentation que traversent d’autres personnages épiques (le coureur des bois, la femme en peau d’ours ou le poète) sur fond de tragédie dont les aboutissants relèvent toujours du pur gâchis.
Mais peut-on entendre Peter Handke ? N’est-il pas jugé d’avance ? Classé génocide platonique une fois pour toutes ?
En attendant qu’un théâtre ose relever le défi de monter cette pièce à la fois percutante et passionnante, osons au moins la lire, et parlons-en…
François Garçon. Enquête sur Le cauchemar de Darwin. Flammarion, 265p.
Peter Handke. Le voyage en pirogue ou la pièce du film de la guerre. La Différence, 141p. -
Un regard insoutenable
De Truman Capote à Jonathan Littell
La scène la plus forte, et la plus émouvante aussi, du film récent consacré à Truman Capote, est celle où l’on voit l’écrivain obtenir enfin, après des années de présence et d’écoute, l’aveu de Perry Smith, l’un des deux tueurs, sur ce qui se passa réellement, d’instant en instant, durant la nuit où lui et son acolyte massacrèrent quatre innocents pour les dépouiller de moins de 50 dollars.
Perry Smith, métis de mère indienne, est celui des deux tueurs qui avait la plus riche sensibilité et le moins de raisons de tuer les Clutter. Or c’est bien lui qui les a égorgés et fusillés, comme il le détaille à Truman, après avoir décidé de les laisser tranquilles tandis que son acolyte, le très primaire et très écervelé Richard, cherchait partout les 10.000 dollars supposés planqués dans la ferme de Clutter. Et ce que Perry précise, c’est que c’est le regard du père, en lequel il a identifié un homme gentil plus que le riche fermier qu’on lui avait décrit, ce regard d’honnête homme appelant la pitié, ce regard qu’il n’a jamais vu à son propre père, qui l’a soudain affolé et l’a fait basculer dans la panique et la folie meurtrière.
Cette confrontation avec l’insoutenable regard de l’innocence, Max Aue, protagoniste des Bienveillantes de Jonathan Littell, l’a observée et vécue personnellement au fil des « actions » auxquelles il a participé, où il a vu des pères de famille, des jeunes gens cultivés et délicats autant que lui, des officiers et des soldats ordinaires « péter les plombs » et devenir des brutes sanguinaires en voyant simplement cela: ces hommes nus et ces femmes sans défense, cette jeune fille que Max exécute soudain ou ces enfants qu’on éventre pour ne plus endurer leurs pleurs…
Reprocher à Jonathan Littell de se complaire dans ces scènes me semble aussi injuste et vain que tous les reproches adressés à Truman Capote, invoquant le penchant de celui-ci pour Perry Smith ou le rôle qu’il a joué dans les recours et les sursis préludant à l'exécution des deux tueurs. Capote en a –t-il pincé pour Perry Smith, qui était beau et avait eu une enfance de misère rappelant à Truman la sienne ? C’est plausible mais ne compte guère à côté de l’extraordinaire effort de recomposition que représente De sang froid, étant entendu que l’écrivain a écouté tous les acteurs et scruté tous les détails de tout le décor. De la même façon, Jonathan Littell a ressaisi sa matière documentaire avec une prodigieuse minutie et un souci de faire parler les faits qui rappelle le « roman-vérité » selon Truman Capote. Littell n’est pas pour autant « le nouveau Capote », pas plus que son livre ne s’apparente aux Maudits de Visconti ou à La guerre et le paix de Tolstoï.
Son livre se suffit à lui-même, dont il ne faut parler, une fois pour toutes, qu’après l’avoir vraiment lu: telle étant aussi bien la lecture-vérité… -
Coups de coeur
Les choix de 3 libraires
Maryjane Rouge
Librairie Payot, Lausanne
 Deon Meyer. L’âme du chasseur. Traduit de l’anglais (Afrique du sud) par Estelle Roudet. Points Seuil, 472p.
Deon Meyer. L’âme du chasseur. Traduit de l’anglais (Afrique du sud) par Estelle Roudet. Points Seuil, 472p.
«Ce thriller politique est mon coup de cœur ! Très intéressant par son aperçu de la nouvelle réalité sud-africaine, après la fin de l’apartheid, où l’on voit qu’il y a encore beaucoup à faire en matière d’égalité raciale et de justice, il est en outre superbement écrit. Le protagoniste, surnommé P’tit, est en réalité un immense gaillard qui fait figure de héros malgré son passé de tueur des services spéciaux. Au moment où il a décidé d’assagir, amoureux et en charge du gosse de son amie, voilà qu’on l’appelle au secours, et c’est reparti… »
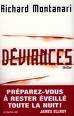 Richard Montanari. Déviances. Traduit de l’américain par Fabrice Pointeau. Le Cherche-Midi, 470p.
Richard Montanari. Déviances. Traduit de l’américain par Fabrice Pointeau. Le Cherche-Midi, 470p.
«Tous les ingrédients du polar noir haletant se retrouvent dans cette histoire de serial killer à délire mystique, dont la première victime est une adolescente retrouvée mutilée et en posture de prière. Cela se passe à Philadelphie, où un flic un peu rétamé et bordeline enquête avec la jeune Jessica, laquelle assure « un max ». Très bien construit et d’une écriture non moins convenable, ce roman intéresse à la fois par son aperçu des dérives violentes de la religion et par ses personnages, réellement attachants. »
 Henning Mankell. Le retour du professeur de danse. Traduit du suédois par Anna Gibson. Seuil policiers, 410p.
Henning Mankell. Le retour du professeur de danse. Traduit du suédois par Anna Gibson. Seuil policiers, 410p.
«Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas l’enquêteur favori de l’auteur que nous retrouvons ici, mais un jeune inspecteur angoissé par le cancer qu’on vient de déceler chez lui. A cette mauvaise nouvelle s’ajoute celle de l’assassinat d’un ancien collègue, sur lequel il va enquêter pour se trouver bientôt plongé dans le milieu glauque des anciens nazis et de leurs émules actuels, avec un deuxième crime corsant encore l’affaire. Mêlant suspense et investigation sur un thème de société, Henning Mankell nous captive une fois de plus… »
Claude Amstutz
Librairie Payot, Nyon.
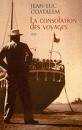 Jean-Luc Coatalem. La consolation du voyageur. Livre de poche, 181p.
Jean-Luc Coatalem. La consolation du voyageur. Livre de poche, 181p.
«Le double intérêt de ce livre tient aux contrées qu’il évoque, des Indes aux Marquises ou de Turquie en Bretagne, entre beaucoup d’autres, et aux écrivains qui « accompagnent » l’auteur dans ses pérégrinations, tels Rimbaud ou Cendrars, Loti ou Segalen. Cette double bourlingue nous fait croiser le sillage des mutins du Bounty autant que Paul Gauguin en ses îles, au fil d’un récit littéraire agréable de lecture et très bien écrit, où la réalité est souvent ressaisie par le petit bout de la lorgnette ».
 Antoine Blondin. Mes petits papiers. Chroniques et essais littéraire. La Table ronde, 423p.
Antoine Blondin. Mes petits papiers. Chroniques et essais littéraire. La Table ronde, 423p.
« Ces chroniques ont valeur de fresque d’époque, qui recouvrent la deuxième partie du XXe siècle et sont marquée par le ton très personnel et la « patte » de ce marginal mélancolique qu’était l’auteur d’Un singe en hiver. A ce propos, il revient ici sur les reproches qu’on lui a faits d’exalter l’alcoolisme, avec des nuances aussi malicieuses que justifiées. L’amitié (pour Marcel Aymé, Roger Nimier ou René Fallet) va de pair avec la liberté d’esprit, comme lorsqu’il s’en prend à la haine des « justiciers » de l’épuration. »
 Penelope Fitzgerald. L’affaire Lolita. Traduit de l’anglais par Michèle Levi-Bram. Quai Voltaire, 172p.
Penelope Fitzgerald. L’affaire Lolita. Traduit de l’anglais par Michèle Levi-Bram. Quai Voltaire, 172p.
« Il vaut la peine de redécouvrir ce roman datant des années 50 dont les observations vives, voire féroces, contrastent avec son écriture un tantinet fleur bleue. Il y est question des tribulations d’une veuve qui ouvre une librairie dans la province anglaise, suscitant la réprobation croissante des gardiens de la conformité vertueuse, et notamment lorsque éclate le scandale lié à la publication du Lolita de Nabokov. Comme on dit que son chien a la peste pour le noyer, tout est bon pour couler la librairie en question… »
Nicolas Sandmeier
Librairie du Midi, Oron-la-Ville
 Kent Haruf. Les gens de Holt County. Traduit de l’américain par Anouk Neuhoff. Robert Laffont, 409p.
Kent Haruf. Les gens de Holt County. Traduit de l’américain par Anouk Neuhoff. Robert Laffont, 409p.
« On retrouve ici les deux vieux frangins du précédent Chant des plaines dans leur ferme perdue du Colorado, après l’épisode qui les a vus accueillir une jeune fille-mère, laquelle est repartie vivre de son côté. La mort d’un des frères est l’événement central de cette suite, qui verra réapparaître la jeune fille auprès du frère survivant. Par ailleurs, l’auteur brosse un tableau plein de relief de la société provinciale, en s’intéressant surtout aux plus démunis dont il détaille de beaux portraits. »
 Andréi Guelassimov. L’année du mensonge. Traduit du russe par Joëlle Dublanchet. Actes Sud, 378p.
Andréi Guelassimov. L’année du mensonge. Traduit du russe par Joëlle Dublanchet. Actes Sud, 378p.
« Le protagoniste de ce roman est un traîne-patins qui se fait virer de la multinationale moscovite où il travaille, dont le boss le récupère aussitôt pour qu’il s’occupe de son jeune fils trop sage, qu’il aimerait encanailler. Le rapport entre le tuteur et son pupille sera marquant pour celui-là plus encore que pour celui-ci, jusqu’à ce que se pointe une femme évoquant Audrey Hepburn. Sur fond de nouvelle société russe, l’auteur de La soif entraîne ses personnages dans de nouvelles virées très arrosées… »
 Javier Cercas. A la vitesse de la lumière. Traduit de l’espagnol par Elisabeth Beyer et Aleksander Grujicic. Actes Sud, 286p.
Javier Cercas. A la vitesse de la lumière. Traduit de l’espagnol par Elisabeth Beyer et Aleksander Grujicic. Actes Sud, 286p.
« Après son premier roman à succès, Les soldats de Salamine, Javier Cercas endosse ici son propre rôle en se rappelant un séjour qu’il a fait, dans sa vingtaine, aux Etats-Unis où il a été marqué par la rencontre d’un certain Rodney, ancien du Vietnam qui l’influence notamment par les étonnantes considérations qu’il développe sur la création littéraire, avant de disparaître soudain. Revenu en Espagne, le jeune auteur, auquel son succès donne la « grosse tête », va retrouver par hasard son mentor et en nourrir une réflexion lucide sur sa vie ».
-
Poète de l'instant
Hommage à Pierre-Alain Tâche. Une exposition et un nouveau livre marquent 40 ans de poésie.
« Le poète est un jeune homme aux cheveux blancs, il est myope avec de gros yeux et il y a toujours quelqu’un qui vient de marcher sur ses lunettes », notait Roland Dubillard dans ses carnets, et cette image nous est revenue en lisant Roussan de Pierre-Alain Tâche, qui vient de paraître en même temps qu’un bel hommage est rendu au poète lausannois au palais de Rumine.
On nous objectera que rien, au premier regard, ne rapproche le jeune poète de Dubillard et le digne Pierre-Alain Tâche, figure éminente de la poésie romande qu’on pourrait dire le double héritier de Gustave Roud et de Philippe Jaccottet, dont le personnage de notable bien établi, magistrat en retraite, n’a guère du bohème à lunette fendues.
Or à y regarder de plus près, sans fard social, c’est bel et bien le poète frais émoulu que nous retrouvons dans ce que nous préférons des fusées lyriques de ce Pierre-Alain Tâche qui, il y a quarante ans de ça, avec Greffes puis La boîte à fumée, incarnait le jeune poète à nos yeux adolescents. Depuis lors, l’écrivain régulier a produit son œuvre, riche aujourd’hui d’une trentaine de titres. Or sa poésie, à travers son évolution vers moins de fioritures précieuse et plus de simplicité, a conservé cette fraîcheur du verbe à sa source (laquelle a des cheveux d’écume blanche et des éclats de lunettes en miettes) qui se joue des âges.
D’un recueil à l’autre, Pierre-Alain Tâche a cartographié, bien au-delà de nos régions, une géographie poétique qui sait ressaisir le génie du lieu (autant que Charles-Albert Cingria, Michel Butor ou Jacques Réda) et magnifier l’instant vécu. De notre Cité lausannoise à l’île d’Orta ou, dans Roussan, des bleus salés-sableux de Vindilis (Belle-Île-en-Mer) à tel jardin perdu d’une enfance ou à telle maison close de Semur-en-Auxois, le poète nous lave le regard au fil de mots comme rénovés. Francis Ponge disait qu’il prenait les objets du monde pour les réparer dans son atelier. Tâche s’y emploie lui aussi, avec une sorte d’enjouement amoureux et de gravité légère. Tantôt limpide et tantôt baroque, ludique ou pensive, musique et peinture en contrepoints subtils, la poésie de Pierre-Alain Tache est éloge serein. D’aucuns lui reprocheront d’ignorer l’effondrement des tours de Manhattan. C’est que son horloge est réglée sur le temps des forêts qui repoussent, dont les allées résonnent comme celles de cathédrales…
Pierre-Alain Tâche. Roussan. Empreintes, 109p.
Lausanne. Palais de Rumine. Pierre-Alain Tâche, une poétique de l’instant. Exposition, jusqu’au 31 mars 2007.
