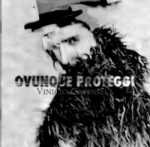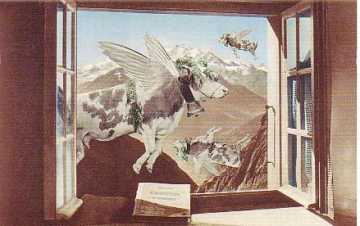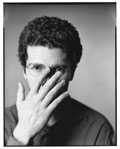 Quartier général du bruit, de Christophe Bataille
Quartier général du bruit, de Christophe Bataille
« Pourtant la langue d’or échappe aux vers », écrit ici Christophe Bataille. « Les follets dansent au cimetière. Ça crépite. Ça grimace. »
Tout est perdu fors les mots : «Je songe qu’au moins, pour la forme et les larmes qui montent en moi, brûlantes, dangereuses, il me reste comme à l’enfant un carquois de ferraille fouaillant le monde, l’histoire, le spectacle, la beauté, le diable et l’empire, pour vous abolir puis vous rédimer, car il le faut, vous tous. Vous ? Mais qui ? Mais quoi ? Les mots »…
Ainsi s’achève, à coups de mots cinglants et cinglés, ce Quartier général du bruit qui rend le son noir et sonore, fringant, canaille en élégance, d’une aventure qui est celle à la fois de la passion de faire des livres et de les lire, de la littérature et du commerce tel que l’incarna le surnommé Patron, prénom Bernard comme l’ermite ou le saint mais en plein Paris faisandé où il régnait dans son bain de la rue des Saints-Pères, son nom étant Grasset et l’une des formules de son goût : « L’édition, c’est l’électricité + les mots ».
Dans la partie électrique de la syntaxe et du vocabulaire Bataille est ferré à bloc, parfois un peu trop porté sur l’effet à mon goût mais enfin : vieille passion française. Dès la phrase deuxième la « Seine cruelle » est dite « serpe de limon » et ça craint, comme on dit, mais la suite prouvera que le sujet mange tout, à la lettre, jusqu’au cadavre et au papier du testament : « C’est le destin des livres, cette longue course d’une eau à une eau chiffonnant le crâne de l’enfant mort, le corsage d’une jeune fille, les nuits mauvaises ».
Le destin, la vie des livres, le petit et le grand négoce, l’esthète et le requin, le squale lettré à moustache imitant celle du Kanzler Hitler et prenant son bain entouré de putains qui écrivent ou salivent, tout cela kif kif : « C’était le même mouvement : une grande passion humaine, et un grand mépris ».
De grands voyous à la ville et de petits saints au coin de la cheminée, avec pour Grasset quelques séjours de repos au milieu des toqués à Meudon, d’un fou l’autre : tels sont les grands éditeurs, et Gaston Gallimard passe au cocktail, « beau à damner un ange », flanqué de sa « poule inouïe », ou là-bas c’est Pétain « vert et sucre » ou encore on reconnaît Godfather le marchand d’armes embusqué à Lausanne (on est vers 1934), et passent aussi les ombres non moins archangéliques de ces salopes de Proust et de Céline…
C’est l’éternel factotum de l’éditeur, le double damné qui partage manuscrits, maîtresses et mépris du maître, ici nommé Kobald, qui tient le fil du récit. Bataille s’avançant masqué ? On peut le penser tout en laissant le roman se faire sur deux temps en un même mouvement : « J’aimais ce métier de lire. Lire sans fin, le jour, la nuit. Comme cogneraient les décors à coulisse, lire et chercher, fébrile, porter chaque soir son lit de papier, barque serpentine, mastaba, jonque, sarcophage. Et l’œil sale au matin méditer le motto : Regarde longtemps les abîmes ».

-
-
Sur les pas de Robert Walser
Une promenade à Herisau
par Fabio Pusterla

Il y avait eu un précédent, déjà, qui aurait dû me mettre en garde. Quelques années plus tôt, durant un bref séjour au Piémont, l’un d’entre nous avait lancé l’idée de se mettre à la recherche de la tombe de Cesare Pavese, dans un cimetière proche. Et pourquoi pas ? Suivit alors une ample virée par les montueuses collines automnales, jusqu’au village en question. Mais le cimetière ? Les passants se contredisaient, nous envoyant d’abord d’un côté, puis nous expliquant que non: qu’il faudrait plutôt rallier l’autre bout du village. Or nous voici devant l’enceinte des défunts. Nous entrons donc, déchiffrons les noms sur les pierres tombales; demandons conseil: “Pavese, le grand écrivain: peut-être savez-vous où il est enterré ?” - “Ah, nous répond une petite vieille, ce sera celui-là, fils d’Unetelle, pourtant il a disparu depuis longtemps, je ne sais où”; mais non, il n’y a pas de Pavese par là, vous faites erreur”, dit une seconde d’un ton farouche. Un autre hausse les épaules. Finalement, quelqu’un nous explique qu’il n’est pas enterré par là en haut dans ses Langhe mais à Turin, près de sa maison de famille, actuellement transformée en musée.
C’était évidemment notre faute: nous aurions dû commencer par nous informer. Cela étant, tombe ou pas, cette brève promenade nous avait à vrai dire conduits bien plus près de Pavese, dans la proximité de ceux-là qui en ignoraient jusqu’à l’existence, au milieu du paysage qui avait été le sien et qui conservait encore, malgré le bouleversement du présent, une trace de douceur sensuelle; jusque sur les murs de certaines maisons.
Ainsi, j’aurais dû m’en aviser. Pourtant, me trouvant pour une semaine en Appenzell, comment résister à la tentation d’y chercher des traces de Robert Walser, et d’abord à Herisau ? Un dépliant touristique parlait même d’un Sentier Robert Walser. Après tout, on était là pour faire de belles balades; ainsi nous aurions pu rallier Herisau, chercher la clinique, imaginer ses pas s’éloignant de là et tourniquant tant de fois autour de la ville pour se perdre un jour dans la neige. Balade agréable en somme, pas trop pénible: idéale pour les enfants et la grand-mère, qui n’aurait certes pas eu trop de difficulté, malgré sa canne. Mais là encore, quelle impréparation ! Non seulement j’avais laissé, sottement, les livres de Walser que je me promettais de relire, mais également le précieux ouvrage de son ami Carl Seelig dans lequel j’aurais pu découvrir tant de choses intéressantes. Par exemple: nous logions à Teufen, commune d’origine de la famille Walser; et à Teufen préciséemt, qui sait si le restaurant à boucherie attenante où nous avions si bien mangé n’était pas le même établissement qui avait accueilli les deux amis après une longue journée de vagabondage à travers les collines de Hundwil à Stein, le 10 septembre 1940, où on leur avait offert “un beau plat de rôti avec haricots et pommes de terres frites”.
Au lieu de ça, nous allions nous promener, ignares, le long des mêmes sentiers parcourus tant d’années auparavant par un écrivain que nous étions juste bons à associer au nom d’Herisau. Comme s’il n’avait fait qu’y rester enfermé pendant des décennies et n’était pas allé à Saint-Gall ou à Urnäsch; comme s’il n’avait pas regardé les mêmes paysages que nous regardions, les mêmes maisons noyées dans la verdure, les troupeaux silencieux, les nuages, la silhouette lointaine du Säntis. Pour tout dire: Herisau, dix minutes en voiture et finalement le Sentier Robert Walser. Pas plus compliqué que ça…
Mais il pleuvait. Pas la toute fine petite pluie appenzelloise qui mouille et pénètre, mais la grosse averse trempant les prés comme des soupes. Il pleuvait le matin à Teufen; et il pleuvait encore plus à Herisau, où une variation de luminosité du ciel nous avait vainement fait croire à une éclaircie. Et là mieux valait naturellement attendre un peu; quelques pas dans le centre, un peu de lèche-vitrines, peut-être un café; ensuite on verrait.
Ah les vitrines: c’est toujours un sacré problème avec un enfant, dans la petite tête duquel le désir ne tarde à insinuer ses sollicitations, suscitant l’habituelle stratégie de caprices et de séductions. Et les adultes aussi, d’ailleurs, quand, en vacances, ils se baladent, peinent à résister sereinement à la tentation. Cette lampe, par exemple, dans la boutique d’un brocanteur : n’est-elle pas gracieuse ? Ne dispenserait-elle pas une lumière idéale à nos soirées de lectures, dans la pénombre d’un salon ? Ensuite, cette pluie qui a traversé le cuir de nos souliers et s’en prend maintenant à nos chaussettes, nous amène à regarder sérieusement cette paire de si robustes chaussures avec lesquelles ce serait tout de même autre chose de braver le pavé mouillé de la chaussée, alors que leur base renforcée permettrait d’affronter jusqu’aux passages boueux des chemins de campagne. Et voici ce si joli petit magasin avec ses animaux de bois découpé, ses petits bateaux colorés, des tas d’autres animaux encore et des maisons ou des usines en miniatures. Celui-là est le loup, cet autre le cerf, les vaches et les brebis, les chiens. Au-dessus sont suspendus des avions et des poupées accrochées à un ressort, dansant dans le vide, effleurant les petits cubes jaunes encastrés les uns dans les autres pour former on ne sait trop quoi : une montagne, un palais enchanté, un château ? Mais non, pas question d’acheter : nous en avons déjà tant à la maison. Pourtant attendez : n’y a-t-il pas deux bambins de quelques semaines à peine à qui, de toute façon, nous devons faire un petit cadeau ? Un pour Otto et un autre pour Caroline, c’est pourtant vrai. L’un de nous pourrait entrer, pendant que je resterai avec le petit Leo, calmé par la promesse d’une bande dessinée que nous irons chercher ensuite, j’attendrai donc dehors, quitte à faire encore deux ou trois pas. Ainsi nous retrouvons- nous là, avec Leo, à regarder si ne passe pas une voiture avec trois mêmes chiffres sur sa plaque, ou à faire cet autre jeu où l’un choisit une couleur et dont le vainqueur est le premier qui voit une chose de ladite couleur. Sous ce porche, oui, pour ne pas nous mouiller, même si nous le sommes déjà, disons alors : pour ne pas l’être encore plus.
Et puis s’approche une jeune fille vêtue de noir. Elle a un long manteau, de longs cheveux aussi et une paire de chaussures de forme étrange. Elle se dirige vers nous, nous regarde et j’affûte mon pauvre allemand car je présume qu’elle va me demander un renseignement. Ce n’est pas à vrai dire le meilleur moment, d’abord parce qu’il continue à pleuvoir, ensuite du fait que je suis en train de m’allumer une cigarette après une pensive et douloureuse réflexion liée au fait que j’aimerais arrêter la fumée. Mais nous parlons du mauvais temps et de l’été pourri. Ensuite elle me demande si je suis roumain moi aussi et si je lui offre une cigarette. Vaguement étonné, le briquet à la main, je lui réponds que non : que je ne suis pas roumain. Là-dessus, même si je ne suis pas roumain, ne pourrais-je lui donner un peu de sous ? Je cherche alors de la monnaie dans ma poche trempée : cinq francs, ça ira ? Elle aurait préféré un peu plus, mais ça ira quand même. Au revoir. Dans l’intervalle j’ai relevé le regard de reproche que m’a jeté un quidam, signifiant, un, qu’on ne devrait pas demander l’aumône, et deux qu’on ne devrait pas l’accorder. En quel honneur cette aumône, au fait ? Je me le demande d’ailleurs moi aussi : que fera-t-elle avec ces cinq francs ? Un jour, tel ami italien m’a fait remarquer que la pièce suisse de cent sous représentait un gage de sécurité et de solidité, étant de bon poids et de belle taille, semblant réellement valoir quelque chose. De fait, ne l’appelait-on pas un écu jusqu’il y a peu ; et n’est-ce pas avec le plus grand sérieux qu’on dépose un écu sur une table ? Ainsi la demoiselle fera-t-elle avec son écu, cherchant à conjurer quelle adversité ? Et le modeste écu en question l’aidera-t-elle à affronter le dragon quand celui-ci crachera de nouvelles flammes ?
A présent j’avais à expliquer à Leo ce qui s’était passé, ce que voulait la demoiselle et si nous autres, aussi, étions pauvres ou non. Mais non : nous non plus ne sommes pas riches. Fortunés au moins ? Fortunés si l’on veut, juste ce qu’il faut. Entre temps reviennent les autres avec deux petits paquets ; et l’on repart en quête d’un kiosque à journaux. C’est qu’il n’est pas facile, à Herisau, de trouver une bande dessinée pour un enfant qui ne sait pas l’allemand. Or, ayant renoncé, après une première reconnaissance, à l’idée d’en trouver une en italien, nous nous rabattons sur celle d’un petit journal aux personnages possiblement connus, qui feraient passer le texte au second plan. Le supermarché tout proche paraît le lieu approprié ; et de fait il est bien doté. On peut en outre y boire un café au premier étage. Plus encore, vu qu’il pleut maintenant à verse et que c’est pour ainsi dire l’heure du déjeuner, nous n’allons pas nous remettre en route mais à table, vite fait, au self service spécialisé ès pâtes et lasagnes. La table à laquelle nous nous installons est l’un des quatre ou cinq restées libres. Sur la gauche, en contrebas, monte l’escalier roulant du supermarché. Devant nous, formant angle, c’est le comptoir des mets et boissons. Derrière, encore dans l’obscurité, une salle de jeux qui ouvrira sous peu et que zèbrent d’éclairs les lampes rouges des machines à sous. Ces lueurs sont rendues plus mystérieuses encore par un aquarium, à vrai dire déplacé, qui trône au milieu du salon de jeux, jetant alentour des ondes lumineuses aux mouvements étranges. Est-ce là que la jeune fille vêtue de noir viendra tôt ou tard tenter sa chance ? Là que l’écu tintera derrière l’aquarium ? Là qu’elle plongera elle aussi, ou que quelque roi pêcheur surgira des abysses pour lui tendre la main ? Dans le snack on ne parle presque que l’italien et le café est bon. Le personnel et une bonne partie de la clientèle parlent italien, comme ces deux hommes, à coté de nous, qui discutent avec animation. L’un d’eux, avec une queue de cheval qui rappelle un chanteur à la mode d’il y a quelques années, champion à ce qu’il semble de karaoke, doit être le père d’un gosse qui joue sur l’escalier roulant, descendant où les autres montent et remontant où il devrait descendre, criant et riant. De temps à autre le père lui dit quelque chose en schwyzerdütsch, avant de reprendre la jactance avec son ami. A quelques bribes de conversation, et bien que la chose puisse sembler banale, on dirait qu’ils parlent voitures et conquêtes féminines, donne e motori, comme dans une vieille chanson de Bobby Solo que presque personne ne se rappelle. C’était une chanson très triste parlant d’un amoureux désespéré qui, à la fin, choisissait de se tuer. Les derniers vers disaient : Maintenant on dit que c’était un poète / parce qu’il savait parler d’amour / mais qu’importe si tel meurt à la fin / qui ne peut plus parler de toi ?
Et Robert Walser là-dedans? L’avions-nous déjà abandonné, laissant tomber le projet de Wanderweg dont je mesurais distraitement l’itinéraire, à présent, sur un dépliant reposant sur la serviette en papier, à côté des restes de pain ? Peut-être. Et de fait, dans l’après-midi, décidant de descendre à Saint-Gall pour en visiter encore la Bibliothèque et montrer les momies aux enfants, puis le soir, à Appenzell au souper, de Walser il ne fut plus question. Mais repensant à présent à cette étrange journée et à ses imprévus, à la jeune fille vêtue de noir que je ne reverrai jamais plus, au gosse démonté sur l’escalier roulant, au surgissement imprévu et hasardeux d’une humanité surprenante ; resongeant à tout cela me vient comme l’impression contraire. Peut-être, comme il en va de Pavese, Walser n’est-il pas à chercher dans les sites officiels qui en conservent une mémoire muséifiée ? C’est peut-être dans le rythme : dans le rythme imprimé, sur le papier, par son vagabondage et celui de ses personnages, dans le rythme de son récit qui ne cherche pas à imposer d’ordre préétabli aux choses mais s’accorde à leur courant, tantôt ludique et tantôt dramatique. C’est un rythme très difficile, et précisément dans la mesure où il paraît si facile. Il risque de tourner au jeu, dans une forme un peu trop infantile parce que voulue un peu trop infantile. Ou bien il peut s’égarer dans une rêvasserie mièvre, ou encore dans quelque morceau de bravoure. Mais quand il parvient à résister à ces deux tentations, c’est pour devenir le rythme même des choses et des vies qui se mêlent dans les choses, s’effleurent et s’éloignent, chacune selon sa propre ligne d’aventure, de souffrance ou d’éprouvante liberté. Quand, en 1929 Walser a choisi et subi l’isolement d’Herisau, l’Europe était en train de passer d’un premier à un second massacre, prisonnière d’une logique de fer dans laquelle les destins individuels n’avaient pas la moindre importance ; cette même logique qui a perduré et résonne aujourd’hui avec de nouveaux tambours de guerre. Walser nous parle d’autre chose ou mieux : il nous parle d’une autre façon, avec une autre musique ; et dans son altérité se découvre l’une des formes d’opposition les plus extrêmes et lancinantes qu’il nous soit donné d’imaginer.
La jeune fille en noir, qui probablement ne le lira jamais, errant solitaire par les routes d’Europe en quête d’un écu, n’est-elle pas plus proche de Walser que nous tous, ses lecteurs passionnés mais un peu hypocrites ?
(Traduit de l’italien par Jean-Louis Kuffer)
Ce texte a été publié dans Le Passe-Muraille, No 64-65.
-
Les copains d'abord
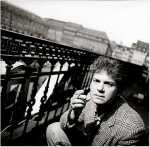
Cinquante ans passés, de Jean-Marc Roberts
On se dit une fois de plus que Jean-Marc Roberts se la joue facile, brodant sur le canevas de sa vie qui va, comme depuis Les petits Verlaine, en 1973, ou plus exactement dès Samedi, dimanche et fêtes, son premier livre paru en 1972.
Et puis voilà, et puis non: comme toujours il y a cette petite musique, c’est vraiment ça même si ça fait cliché, cette petite musique qui est à la fois la modulation d’un sentiment de l’existence et le faufil d’une écriture nette faite d’ellipses, de petits points, de traits, de fusées parfois, de touches blanches et noires comme d’un piano de Bill Evans ou de Michel Berger jouant debout, c’est selon.
Donc c’est reparti pour la suite d’un autoportrait en creux aux copains d’abord, où le mieux dessiné est celui qui a le mieux raté sa vie aussi, juste bon à se souvenir de ses belles années et à donner son point de vue sur la chose politique, autant dire du remplissage dans une vie dont on ne saura presque rien mais qui dégage la douce mélancolie d’un modeste, Richard Hermann de son nom, que le narrateur et son ami Jean-Louis n’avaient plus revu depuis trente ans.
A l’époque yéyé et même avant : à celle de Minou Drouet et de Joselito, les enfants-stars première volée, Richard a failli devenir chanteur et même l’a été sur quatre 45 tours, les deux derniers chez Barclay.
Or trente ans plus tard les compères du lycée Carnot se retrouvent pour aller, prétexte bientôt différé, fêter l’anniversaire d’un certain Gavotti qui n’a jamais vraiment été de la bande. En chemin donc, dans la Mercedes deux portes de Jean-Louis (notaire en vue), se repassant les disques du beau temps (comme on dit), on dévie bientôt sur Calais avec l’idée de pousser une pointe sur l’Angleterre. Ce sont des lubies qu’on peut avoir, passé cinquante balais, avec les moyens et la liberté de ses les accorder.
Peu importe au demeurant, et pas grave si le projet anglais tombe à Calais au lendemain d’une soirée passé à picoler et se raconter des choses, histoire de recoller quelques morceaux.
Tout cela fait-il un livre ? Un petit livre, oui-da. Et même un petit film, genre Sautet en plus velléitaire et bluesy. Et le portrait de Richard (poids lourd existentiel à dégaine de Michael Moore sans la barbe), les souvenirs évoqués qui en font revenir d’autres kyrielles au lecteur, l’allant doux acide, surtout le climat, l’atmosphère, la fine mailledu filet de mots à repêcher le passé sont d’un écrivain racé, ça ne fait pas un pli…
Jean-Marc Roberts. Cinquante ans passés. Grasset, 103p.
-
Varia 2006 (1)

Mon premier livre de l’année est un régal savoureux, d’une fantaisie imaginative et verbale qui fait florès à chaque page et dont l’empreinte finale a quelque chose à la fois de radieux et d’étrangement mélancolique.
On se rappelle le Michaux d’Ecuador et des explorations oniriques, les chroniques imaginaires de Milorad Pavic ou le toboggan aux images de Jean-Marc Lovay en lisant les «entrevoûtes» de Nos animaux préférés d’Antoine Volodine, qui relève à la fois du conte fantastique et de la variation délirante sur une suite de thèmes qui ne le sont pas du tout, dans le droit fil des fictions post-exotiques de l’auteur.
Celui-ci explique d’ailleurs sa démarche par le truchement du Commentaire à la Shagga du ciel péniblement infini, superbe ensemble de sept textes poétiques d’un ton plus grave et d’une teneur soudain plus dense que l’ensemble foldingue du recueil. Le commentaire en question précise que «la Shaggå a été conçue pour évoquer, et en même temps pour leurrer, pour protéger, pour résister à toute effraction. Elle contient une part de mystère indéchiffrable et, sous ses dehors anodins, elle proclame paisiblement que sa raison d’être est ailleurs: c’est une esthétique de l’esquive qui lui donne sa force poétique (…), et plus loin il est encore dit que la Shagga module «une rêverie susceptible de vriser encore ça et là le réel, l’inexorable réel de la marchandise et de la guerre; un territoire d’exil; une parole chamane».
A part les sept morceaux de sagesse du livre, celui-ci se déploie comme une suite de chroniques humanoïdo-animales où, après la première Brève rencontre de l’éléphant Wong avec une humaine agressive, qu’il est contraint d’écraser d’une ferme patte défensive, défilent Sa Majestable Balbutiar le roi du varech à l’échine bouldebrayée, dont on apprend le mode cruel de reproduction, les sept reines sirènes aux règnes ponctués d’événements hégémoniaques ou insurrectionnels variés (méditons au passage sur le sort de Sole-Sole III la reine des Anarchistes qui fit la peau de Jean Balbutiar avant de finir violée et envasée), pour finir sur la triste fin de vie de Wong assisté en ses derniers instants par Tatiana Crow l’humaine compatissante et à belles mamelles mais incapable de surseoir à son enlisement fatal.
Evidemment un tel livre ne se raconte pas: il se slurpe et s’absorbe à fond les papilles, tout ouïes et branchies branchées et toutes palpèbres, tout nasarium et tous doigts peloteurs actionnés à pleines manettes.
Enfin il me faut, pour embrayer sur les Bonnes Résolutions convenant à un 1er de l’An, recopier ce fragment du Passage, le premier des sept textes sapientiaux de l’ouvrage: «Et c’est sur cette lumière-là, non navigable, fictive, que tu façonneras le passage, dans cette lumière volée, dans la misère orgueilleuse de cette lumère volée». (1er janvier 2006)«Le plus favorable moment, pour parler de l’été qui vient, c’est quand la neige tombe» (Jacques Audiberti)
«Pourquoi lisons-nous, sinon dans l’espoir d’une beauté mise à nu, d’une vie plus dense et d’un coup de sonde dans son mystère le plus profond». (Annie Dillard)
«Et toute lecture – même entreprise pour les motifs les plus bas – nous fait pénérer dans le cabinet secret où l’humanité nous entretient à voix basse du sort qui lui est fait sous le soleil». (John Cowper Powys)
«Laissez venir l’immensité des choses» (C.F. Ramuz)On n’a pas besoin de grades, disait à peu près Ramuz: on a plutôt besoin d’égards. A quoi j’ajouterai: et de regards. On a besoin d’égards et de regards
Je me trouvais là bras-deci bras-deça avec deux très vieilles gredines pleines de malice auxquelles j’avais proposé de se rendre en certaine auberge Zum Schiff pour s’y tasser la cloche, ensuite de quoi nous irions à la Collection Rosengart revoir les Cézanne et les Rouault, en traversant vite fait les trois grandes salles de Picasso. Et nous nous sommes retrouvés devant les Baigneuses bleues de Cézanne; et le temps s’est arrêté entre le paysage nocturne de Rouault et la tempête d’huile de Soutine… (A Lucerne, ce 7 janvier)
On ne saurait imaginer meilleure lecture que Les carnets de Johanna Silber de Jean-Michel Olivier en traversant, du sud au nord, les hauts gazons enneigés de ces régions mitteleuropéennes balisées à l’est par les lacs argentins de Sils-Maria chers à Nietzsche et au nord-ouest par le café Odéon où Joyce venait griffonner ses obscénités à Nora.
Le privilège d’un personnage de roman tel que Johanna Silber, et l’agrément de sa fréquentation, snobisme mis à part, tiennent autant aux facilités d’accès à divers lieux plus ou moins mythiques - comme la couche du roi George VI (auquel Johanna cède après l’avoir baffé), la Fenice au temps de Toscanini, le Chelsea Hotel en 1940 ou le restaurant Cathy’s de Sunset Boulevard, où elle rencontra Fritz (Lang) et David (Selznick), entre autres – qu’aux multiples rêveries découlant de la vie d’une diva folle de Schubert et fondue en musique comme sainte Thérèse en mystique amniotique.
D’ailleurs la métaphore est là page 112: «La musique vient de là, peut-être: le souvenir d’un bonheur oublié, le doux balancement du corps dans le flux maternel – cet univers liquide et chaud où nous avons baigné hors du temps et de la mort. C’est le premier rivage et la douceur inexprimable du bord de mère. Toute la musique de Schubert est empreinte de cette nostalgie». Mais pas que la musique de Schubert, sans blague: à l’instant la voix mourante de Billie Holiday m’enveloppe de son nuage camé aux volutes d’Embraceable you, et du coup je me dis que Johanna la diva fut à peu près la contemporaine de Lady Day, et aussi peu capable que celle-ci de vivre une vie ordinaire.
Or c’est tout l’art de Jean-Michel Olivier, après Le voyage en hiver qui évoquait la destinée de Matthias Silber, le fils incestoïde de Johanna, dans l’Allemagne des années 50, que d’évoquer, à fines touches légères, et sous sa plume elliptique puisqu’il s’agit de carnets, cette destinée d’ange à deux têtes (l’autre étant celle de son frère Théo) qui se titubent comme deux albatros à travers les années dominée par l’horrible voix du Führer.
Le Voyage en hiver constitue le fil liant de ce nouveau livre, qu’on lit en se rappelant les images d’un Daniel Schmid surtout dans Heute nacht oder nie) ou du Château de Manderley de Rebecca, de Selznick et Hitchcock, d’ailleurs cité au passage. Sans peser ni forcer sur le kitsch rétro, Jean-Michel Olivier donne une suite à son autre roman qui n’a rien d’une resucée, lui ménageant au contraire une nouvelle profondeur.Je cherchais tout à l’heure la nuance de rose bleuté convenant à mon nouveau petit Niesen à l’acryl, quand je l’ai trouvée au ciel de ce lever du jour. C’est ainsi, une fois encore, que tout communique.
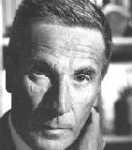 En lisant la nouvelle de Buzzati intitulée Le mot prohibé, je découvre une société toute pareille à la nôtre, avec des observations recoupant exactement celle de Dürrenmatt dans son Discours à Vaclav Havel, où l’écrivain alémanique comparait la Suisse à une prison sans barreaux dont chaque habitant serait le geôlier. Tout au long de la nouvelle, le narrateur, débarqué depuis trois mois dans une ville étrangère, harcèle un des amis qu’il s’y est fait pour que celui-ci lui dise enfin quel est le mot désormais prohibé en ces lieux. L’ami se dérobe, lui expliquant que la prohibition de ce mot découle du besoin d’harmonie des habitants de la ville, qui ont découvert que le conformisme était en somme la meilleure façon de vivre ensemble, avec pour condtion le seul sacrifice de ce mot. Buzzati laisse blancs les deux espaces où le narrateur prononce bel et bien ce mot, que le lecteur est supposé deviner, ce que j’ai fait aussitôt, obsédé que je suis par le besoin de. En lisant la nouvelle à ma bonne amie, elle a prononcé le mot confiance, mais ce n’était pas cela - du moins sa réponse m’a-t-elle paru significative. D’ailleurs je me dis que ce pourrait être un test éclairant. Dis-moi ce que que tu redoutes les plus de voir prohibé et je te dirai qui tu es. La première phrase dans laquelle Buzzati suggère le mot est celle-ci. «Mais nous pouvons parler en toute…. Il n’y a ici personne pour nous entendre. Tu peux bien me le dire, ce fichu mot. Quoi pourrait te dénoncer?» Et la seconde: «Et la …? Le bien suprême. Jadis, tu l’aimais. Tu aurais fait n’importe quoi pour ne pas la perdre. Et maintenant?»
En lisant la nouvelle de Buzzati intitulée Le mot prohibé, je découvre une société toute pareille à la nôtre, avec des observations recoupant exactement celle de Dürrenmatt dans son Discours à Vaclav Havel, où l’écrivain alémanique comparait la Suisse à une prison sans barreaux dont chaque habitant serait le geôlier. Tout au long de la nouvelle, le narrateur, débarqué depuis trois mois dans une ville étrangère, harcèle un des amis qu’il s’y est fait pour que celui-ci lui dise enfin quel est le mot désormais prohibé en ces lieux. L’ami se dérobe, lui expliquant que la prohibition de ce mot découle du besoin d’harmonie des habitants de la ville, qui ont découvert que le conformisme était en somme la meilleure façon de vivre ensemble, avec pour condtion le seul sacrifice de ce mot. Buzzati laisse blancs les deux espaces où le narrateur prononce bel et bien ce mot, que le lecteur est supposé deviner, ce que j’ai fait aussitôt, obsédé que je suis par le besoin de. En lisant la nouvelle à ma bonne amie, elle a prononcé le mot confiance, mais ce n’était pas cela - du moins sa réponse m’a-t-elle paru significative. D’ailleurs je me dis que ce pourrait être un test éclairant. Dis-moi ce que que tu redoutes les plus de voir prohibé et je te dirai qui tu es. La première phrase dans laquelle Buzzati suggère le mot est celle-ci. «Mais nous pouvons parler en toute…. Il n’y a ici personne pour nous entendre. Tu peux bien me le dire, ce fichu mot. Quoi pourrait te dénoncer?» Et la seconde: «Et la …? Le bien suprême. Jadis, tu l’aimais. Tu aurais fait n’importe quoi pour ne pas la perdre. Et maintenant?»L’ami Pierre Gripari me disait qu’il ne suffisait pas, pour un romancier, d’avoir quelque chose à dire, mais qu’il lui fallait quelque chose à raconter – et cela, qu’on dira le plot, l’intrigue, se retrouve à tout coup dans les films d’Hitchcock. Les meilleurs fondent les deux éléments en une forme immédiatement singulière, dès A l’Est de Shangaï (1932) et jusqu’à Pas de printemps pour Marnie (1964), deux échecs publics retentissants, soit dit en passant. Or ce qui me frappe à (re) voir tous ces films en enfilade, de Sueurs froides (19589 aux Oiseaux (1963) ou du sublime Rebecca (1940) à Frenzy (1972), c’est l’inépuisable richesse d’observation en matière de signes mimiques ou gestuels (tout ce que Hitch fait ajouter par ses comédiens au script), le sens qui en découle, et plus encore l’humour fou qui survole le combat éternel de l’homme et de la femme, du noble et du vil, du bourreau (ou de la bourrelle) et de la victime.
On se souvient des impayables apparitions du cher Hitch à la télévision, feignant de s’excuser d’avoir à présenter tel ou tel crime affreux. Dans Frenzie, la brusque érection d’un pied de femme hors d’un sac de patates pourrait résumer son humour, dont le burlesque touche à des abîmes. Oui, le crime est incongru. L’acte de griffer ou de tuer est moins lisse que ne le dit le cinéma. Un romancier ne peut pas ne pas imaginer qu’un amant (même Cary Grant en pleine forme) s’empêtre dans sa culotte au moment stratégique ou que le suicide d’une désespérée dans le Tibre (c’est dans le Sheikh blanc de Fellini) rate faute d’eau, et que la vie reprenne ses droits.
L’incongruité du crime, autant que les accrocs de la passion romantique ou les ratés de l’élan amoureux, ressortissent à l’humour. Non pas à la rigolade facile mais à l’humour profond, qui mêle indissolublement tragique et comique. Or de cet humour, qu’il serait réducteur de ne dire que noir, les films d’Alfred Hitchcock sont pleins… Je riais sous cape ce matin en me rappelant l’irrésistible histoire que raconte Alexandre Jollien, dans son Eloge de la faiblesse, évoquant son pote handicapé qui, dans le train, pour n’avoir pas à payer sa course, tire la langue au moment où le contrôleur se pointe dans son compartiment. Le drôle en question appelle ça: Opération Lézard. Or ce que je me dis ce matin, c’est que toute la philosophie de Jollien tient en ce programme basique de l’Opération Lézard. C’est en tirant la langue à sa poisse de naissance qu’il est devenu ce qu’il est: à savoir un putain de clown de Dieu, un danseur à la Nietzsche, un resquilleur du SuperHandicap de vivre.
Je riais sous cape ce matin en me rappelant l’irrésistible histoire que raconte Alexandre Jollien, dans son Eloge de la faiblesse, évoquant son pote handicapé qui, dans le train, pour n’avoir pas à payer sa course, tire la langue au moment où le contrôleur se pointe dans son compartiment. Le drôle en question appelle ça: Opération Lézard. Or ce que je me dis ce matin, c’est que toute la philosophie de Jollien tient en ce programme basique de l’Opération Lézard. C’est en tirant la langue à sa poisse de naissance qu’il est devenu ce qu’il est: à savoir un putain de clown de Dieu, un danseur à la Nietzsche, un resquilleur du SuperHandicap de vivre. -
Un Fellini musical
Découverte de Vinicio Capossela
Chanteur et musicien d’une folle originalité, notamment du fait des atmosphères déjantées qu’il crée par la magie conjuguée des mots (ses textes sont magnifiques), des rythmes et des constructions sonores, Vinicio Capossela, encore méconnu dans les contrées francophones, est à découvrir subito par les amateurs de musiques exploratoires.
Comment le situer ? Quelque part entre Nino Rota et les Beatles du Sgt Pepper, les fanfares gitanes et le Bashung le plus expérimental, la musique populaire italienne arabisante et cent autres « couleurs » rythmiques ou lyriques, tout cela sans rendre vraiment compte d’un cocktail unique et détonant, dont les ressources variées font tout l'intérêt de son dernier opus, intitulé Ovunque proteggi.
Dès le sardonique Non trattare, mêlant d’emblée les instruments les plus surprenants (de telle « guitare préhistorique » au balafon, en passant par le shaba dum dum, la trombe et le violon chinois…), sur un rythme lancinant, le lascar et sa bande nous entraînent dans un voyage tantôt envoûtant et tantôt hyperfestif, valsant sur la place Rouge (Moscavalza) ou parodiant un haletant hymne monumental à réjouir le Duce et ses émules réunis (Al Colosseo), égrenant sarcastiquement une incantation charnelle (Rosario della carne) ou tournoyant dans les sphères chuchotées d’un cha-cha-cha et de telle envolée orchestrale à la Bernstein (Nel blu), entre romances piégées (Nutless) et moult autres bonheurs vocaux ou multisonores…
Vinicio Capossela. Ovunque proteggi. Atlantic -
Varia 2006 (2)
«Mon père n’avait peur de rien, c’est ce qui l’a sauvé pendant la guerre, et je crois que je tiens de lui…», a-t-elle remarqué en me racontant l’Occupation qu’elle a vécue à Mulhouse, lycéenne aux ordres des Führerinnen, tandis que ses deux frères étaient embarqués dans la Wehrmacht.
C’était hier, elle m’a accosté sur le quai de la gare de Lausanne, elle m’avait entendu une fois dans une soirée littéraire et venait de lire mon papier du jour, bref warning: la raseuse, me disais-je en imaginant une échappatoire - mais plus moyen de m’en débarrasser, nous allions tous deux à Genève et je n’avais pas le cœur de la remballer, d’autant moins que ce qu’elle a commencé de me raconter d’elle était intéressant…
Je n’en retiens que l’histoire du pharmacien Weiss. A Mulhouse, où les commerçants juifs abondaient, l’annexion de l’Alsace par les Allemands s’est soldée, à part la germanisation à outrance des écoles, par l’humiliation publique, la spoliation de leurs biens et la déportation ultérieure des Juifs, dont Marguerite B. a retenu cette scène: les agents de la Gestapo traînant le pharmacien Weiss devant sa boutique, l’obligeant à s’agenouiller et le contraignant, devant une foule croissante et muette, à brouter l’herbe du pavé qu’il y avait là…
Cette scène m’a rappelé la chèvre d’Umberto Saba, et c’est avec émotion, avec reconnaissance que j’ai quitté Marguerite B. sur le quai de la gare de Genève, hier dans la lumière voilée de cette fin de matinée d’hiver… (Brasserie hollandaise, ce jeudi 12 janvier.)Dans la catégorie variée des femmes d’écrivains, un genre me fait horreur et c’est celui que l'Auteur désigne comme l’Admirable Compagne, dont la seule appellation dissimule le plus souvent des liens de dépendance plus que douteux, alors que me ravit le type en voie de disparition de l’épouse aux petits soins, qui s’écrit naturellement sans majuscules et s’entend avec malice. Telle étant Madame Berchtold.
Madame Berchtold est le type de l’épouse aux petits soins, et c’est donc avec une double allégresse que je me rendais, avant-hier, à Genève, chez le professeur Alfred Berchtold, qui est la fois le plus grand historien suisse vivant (je dirai à vue de nez: 1m.92), l’un des derniers représentants du Gai Savoir helvétique de haute tradition, l’auteur d’au moins trois livres incomparables (La Suisse romande au cap du XXe siècle, Bâle et l’Europe et sa captivante approche du personnage de Guillaume Tell à travers les siècles et les cultures), enfin un homme aussi bienveillant (il m’a fait l’amitié de relire le tapuscrit de mon prochain livre, qui lui est dédié) qu’intéressant, dont l’humour me régale et me rappelle à tout coup le bien fondé du surnom de Pingouin que lui ont collé ses condisciples de la Communale de la rue Lepic, à Montmartre, où il a fait ses premiers pas de môme studieux à bonnet de plouc préalpin.
Dire que Madame Berchtold est aux petits soins ne signifie pas qu’elle soit piètrement soumise: elle fait ça naturellement, aussi naturellement que Pingouin porte cravate et s’abstient de marmonner «fait chier» ou «j’veux dire». C’est une affaire de génération. Albert Camus avait honte de voir sa mère se tenir debout derrière sa chaise, et je me suis efforcé longtemps de décourager ma propre mère d’être aux petits soins, mais en observant hier Madame Berchtold, son plaisir de faire plaisir tout en riant de nous entendre rire de certains ridicules de certaines gendelettres de notre connaissance, je me disais «et merde, c’est quand même une société que tout ça», et «oui Madame je veux bien encore de votre poule au riz délicieuse» disais-je alors que je n’en pouvais plus, juste pour le plaisir de lui faire plaisir.
Nous avons publié, avec Alfred Berchtold, un livre d’entretiens intitulé La passion de transmettre, que j’ai eu un vrai bonheur à faire et qui reste un précieux témoignage sur la multiculture que nous vivons dans ce pays. Or à chaque fois que nous nous rencontrions, Madame Berchtold était là pour nous faciliter la tâche, aux petits soins une fois encore. Au fil des jours, je n’ai pas appris grand’chose sur elle, sinon qu’elle avait été prof et qu’elle ne supportait pas la chimie pharmaceutique, lisait pas mal et partageait les curiosités et les enthousiasmes de son maxi-jules. Or jamais, au grand jamais, je n’ai relevé la moindre trace de condescendance, de sa part à lui, à l’égard de cette petite dame toujours souriante et complice. Ah mais, tout cela ne fait-il pas vieux jeu? Je l’espère bien, ma caille… «L’art doit être aussi méticuleux que la vie», dit Fellini à propos de la forme artistique la plus proche de la réalité que semble le cinéma, qui requiert précisément, alors, la transformation de la réalité apparente en trompe-l’œil dont la mer de plastique du Casanova est l’un des exemples.
«L’art doit être aussi méticuleux que la vie», dit Fellini à propos de la forme artistique la plus proche de la réalité que semble le cinéma, qui requiert précisément, alors, la transformation de la réalité apparente en trompe-l’œil dont la mer de plastique du Casanova est l’un des exemples.
Le film intitulé Je suis un grand menteur, dans lequel le Maestro décrit la germination de son art avec une quantité d’exemples vécus sur le plateau, est une merveilleuse leçon de choses dans laquelle interviennent, autant que le marionnettiste, ses poupées plus ou moins consentante, du malheureux Donald Sutherland qui semble ne pas être encore revenu du fait d’avoir tant été malmené durant les premières semaines du tournage du Casanova (on sait que Fellini ne pouvait pas l’encadrer…) à Terence Stamp évoquant surperbement sa propre expérience, en passant par Giuletta Masina ou Roberto Begnini aux impayables déclarations.
Sceptique à l’endroit de tout scepticisme, plaidant pour la disponibilité totale du créateur, médium plus qu’ingénieur trop lucide, Fellini apparaît à la fois en Dieu le père et en enfant pénétré par son jeu, et le voir travailler avec ses acteurs (la scène de triolisme où il dirige, un regard après l’autre, un geste après l’autre, les caresses des jeunes amants du Satyricon), le voir détailler l’importance absolue de telle couleur ou de telle lumière, le voir cajoler ses gens ou les houspiller, le voir créer son univers apparemment ex nihilo, mais fait de tout ce qui existe et nous traverse, est une fabuleuse leçon d’attention amoureuse à cela simplement qui est…En regardant, hier, le film consacré à Fellini Par Damian Pettigrew, j’étais ému d’y retrouver maintes observations sur le travail de l’artiste qui valent évidemment pour l’écrivain, comme ces propos que je relève dans une lettre de Rilke à Clara datant de 1907: «… Mais à propos de Cézanne, je voulais encore dire ceci: que jamais n’était mieux apparu à quel point la peinture a lieu dans les couleurs, et qu’il faut les laisser seules afin qu’elles s’expliquent réciproquement. Leur commerce est toute la peinture. Celui qui leur coupe la parole, qui arrange, qui fait intervenir d’une manière ou d’une autre sa réflexion, ses astuces, ses plaidoyers, son agilité d’esprit, dérange et trouble leur action. Le peintre (comme l’artiste en général), ne devrait pas pouvoir prendre conscience de ses découvertes; il faut que ses progrès, énigmatiques à lui-même, passent, sans le détour de la réflexon, si rapidement dans son travail qu’il soit incapable de les reconna’itre au passage. Quiconque, à ce moment-là, les épie, les observe, les arrête, les verra se métamorphoser comme l’or des contes, qui ne peut rester pur par la faute de tel ou tel détail. Le fait que les lettres de Van Gogh se lisent si bien, soient si riches, parlen en fin de compte contre lui, comme parle contre ce peintre (comparé à Cézanne) le fait davoir voulu, su, éprouvé ceci ou cla: que le bleu appelait l’orange, et le vert le rouge; ainsiq u’il l’avait entendu dire, le curieux, aux aguets au fond de son œil. Aussi peignait-il des tableaux fondés sur un seul contrast, tout en pensant au coloris simplifié des Japonais qui ordonnent les surfaces selon le on voison, plus haut ou plus bas, et les additionnent pour obtenir une valeur totale; ce qui les conduit au contour continu, exprimé (c’est-à-dire inventé), serrissage de surfaces équivalentes, donc à l’ntentionnel, à l’arbitraire, en un mot: au décoratif.
Un peintre qui écrivait, donc un peintre qui n’en était pas un, a voulu inciter Cézanne aussi à s’expliquer en lui posant des questions de peinture: mais, quand on lit les quelques lettres du vieillard, on constate qu’il en est resté à une ébauche maladroite, et qui lui répugnait infiniment à lui-même, d’espression. Il ne pouvait presque rien dire. Les phrases où il s’y efforce s’étirent, s’embrouillent, se hérissent, se nouent, et il finit par les abandonner, furieux. En revanche, il parvient à écrire très clairement: «Je crois que ce qui vaut mieux, c’est el travail». Ou bien: «Je fais tous les jours des progrès, quoique lentement». Ou bien: «J’ai près de soixante-dix ans». Ou bien: «Je vous répondrai avec des tableaux». Ou encore: «L’humble et colossal Pissaro» (celui qui lui a appris à travailler); ou enfin, après avoir bataillé un peu (on sent comme c’est caligraphié, et avec soulagement), la signature complète: «Pictor Paul Cézanne». Et dans la dernière lettre (du 21 septembre 1905), après des plaintes sur sa mauvaise santé, simplement: «Je continue donc mes études». Et dans la dernière lettre (du 21 septembre 1905), après des plaintes sur sa mauvaise santé, simplement: «Je continue donc mes études». Et le vœu qui a été exaucé littéralement: «Je me suis juré de mourir en peignant.» Comme dans une vieille Danse des Morts, la Mort a saisi sa main apr derrière, posant elle-même la dernière touche, avec un frisson de plaisir; son ombre s’étendait depuis quelque temps sur sa palette, elle avait eu le temps de choisir, dans la ronde franche des couleurs, celle qui lui plaisait le mieux; quand le pinceau y aurait plongé, elle s’en saisirait et peindrait… Le moment vint; la Mort allonga la main et posa sa touche, la seule dont elle soit capable». Et cela enfin qui me semble incontestable: «Toute parlote est un malentendu. Il n’y a de compréhension qu’à l’intérieur du travail, sans aucun doute.»
 En sortant l’autre soir de la représentation de Liberté à Brême de Fassbinder, dont le sarcasme va de pair avec la question sérieuse de savoir à quel moment nous devenons capables de tuer, je me suis rappelé la scène que j’ai vécue il y a quelques années, dans un wagon-restau où, interrompant ma lecture de La force de tuer de Lars Noren, dont il fixait depuis un moment le titre avec des yeux inquisiteurs, tel jeune homme m’a soudain entrepris sur le sujet, affirmant d’abord qu’il était, lui, absolument incapable d’imaginer une situation dans laquelle il aurait la force de tuer…
En sortant l’autre soir de la représentation de Liberté à Brême de Fassbinder, dont le sarcasme va de pair avec la question sérieuse de savoir à quel moment nous devenons capables de tuer, je me suis rappelé la scène que j’ai vécue il y a quelques années, dans un wagon-restau où, interrompant ma lecture de La force de tuer de Lars Noren, dont il fixait depuis un moment le titre avec des yeux inquisiteurs, tel jeune homme m’a soudain entrepris sur le sujet, affirmant d’abord qu’il était, lui, absolument incapable d’imaginer une situation dans laquelle il aurait la force de tuer…
Je n’ai pas dit à ce charmant garçon, ce jour-là, que j’étais parfaitement capable, moi, de tuer un quidam interrompant ma lecture dans un train, pressentant qu’il manquait d’humour. En revanche je lui ai présenté quelques situations précises qui l’ont rendu tout songeur et moins sûr de lui, avant de lui avouer que, pour ma part, je n’avais éprouvé le désir de tuer vraiment qu’une fois, au MozartPark de Vienne, en observant le manège de dealers de luxe faisant ramper devant eux des gamins toxicos. «Là, vous m’auriez donné un flingue, je les flinguais sans la moindre hésitation»…
Dès la première scène de Liberté à Brême, l’éventualité de tuer le premier jules de Geesche, qui l’humilie et la brutalise avec la mâle bonne conscience du macho couillu au pouvoir de droit divin (la chose se passe en Allemagne bigote vers la fin du XIXe, mais vaut encore sûrement un peu partout), m’a paru la seule solution pour elle, et ensuite il m’a paru juste et bon qu’elle empoisonne successivement son faux-cul de deuxième soupirant (louchant sur l’entreprise familiale), son père invoquant Son Autorité, sa mère l’autorité du Très-Haut, enfin son frère revenu de guerre aussi con qu’il y était parti. Tout ça est évidemment schématique à souhait, le trait est forcé comme dans toute gravure expressionniste, et pourtant il y a quelque chose de bel et bien libérateur dans le rire, à la fois noir et jaune, que Fassbinder déclenche par le truchement de cette pièce.
Or je me le demande à l’instant: qui aurais-je vraiment la force de tuer ce matin si j’en éprouvais la nécessité vitale, que dis-je: le Devoir? A vrai dire je ne vois vraiment pas. Est-ce le fait d’un début de gâtisme frappant mon imagination, ou cela tient – il à la croissante indulgence qui me vient pour le genre humain, accentuée par la présence éminemment irénique de mon cher Filou?Se réveiller à l’hôtel a toujours signifié pour moi: je serais nulle part, je ne serais personne. Je serais le commercial X. ou la cheffe de projet Y. Peut-être un transsexuel? Peut-être un pasteur méthodiste ou un brasseur bavarois en tournée de promotion? Peut-être un ancien amant de Marthe Keller que j’ai cru voir tout à l’heure, assise seule sur un mur, sous la pluie mêlée de neige, en robe de chambre, là-bas près de la place d’aviation?
Elle était sortie du film Fragile de Laurent Nègre, vu hier soir aux Journées cinématographiques de Soleure, qui raconte les retrouvailles-affrontement d’une sœur irascible et de son frère rêveur, confrontés au suicide de leur mère désireuse de leur éviter les séquelles de la maladie d’Alzheimer qui la fait errer de par les rues. Deux ou trois séquences de ce premier film, dégageant une réelle émotion en dépit d’une écriture conventionnelle (le redoutable nivellement actuel de l’esthétique téléfilm), m’ont frappé sur le moment et j’y suis revenu en rêve, croisant l’ombre de ma propre mère qui me reprochait de ne pas avoir pris de laine. (Kriegstetten, Hôtel Sternen, Bel Etage, ce mercredi 18 janvier.)Nous parlions hier soir, avec un compère de la Cinémathèque, de ce qui distingue un film de cinéma d’un produit de télé. Pas compliqué: l’écriture. Pas la littérature: l’art de passer d’un plan à l’autre sans alternative, où tout est surprise et où tout signifie. Tandis que dans ces feuilletons filmés: bavardage et dosage prévu d’émotion-suspense-amour-action à 99%. Je me repasse à l’instant un quart d’heure des Vitelloni de Fellini, et voilà: tout y est cinéma comme tout est peinture chez Cézanne, musique chez Debussy ou littérature chez Proust…
 Il y a des années que j’en veux férocement, à toute une caste d’intellectuels sans entrailles, d’entretenir le cliché d’un pays mortifère, réduit à ses banques et à ses névroses, aussi est-ce avec un plaisir d’enfant que j’ai retrouvé, dans le tourbillon farceur de My name ist Eugen du jeune réalisateur Michael Steiner, qui vient d’obtenir le Prix du meilleur film de fiction aux Journées cinématographiques de Soleure, ce que je ressens au fond de moi comme un atavisme sauvage et qui participe de l’esprit du conte.
Il y a des années que j’en veux férocement, à toute une caste d’intellectuels sans entrailles, d’entretenir le cliché d’un pays mortifère, réduit à ses banques et à ses névroses, aussi est-ce avec un plaisir d’enfant que j’ai retrouvé, dans le tourbillon farceur de My name ist Eugen du jeune réalisateur Michael Steiner, qui vient d’obtenir le Prix du meilleur film de fiction aux Journées cinématographiques de Soleure, ce que je ressens au fond de moi comme un atavisme sauvage et qui participe de l’esprit du conte.C’est une belle petite ville que Soleure où il fait bon, dans les vieux bistrots de bois ciré fleurant l’Europe cultivée autant que la bohème artiste et le populo à cigares, discuter des derniers films de la cinématographie helvétique qu’on y projette à journée faite dans de multiples salles.
La Suisse est ce pays d’extrême-Europe, au fonds populaire, et même sauvage, à peu près méconnu par les temps qui courent, réduite qu’elle se trouve aux clichés du banquier à face blême, ou pire: du fonctionnaire chiant, ou pire encore: de l’intellectuel responsable convaincu que l’art et le commerce sont incompatibles. Ce fut le débat tournant à vide lancé par les médias à ces 41es Journées de Soleure, constituant les Etats généraux annuels du cinéma suisse, sur fond de remaniement de la politique fédérale en la matière, mais il a suffi de quatre chenapans fuguant à travers les monts de Heidi et les vaux de Guillaume Tell, dans la foulée de Bakounine et de Max und Moritz, sur un ton picaresque oscillant entre Twain et Harry Potter, pour déplacer la discussion sur le terrain d’un cinéma renouant, contre toute attente, avec l’esprit du conte.
Je me fiche bien, pour ma part, de ce qu’on a appelé l’helvétisme, à propos d’une idéologie qui a fait date, mais j’ai toujours pensé que les clichés contenaient une part de vérité et pouvaient être revivifiés, et c’est toute une Suisse profonde de nos enfances que j’ai retrouvée dans ce film - nos enfances de plusieurs siècles, jusqu’à ces bandes d’escholiers pieds nus qui sillonnaient l’Europe de la Renaissance en quête de maîtres de latin ou d’hébreu, qui filent aujourd’hui en skateboard et s’envoient par SMS des serments de fidélité à la vie à la mort et crèvent les vioques… J’ai commencé, ces derniers jours, à rédiger une espèce de journal parallèle dont le fil conducteur est ma lecture d’ Une vie divine de Philippe Sollers, livre-mulet qui a commencé par m’agacer et qui m’intéresse de plus en plus. C’est un jeu curieux dont je nourris mes Carnets de JLK, avec maints échos au fur et à mesure témoignant de l’intérêt de mes lecteurs, et que je vois comme une sorte de prolongation phénoménologique du livre, lequel est lui-même enté sur l’œuvre de Nietzsche. (A La Désirade, ce samedi 21 janvier).
J’ai commencé, ces derniers jours, à rédiger une espèce de journal parallèle dont le fil conducteur est ma lecture d’ Une vie divine de Philippe Sollers, livre-mulet qui a commencé par m’agacer et qui m’intéresse de plus en plus. C’est un jeu curieux dont je nourris mes Carnets de JLK, avec maints échos au fur et à mesure témoignant de l’intérêt de mes lecteurs, et que je vois comme une sorte de prolongation phénoménologique du livre, lequel est lui-même enté sur l’œuvre de Nietzsche. (A La Désirade, ce samedi 21 janvier).Je l’ai fait presque en courant ce matin, et pourtant il me semble que je suis arrivé à concentrer toutes mes notes de lecture de ces derniers jours, prises en marge d’ Une vie divine, dans un article dense et nuancé, qui rend à la fois l’enjeu et la richesse de ce livre, le premier de l’auteur à me plaire à ce point – et je sens que je suis loin d’en avoir épuisé les ressources. J’ai intitulé ça Sollers le pied léger et voilà ce que ça donne :
«Encore une journée divine!», s’exclame Winnie au lever de rideau d’Oh les beaux jours de Beckett, et c’est en somme ce qu’on se répète, trente guerres et quelques génocides plus tard, en lisant Une vie divine de Philippe Sollers: que la vie est un cadeau, sans doute empoisonné pour à peu près tout le monde, mais à quoi nous nous accrochons, même aussi empêtrés que Winnie dans notre tas de misère. La contemplation navrée de celui-ci, par les temps qui courent, imprègne l’esprit du siècle d’une mélancolie désenchantée, genre spleen destroy dont le plus symptomatique interprète, dans la littérature récente, est un Michel Houellebecq. Or c’est à l’exact opposé que, malgré son soutien loyal de pair aîné à l’auteur de La possibilité d’une île, se situe Philippe Sollers dans Une vie divine, dont les constats sur le monde contemporain, aussi radicaux que ceux de l’amer Michel, aboutissent à une attitude absolument contraire, laquelle consiste à célébrer cela simplement que voit Winnie enfoncée dans son tas et que tous nous découvrons chaque matin: «L’horizon est radieux, le soleil brille, jamais un jour n’a été plus beau. Les mots sont des cailloux frais, l’eau les caresse».
Lieux communs d’une littérature qui «positive»? Pas exactement: Plutôt: effort de présence et travail de chaque instant visant à ressusciter, contre tout ce qui pèse et nous tue: notre paresse et notre déprime, notre lassitude et notre désabusement, notre nihilisme en un mot que l’époque flatte en nous soufflant que rien n’a d’importance que bouffer et baiser et nous remplir les poches de pognon, alors qu’un philosophe un peu dingue n’en finit pas de nous envoyer de drôles de SMS ou de fax ou de mails que nos déchiffrons en continuant de «stresser un max» et qui nous souhaitent «un bonheur bref, soudain, sans merci», ou «les pieds ailés, l’esprit, la flamme, la grâce, la grande logique, la danse des étoiles, la pétulance intellectuelle, le frisson lumineux du Sud – La mer lisse – la perfection»…
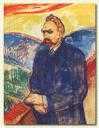 Une vie divine est le grand roman solaire – il faudrait plutôt dire conversation, carnet de croisière, essai-gigogne, livre-mulet, exercice de mimétisme, work in progess phénoménologique et poétique à la fois – du retour de Nietzsche, surgi de son suaire à la page 52 sous les initiales de M.N., «instruit par l’épouvantable saloperie du 20e siècle (dont 70 ans passés au goulag)» et revivant, ses livres battant des ailes autour du lecteuri, sous la plume d’un écrivain-philosophe du début du XXIe siècle flanqué d’une Nelly (très ferrée elle aussi en questions essentielles, non moins que bien dans son corps) et d’une Ludi (la femme-fille à croquer dont la jeunesse stimule son fringant barbon), radieuse trinité faisant la pige à l’humanité humanitaire, au bénéfice d’un nouvel homme à venir, mais lequel?
Une vie divine est le grand roman solaire – il faudrait plutôt dire conversation, carnet de croisière, essai-gigogne, livre-mulet, exercice de mimétisme, work in progess phénoménologique et poétique à la fois – du retour de Nietzsche, surgi de son suaire à la page 52 sous les initiales de M.N., «instruit par l’épouvantable saloperie du 20e siècle (dont 70 ans passés au goulag)» et revivant, ses livres battant des ailes autour du lecteuri, sous la plume d’un écrivain-philosophe du début du XXIe siècle flanqué d’une Nelly (très ferrée elle aussi en questions essentielles, non moins que bien dans son corps) et d’une Ludi (la femme-fille à croquer dont la jeunesse stimule son fringant barbon), radieuse trinité faisant la pige à l’humanité humanitaire, au bénéfice d’un nouvel homme à venir, mais lequel?
On sait ce que fut la grande affaire de Nietzsche, de libérer l’humanité d’un Dieu mort selon lui et d’une morale mortifère – d’un culte de la nécessité et de la société bel et bien massifié et mondialisé de nos jours, à l’enseigne d’une nouvelle religiosité consacrant tous les simulacres. Lecteur admirable, et prosateur étincelant aux fulgurantes fusées, Sollers vit ici Nietzsche comme une nouvelle possibilité de liberté, qui nous vaut de merveilleuses pages (sur l’esprit d’envie et de ressentiment du nihiliste, la musique, le French kiss à lèvres qu’il oppose au froid culte du cul, la vulgarité, les bonheurs menus et foisonnants de la vie qui va, les billets de Sade en taule, les oiseaux ou l’Evangile de Jean transposé au présent…) frappées au sceau d’un égotisme impérial qu’on pourrait croire celui d’un cynique absolument dédaigneux des vicissitudes de la vie, voire d’un Paon littéraire soucieux de sa seule brillance. Or à lire attentivement Une vie divine, cette superbe et cette morgue tendent à s’adoucir et à s’humaniser, hors de tout sentimentalisme, au fil d’une «histoire» dont le «héros», prof mal dans sa peau se rêvant Dionysos, surmontant toutes les poisses et les crasses de ses semblables, nous murmure lui aussi en éternel retour: «encore une journée divine»…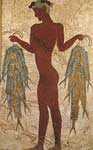 Celui qui fait la gueule pendant que Madame regarde Les Experts/Celle qui est toujours en conférence/Ceux qui s’interrogent sur les mystères de la météo/Celui qui salue tous les matins le Drapeau/Celle qui parle du cash-flow de Vivendi au bar du Lutetia/Ceux qui disent que la plaine Monceau n’est plus ce qu’elle fut/Celui qui a tant aimé l’odeur des couches de ses enfants petits/Celle qui vitupère les chiens malpropres de la rue Legendre/Celui qui trouve que Bob Geldof a mérité le Prix Nobel de la paix/Celle qui a connu la cousine de Bob Geldof lors d’un séjour en Cornouailles/Ceux qui pensent que Bob Geldof est un Tour Operator travaillant sur l’Afrique/Celui qui prétend que Lou Reed est un meilleur poète que Jim Morrison/Celle qui a vu tous les concerts de Nico/Ceux qui ont bu des coups avec Reiser/Celui qui dit qu’il n’en a rien à foutre de l’atomisme de Démocrite/Celle qui prétend que Cauet gagne à être connu/Ceux qui se sont promis de mettre un pain sur la gueule de Cauet/Celui qui prétend que sa belle-sœur s’est tapé Poivre d’Arvor dans une boîte échangiste de Soulac-sur-mer/Celle qui se frotte au citron tous les soirs/Ceux qui écoutent Haydn les yeux fermées/Celui qui va chier dans le jardin du presbytère/Celle qui découvre les Evangiles apocyrphes et le dit à sa manucure/Ceux qui savent où se trouve Aldébaran/Celui punit ses enfants d’il ne sait quoi/Celle qui mate les gens pendant la prière/Ceux qui parlent de leur Admirable Compagne/Celui qui se rappellent les cabanes de leur enfance, etc.
Celui qui fait la gueule pendant que Madame regarde Les Experts/Celle qui est toujours en conférence/Ceux qui s’interrogent sur les mystères de la météo/Celui qui salue tous les matins le Drapeau/Celle qui parle du cash-flow de Vivendi au bar du Lutetia/Ceux qui disent que la plaine Monceau n’est plus ce qu’elle fut/Celui qui a tant aimé l’odeur des couches de ses enfants petits/Celle qui vitupère les chiens malpropres de la rue Legendre/Celui qui trouve que Bob Geldof a mérité le Prix Nobel de la paix/Celle qui a connu la cousine de Bob Geldof lors d’un séjour en Cornouailles/Ceux qui pensent que Bob Geldof est un Tour Operator travaillant sur l’Afrique/Celui qui prétend que Lou Reed est un meilleur poète que Jim Morrison/Celle qui a vu tous les concerts de Nico/Ceux qui ont bu des coups avec Reiser/Celui qui dit qu’il n’en a rien à foutre de l’atomisme de Démocrite/Celle qui prétend que Cauet gagne à être connu/Ceux qui se sont promis de mettre un pain sur la gueule de Cauet/Celui qui prétend que sa belle-sœur s’est tapé Poivre d’Arvor dans une boîte échangiste de Soulac-sur-mer/Celle qui se frotte au citron tous les soirs/Ceux qui écoutent Haydn les yeux fermées/Celui qui va chier dans le jardin du presbytère/Celle qui découvre les Evangiles apocyrphes et le dit à sa manucure/Ceux qui savent où se trouve Aldébaran/Celui punit ses enfants d’il ne sait quoi/Celle qui mate les gens pendant la prière/Ceux qui parlent de leur Admirable Compagne/Celui qui se rappellent les cabanes de leur enfance, etc.Rencontrer des gens est un privilège de mon activité de journaliste, dont je ne me lasse pas. Nanti de mon carnet de notes et de mon ordinateur portable, je grappille sans discontinuer impresssions et sensations, bribes de conversations et de lectures. Je me retrouve, dans ce quartier, plus de trente-cinq ans après y avoir erré comme une âme en peine, avec une vivacité d’esprit aussi aiguë que celle du garçon de vingt ans que j’étais, avec la même sourde conviction que tout cela a un sens, à quoi s’ajoute un certain bagage acquis depuis lors. Je me rappelle, comme d’aujourd’hui, le désarroi total dans lequel je me trouvais cette année-là, précisément au début de l’été 1968, qui m’amena au bord de la délinquance, avant certaine rencontre qui compta pour moi, de quelqu’un que je n’ai plus vu depuis trente ans… Or, resongeant à tous ceux qui ont compté pour moi, à un moment donné, et que j’ai perdus en route, je n’éprouve plus désormais la moindre tristesse, le moindre regret ni la moindre nostalgie, comme si tout cela procédait du scénario d’un film à la fois chaotique et cohérent, dont je poursuis aujourd’hui plus librement le tournage… (A Zurich, au Niederdorf, ce vendredi 27 janvier.)
C’est une nouvelle du feu de Dieu que Patriotisme d’Yukio Mishima qu’Amélie Nothomb m’avait recommandé, dont le tenant et l’aboutissant tragique s’expose dès les premières lignes: «Le 28 février 1936 (c’est-à-dire le troisième jour de l’Incident du 26 février), le lieutenant Shinji Takeyama du bataillon des Transports de Konoe – bouleversé d’apprendre que ses plus proches camarades faisaient partie des mutins et indigné à l’idée de voir des troupes impériales attaque des troupes impériales – prit son sabre d’ordonnance et s’éventra rituellement dans la salle aux huit nattes de sa maison partiulière. Résidence Yotsuya, sixième d’Aoba-Chô. Sa femme, Reiko, suivit son exemple et se poignarda». Voilà: c’est tout. Parce qu’il ne supporte pas l’idée de prendre les armes contre ses camarades, le jeune lieutenant se fait seppuku; et comme il sied à une femme de soldat, Reiko le suit immédiatement dans la mort. S’il avait eu le moindre doute à ce propos, le lieutenant eût poignardé Reiko lui-même avant de s’immoler. Mais il sait que la jeune femme (il y a moins de la moitié d’une année que les noces de ces deux exemplaires parfaits de la race nippone ont été célébrées) est entièrement prête à la totale observance du Décret sur l’Education qui ordonne au mari et à la femme de vivre en harmonie, interdisant ainsi l’épouse de contredire l’époux, sous la grave protection des dieux et le respect de Leurs Majestés impériales. «Même au lit, est-il précisé, ils étaient, l’un et l’autre, sérieux à faire peur. Au sommet le plus fou de la plus enivrante passion ils gardaient le cœur sévère et pur». Et c’est exactement ça: sévère et pure est cette histoire d’une toute jeune femme qui fait, avant même de connaître la décision du lieutenant, de soigneux préparatifs de répartition, entre ses amies d’enfance et camarades de classe, de ses kimonos et autres objets chers (un petit chien de porcelaine, un lapin, un écureuil, un ours, un renard exposés sur la radio), après quoi, comme elle s’y attendait, le lieutenant lui annonce son implacable résolution de s’ouvrir le ventre.
 Amélie Nothomb m’avait dit que cette nouvelle était l’un des plus beaux textes contemporains qu’elle connaissait, en ajoutant prudemment qu’elle ne cautionnait pas pour autant son côté «facho». Or je ne trouve rien là dedans que de conforme absolument à la règle d’un Empire et d’un ordre militaire rigoureux, sans quoi la tragédie n’y serait pas. Le tragique tient au dilemme insoluble devant lequel se trouve le lieutenant, qui sait que l’empereur va lui ordonner de châtier ses frères d’armes, sait qu’il ne peut désobéir au maître sacré ni tuer ses camarades.
Amélie Nothomb m’avait dit que cette nouvelle était l’un des plus beaux textes contemporains qu’elle connaissait, en ajoutant prudemment qu’elle ne cautionnait pas pour autant son côté «facho». Or je ne trouve rien là dedans que de conforme absolument à la règle d’un Empire et d’un ordre militaire rigoureux, sans quoi la tragédie n’y serait pas. Le tragique tient au dilemme insoluble devant lequel se trouve le lieutenant, qui sait que l’empereur va lui ordonner de châtier ses frères d’armes, sait qu’il ne peut désobéir au maître sacré ni tuer ses camarades.
Si la nouvelle de Mishima nous prend à la gorge et aux tripes, c’est parce que l’écrivain, si fasciné qu’il soit par ce Japon du Devoir Divin, est également un artiste, un psychologue et un poète d’une extraordinaire porosité, qui nous fait vivre, un instant après l’autre, le drame de Reiko, puis la dernière nuit des amants se chargeant d’un érotisme absolu, puis l’effrayante boucherie rituelle du seppuku (que Mishima vivra lui-même) à laquelle Reiko assiste sans faillir, enfin le geste ultime de la jeune femme sur elle-même. Tout cela, bien entendu, devrait se lire à la vitesse des idéogrammes, alors q’on passe ici du japonais au français par l’anglais. Mais la beauté de cette nouvelle, mélange d’inflexible pureté et de tendresse, la fulgurante rapidité du récit, la justesse de chaque sensation et de chaque émotion, passent les cloisons des langues et les obstacles des langues, autant qu’elles passent les barrières de cultures et de mœurs, de nations ou d’époque, participant bel et bien de la ressemblance humaine.J’ai parlé de conversation à propos d’Une vie divine, mais le mot est lesté d’un autre poids dans l’inoubliable Conversation en Sicile d’Elio Vittorini que, sans doute, Sollers jetterait aujourd’hui dans le sac des «auteurs lourds», comme il le fait des auteurs américains. Autant dire qu’on passe du salon français à ce qu’on pourrait dire l’éternel entretien de l’homme avec lui-même, à travers les siens, sa terre natale et ses souvenirs d’enfance, ici: les figuiers de barbarie et l’odeur du soufre que Silvestro, le fils déprimant à Milan que son père fait revenir en Sicile, retrouve avec le monde des humbles, ou les harengs et les fèves aux cardons de la Mamma. Ahimè tout cela est tellement lourd, n’est-ce pas?
A propos de conversation, il est très intéressant d’observer les dialogues d’Une vie divine, qui relèvent exactement de la non-conversation. Intéressant dans le soliloque, Sollers est absolument incapable de moduler un vrai dialogue, l’interlocutrice n’intervenant jamais qu’en faire-valoir, comme d’ailleurs tous les «personnages» féminins des «romans» de l’auteur.
Avec le «pesant» Vittorini, tout au contraire dialogue, les gens entre eux, la lumière et les parfums, les noms et les larmes…