 L’Auteur démasqué (19)
L’Auteur démasqué (19)
Ce texte est extrait d'une prose du poète Franck Venaille, intitulée Haine de la poésie et datant de 1979. Je l'ai tiré de la monographie, assortie d'une anthologie, que François Boodaert à consacrée à Venaille sous le titre de Je revendique tous les droits, parue à l'enseigne de Jeanmichelplace/poésie en 2005. Personne n'a identifié ce texte d'un poète trop souvent inaperçu quoique des plus remarquables, à (re)découvrir assurément.
« Comme arrachées d’un livre voici des feuilles, des pages, voici la part féminine des mots qui m’entourent. Qui parle ? D’où vient cette voix ? Et qui se cache derrière ce visage ? Je le sais à peine. Ne connais pas son nom. C’est une silhouette, un homme, quelqu’un que l’on rencontre, que l’on croise et sur lequel jamais on ne se retourne : des phrases, comme arrachées à un livre.
On ne sait rien de lui. Simplement je peux vous dire que l’été dernier on le voyait au Café Armandie chaque fin d’après-midi venir s’asseoir à une table de la terrasse où il se reposait. Souvent il portait sa main droite à la hauteur de sa vésicule. Un tic. Peut-être autre chose. A ceux qui s’étonnaient de la fréquence de ce geste il répondait simplement « j’ai mal parce que j’écris ».
Je ne connais pas son nom. Mais je sais qu’il travaille régulièrement à son bureau. Il s’entoure de livres. Il se protège avec des livres. Lorsqu’il va mal il ferme la porte de cette pièce, de ce lieu de fiction, et s’en va dans les rues maudissant l’écriture. Puis il revient. S’installe à sa place et demande pardon : comme arrachées d’un livre.
Un livre. Tenez. Kierkegaard raconte qu’étant enfant il demandait parfois à son père l’autorisation de sortir. Le vieil homme refusait, lui offrait cependant de le prendre par la main et de faire une promenade en parcourant en tous sens le parquet de la pièce. Alors, tout en marchant, le père décrivait – passants, voitures, fruits des étalages – tout ce qu’ils voyaient et saluait ses connaissances. Il semblait à l’enfant qu’au cours de la promenade le monde sortait du néant, que son père était Dieu et lui-même son favori… »

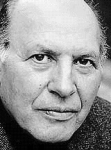
 Attention: chute d'anges (2)
Attention: chute d'anges (2)