
Le monde vu de l’Ecart
Le nom de Butor appelle ordinairement, comme par automatisme pavlovien, l’immédiate mention scolaire du Nouveau Roman et de deux livres incontournables, de L’Emploi du temps et de La Modification, à quoi se réduit pour beaucoup une œuvre aussi prolifique (plus de 1000 titres en bibliographie) qu’inaperçue, à quelques îlots près dont une série de lectures fameuses, de Balzac à Rimbaud.
Or il y a à la fois du lecteur universel chez Michel Butor, du critique éclairant et du poète de la même espèce poreuse, à la parole toute directe en apparence, mais lestée de sens, aux divers sens du terme, et diffusant une musique faisant elle aussi sens et pour les cinq sens pourrait-on dire en redondant doucement.
Une parfaite illustration, et peut-être la meilleure en ce moment précis où l’écrivain fête ses 80 ans, en est alors donnée par ce recueil récapitulatif de Seize lustres (seize lustres font juste 80 ans, selon la mesure romaine fixant les cinq ans de magistrature romaine ponctués chaque fois par un sacrifice) où, plus qu’une sage anthologie, l’on trouve le relevé poétique d’un parcours touchant à peu près tous les points de la circonférence terrestre (de Venise au Sahel ou des States au jardin de Bécassine) et dont le moyeu reste A l’écart, la maison du poète à Lucinges, non loin d’Annemasse et de Genève (Genève « où même la poussière est propre », tandis qu’à Annemasse « même le savon est sale »), à partir de laquelle se développe d'ailleurs un texte liminaire intitulé Ce qu’on voit depuis l’Ecart, qui ne dit pas autre chose : savoir qu’à l’Ecart on est au centre du monde, entre la plume du scribe et l’encrier des étoiles…
Michel Butor est virtuellement entré en poésie en 1926, « quand mon papa et ma maman faisaient l’amour entre leurs draps », et c’est sur le déclencheur magique de La baguette du sourcier, datant de 1990 (l’époque où il dispensait ses cours à Genève) qu’il ouvre ce recueil avec l’évocation du geste de l’ange bouclant les portes du Jardin d’Eden d’une main, sur ordre du dieu jaloux, pour bénir de l’autre le couple en faisant « lever un pain à chaque goutte répandue »…
La poésie de Michel Butor ne fait rien pour avoir l’air d’en être, ce qu’elle est pourtant, tandis que la poésie de Dominique de Villepin, qui fait tout pour en avoir l’air, n’en est pas l’ombre d’un semblant.
Or on lit, dans Passe et repasse, ces vers très peu villepiniens :
« Le fer du trafic ferroviaire
écrase les plis des talus
et celui des camions-citernes
roussit les parkings d’autoroutes
où les vacanciers font des tresses
tentant de doubler les copains
avant de s’enfiler aux peignes
qui les délestent de leurs sous »…
C’est une poésie qu’on pourrait dire, pour faire la nique aux mânes de Mallarmé, positivement journalistique, à cela près qu’elle est de la poésie et non du journalisme, disant par exemple encore ceci dans L’Arrière-automne :
« Et l’on était suspendu aux nouvelles
il y avait des menaces de guerre
dans un autre continent il est vrai
mais s’il y avait mondialisation
c’était bien dans l’appesantissement
de ces ailes ténébreuses partout
Les arbres suffisamment à l’abri
gardaient leur feuilles approfondissant
leurs couleurs et l’on avait l’impression
qu’elles disaient individuellement
écoutez-moi contemplez-moi sauvez
la formule que je vous ai trouvée »
C’est cela même : comme l’arbre, le poète trouve des formules. Or je sens que, ce livre-là, je vais me le garder ces jours à portée de main, car il va de soi que Seize lustres ne parle pas que d’autoroutes et de mondialisation et que la poésie c’est tous les jours…
Michel Butor. Seize lustres. Gallimard, 273p. 2006.

 Houellebecq et les lemmings…
Houellebecq et les lemmings…
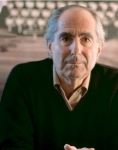

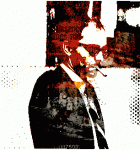 Nous sommes en train de tourner un film, avertit Godard, avec tel ou tel matériau et pour dire ceci et cela que vous trouverez entre les lignes des sous-titres, avec le supplément de tout ce que raconte le cinéma à sa façon, vous voyez quoi ?
Nous sommes en train de tourner un film, avertit Godard, avec tel ou tel matériau et pour dire ceci et cela que vous trouverez entre les lignes des sous-titres, avec le supplément de tout ce que raconte le cinéma à sa façon, vous voyez quoi ?