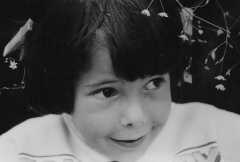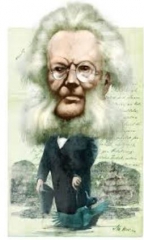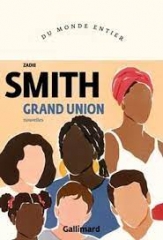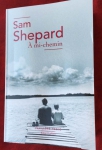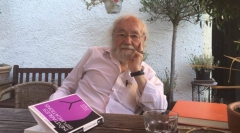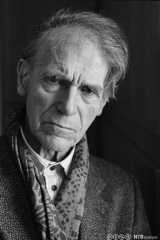À propos des paquets de réalité qu'on prend en pleine gueule, et de la difficulté d'en tirer un récit cohérent. Quelques messages échangés avec Quentin Mouron, le dernier polar de Michael Connelly et celui de l'auteur romand Julien Sansonnens. De la fureur compulsive de Snoopy à lécher sa patte blessée, etc.
Le retour à la case casa est toujours un moment riche en sentiments-sensations confus, marqué notamment par la retrouvaille des odeurs familières, avec quelque chose de fruité et de vaguement somnolent qui se réveille au réveil des objets que nous retrouvons et qui nous murmurent des choses.

Le "Proust norvégien" Karl Ove Knausgaard est particulièrement attentif à ce genre de détails, qu'il capte et restitue, dans sa langue claire et prégnante à la fois, avec la même justesse précise qui lui fait décrire l'épave d'une voiture dans une forêt ou suggérer les relations physiques entretenues par un jeune garçon avec ses parents: "Grand-mère était la seule qui nous touchait, Yngve et moi, la seule qui nous embrassait et nous touchait le bras", etc.

Et pour la voiture retournée à l'état de nature: "Oh l'odeur de la vieille épave de voiture dans la forêt humide ! L'odeur de synthétique de sièges lacérés, auréolés et moisis, forte et presque fraîche comparée au parfum lourd et profond des feuilles en décomposition qui l'entourait de toute part. Les joints décollés qui pendaient des fenêtres, noirs comme des tentacules. Le verre en mille morceaux, disparu en grande partie dans la terre, gisant sur les tapis et sur le suis de sportives comme autant de petits diamants mats. Oh les tapis noirs ! Vous les secouiez un peu et une horde de petites bêtes affolées fuyait de tous côtés. Araignées, faucheux et cloportes. La résistance des pédales qu'on ne pouvait pratiquement plus enfoncer. les gouttes qui, traversant le pare-brise, nous tombaient directement sur la figure chaque fois que le vent les faisait dévier de leur trajectoire ou tomber des branches qui se balançaient juste au-dessus. Parfois, on trouvait des choses aux alentours, beaucoup de bouteilles, des sacs plastique contenant des magazines auto ou pornos, des paquets de cigarettes vides, des bidons vides de liquide lave-glace,un préservatif, une fois on avait m'aime trouvé un slip plein de merde. Qu'est-ce qu'on avait ri ! Quelqu'un avait chié sur lui et jeté son slip dans la forêt !"
Hier soir, juste avant le crépuscule genre décor d'opéra romantique, j'ai continué de lire À l'ombre des jeunes filles en fleurs aux waters de La Désirade, et je me surprenais là aussi d'être scotché à l'incroyable embrouillamini psychologique du petit Marcel fuyant Gilberte pour être plus sûr qu'elle lui revienne et lui dise qu'elle ne l'aime pas histoire de relancer sa passion à lui quitte à la faire décamper - tout ça dans le même paquet de réalité qu'on prend en pleine gueule comme l'autre jour les vagues soulevées par le vent de mer et ma peine à rester debout du fait de la putain de douleur plantaire dont j'espère être débarrassé après-demain sur l'intervention chirurgicale d'un docteur à nom rital, etc.

Autre épisode sur la Piste Santé: Notre cher ami et voisin Philip Seelen a passé l'autre jour deux minutes de l'autre côté du miroir, tenu pour mort par l'équipe médicale en train de le travailler au coeur , mais il n'a rien eu le temps de voir de l'outre-monde, ou alors il garde ça pour lui, ce qui est sûr, c'est que cinq minutes lui eussent été fatales, et puis non: ce n'était pas l'heure, ouf le louf...
D'où la bonne conversation que nous avons pu avoir hier soir, chacun en face de son laptop, sur divers artistes peintres-photographes-plasticiens plus ou moins attachés à la représentation critique de l'hyperréalité, tels que le chinois Yan Pei- Ming dont je lui ai montré les images que j'ai faites de ses œuvres exposées à Sète, L'Allemand Gottfried Helnwein qu'il a rencontré perso il ya quelques années, l'italien Luca del Baldo aux portraits rappelant ceux de Lucian Freud et l'Américain Terry Rodgers aux orgies silencieuses et aux bords de mer crépusculaires.

À propos d'orgie, j'ai tout de suite été accro à la lecture du polar que Julien Sansonnens m'a envoyé pendant notre absence, intitulé Les ordres de grandeur et entremêlant plusieurs récits (d'une étudiante qui se fait kidnapper au bord du lac et maltraiter ensuite par un taré, d'un présentateur vedette de télé du genre brillamment puant, et d'un couple plus tranquillement en quête de bonheur simple) avec une empathie froide pour les froids et plus chaleureuse pour les chaleureux doublée d'une étonnante maîtrise narrative: travail de pro comme celui, toute proportions gardées, de Michael Connelly, vieux routier du thriller social retrouvant les gangs de L.A. dans Mariachi Plaza.
Or l'évocation de la partie fine en milieu de riches affairistes à laquelle participe le bellâtre médiatique, dans les cent premières pages du roman de Julien Sansonnens, m'a semblé aussi nette et concise qu'il le fallait vu qu'un tableau plus appuyé de ce genre de partouzes reste l'apanage de Gérard de Villiers & co et pas d'un garçon sérieux...

Nous avons en outre pas mal échangé hier soir sur Messenger, avec Quentin Mouron, qui se trouve ces jours au Québec et me demande si cette suite de Pour tout dire, qu'il a l'air d'apprécier, constituera un nouveau recueil genre carnets. Je lui réponds que cette série, se développant depuis un mois à partir de la découverte de l'autobiographie de Karl Ove Knausgaard, est un rameau indépendant poussé sur le tronc de mes Lectures du monde, qui se propose d'entremêler une narration quotidienne aux côtés de Lady L. et Snoopy , plus nos filles et leur jules, avec l'écho de mes lectures et autres rencontres, Shakespeare devant succéder à Knausgaard avec regards latéraux sur Dante revisité par Alberto Manguel, la catastrophe stratégico-humanitaire du Moyen-Orient et tutti quanti, cela en 1001 pages pour la Saison 1, et ensuite on enchaîne dans la foulée des After d'Anna Todd - tu vises l'ambition...
Miracle de la technologie de pointe (j'ai pianoté les 135 premières pages de Pour tout dire sur mon iPod, tantôt couché entre Lady L. et Snoopy, et tantôt attablé à une table de café voire dans une salle d'attente d'hôpital, si ça se trouve), Quentin m'apprend ce matin qu'il est "sur" un nouveau roman dans lequel il reprendra sa peinture à l'acide de notre drôle de monde, et voilà qu'à son tour Julien Sansonnens m'envoie un texto où il me remercie d'avance de le lire sans lui épargner d'éventuels commentaires critiques.
Tout cela me plaît d'autant plus que l'un des thèmes sous-jacent du Viol de l'ange, dont le premier titre était Roman virtuel, travaille cette nouvelle réalité de la perception simultanée qui fait s'empiler et s'entre couper, se télescoper et se court-circuiter une quantité Q de plans de réel, comme dans un roman d'Antonio Lobo Antunes ou un film de Godard revu par quelque youngster à la Xavier Dolan shooté au Coca Zéro, etc.
Et Snoopy là-dedans ? Snoopy se lèche compulsivement la patte droite, que Lady L. est obligée de lui bander pour l'en empêcher, avant qu'il ne l'arrache dès qu'elle a le dos tourné. Ainsi était Marcel Proust le grand blessé de la vie, qui grattait sa plaie à qui mieux mieux pour s'en délecter du récit, et nous avec, etc.


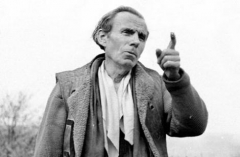 Dans la littérature française du XXe siècle, un Louis- Ferdinand Céline y est parvenu au fil d'extraordinaires pages évoquant la guerre, donnant du galon stylistique à ce qu'un Guido Ceronetti, à son propos, appelait le fantastique social. On peut vomir les pamphlets antisémites de Céline, relevant de son TOUT DIRE porté au délire paranoïaque, mais ses visions de témoin épique du désastre restent incomparables, et l'on mesure l'affadissement terrible d'une certaine critique faisant la fine bouche devant l'intrusion du réel dans le roman contemporain (le même Céline idiotement taxé de "populiste" dans une polémique franco-française débile) alors que
Dans la littérature française du XXe siècle, un Louis- Ferdinand Céline y est parvenu au fil d'extraordinaires pages évoquant la guerre, donnant du galon stylistique à ce qu'un Guido Ceronetti, à son propos, appelait le fantastique social. On peut vomir les pamphlets antisémites de Céline, relevant de son TOUT DIRE porté au délire paranoïaque, mais ses visions de témoin épique du désastre restent incomparables, et l'on mesure l'affadissement terrible d'une certaine critique faisant la fine bouche devant l'intrusion du réel dans le roman contemporain (le même Céline idiotement taxé de "populiste" dans une polémique franco-française débile) alors que

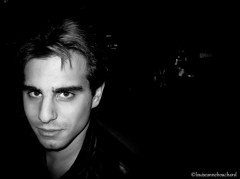

 À propos du caractère diabolique de l'écrivain de caractère. Ce que m'en dit Georges Haldas à notre première rencontre. Des raisons qui ont poussé certains proches de Karl Ove Knausgaard à l'attaquer publiquement. De la tendance actuelle à recourir aux avocats ou aux juges sur tout et n'importe quoi, y compris les rumeurs infondées, etc.
À propos du caractère diabolique de l'écrivain de caractère. Ce que m'en dit Georges Haldas à notre première rencontre. Des raisons qui ont poussé certains proches de Karl Ove Knausgaard à l'attaquer publiquement. De la tendance actuelle à recourir aux avocats ou aux juges sur tout et n'importe quoi, y compris les rumeurs infondées, etc.