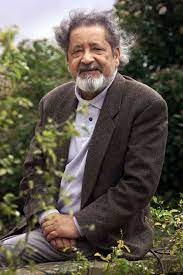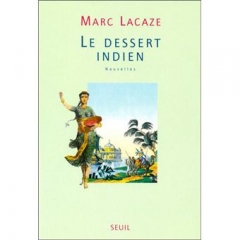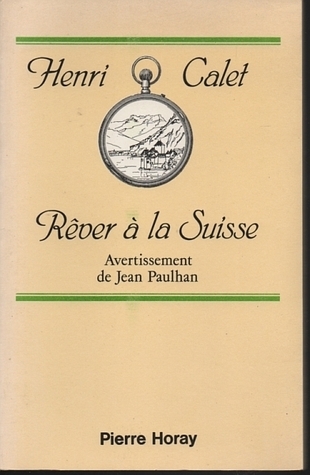(Lectures du monde, 2018)
À LIRE ET À VOIR. - J’avais promis à Lady L. de ne pas acheter de nouveaux livres mais c’est mal parti puisque me voici, à la terrasse de la pizzeria Da Bartolo, attablé avec les Journaux de voyage de Bashô, traduits et présenté par René Sieffert, après avoir acheté aussi l’un des derniers récits autobiographiques de Thomas Wolfe, Mon suicide de Roorda, un essai sur la lecture d’Edith Wharton, un recueil de récits d’Antonio Tabucchi et trois volumes de poèmes de William Cliff parus au Dilettante…
En visitant ce matin l’exposition consacrée au jeune Tintoret, au Musée du Luxembourg, où j’ai passé moins de temps dans les salles qu’à patienter dans la file d’attente, j’ai été content d’identifier, assez rapidement, les parties vraiment originales, pour ne pas dire géniales, traduisant plus qu’un métier accompli: des moments de liberté totale, voire de folie, ou de plus profonde vision dans ses grands portraits de Nicolò Doria ou du vieil homme du Kunsthistorisches Museum, de Vienne dont parle tant Thomas Bernhard dans Maîtres anciens.
AU YUSHI. - Très bonne soirée d’hier en compagnie de RJ, au petit restau japonais de la rue des Ciseaux, tout près de La Perle, où il a sa bouteille de whisky et une chaise à son nom comme un metteur en scène de cinéma. Le courant a tout de suite passé entre nous, facilité par nos nombreux échanges récents sur Facebook. La première chose qu’il m’a dite se rapportait à tout le bien que Pierre-Guillaume de Roux lui a dit à mon propos, qui m’a surpris et réellement touché. Ensuite la conversation, très nourrie et très variée, s’est poursuivie assez tard sans la moindre affectation, comme si nous nous connaissions depuis tout le temps… (Ce jeudi 15 mars)
SYLVOISAL. - Je me disais ce matin que j’aurai eu la chance de connaître un être d’exception, doublé d’un poète aussi singulier que volontairement méconnu, en la personne de Gérard Joulié, mon vieil, ami depuis 1973, éternel enfant vieille France et prince des lettres à sa façon. Or je m’efforcerai, un de ces jours prochains, de rendre justice à l’auteur des Poèmes à moi-même, d’une qualité supérieure, dont la densité et la vigueur, la plasticité et la profondeur, sont des plus rares.
L’époque est à la fois à l’exhibition et au voyeurisme, aussi l’exercice de liberté consiste-t-il à échapper à l’un et à l’autre en évitant de plus en plus les intermédiaires médiatiques de toute sorte où prolifèrent l’opinion jetée et la jactance.
SIMULACRES. - On apprend ce matin qu’une famille de quatre personnes a été assassinée aujourd’hui à Mexico. Ah bon ? Et après ? Combien de cambriolages la nuit dernière à Cleveland ? Combien de meurtres à Melbourne ou à Medellin ? Et au nom de quoi en serions-nous comptables ou solidaires ? Le simulacre mondial voudrait que l’on se torde les mains et brandisse son cœur, mais je n’ai cure du simulacre. Fuck the simulacre !
À UN AMI. - J’ai commencé ma semaine avec un poème - bon poème je trouve -, que j’ai dédié à Thierry Vernet :
La beauté de l’objet
soit la seule mesure de la chose.
Rien n’ira par hasard.
À l’établi l’orfèvre
est concentré sur son art
tout humble d’artisan
qui cisèle des roses -
ou cet objet secret
révélé par son autre part.
On ne sait rien d’avance
de l’eau sur laquelle on ira
là-bas dans le miroir
d’un ciel à jamais incertain.
L’objet se révèle à mesure
qu’on oublie d’y penser.
Le chant s’élève et dure
le temps de ne pas oublier.
REVIF. - Ce jour restera marqué, pour moi, d’une pierre blanche, puisque, au-delà de ce que j’en attendais, m’est arrivé un message de Pierre-Guillaume de Roux qui qualifie les textes de La Maison littérature, que je lui ai envoyée la semaine passée, de «merveilleux» et me dit qu’il sera «mon homme» pour la réalisation de ce livre.
J’en ai été touché aux larmes en m’exclamant «enfin !!!», non tant pour la perspective de publier à Paris que pour avoir suscité un écho aussi prompt que chaleureux que je désespérais d’obtenir depuis des années.
Ah mais quel sentiment de revivre, soudain ! (Ce mercredi 28 mars)
PROUST : « En réalité, chaque lecteur est quand il lit le propre lecteur de soi-même. L’ouvrage de l’écrivain n’est qu’une espèce d’instrument d’optique qu’il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que sans ce livre il n’eût peut-être pas vu en soi-même. La reconnaissance en soi-même, par le lecteur, de ce que dit le livre, est la preuve de la vérité de celui-ci, et vice versa, au moins dans une certaine mesure, la différence d’entre les deux textes pouvant être souvent imputée non à l’auteur mais au lecteur ». (Le Temps retrouvé)
CONNIVENCE. - Premier téléphone avec Pierre-Guillaume de Roux, de presque une heure. Tout à fait sur la même longueur d’ondes. Nous nous verrons le 19 avril prochain. D’ici-là je vais foncer sur la mise au net de La Maison Littérature que je lui présenterai dans une forme à la fois plus fluide et (re)construite, mais quel soulagement en attendant ! (Ce jeudi 29 mars)
MOI ET ELLES. - Misogyne moi ? Pas que je sache. Mais plutôt sur la réserve ou plus ou moins en fuite dès que se profile une emmerdeuse du style du Petit bout de femme de Kafka, entre autres specimens du genre.
Par ailleurs, aucun goût pour l’érotisation de la femme, sauf au Japon ou au cinéma, et la vision du porno féminin m’est carrément insupportable. Les mecs c’est autre chose: je les vois comme des compères forestiers ou des camarades de ruisseau, style gréco-romain. En fait, le hard homo a quelque chose du cirque hilarant que pointait Nabokov à propos des romans de Genet. Mais à tout prendre je préfère, sublimées par l’art, les fesses rebondies du jeune homme de la Résurrection de la chair de Luca Signorelli, au dôme d’Orvieto. Permission d’enculer de l’œil, si l’on peut dire…
BRIBES. - Le café au lait coûte 4 francs 50, et le croissant 1 franc 60. Cela me semble excessif, mais c’est la Suisse, où les hôtels sont les plus chers du Vieux-Continent.
Assez impressionné par la lecture de L’Implacable brutalité du réveil de Pascale Kramer, que je vais achever sur le trajet Lausanne-Paris, parfois à la limite de l’agacement tant on est sur l’exacerbation du malaise de cette mère refusant son état, et pourtant non: tout cela tient à la fois psychologiquement et littérairement, dégageant une espèce d’âpre poésie. (Au fond de l’Angel’s Bar, à Montreux, en attendant le train de Lausanne d’où je partirai à Paris à midi, ce 17 avril)
APORIE. - Jamais je n’ai été capable de noter quoi que ce soit de précis et de continu, dans mes carnets, qui se rapporte à ma «vie sexuelle». Les mots m’ont toujours manqué. Et les rares fois que je m’y suis essayé cela sonnait creux ou faux, pour ne pas dire aussi ridicule que si je m’étais appliqué à parler de ma «vie spirituelle»…
JACCARDO. - Soirée au Yushi avec Roland et deux écrivains sympathiques dont je n’ai d’abord compris le nom que d’un seul : Patrick Deklerck. Très bien les deux. Nous avons pas mal ri. Je me sens avec Roland, très naturel et très libre. En fin de soirée j’ai sympathisé avec Mark Greene, l’autre compère, qui me plaît beaucoup et m’a promis de m’envoyer son prochain roman, à paraître chez Grasset sous le titre de Federica B.
En somme, la qualité rare de RJ est de mettre les gens en relation et de faire apparaître les choses – il incite chacun à sortir du bois. Je l’avais d’ailleurs déjà remarqué il y a plus de quarante ans de ça, je ne sais plus où, peut-être à L’Âge d’Homme ou peut-être en Grèce où il m’a dit que nous nous étions croisés en 71 ou 72 sans que je me le rappelle bien. Cette qualité, mélange de curiosité vive et de plaisir plus louche de voyeur, se retrouve dans sa façon de poser et de s’exposer dans son journal, qui recoupe ma propre propension à l’aveu sans aveu… (Ce 18 mars)
JOUR J. - C’est aujourd’hui le jour J pour moi et mes livres, avec la rencontre ce soir de Pierre-Guillaume de Roux, dont j’attends le meilleur. Nous avons parlé de lui hier soir au Yushi, et plus j’entends parler de la fronde des bien-pensants contre le fils de Dominique, notamment après le lynchage hideux de Richard Millet, et plus je me sens conforté dans mon choix de n’être pas du côté de la lâche meute du milieu médiatico-littéraire, mais de celui d’un homme à la vraie passion littéraire, indépendant et courageux.
(Soir). – La rencontre avec Pierre-Guillaume s’est passée au mieux. Je l’ai rejoint à vingt heures en son bureau de la rue de Richelieu, auquel on accède par un escalier très pentu et dont le beau désordre m’a rappelé celui de L’Âge d’Homme avec, au mur, en face d’une grande toile incandescente de Mircea Ciobanu, des portraits de son père et de Dimitri, de Pound et de je ne sais plus qui. Je ne me le rappelais pas si grand, je lui ai découvert de très belles mains et une façon de rire presque silencieuse, mais surtout je ne m’attendais pas à signer si vite le contrat en bonne et due forme qu’il avait déjà préparé, ce que j’ai fait en le lisant en croix avant de lever le camp, avec une douzaine de ses livres plus ou moins récents, dont le génial Tarr de Wyndham Lewis, pour un restau italien du quartier où nous avons parlé très librement et pêle-mêle de tant de nos souvenirs communs et de tout ce qui nous importe sans discontinuer, jusque tard. (Ce jeudi 19 avril)
PIERRE REVERDY : «Nous sommes, je le crains, dans la saison des petits bonshommes et des grands mauvais hommes Quand ces grands mauvais hommes sont à bas, il ne reste plus que les petits bonshommes bavards». (En vrac).
CONCLUSION. - Passablement rétamé ce matin, après une longue et joyeuse soirée au Yushi en compagnie de Roland et de son impayable ami américain Steven Sampson, plus une sympathique et questionneuse Angélique. Pour qualifier mon séjour, Roland s’est exclamé : «Mais c’est un triomphe !», ce que j’ai nuancé en parlant de mon réel et profond bonheur d’avoir rencontré Pierre-Guillaume, en lequel je pressens, plus que l’éditeur rêvé : un ami… (Ce samedi 21 avril)
ROLAND JACCARD : «Mais peut-être en est-il des livres que nous avons lus comme de ceux que nous avons écrits : s’ils ne nous ont pas appris à nous en passer, c’est qu’ils n’auront servi à rien ». (Flirt en hiver).
L’ENFANT. - Hier avec Julie et Anthony, nos douces lumières. RJ me fait sourire avec sa récurrente façon de dénigrer la vie, les enfants et les mères à la suite de Cioran et Schopenhauer: cela ne m’en impose pas le moins du monde ni ne m’oppose à lui, mais je donnerai tout Cioran et Schopenhauer pour un sourire de cet enfant. (1er mai)
MAI 68. - Les commémorations de mai 68 ont quelque chose de convenu et de remâché qui m’est à vrai dire insupportable, comme si personne à vrai dire n’y croyait que quelques jobards. La célébration du bon vieux temps ou de «nos meilleures années» m’a toujours horripilé, et le pire est aujourd’hui qu’on y ajoute de l’amertume ou qu’on idéalise la chose aux yeux des nouvelles générations qui, de toute façon, n’en ont rien à braire.
Tout ça me rappelle le plus bourgeois de nos rédacteurs en chef s’exclamant avec cette espèce de veulerie du conformiste satisfait: «Enfin c’est vrai, quoi, moi aussi j’ai lancé, comme tout le monde, deux ou trois pavés en mai 68»…
VIEILLIR. - Téléphone à l’abbé. Ni l’un ni l’autre n’est enchanté de vieillir, mais la conversation reste vive et joyeuse. Me dit que Philippe Jaccottet ne va pas bien. Tout faible et furieux, récemment, d’avoir été récompensé par je ne sais quel prix de l’Académie française. Après la Pléiade, il préférerait maintenant qu’on lui foute la paix. (Ce jeudi 10 mai)
Tout le monde se met à écrire et c’est donc la fin de la littérature.
AVEC L’ABBÉ. - Bon moment ce midi avec l’abbé Vincent, à l’auberge de la Gare de Grandvaux. La conversation dense et de plus en plus libre. Il me raconte ses lectures en rapport avec le substrat humain du Grand Œuvre, notamment de Leopardi, Rilke, Mallarmé ou Lorca. Et c’est lui, le prêtre, qui évoque le mal qu’a pu faire la religion dans certaines vies, dont celle de Federico Garcia Lorca précisément ! Et c’est moi qui corrige : l’idéologie religieuse, plus que la religion. Mais sais-je seulement ce que signifie en réalité ce terme de religion ?
(SOIR) - J’ai fini ce matin de coller, dans mes albums chinois, les 500 pages du premier état complet de La Maison Littérature devenue Les Jardins suspendus, à partir desquelles je vais façonner la mouture définitive que je remettrai à Pierre-Guillaume de Roux le 14 juin prochain, jour de mon 71e anniversaire...
(Ce mercredi 16 mai)
AMIEL. – RJ m’envoie les épreuves de son prochain livre évoquant Les derniers jours d’Amiel, dont je me suis illico régalé. Se glisser dans la peau du cher pusillanime et rester crédible en le faisant évoquer ses successifs fiascos amoureux relevait de l’acrobatie, mais c’est tout en tendre souplesse, et non seulement en profond connaisseur du sujet, que Roland s’y colle sans se priver de délicieux anachronismes et sans guigner au coin de la page comme Hitchcock à l’écran, avec quelque chose en plus, dans la tonalité et la tournure d’une histoire rappelant – par contraste évidemment – celle d’Adolphe en beaucoup plus coincé, qui serait de la plume de Benjamin Constant plutôt que de celle d’Amiel. Mais quel beau cadeau notre ami fait donc à celui-ci, qui devrait adoucir et même émoustiller son séjour sur les corniches arides du Purgatoire.
BILAN CARDIO. - Les derniers examens relatifs à mon état cardiaque et vasculaire n’indiquent rien d’inquiétant, tout en révélant les traces d’un infarctus dont je n’ai rien senti quand il s’est produit sans conséquence aiguë, mais je n’éprouve pas moins, souvent, un manque de souffle assez pénible à la montée et de lancinantes douleurs aux jambes et aux articulations. Cela étant je me trouve au top de ma santé psychique et mon livre en chantier me tire en avant comme Snoopy dans la chemin d’accès à la Désirade… (Ce 18 mai)
FLASH BACK. - L’idée m’est venue, pendant la nuit, de consacrer ma prochaine chronique (la 40e) du média indocile Bon Pour La Tête à une série de Je me souviens toute dédiée à ce que fut pour moi mai 68, pendant et après. Ce me sera l’occasion de préciser ma position par rapport à l’idéologie, qu’elle soit de gauche ou de droite, et de pointer à la fois ce qui m’a attiré d’un côté ou de l’autre et ce qui m’en a détourné, non pas en un jour ni même en une année mais dans le temps de successives expériences. Or je crois que ce terme est clef pour moi : l’expérience. (Ce dimanche 20 mai)
Je me souviens d’avoir cessé d’être gauchiste en mai 68
Je me souviens d’avoir souscrit, en 1967, à l’anniversaire de ma naissance un 14 juin, le même jour qu’un certain Che Guevara, à la phrase de Paul Nizan: «J’avais vingt ans et je ne permettrai à personne de dire que c’est le plus bel âge de la vie»…
Je me souviens qu’à dix-neuf ans, durant mon premier séjour en Pologne, j’ai découvert l’usine à tuer d’Auschwitz et le socialisme réel vécu par la famille de l’ingénieur L. qui nous avait reçus à Wrocław, mon compère U. et moi…
Je me souviens d’avoir conseillé à l’ingénieur polonais L., petit con que j’étais, de patienter jusqu’à la réalisation réelle du socialisme socialiste dont il avait, en 1966, quelques raisons de douter…
Je me souviens de la petite fille à l’énorme bouquet de fleurs, au milieu de l’immense stade de Wrocław rempli de jeunes socialistes en uniformes, qui s’écria dans le micro, à propos de l’agression impérialiste des Américains au Vietnam: «Protestujem!»…
Je me souviens des tas de cheveux et des tas de prothèses et des tas de jouets dans l’usine à tuer transformée en sanctuaire de mémoire, et de l’odeur des saucisses vendues à l’entrée, et de leur graisse sur nos mains innocentes…
Je me souviens du terrible choc éprouvé à la découverte, en pleine nuit, des barbelés et des miradors du Rideau de fer à la frontière de Berlin-Est, et de la gratitude des jeunes douaniers polonais auxquels nous avions offert un tourne-disques portable dernier cri et la version originale des Portes du pénitentier par The Animals…
Je me souviens de cette autre nuit, en mai 68, où notre caravane de Deux-Chevaux débarqua dans la cour de la Sorbonne avec son précieux chargement de plasma sanguin destiné aux camarades révolutionnaires blessés sur les barricades…
Je me souviens de la folle animation de cette nuit-là, et des suivantes, dans les auditoires bondés de la Sorbonne, et des Katangais dormant dans les couloirs et ne participant guère plus aux «prises de paroles» que nos camarades filles…
Je me souviens de notre perplexité, avec mon ami R. étudiant de première année en médecine, quand nous entendions parler, sur les terrasses ensoleillées du quartier de l’Odéon, de la Révolution comme d’une chose irréversiblement accomplie…
Je me souviens de la même perplexité ressentie par Samuel Belet, le personnage de Ramuz, quand il entend les communards, en 1870, parler de la Révolution comme d’une réalité non moins irréversiblement accomplie…
Je me souviens de notre semblable perplexité, avec Lady L. et notre ami Rafik Ben Salah, en juillet 2011, quand toutes et tous parlaient, dans les rues encore en liesse de La Marsa, de l’irréversible révolution du Jasmin après laquelle rien ne serait plus jamais comme avant…
Je me souviens de la reprise en mains annoncée, dès la fin des vacances de l’été 68, par notre leader de la Jeunesse progressiste lausannoise impatient de nous voir nous remettre au Travail, étant entendu qu’il fallait au moins trois ans pour devenir communiste…
Je me souviens de la mine horrifiée de notre chère tante E. pour laquelle le socialisme était «le diable» (ce qu’elle m’avait répondu lorsque je lui avais posé la question vers l’âge de sept ans), alors que le communisme était encore «pire que le diable», quand elle découvrit sur les murs de ma chambre les affiches de mai 68 ramenées des ateliers des Beaux-Arts du Quartier latin dont l’une proclamait: Aimez-vous les uns sur les autres…
Je me souviens d’un premier doute éprouvé lorsque je me suis vu présenter le sociologue Marcuse, à la télé romande, au titre d’étudiant progressiste argüant du fait que la théorie de L'Homme unidimensionnel devait être «expliquée aux masses»…
Je me souviens d’avoir éprouvé le même sentiment de ridicule en m’entendant parler à une Assemblée extraordinaire de l’université réunie en octobre 1968 dans l’aula du palais de Rumine où j’évoquais la constitution des groupes de fusion et l’urgence de rallier le prolétariat et les camarades paysans de l’arrière-pays - avec la sensation physique d’avoir dans la bouche une langue de bois.
Je me souviens de mon premier papier d’aspirant journaliste de quatorze ans, dans le journal Jeunesse des Unions chrétiennes (YMCA) consacré au pacifisme et à l’objection de conscience…
Je me souviens de la petite revue des Etudes soviétiques que je lisais à quinze ans à la Bibliothèque des Quartiers de l’Est avec l’impression d’entrer en subversion…
Je me souviens du prof et écrivain Jeanlouis Cornuz qui me poussa à seize ans à lire le fameux Jean Barois de Martin du Gard après que je lui eus déclaré que la lecture de son roman Le Réfractaire m’avait conforté dans la conviction que l’objection de conscience s’imposait au niveau éthique…
Je me souviens des Chiens de garde de Paul Nizan dénonçant les philosophes idéalistes du début du siècle, et du commentaire que j’en avais fait dans L’Avant-garde, organe ronéotypé de la Jeunesse progressiste, en visant nos profs de philo aux cours desquels je pionçais…
Je me souviens de la réprobation de notre leader de la Jeunesse progressiste me surprenant à lire du Céline (ce facho) et du Cingria (ce réac), et de mon excessive timidité m’empêchant de l’envoyer promener…
Je me souviens de ma propre réprobation muette quand mes camarades taxaient Beethoven de musicien bourgeois ou les Rolling Stones de rebuts de la décadence capitaliste…
Je me souviens de mon incapacité totale de suivre les cours d’économie politique du professeur Schaller, que je taxais dûment de valet du capitalisme dans un autre article de L’Avant-garde…
Je me souviens que la matinée ensoleillée de mon premier examen d’économie politique s’est passée dans une clairière de la forêt de Rovéréaz à lire Je ne joue plus de Miroslav Karleja, et que de ce jour date la fondation de mon université buissonnière…
Je me souviens de mon incapacité de jeune journaliste à parler des débuts du tourisme de masse (mon premier reportage en Tunisie, en mai 1970) en termes marxistes, au dam de mes anciens camarades qui m’estimèrent dès lors vendu à la presse bourgeoise…
Je me souviens de tout ce que j’ai appris de l’anarchiste Morvan Lebesque (l’un des grandes plumes du Canard enchaîné de années 60-70) et des sociologues marxistes Henri Lefebvre et Lucien Goldmann, ces princes de la critique de gauche…
Je me souviens que l’écrivain fasciste Lucien Rebatet, dont j’avais lu Les deux étendards avec passion, et que je suis allé interviewer en 1972 en me fichant de ce qu’on en penserait, me dit que s’il avait eu mon âge, en 68, il eût été maoïste...
Je me souviens du camarade monté sur une table de ce bistrot enfumé dans lequel je me trouvais pour hurler qu’il fallait me tuer au motif que j’avais rencontré cette ordure absolue de Rebatet…
Je me souviens de mon interview d’Edgar Morin revenu de Californie avec un Journal aux vues prémonitoires…
Je me souviens du roman Mao-cosmique publié sans nom d’auteur à Lausanne et restituant avec justesse et mélancolie le climat de ces années-là dans une communauté frappée par la mort d’un de ses membres – et je me souviens du mécontentement vif de Claude Muret, l’auteur en question, dont j’avais cru bon de révéler l’identité dans un papier fort élogieux de la Gazette de Lausanne…
Je me souviens des belles années du bar à café Le Barbare, et de la Fête à Lausanne, et de nos amours mêlées, et du Festival international de théâtre contemporain à l’esprit indéniablement soixante-huitard.
Je me souviens de la réapparition de Lady L. aux abords du Barbare, dix ans après notre premier flirt, dont la coupe de cheveux à la Angela Davis signalait son appartenance au Groupe Afrique, et de nos retrouvailles définitives scellées quelques années plus tard par la naissance de deux futures jeunes filles en fleur…
Je me souviens de ceux qui sont morts, et de ceux dont je ne suis pas sûr qu’ils soient encore vivants…
Je me souviens que je dois aux dogmatiques de gauche et de droite de m’avoir éloigné de leurs idéologies respectives…
Je me souviens de notre bohème des années 60 avec une tendresse croissante quoique de moins en moins sentimentale, etc.
TRAVAIL. - La préparation des Jardins suspendus m’enchante à proportion de l’écoute réelle de Pierre-Guillaume, que je n’ai trouvée jusque-là qu’avec Dimitri pour mes deux premiers livres, et ensuite avec Bernard Campiche, sur huit ouvrages magnifiquement édités, jusqu’ à l’incompréhensible clash de notre relation, au prétexte insignifiant mais exacerbé par son délire victimaire, suivi des humiliations qu’il m’a fait subir équivalant à une mise à mort mais dont je ne lui en veux pas dans la mesure où elle procédait d’un esprit malade et d’un cœur blessé. Tout au contraire, la relation avec PGDR se fait dans la confiance et le naturel, la simplicité et le respect; et je sens que toute une communauté d’esprits vit la même relation avec lui où voisinent, si divers, Roland Jaccard et Michel Lambert, mon ami Gérard Joulié et Philippe Barthelet, ou encore le très étonnant Fabrice Pataut dont les nouvelles de Jeudi parfait m’épatent par leur mélange de poésie et de génie inventif...
(Ce dimanche 20 mai)
LYNCHAGE. - La polémique lancée par une chronique de Fernand Melgar, dans les colonnes de 24Heures, à propos des dealers de rue à Lausanne, a enflammé les réseaux sociaux avant de provoquer diverses réactions, dont le renforcement subit de la présence policière dans le quartier du Maupas, divers débats médiatiques à la radio et à la télé et, surtout, une lettre ouverte collective signée par plus de 200 prétendus représentants du «milieu du cinéma», dont en effet quelques cinéastes de renom (tels Jean-Stéphane Bron, Lionel Baier et Germinal Roaux, notamment, qui m’ont bien déçu) se dressant contre la méthode de Melgar au nom de l’Éthique, au motif qu’il a publié sur Facebook des images de dealers immédiatement assimilés à des victimes, ce qui me semble le comble. J’y ai vu un véritable lynchage, me rappelant fort celui du festival de Locarno, il y a quelques années, quand le président du jury Paulo Branco avait taxé Melgar de «fasciste» au motif que son documentaire sur les vols spéciaux donnaient aussi la parole aux fonctionnaires de la police chargés d’encadrer les requérants d’asile déboutés au lieu de les dénoncer, et j’ai réagi sur mon blog et sur Facebook pour me voir aussitôt traité de «crétin réac» par cette vieille ganache de Francis Reusser, parangon du démagogue gauchiste qui félicite «les jeunes» de se faire ainsi délateurs.
Bref tout cela m’a paru à vomir et je me suis bien gardé de m’enferrer dans ce pseudo-débat de basse jactance…
AIMONS-NOUS… - Dans ma 71e année depuis minuit. La lecture, ce matin, des tankas de Takuboku, que j’ai découvert grâce à Roland Jaccard, me porte au développement bien tempéré d’un égotisme de protection immunitaire. Le titre du recueil est: L’Amour de moi, et c’est cela même que je me dis ce matin : aimons-nous mieux que ça ! (Ce jeudi 14 juin)
JULES RENARD. - «Aujourd’hui on ne sait plus parler, parce qu’on ne sait plus écouter. Rien ne sert de parler bien : il faut parler vite, afin d’arriver avant la réponse, on n’arrive jamais. On peut dire n’importe quoi n’importe comment : c’est toujours coupé. La conversation est un jeu de sécateur, où chacun taille la voix du voisin aussitôt qu’elle pousse». ( Journal, 29 janvier 1893.)
VAILLANTES ROTULES. - C’est aujourd’hui que nous fêtons les 70 ans de ma bonne amie, avec une trentaine de proches et autres amis. Grand ciel pur à la fenêtre. Je vais lui remettre La maison dans l’arbre, mon premier recueil de poèmes conçu et édité dans le plus grand secret, qui me semble un bel acte de reconnaissance à celle à qui je dois tant. Or nous continuons de tout partager et même à quatre genoux. De fait, nous allons – elle vient de l’apprendre - vers une double opération des siens (le 3 juillet prochain, et il y en aura pour un mois) et les miens ne sont pas en reste, mais quel beau quatuor tout de même…
(Ce 22 juin)
REVERDY : « La poésie n’est pas dans l’émotion qui nous étreint dans quelque circonstance donnée – car elle n’est pas une passion. Elle est même le contraire d’une passion. Elle est un acte. Elle n’est pas subie, elle est agie. Elle peut être dans l’expression particulière suscitée par une passion, une fois fixée dans l’œuvre qu’on appelle un poème et seulement dans l’émotion que cette œuvre pourra, à son tour, provoquer. En dehors de l’œuvre poétique accomplie, il n’y a nulle part de poésie. Elle est un fait nouveau, certainement relié aux circonstances qui peuvent émouvoir le poète dans la nature, mais ce n’est que formé par les moyens dont dispose le poète que ce fait, chargé de poésie, viendra prendre la place qui lui revient dans la réalité. Ce n’est pas l’art que la nature imite, c’est la poésie, parce que la poésie nous a appris à y voir ce qu’elle y a mis ». (En vrac)
POESIE «POÉTIQUE». - La poésie qui se veut poétique est à mes yeux la négation de la poésie, laquelle ne veut rien par définition si ce n’est apparaître par surprise. La poésie poétique pose, et la plupart de celles et ceux qui se disent ou se veulent poètes posent. À vrai dire les pires poseurs, parmi les gens de lettres, qui la plupart posent, sont les poètes et plus gravement souvent : les poétesses.
Poètes et poétesses se tiennent cependant les coudes et se déclarent volontiers frères et sœurs, comme les membres d’une secte, se flattant les uns les autres et parfois se rejetant comme les membres de sectes concurrentes ou adverses, se jugeant et parfois s’anathématisant comme ce fut la pratique des églises rivales ou comme cela se voit encore dans les congrégations cultuelles ou culturelles de toute sorte, jusqu’aux grouillements tribaux des sectateurs de poésie pseudo-poétique des réseaux sociaux, etc.