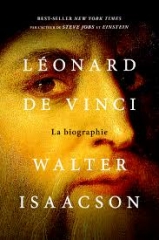C'est avec une profonde tristesse que nous venons d'apprendre le décès, à Vienne de notre amie Gemma Salem, soeur de feu Gérard et de Gilbert, et mère de Richard et Karim Dubugnon.
Avec Gemma Salem disparaît une auteure très remarquable, qui était entrée en littérature en 1982 avec un portrait romanesque mémorable de Mikhaïl Boulgakov, son premier amour littéraire avant sa rencontre de Thomas Bernhard auquel elle consacra plusieurs ouvrages de premier ordre et à qui elle rendait un nouvel hommage dans son dernier livre paru à la fin de l'an dernier, intitulé Où sont ceux que ton coeur aime et publié dans la collection La rencontre des éditions Arléa...

Un amour de Boulgakov
Au début des années 80, Gemma Salem publiait son premier roman, auquel je consacrai ce papier, paru dans le journal Libération le 22 avril 1982.
L’histoire du Roman de Monsieur Boulgakov est celle d’une passion « incendiaire ». Une jeune comédienne aux origines panachées d’Orient pimenté et de Suisse confite, installée dans le Midi et languissant un peu d’accéder à la gloire tous azimuts, tombe soudain sur le specimen masculin de ses rêves : un écrivain russe très grand en centimètres autant qu’en format littéraire, mais rayé du nombre des vivants dans le crépuscule sanglant des années 30. Rencontre donc de type occulte…
La comédienne s’appelle Gemma Salem. L’auteur est Mikhaïl Afanassiévitch Boulgakov, auteur du Maître et Marguerite, des Oeufs fatidiques, du Roman théâtral et de Cœur de chien.
Or le coup de foudre de Gemma Salem est tel que, non contente de dévorer tous les écrits traduits de Boulgakov en quelques mois, elle en a investi et réfracté l’univers à la façon de Diablerie - nouvelle du même Boulgakov -, poussant l’observation mimétique de la discordance entre réalité et discours jusqu’à l’absurde hallucinant.
À dire vrai, Le Roman de Monsieur Boulgakov ne nous intéresse pas tant par son approche, d’ailleurs très partielle, des positions éthiques ou esthétiques de l’écrivain, que par la recréation, vivante et truculente, d’un destin et de ses péripéties. Gemma Salem suggère des lieux et projette des espaces, fait parler des personnages de chair et fond tout cela dans le mouvement d’un temps fuyant, à la fois tangible et impalpable.
C’est ainsi que, dès les premières pages du roman, nous nous transportons, aux côtés du jeune Micha, alors toubib débutant, dans le Kiev de son enfance. Puis nous voilà, après un voyage congelant, dans le trou de province des Récits d’un jeune médecin, la première de ses œuvres, où Mikhaïl Boulgakov brassa maux et misères à pleines mains.
Et dès ce moment, aussi, se remarque l’habileté avec laquelle Gemma Salem tire parti d’éléments empruntés aux œuvres de l’écrivain, pour donner au roman son climat, ses couleurs et sa vraisemblance, et cela sans qu’on n’ait jamais l’impression de subir une compilation non plus qu’un relevé de filature.
Ensuite nous suivrons Boulgakov à travers les années, des lendemains de la Révolutuoin à la fin des années 30, au fil d’une production littéraire très étroitement surveillée dès ses débuts, à cause de sa liberté de ton et de sa propension satirique, complètement interdite de publication et de représentation au tournant de 1928 (quand bien même Staline avait vu et revu dix–sept fois la pièce intitulée Les Journées des Tourbine !) et que l’acharnement de sa dernière compagne – le très beau personnage de Lena – fera sortir des tiroirs d’infamie après la mort de l’écrivain.
De ce dernier, Le Roman de Monsieur Boulgakov nous donne une image attachante et nuancée. En évitant les pièges de l’idéalisation ou du sentimentalisme, si fréquents dans le genre, Gemma Salem a recomposé le portrait d’un Monsieur très porté sur la vie et les femmes, capable d’autant d’amitié chaleureuse que d’intransigeance têtue, qui tenait par-dessus tout à préserver ses œuvres de toute compromission.
En outre, l’intérêt du livre, autant qu’à la figure du grand écrivain, tient aussi aux scènes multiples visant à restituer l’ensemble d’une époque, avec sa kyrielle de personnages nimbés d’ombre ou de lumière : le maître du Kremlin grasseyant au téléphone, Constantin Stanislavski pontifiant et un peu cacochyme., qui tyrannise ses disciples du Théâtre d’Art, l’affreux journaliste flicard Orlinski commis à l’exécution systématique des œuvres de Boulgakov, ou Sergueï Ermolinski, l’ami des bons et des mauvais jours, et enfin la toute dévouée et tout aimante Lena, à laquelle Gemma Salem prête sa voix dans le monologue poignant du dernier chapitre, devant la dépouille mortelle de son génial compagnon.
Gemma Salem. Le Roman de Monsieur Boulgakov. Editions L’Âge d’homme, collection Contemporains, 1982.

La maison des vifs
D'une verve mordante sur fond de tendresse, le roman de Gemma Salem intitulé Bétulia confirmait les dons de la romancière en 1987. Ce que j'en écrivais dans Le Matin de Lausanne...
Si les verts paradis de l’enfance ont inspiré les écrivains jusqu’à satiété, il n’en va pas de même de l’adolescence, dont la tonalité souvent discordante est plus malaisée à rendre, aussi ingrate en somme que l’âge qu’elle désigne.
Tantôt poétisée, comme dans Le grand Meaulnes d’Alain-Fournier, et tantôt associée à une mythologie plus truculente, ainsi que s’y est employé Alexandre Vialatte dans Les fruits du Congo, l’adolescence est magnifiée dans les meilleures oeuvres qui en évoquent les brumes ou les frasques. Mais le portrait définitif de l’adolescent contemporain, qui en sait à la fois trop et trop peu, et dont les sentiments s exacerbent à proportion de son impatience idéaliste, reste encore à faire.
Du moins en trouve-ton déjà, ici et là, des esquisses appréciables, et celle que nous propose Gemma Salem dans son dernier roman nous paraît des plus attachantes, avec cela de notable qu’il s’agit d’abord d’un livre comique.
Le premier mérite de l’auteur est d’avoir évité tous les poncifs au goût du jour, nous surprenant à chaque page. Qu’il soit question, en l’occurrence, d’un garçon prénommé Léon, fils de parents désunis et que son père accueille en cette arche lausannoise qui donne son nom au titre du livre et où cohabite toute une smalah de plus ou moins marginaux, pouvait faire craindre le pire : les sanglots du caniche abandonné, sa prise de conscience politique au voisinage de tel chanteur boy-scout, ou le déploiement de ses fantasmes à l’approche de vraies dames en chair...
Or c’était compter sans la bonne nature de l’auteur, qu’on retrouve ici en veine et en verve, et qui parvient, à touches légères et mordantes à la fois,; à faire revivre une frise de personnages hauts en couleur dont les traits pittoresques s’intégrent, finalement, dans une vision singulièrement mélancolique.
Une ménagerie
Sur le moment, le défilé de Kuneba le chanteur révolté gui sent des pieds, de Tabernacle le pédé que tyrannise son julot criseux, de Cul et Chemise les sempiternels frères ennemis à la Laurel et Hardy, de la veuve Schütz appelant la police dès qu’un locataire se mouche trop bruyamment, de Clarisse l’intempestive et de ses deux petits lions, d’Arthur le fol ou de José le violoncelliste aux élégances discrètes, ne laisse de nous faire sourire sans discontinuer, et parfois éclater du rirele plus sonore.
Nous sommes, avec Léon le narrateur, comme en visite au jardin zoologique de la vie, loin des parents indifférents et des cafards du monde environnant qui ne s’affirment qu’en traquant le désordre et la moindre saleté.
A cet égard, l’on pourrait reprocher à Gemma Salem de caricaturer la mornitude helvétique à un point qui frise certain nouveau conformisme; mais l’effet comique est tel, dans sa foulée, que la réserve porte à faux.
Jardin secret
De la même façon, si l’auteur ne fait pas toujours dans la dentelle, stylistiquement parlant, le rythme et le tonusde sa phrase, et son sens de la construction romanesque et son art du dialogueparviennent à dissiper nos réticences.
Enfin, le sentiment qui se dégage du livre incline à la pacification, en dépit de ses pointes féroces. Sans rien d’amer ni d’insidieux, c’est un regard amical et un lieu préservé. Ce qu’il y a de beau à Bétulia, c’est que Léon y a découvert la vie en dépit de l’attitude lamentable de son père. Celui-ci, fuyant toute rencontre, n’en aura rien vu. Tandis que Léon, fuyant finalement le foyer pour jeunes inadaptés à quoi son paternel le destine, reviendra, plus tard, à son jardin secret…
Gemma Salem. Bétulia. Editions Flammarion, 1987.
À ces deux aperçus de l'oeuvre de Gemma Salem, riche de nombreux autres titres - romans et pièces de théâtre alternés - je me propose d'ajouter sous peu un développement plus conséquent, digne d'un écrivain de tempérament exceptionnel, dont le dernier livre, de tournure très personnelle, résonnait comme un poignant bilan existentiel.





 Quel rapport y a-t-il entre un certain Leonardo, bâtard notoire d’un notaire toscan au prénom de Piero et natif du bourg de Vinci, une paysanne de montagne râtelant le foin de son parchet sur les hauts du hameau valaisan de Pinsec, et le «mentaliste» californien Patrick Jane connu pour son sens de l’observation et sa mémoire exceptionnelle - quel rapport sinon la même touche d’humanité liant un génie « universel » et nos humbles et très diverses personnes plus ou moins talentueuses…
Quel rapport y a-t-il entre un certain Leonardo, bâtard notoire d’un notaire toscan au prénom de Piero et natif du bourg de Vinci, une paysanne de montagne râtelant le foin de son parchet sur les hauts du hameau valaisan de Pinsec, et le «mentaliste» californien Patrick Jane connu pour son sens de l’observation et sa mémoire exceptionnelle - quel rapport sinon la même touche d’humanité liant un génie « universel » et nos humbles et très diverses personnes plus ou moins talentueuses…