
(Dialogue schizo)
À propos de l'avant-dernier roman de Michel Houellebecq. Sur l’essai de Bernard Maris, Houellebecq économiste, et sur le premier tome du Journal intime de Philippe Muray, Ultima necat (1978-1985)
Moi l’autre : - Alors compère, on se la joue rebelle ?
Moi l’un : - Tu dis encore une obscénité du genre et je sors ma kalache. Non mais sans blague : tous indignés, tous CHARLIE, tous plus libres d’esprit et d’expression les uns que les autres, tous rebelles et pour faire bon poids : tous assumant leur différence consistant à être différents comme tous. Au secours Philippe Muray !
Moi l’autre : - Ce réac ? comme ILS disent.
Moi l’un : - Exactement, ce réac, vu qu’ILS ne l’ont pas lu, comme Houellebecq est un réac vu qu’il ne se positionne pas clairement par rapport à la droite. Mais baste avec cette phraséologie binaire genre BONUS et MALUS, comme l’avait excellemment gorillée ce réac ( ?) de Godard dans sa carte d’identité filmée.
Moi l’autre : - On reviendra sur Ultima necat, le journal intime de Muray entre 1978 (il a alors 33 ans) et 1985, mais parlons de Soumission. Finalement c’est quoi d’après toi ?
 Moi l’un : - C’est une variation de plus sur le thème du vieillissement, déjà présent dans La possibilité d’une île. Je crois qu’on se trompe en y voyant, comme Jacques Julliard, une charge « dévastatrice » contre l’intelligentsia « collabo », pas plus que ce n’est un roman islamophobe comme l’a prétendu un Edwy Plenel. En titre, L’Obs a balancé entre « génial » et« pervers », conformément à la même rhétorique binaire qui dédouane un peu tout le monde...
Moi l’un : - C’est une variation de plus sur le thème du vieillissement, déjà présent dans La possibilité d’une île. Je crois qu’on se trompe en y voyant, comme Jacques Julliard, une charge « dévastatrice » contre l’intelligentsia « collabo », pas plus que ce n’est un roman islamophobe comme l’a prétendu un Edwy Plenel. En titre, L’Obs a balancé entre « génial » et« pervers », conformément à la même rhétorique binaire qui dédouane un peu tout le monde...
Moi l’autre : - Il doit être forcément « génial » pour intéresser autant de médias responsables, mais quand même« pervers » pour s’intéresser à Huysmans et à Youporn en même temps
Moi l’un : - Mais c’est le protagoniste de Soumission qui surfe sur le site de cul et disserte sur Huysmans, et pas Houellebecq. Enfin on est censé faire la différence, quoique l’Houellebecq joue là-dessus à plaisir comme il joue au paumé dingo dans son film assez rigolo tiré de La Possibilité d’une île (que les critiques ont trouvé nul, ce qu’il est en effet et se veut tel comme les Deschiens se veulent nuls) ou dans ses numéros de duettistes avec BHL ou Jean-Louis Aubert…
Moi l’autre : - Son côté singe ?
Moi l’un : - Exactement : regarde-le chanter avec Jean-Louis Aubert sur Youtube :c’est un numéro de grimace simiesque irrésistible. Michel Houellebecq est le grimacier génial, nullement pervers, de la singerie mondialisée...
Moi l’autre : - Quant à dire que Soumission est génial…
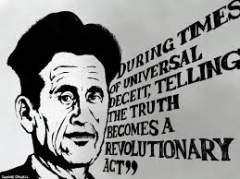 Moi l’un : - Il l’est pour qui le prend avec humour, même si ce n’est pas « évident ». Si tu le prends comme un roman « politique », tu te dis, en te rappelant Orwell ou Karel Capek, que c’est assez faiblard, à tout le moins ambigu. Mais là encore le vrai sujet est ailleurs : François se fait chier à l’université, n’a pas d’amis, pas de meuf durable non plus (je parle comme les jeunes lecteurs d’Houellebecq), ne s’intéresse quasiment plus à rien à part la petite secousse sexuelle ou le supplément d’âme gastro, et le Grand Remplacement de sa culture fatiguée par une autre qu’on lui impose ne lui fait pas trop problème quand on lui explique qu’avec l’islam il va avoir son petit harem et des fins de mois assurées. Il faut alors constater qu’en vieillissant Houellebecq a passé de Schopenhauer à un écrivain plus cool en la personne de Joris-Karl Huysmans le converti dont Léon Bloy fustigeait la religion de bric et de broc après lui avoir montré la porte étroite de la seule vraie foi…
Moi l’un : - Il l’est pour qui le prend avec humour, même si ce n’est pas « évident ». Si tu le prends comme un roman « politique », tu te dis, en te rappelant Orwell ou Karel Capek, que c’est assez faiblard, à tout le moins ambigu. Mais là encore le vrai sujet est ailleurs : François se fait chier à l’université, n’a pas d’amis, pas de meuf durable non plus (je parle comme les jeunes lecteurs d’Houellebecq), ne s’intéresse quasiment plus à rien à part la petite secousse sexuelle ou le supplément d’âme gastro, et le Grand Remplacement de sa culture fatiguée par une autre qu’on lui impose ne lui fait pas trop problème quand on lui explique qu’avec l’islam il va avoir son petit harem et des fins de mois assurées. Il faut alors constater qu’en vieillissant Houellebecq a passé de Schopenhauer à un écrivain plus cool en la personne de Joris-Karl Huysmans le converti dont Léon Bloy fustigeait la religion de bric et de broc après lui avoir montré la porte étroite de la seule vraie foi…
Moi l’autre : - C’est vrai qu’on ne croit pas plus à la « conversion » de François à l’islam que Bloy ne croyait à celle d’Huysmans au catholicisme. Mais Bloy était un foldingue, non ? Un véritable pur allumé, dont Philippe Muray parle d’ailleurs à propos d’Ernest Hello, sur la fin du monde. Ces deux-là étaient de vrais mystique timbrés…
Moi l’un : - Je vois que tu lis par-dessus mon épaule. Mais c’est vrai qu’on sent moins le « professeur de désespoir », comme disait Nancy Huston, chez l’auteur de La carte et le territoire et de Soumission, qu’à l’époque des Particules. Tu auras noté au passage que le protagoniste François apprécie particulièrement la « générosité » de Huysmans et son goût pour les maîtres flamands.
Moi l’autre : - Donc tu verrais plutôt Houellebecq-François « âme sensible » que réac.
Moi l’un : - Je le vois essentiellement écrivain, et comme le dit Sollers au début de Littérature et politique, un écrivain peut parler de politique comme personne sans avoir de comptes à prendre à qui que ce soit. Notre ami JLK souscrirait d’ailleurs…
Moi l’autre : - « Encore votre Sollers ! » vont s’exclamer certaines dames sur Facebook…
Moi l’un : - Transmets-leur mes cordialités et voici la citation : « En réalité c’est toute la bibliothèque qui trouve son plein emploi pour comprendre et juger l’actualité. La politique fait semblant de maîtriser un monde qui lui échappe, elle va toujours dans le même sens (gauche effondrée, droite en miettes), alors que la littérature, elle, est sans arrêt partout et nulle part. La politique ne lit rien, la littérature est une frénésie de lecture. Il était fatal que le pays qui a été le plus« littéraire » du monde souffre particulièrement de la mondialisation ».
Moi l’autre : - Oui, c’est intéressant…
Moi l’un : - Donc je continue : « Du coup, la politique moralisante s’insinue partout et juge la littérature, alors que, sans efforts, c’est à la littérature de juger la politique. Ouvrez un livre digne de ce nom : la vraie morale est là, avec l’acide ou l’ironie qui conviennent à chaque situation. Sin intervention est un acte d’interruption, d’éveil, et, malgré le tragique, une anticipation d’identité heureuse. La politique favorise beaucoup l’identité malheureuse, c’est-à-dire le contraire de la liberté et de la singularité poétique ».
Moi l’autre : - Tu me rappelles les coordonnées du livre afin que je puisse le conseiller à ma coiffeuse camerounaise lettrée ?
Moi l’un : - Flammarion 2014, 806 pages, 25euros. Une vraie mine d’observations et de réactions sur l’époque. Je m’attendais à du réchauffé complaisant, et c’est du vif et du pénétrant !
 Moi l’autre : - Quant à feu Bernard Maris, il aura décrypté un Houellebecq économiste. Et là aussi la lecture décape…
Moi l’autre : - Quant à feu Bernard Maris, il aura décrypté un Houellebecq économiste. Et là aussi la lecture décape…
Moi l’un : - J’en suis resté baba vu qu’on m’a expliqué clairement ce que j’avais effectivement observé, mais plus confusément. L’oncle Bernard de Charlie-Hebdo a lu tout Houellebecq après avoir découvert La carte et le territoire, donc en 2010 seulement, mais sa lecture me fait penser à celle des essayistes ou des écrivains anglo-saxons à la Orwell, une fois encore, ou à la Martin Amis, Hanif Kureishi ou V.S. Naipaul, ou encore à la Lucien Goldmann, le critique marxiste, ou à la Simenon. J’entends par là qu’il aborde les thèmes de Houellebecq en économiste dissident, aussi critique par rapport à la « secte » des théoriciens de l’économie que lucide dans son approche des personnages du romancier et de leurs jeux de rôles du point de vue social ou économique, sans oublier les dimensions fondamentales de l'affect personnel, du sexe et de l'angoisse.
Moi l’autre : - Le fait est que Bernard Maris prend très, très au sérieux le travail de Houellebecq, même qu’il en fait le « plus grand écrivain français vivant »…
Moi l’un : - Alors là ça se discute, paix à l’âme de l’oncle Bernard, mais disons qu’Houellebecq est, dans sa catégorie d’une espèce d’hyperréalisme social sur fond de psychose d’époque, le plus révélateur des médiums littéraires, avec un art mimétique qui lui permet de rendre à merveille la langue de coton de l’idéologie consumériste dominante.
 Moi l’autre : - Et Philippe Muray, que dit-il de Michel Houellebecq dans son journal ?
Moi l’autre : - Et Philippe Muray, que dit-il de Michel Houellebecq dans son journal ?
Moi l’un : - Pas un mot évidemment, vu que la publication d’Extension du domaine de la lutte ne date que de 1994…En revanche,l’on y trouve une sorte de chronique de ses relations avec Philippe Sollers, à l’époque de Tel Quel, qui se compliquent et se dégradent à proportion d’une rivalité toujours problématique sur un territoire exigu…
Moi l’autre : - Tu auras relevé les pages magnifiques qu’il consacre à René Girard…
Moi l’un : - Et ce n’est qu’un début. Ce qu’on voit surtout, c’est sa difficulté à écrire un roman et sa rage de voir son travail personnel si mal reconnu. Mais le meilleur Muray n’est pas encore là, qui comptera beaucoup dans la cristallisation des romans de Houellebecq.
Moi l’autre : - Qui lui a rendu hommage maintes fois. Et pas qu’un peu. Ce qui leur à valu d’être classés ensemble « nouveaux réactionnaire » par Daniel Lindenberg…
Moi l’un : - Les accusations en l’air passent, et les écrits restent. Le sous-titre de l’essai de Lindenberg était Le rappel à l’ordre. On a vu en l’occurrence qui était le chien de garde de l’idéologiquement correct
Moi l’autre : - Un « rebelle » contre les « réacs » qui faisait très « mutin de Panurge », comme l’aurait dit Philippe Muray.
Moi l’un : - Qui a aussi parlé des « matons de Panurge »…


 Moi l’un : - C’est une variation de plus sur le thème du vieillissement, déjà présent dans La possibilité d’une île. Je crois qu’on se trompe en y voyant, comme Jacques Julliard, une charge « dévastatrice » contre l’intelligentsia « collabo », pas plus que ce n’est un roman islamophobe comme l’a prétendu un Edwy Plenel. En titre, L’Obs a balancé entre « génial » et« pervers », conformément à la même rhétorique binaire qui dédouane un peu tout le monde...
Moi l’un : - C’est une variation de plus sur le thème du vieillissement, déjà présent dans La possibilité d’une île. Je crois qu’on se trompe en y voyant, comme Jacques Julliard, une charge « dévastatrice » contre l’intelligentsia « collabo », pas plus que ce n’est un roman islamophobe comme l’a prétendu un Edwy Plenel. En titre, L’Obs a balancé entre « génial » et« pervers », conformément à la même rhétorique binaire qui dédouane un peu tout le monde... 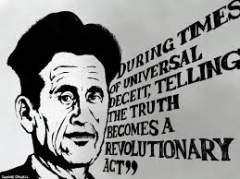 Moi l’un : - Il l’est pour qui le prend avec humour, même si ce n’est pas « évident ». Si tu le prends comme un roman « politique », tu te dis, en te rappelant Orwell ou Karel Capek, que c’est assez faiblard, à tout le moins ambigu. Mais là encore le vrai sujet est ailleurs : François se fait chier à l’université, n’a pas d’amis, pas de meuf durable non plus (je parle comme les jeunes lecteurs d’Houellebecq), ne s’intéresse quasiment plus à rien à part la petite secousse sexuelle ou le supplément d’âme gastro, et le Grand Remplacement de sa culture fatiguée par une autre qu’on lui impose ne lui fait pas trop problème quand on lui explique qu’avec l’islam il va avoir son petit harem et des fins de mois assurées. Il faut alors constater qu’en vieillissant Houellebecq a passé de Schopenhauer à un écrivain plus cool en la personne de Joris-Karl Huysmans le converti dont Léon Bloy fustigeait la religion de bric et de broc après lui avoir montré la porte étroite de la seule vraie foi…
Moi l’un : - Il l’est pour qui le prend avec humour, même si ce n’est pas « évident ». Si tu le prends comme un roman « politique », tu te dis, en te rappelant Orwell ou Karel Capek, que c’est assez faiblard, à tout le moins ambigu. Mais là encore le vrai sujet est ailleurs : François se fait chier à l’université, n’a pas d’amis, pas de meuf durable non plus (je parle comme les jeunes lecteurs d’Houellebecq), ne s’intéresse quasiment plus à rien à part la petite secousse sexuelle ou le supplément d’âme gastro, et le Grand Remplacement de sa culture fatiguée par une autre qu’on lui impose ne lui fait pas trop problème quand on lui explique qu’avec l’islam il va avoir son petit harem et des fins de mois assurées. Il faut alors constater qu’en vieillissant Houellebecq a passé de Schopenhauer à un écrivain plus cool en la personne de Joris-Karl Huysmans le converti dont Léon Bloy fustigeait la religion de bric et de broc après lui avoir montré la porte étroite de la seule vraie foi…  Moi l’autre : - Quant à feu Bernard Maris, il aura décrypté un Houellebecq économiste. Et là aussi la lecture décape…
Moi l’autre : - Quant à feu Bernard Maris, il aura décrypté un Houellebecq économiste. Et là aussi la lecture décape… Moi l’autre : - Et Philippe Muray, que dit-il de Michel Houellebecq dans son journal ?
Moi l’autre : - Et Philippe Muray, que dit-il de Michel Houellebecq dans son journal ?